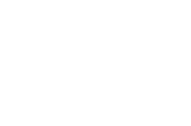La conscience
Introduction
La conscience, faculté propre à l’homme, a essentiellement deux fonctions:
- l’une orientée vers le passé: donner à celui qui a commis une faute le sentiment de sa culpabilité;
- l’autre orientée vers le futur: évaluer au point de vue moral (c.-à-d. au niveau du bien et du mal) une action que l’on envisage.
Notre conscience, lorsqu’elle nous reprend pour une faute commise, doit nous conduire à confesser notre manquement à Dieu et à ceux que nous avons offensés. Et quant aux actions qui sont devant nous, notre conscience, éclairée par la parole de Dieu, doit nous aider à «peser le chemin de nos pieds», selon l’expression de Proverbes 4: 26.
L’expérience courante montre que la conscience peut être très diversement formée ou déformée, sensible ou endurcie. On peut l’écouter et tenir compte de ses avertissements, ou la faire taire et lui faire violence. «Les hommes faits», au sens spirituel de l’expression, «ont les sens exercés à discerner le bien et le mal» (Hébreux 5: 14). Ce qui les a développés, c’est «la nourriture solide» de la parole de Dieu, et «le fait de l’habitude», c’est-à-dire l’exercice régulier.
Les Ecritures placent abondamment devant nous la conscience et son activité, la façon dont Dieu l’éveille et l’exerce, et la manière dont l’homme l’écoute ou la fait taire. De nombreux passages nous en parlent sans utiliser le mot «conscience» lui-même. Dans l’Ancien Testament, ce mot ne figure qu’une fois 1. Et dans le Nouveau, le mot «conscience» est utilisé presque exclusivement par l’apôtre Paul, bien que la notion de conscience apparaisse souvent 2.
Pour le chrétien, un bon état de la conscience est à la base d’une marche à la gloire de Dieu. La conscience est une faculté qui doit être éduquée, cultivée, exercée. Un peu paradoxalement, c’est une voix qui doit être écoutée, mais à laquelle il ne faut pas faire trop confiance; nous reviendrons là-dessus. La conscience doit être maintenue pure, et si nous avons manqué, ne tardons pas à confesser nos fautes pour qu’elle soit rétablie dans son bon état. Vivre avec une mauvaise conscience, ou avec une conscience que l’on fait taire, conduit inévitablement au désastre.
Dans les lignes qui suivent, nous considérerons d’abord de quelle façon l’être humain a acquis une conscience, puis quelques exemples de l’Ancien Testament où on la voit en activité. Nous nous arrêterons ensuite sur l’immense changement que l’oeuvre de Christ a introduit, en purifiant la conscience du croyant. Ceci nous amènera à considérer les nombreux enseignements du Nouveau Testament concernant le maintien d’une bonne conscience, et la manière dont nous avons à tenir compte d’elle, de la nôtre et de celle de nos frères.
La connaissance du bien et du mal
La conscience a été acquise par nos premiers parents, dans le jardin d’Eden, par le péché (Genèse 3). Au milieu du jardin se trouvait l’arbre de la connaissance du bien et du mal, dont Dieu avait interdit de manger le fruit. Ayant transgressé le commandement divin, Adam et Eve ont éprouvé la honte de leur nudité (symbole de leur état de péché), se sont fait des ceintures de feuilles de figuier et se sont cachés de devant Dieu.
Le serpent leur avait dit: «Vos yeux seront ouverts, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal» (verset 5). Et il en a été ainsi. Dieu lui-même le confirme: «Voici, l’homme est devenu comme l’un de nous, pour connaître le bien et le mal» (verset 22). Le serpent avait fait miroiter cette acquisition comme une chose désirable dont Dieu voulait priver sa créature. Quelle tromperie ! L’homme étant devenu pécheur, cette connaissance est en lui comme une voix accusatrice, source de profond malaise devant Dieu. Il réalise que le mal est en lui, et que le bien lui échappe. Dieu a la connaissance du bien et du mal en étant lui-même entièrement caractérisé par le bien. L’homme a la connaissance du bien et du mal, dans une mesure tout au moins, alors que le mal fait partie de sa nature.
La situation d’Adam et Eve se cachant de devant le regard de Dieu est l’image de la situation de tout homme, tant qu’il est dans son état naturel. Aussi longtemps qu’il n’a pas passé par la nouvelle naissance, ou qu’il n’a pas une connaissance claire du salut en Jésus Christ, la conscience de ses péchés lui donne un malaise devant Dieu.
Quelques exemples du travail de la conscience, dans l’Ancien Testament
Jacob
En Genèse 28, alors qu’il s’enfuit de devant son frère Esaü, Jacob fait une halte à Béthel. Dieu se révèle à lui dans un songe avec une grande bonté et lui fait des promesses magnifiques. Mais Jacob n’est pas en état de jouir de ces communications. Il a peur, et dit: «Que ce lieu-ci est terrible ! Ce n’est autre chose que la maison de Dieu» (verset 17). Quand l’homme pécheur se trouve dans la présence de Dieu, sa conscience ne peut que lui donner un sentiment de malaise et de peur. C’est ce qu’on voit aussi dans le cas d’Adam, d’Esaïe ou de Pierre.
Les frères de Joseph
Ces hommes avaient sans doute des consciences bien endurcies, lorsqu’ils ont vendu leur jeune frère comme esclave, et qu’ils ont trompé leur père en lui faisant croire qu’une mauvaise bête l’avait dévoré (Genèse 37). Bien des années plus tard, ils se considèrent encore comme «d’honnêtes gens», du moins ils n’ont pas honte de s’exprimer ainsi devant l’homme qui gouverne l’Egypte (42: 11). Mais lorsque la main de Dieu s’appesantit sur eux, leur conscience s’éveille. «Et ils se dirent l’un à l’autre: Certainement nous sommes coupables à l’égard de notre frère; car nous avons vu la détresse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l’avons pas écouté; c’est pourquoi cette détresse est venue sur nous» (42: 21). Et un peu plus tard, lorsque leur détresse est à son comble, ils disent: «Comment nous justifierons-nous ? Dieu a trouvé l’iniquité de tes serviteurs» (44: 16).
Ce récit nous montre comment Dieu nous discipline afin d’éveiller notre conscience et de nous amener à lui confesser nos fautes, même si elles sont lointaines et oubliées. Qu’il nous accorde de ne pas faire taire notre conscience, lorsqu’elle nous parle ! Si nous le faisons, nous nous exposons à une discipline qui peut être très douloureuse. Mais, si même elle doit s’abattre sur nous, elle est le témoignage de l’amour de notre Père qui travaille en vue de nous ramener.
Quatre lépreux
La ville de Samarie, assiégée par les Syriens, souffrait d’une terrible famine. Quatre lépreux étaient assis à sa porte, attendant la mort (2 Rois 7). La pensée leur étant venue, de Dieu, sans nul doute, de se rendre dans le camp des ennemis, ils trouvent celui-ci désert, les tentes remplies de nourriture, de vêtements et de biens. Ils se mettent à manger, à piller et à cacher le butin. Mais voici que la voix de leur conscience se fait entendre: «Nous ne faisons pas bien. Ce jour est un jour de bonnes nouvelles, et nous nous taisons. Si nous attendons jusqu’à la lumière du matin, l’iniquité nous trouvera» (verset 9). Leur conscience les amène à réaliser leur responsabilité devant Dieu et le jugement auquel ils s’exposent. Heureusement, ils écoutent cette voix intérieure, pour leur bien et celui de tout le peuple.
Esaïe
Dans une vision glorieuse, le jeune prophète voit l’Eternel assis sur un trône haut et élevé, entouré des séraphins qui proclament sa sainteté. Réalisant son propre état de pécheur, il s’écrie: «Malheur à moi ! car je suis perdu; car moi, je suis un homme aux lèvres impures, car mes yeux ont vu le roi, l’Eternel des armées» (Esaïe 6: 5). Ici ce n’est pas une faute particulière qui charge la conscience, c’est l’état de péché de l’homme qui est mis en lumière par le déploiement de la gloire de Dieu.
Le résidu juif des derniers jours
Par l’épreuve intense qu’il devra traverser, ce résidu sera amené à reconnaître et à confesser la culpabilité du peuple juif dans le rejet de son Messie. «Ils regarderont vers moi, celui qu’ils auront percé, et ils se lamenteront sur lui, comme on se lamente sur un fils unique» (Zacharie 12: 10). C’est un exemple de conscience collective.
L’exemple particulier de David
Un des traits distinctifs de ce bien-aimé de Dieu, c’est une conscience délicate. Dans le contexte général de l’Ancien Testament, où il y a des guerres à livrer parce que le peuple terrestre de Dieu doit conquérir ou conserver l’héritage que l’Eternel lui a donné, la douceur et la délicatesse de conscience de David brillent de façon frappante.
Mentionnons d’abord l’épisode rapporté en 1 Samuel 24, lorsque Saül entre dans la caverne où David et ses hommes se sont cachés, et s’y endort. Ses amis lui affirment que c’est là l’occasion que l’Eternel lui offre de se débarrasser de son persécuteur. David coupe le pan de la robe de Saül, mais sans lui faire aucun mal. Puis, nous est-il dit, «le coeur de David le reprit de ce qu’il avait coupé le pan de la robe de Saül» (verset 6) et il empêche ses hommes de tuer le roi. Ce morceau d’étoffe lui permettra ensuite de prouver à Saül qu’il ne cherche pas à lui faire du mal, mais il ne nous est pas dit quelle était l’intention de David au moment où il l’a coupé. Quoi qu’il en soit, ce geste qui pourrait nous paraître anodin amène sa conscience à lui faire un reproche. Et David écoute la voix de sa conscience.
On voit une disposition de coeur analogue lorsque, dans la même période de sa vie, il parle légèrement et exprime le souhait de boire de l’eau du puits de Bethléhem (2 Samuel 23: 13-17). Il y avait alors un poste des Philistins à cet endroit, et aller y chercher de l’eau était très dangereux. Trois amis de David bravent le danger par amour et par dévouement pour leur chef, et lui rapportent de l’eau. Mais la conscience de David le reprend. Il voit cette eau comme le sang des hommes qui sont allés la chercher au péril de leur vie. Il ne veut pas la boire, mais en fait une libation à l’Eternel.
Dans la vie de David, il y a sans doute des périodes où il semble ne plus guère écouter sa conscience. On pense en particulier à son séjour chez Akish (1 Samuel 27-30) et aux mois qui ont suivi son grave péché avec Bath-Shéba (2 Samuel 11; 12). Dans le premier de ces cas, il a fallu la sévère discipline de Dieu pour le ramener, et dans le second, le reproche du prophète Nathan. David a été amené à s’humilier de ses fautes, et sa relation avec Dieu a été restaurée. Le sentiment profond de ses fautes, en ce qui concerne la seconde circonstance, nous est décrit dans le psaume 51, en termes très remarquables.
Dans le psaume 32, où David décrit le bonheur de celui dont les péchés sont pardonnés (versets 1 et 2), nous trouvons l’évocation de l’état qu’il a connu alors qu’il faisait taire la voix de sa conscience et se refusait à confesser ses fautes: «Quand je me suis tu, mes os ont dépéri, quand je rugissais tout le jour» (verset 3). Mais finalement, n’en pouvant plus, il a dit: «Je confesserai mes transgressions à l’Eternel». Et il peut ajouter: «Et toi, tu as pardonné l’iniquité de mon péché» (verset 5).
A suivre
1 Il apparaît en 1 Rois 2: 44, dans l’expression «avoir conscience de». Dans ce verset, la conscience elle-même est désignée par le mot «coeur», de même que dans plusieurs autres passages, par exemple: 1 Samuel 24: 6; 2 Samuel 24: 10.
2 Pierre utilise le mot trois fois dans sa première épître (2: 19; 3: 16, 21).