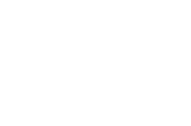Deux maisons (Matthieu 26: 1-30)
Le Seigneur Jésus a achevé ses discours. Il a placé devant ses disciples le chemin de souffrance du résidu, le service des chrétiens, la mise à l'épreuve des nations dans les derniers jours, et le jugement qu'il exécutera, en justice, quand il viendra dans sa gloire (Matthieu 24 et 25).
Il leur annonce maintenant que la Pâque est proche, et que lui-même va être livré pour être crucifié. Il a devant lui, non plus le jugement qu'il exercera (25: 31-46), mais le jugement terrible qu'il portera à cause du péché. Il passe de la vision de sa gloire à celle de son chemin d'humiliation et de souffrance. La paix de son cœur manifeste sa grandeur et sa perfection morale.
Bientôt l'homme va montrer toute sa haine contre le Seigneur. Des iniques jugeront, condamneront, crucifieront le Christ, le Fils de Dieu. Puis, lorsque l'homme livré à Satan sera allé au terme de ce qu'il peut faire, Dieu interviendra lui-même, d'abord dans les heures de l'expiation, les heures de ténèbres, dont l'homme ne peut être témoin, puis dans la résurrection de Jésus — la victoire sur la mort et sur toute la puissance du monde.
Mais avant ces heures, avant le combat de Gethsémané, où le Seigneur se trouvera seul avec son Père, dans une communion insondable, il va pouvoir, dans deux maisons, goûter quelques rafraîchissements — quelques instants de communion, malgré tout ce qui l'entoure.
La maison de Béthanie
Une maison à Béthanie et un palais à Jérusalem
A Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple s'assemblent dans le palais du souverain sacrificateur, et tiennent conseil ensemble pour se saisir de Jésus et le faire mourir (versets 3, 4).
Le palais du souverain sacrificateur était, au yeux des hommes, un lieu de richesse et de pouvoir. Ces richesses avaient pu être acquises par des moyens scandaleux, par du trafic dans le temple (21: 13); le pouvoir pouvait être associé au mensonge et au compromis avec les Romains (cf. Jean 11: 48); pourtant l'homme était toujours fasciné par ces richesses et ce pouvoir. Il les recherche encore, quoiqu'il prétende haïr la malhonnêteté et le mensonge.
Mais le Roi n'avait aucune place dans ce palais. Celui qui unira dans sa personne les gloires de roi et de sacrificateur, qui sera un jour «sacrificateur sur son trône» (Zacharie 6: 13), est rejeté par les conducteurs de son peuple.
A Béthanie par contre, le Seigneur est reçu dans la maison de Simon. Celui qui habitait cette maison était connu comme «le lépreux». Peut-être le Seigneur l'avait-il guéri; et cette appellation lui était restée. Il avait porté, sans pouvoir les dissimuler, les marques de sa maladie. La lèpre est l'image du péché. Le Seigneur, qui n'a pas de place dans les palais du monde, se trouve là, ami des publicains et des pécheurs. Un homme qui ne pouvait pas cacher sa misère, son péché, l'avait reçu. Et, précisément parce qu'il était venu pour sauver et pour guérir, Jésus avait une place dans cette maison.
C'est là qu'une femme le trouve — Marie, que Jean nomme dans son évangile (12: 3). Elle répand sur sa tête un parfum de grand prix, comme il était à table. Elle avait sans doute pensé depuis longtemps à cet acte; elle l'avait préparé; elle avait acquis ce parfum. Quel contraste entre ce qui avait occupé son cœur et les pensées meurtrières des principaux sacrificateurs! Elle offre au Seigneur le parfum — l'hommage que les sacrificateurs lui refusaient. Elle reconnaît le Roi que les chefs du peuple rejetaient. La Pâque qui approchait était le moment de l'accomplissement des conseils de Dieu. Pour les hommes réunis chez Caïphe, cette fête paraissait être un obstacle à la réalisation de leurs plans de haine (verset 5). Mais pour Marie, c'était l'occasion unique d'honorer son Seigneur.
Marie avait été enseignée
Qui avait enseigné Marie? — Le Seigneur lui-même, par ses paroles. Et l'amour qu'elle avait pour lui la conduisait. Les disciples aussi aimaient le Seigneur, et pourtant ils n'avaient pas compris l'importance du moment, la crise qui approchait. Ils l'avaient entendu leur parler de sa mort, de ses souffrances, de sa résurrection. Mais jusqu'à ce moment, ses paroles n'avaient pas encore formé leurs pensées et dirigé leurs affections. Ils n'avaient pas été rendus intelligents par les paroles du Seigneur, ni par ses miracles (cf. Luc 24, 25; Marc 8: 21). Marie, elle, l'avait écouté, et ses paroles étaient restées gravées dans son cœur. Elle s'en était nourrie lorsqu'elle avait été assise à ses pieds, elle en avait éprouvé la puissance lors de la résurrection de son frère. Son amour était ainsi formé et rendu intelligent par les paroles de Jésus qu'elle avait entendues et gardées.
Les disciples avaient été à Jérusalem avec le Seigneur; ils avaient pu constater cette opposition incessante des Juifs contre lui, ces tentatives répétées de le prendre en défaut; ils avaient pu entendre ce qu'il avait annoncé concernant le sort de Jérusalem. Pourtant, leurs pensées restaient attachées au temple, à ses belles et grandes pierres (cf. Marc 13: 1); ils continuaient de penser que le Seigneur allait bientôt établir son royaume et se préoccupaient de la place qu'ils y auraient.
Marie avait vu que le Seigneur ne pouvait plus passer la nuit à Jérusalem, qu'il revenait à Béthanie ou restait en dehors de la ville (Matthieu 21: 17; Luc 21: 37). Elle avait discerné que Jérusalem le rejetait, puisqu'il n'y avait plus aucun repos possible pour lui dans cette ville. Elle réalisait sans doute que ce rejet allait trouver sa pleine manifestation et réalisait que c'était le moment pour elle d'honorer le Seigneur.
Où chercherons-nous le Seigneur, et où apprendrons-nous à connaître ses pensées? Ne le cherchons pas dans ce qui a de l'apparence aux yeux de l'homme et du monde. Ni le palais du souverain sacrificateur — où le pouvoir humain rejette Christ — ni le temple magnifique, ne sont des lieux pour le trouver et apprendre de lui. C'est à Béthanie qu'on le trouve, là où il peut reposer son cœur. C'est dans la maison de Simon, où aucun autre privilège que sa grâce ne peut être invoqué, où aucune autre puissance que celle de sa grâce ne peut être connue. Chercherions-nous parmi le monde et sa religion celui qui en est rejeté?
L'appréciation des hommes, l'appréciation du Seigneur
Les disciples ne comprennent pas l'acte de Marie. Il était déjà arrivé plus d'une fois qu'elle ne soit pas comprise. Lorsqu'elle était assise aux pieds de Jésus pour l'écouter parler, Marthe, distraite par beaucoup de service, ne comprenait pas. Lorsqu'elle s'en allait à Jésus, après la mort de Lazare, ceux qui étaient présents pensaient qu'elle allait au sépulcre — or elle n'allait pas vers le lieu de la mort, mais vers le Prince de la vie. Maintenant, les disciples la blâment. Une foi simple et intelligente, attachée au Seigneur, est souvent mal comprise.
Ici c'est un homme méchant, Judas, qui entraîne des croyants attachés au Seigneur à contester l'acte de Marie, invoquant ce qui paraissait un bon motif — le bien des pauvres. Ils en viennent, sans réaliser la portée de ce qu'ils disent, à estimer que l'hommage rendu au Seigneur est «une perte».
Le Seigneur répond aux disciples de façon à sonder leurs cœurs. «Vous avez les pauvres toujours avec vous» — et, est-il ajouté en Marc, «quand vous voudrez, vous pourrez leur faire du bien» (14: 7). Avaient-ils vraiment pensé à ces pauvres qui étaient toujours avec eux? Voulaient-ils eux-mêmes leur faire du bien?
Leurs critiques montrent que non seulement ils ne comprennent pas l'acte de Marie, mais qu'ils ne discernent pas la gloire du Seigneur. Il avait lui-même nourri les pauvres, plusieurs fois, en associant les disciples à ce service malgré leur incompréhension. N'avaient-ils pas vu cette compassion qui le portait vers les misérables? Toutes les richesses divines n'étaient-elles pas en sa main pour prendre soin des affligés? La pensée que les pauvres puissent être lésés par le dévouement de Marie au Seigneur, par l'hommage qu'elle lui rendait, témoignait de leur méconnaissance du Seigneur.
Mais Jésus donne à l'acte de Marie sa pleine valeur. Cette femme n'avait probablement pas saisi toute la portée de ce qu'elle faisait, même si elle avait discerné le moment d'apporter au Seigneur ce qu'elle avait préparé pour lui. Elle avait senti que la constante opposition de l'homme, l'impossibilité pour le Seigneur de rester à Jérusalem, rendaient de plus en plus proche le moment où il allait quitter cette scène. Bientôt il ne serait plus dans ce monde qui n'avait rien pour lui que de la haine. Le Seigneur l'exprime clairement: ce n'est pas seulement sa mort qu'il évoque, mais particulièrement sa sépulture. C'est le moment où il va être caché aux regards du monde. Désormais, le monde ne le verra plus, jusqu'à son retour en gloire et en puissance. Les siens ne l'auront plus avec eux sur la terre. Il va devenir, pour eux, pour nous, un objet de foi. Il est celui que, bien que nous ne l'ayons pas vu, nous aimons (1 Pierre 1: 8). Il est celui que nous verrons bientôt comme il est, mais qui nous est maintenant caché (1 Jean 3: 2). Le témoignage du Seigneur (Jean 14) et de ses apôtres nous enseigne clairement cela; Marie l'avait compris, et le Seigneur donne toute sa vraie portée à son acte. Bientôt, il sera caché à ce monde, et ne sera connu que par la foi.
Cela nous permet de comprendre que le Seigneur lie l'évangile à l'acte de Marie. Auparavant, il avait parlé de l'évangile du royaume. Maintenant, l'évangile prend un caractère nouveau, lié à sa mort, à son ensevelissement même (cf. 1 Corinthiens 15: 3, 4). «Cet évangile» est celui qui nous attache à Christ rejeté du monde, à Christ mort sur la croix, à Christ exalté et digne de tout amour, mais objet de notre foi, connu par sa parole et par sa puissance. Cet évangile sera «prêché dans le monde entier». Quelle perspective le Seigneur ouvre devant les disciples! Ils croyaient penser aux pauvres, et le Seigneur parle des richesses
108
de la grâce qui va être présentée au monde entier. Le lien qu'il établit ici entre l'adoration qui lui revient et le ministère de l'évangile est pour nous profondément instructif.
La maison choisie par le Seigneur
La maison qu'il a choisie
Après la maison de Simon, nous trouvons ce que nous pourrions appeler la maison du Seigneur, celle où il va manger la Pâque avec ses disciples. Béthanie, c'est la maison où Marie exprime, face à la haine du monde et à l'incompréhension des disciples, l'amour d'un cœur qui s'attache à celui qui va laisser sa vie pour ses amis. La maison du Seigneur, c'est celle où il réunit les siens pour qu'ils soient avec lui. Là, il leur rappelle son amour qui l'a conduit au don de lui-même, à la mort, à cette mort qui est leur délivrance.
C'est lui qui choisit le lieu, qui les réunit à table avec lui, qui leur donne le mémorial de sa mort et l'espérance du royaume.
Le Seigneur agit avec une parfaite autorité, et il dispose les cœurs pour qu'ils reconnaissent cette autorité. Les disciples l'interrogent: «Où veux-tu que nous te préparions ce qu'il faut pour manger la Pâque?» Ils ont le désir de préparer les choses pour lui, et ils réalisent que c'est lui qui connaît le lieu approprié. Jésus n'avait pas de place à Jérusalem; où trouver un lieu pour faire la Pâque? Si nous désirons honorer le Seigneur, nous ne nous laisserons pas guider par notre propre appréciation de ce qui est bon. Si nous avons à cœur d'être avec lui, nous ne pourrons trouver par nous-mêmes, dans le monde qui l'a rejeté, le lieu qui convient. Il faut que lui nous enseigne à cet égard.
Mais il y a, dans cette ville même, quelqu'un dont le cœur est disposé à se soumettre à sa parole. Les mots: «Le maître dit: Je ferai la Pâque chez toi avec mes disciples» lui suffisent. Un homme, dans Jérusalem, avait été préparé pour laisser sa maison au Seigneur, pour reconnaître ses droits sur elle. Cette maison, Jésus l'appelle, dans l'évangile de Marc, «mon logis» (14: 14). Réalisons-nous ces droits du Seigneur? Les disciples font «comme Jésus leur avait ordonné». La valeur de ce moment si précieux pour le cœur du Seigneur — celui où nous nous souvenons ensemble de lui — ne peut être réalisé que par des cœurs entièrement soumis à son autorité. Le lieu, la préparation, tout doit être selon sa parole, et traduire la reconnaissance entière, sans raisonnement, de son autorité.
Le Seigneur se met à table avec ses disciples. Il prend la place du Maître. Mais il leur donne une place avec lui, pour jouir de ce moment de communion.
Une parole pour sonder le cœur des disciples
Toutefois, pendant qu'ils mangent, dans la paix avec lui, il doit leur parler d'une manière qui les attriste profondément. Sans aucun doute, la tristesse du Seigneur lui-même était infiniment plus profonde que celle des disciples, mais il devait les sonder. La communion dans laquelle il veut nous avoir avec lui ne peut être réalisée en mettant de côté la vérité, la vérité dans l'homme intérieur. Jésus leur annonce que l'un d'entre eux le livrera. L'état de leur cœur est manifesté d'abord par leur tristesse. Ensuite, par le fait qu'aucun d'eux ne proteste, mais qu'ils l'interrogent: «Seigneur, est-ce moi?» Comment prendre conscience de ce que nous sommes, sinon en reconnaissant l'autorité de sa parole et en réalisant qu'elle s'adresse directement à nous? C'est vers lui qu'ils se tournent, et cette confiance est précieuse pour le Seigneur.
Ainsi il sonde la conscience des siens, les amène à ressentir leur faiblesse — ils seraient au fond d'eux-mêmes capables de le livrer. Evidemment aucun croyant, aucun de ceux qui ont la vie divine, ne sera un Judas. La grâce le gardera. La défiance d'eux-mêmes que montrent ici les disciples les conduit à exprimer, sans qu'ils en mesurent peut-être la portée, leur entière dépendance du Seigneur et leur confiance en lui. Les récits de Luc et de Jean mettent en avant leurs interrogations, telles qu'ils se les adressent les uns aux autres (Luc 22: 23; Jean 13: 22). Ici et dans Marc, la question est remise au Seigneur.
Judas, après que le Seigneur a évoqué le jugement vers lequel le traître s'en allait, demande aussi: «Est-ce moi, rabbi?» Et Jésus lui dit: «Tu l'as dit». Judas reconnaît extérieurement l'enseignement du Seigneur; mais il ne le connaît pas pour lui-même comme son Seigneur. Il n'a pas de lien vital avec Jésus.
Le souper avec les siens
D'après ce que nous lisons dans l'Évangile selon Jean, il semble bien que Judas soit sorti tout de suite après ces paroles du Seigneur: «Ayant donc reçu le morceau, il sortit aussitôt; or il était nuit» (13: 30).
Dans ce moment de communion, Jésus institue la cène, le mémorial. Il prend à nouveau la place du Maître, mais maintenant, il la prend pour bénir. Il donne aux disciples le pain, la coupe, et il chante une hymne avec eux.
Ici encore, c'est lui qui fait tout. Les disciples reçoivent de lui le pain, la coupe, avec simplicité. Dans le récit que nous donne l'Esprit Saint par Luc, nous remarquons combien se manifeste, dans cette circonstance, la faiblesse des disciples: il s'élève entre eux une contestation, ils sont préoccupés de leur place, de leur importance; Pierre exprime ensuite sa confiance en lui-même, sans écouter les avertissements du Seigneur. Dans le récit de Matthieu, ces circonstances sont relatées après que le Seigneur est sorti avec les siens; elles ne viennent pas troubler ce moment de communion. C'est pourquoi ce passage se termine par la mention de l'hymne que le Seigneur a chanté avec les siens, avant de quitter la maison. Luc ne peut en parler, après le récit des événements qu'il lie au souper. Cela est profondément instructif. Comment pourrions-nous nous associer à cet hymne qui s'élève vers le Père, si nos cœurs sont remplis de nous-mêmes ou insoumis?
Que nos cœurs soient réveillés pour avoir le discernement et la profondeur d'affection qui conduisaient Marie à honorer le Seigneur en lui apportant, sans regarder à qui que ce soit d'autre, le parfum de son adoration! Et que les moments où Jésus lui-même, ayant conduit toutes choses, chante la louange au milieu des siens réunis au lieu qu'il a choisi, aient toujours plus de prix pour nous!