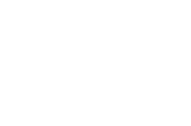Seconde épître aux Corinthiens (suite)
Chapitre 10
Les quatre derniers chapitres de l'épître traitent principalement de sujets de caractère plus personnel, concernant les relations entre Paul et les Corinthiens. Qu'il s'étende aussi longuement sur de tels sujets pourrait paraître surprenant. Paul lui-même parle de cela comme étant une «folie» de sa part (11: 1). Néanmoins ce qu'il écrit là est inspiré aussi bien que le reste de l'épître, et tout aussi profitable pour nous. Ces chapitres contiennent beaucoup de choses qui sont d'une grande importance pour tous les croyants, et dans tous les temps. C'est un gain immense pour nous qu'elles soient présentées non d'un point de vue théorique, mais comme un sujet concret et pratique, à propos des relations entre Paul et quelques-uns de ses frères dans la foi.
Durant l'absence de l'apôtre, les Corinthiens avaient été influencés, et hélas ! égarés, par d'autres ouvriers qui les avaient visités. Quelques-uns de ceux-ci peuvent avoir été de vrais croyants mal instruits, de tendance judaïsante; mais d'autres n'étaient que des «ouvriers trompeurs» (11: 13), de vrais agents de Satan. Quoi qu'il en soit, ils avaient travaillé à discréditer Paul, portant contre lui toutes sortes d'accusations et d'insinuations. Ils disaient, par exemple, que s'il était capable d'écrire des lettres « graves et fortes », en revanche, lorsqu'il était présent en personne, il était faible et insignifiant, et son discours méprisable. Ils déduisaient de cela qu'il ne possédait aucune autorité particulière, et que ses instructions pouvaient être mises de côté. C'est cette insinuation-là que Paul a en vue au début du chapitre 10, et à laquelle il répond.
Il accepte le reproche, avec la plus grande objectivité : oui, il est « chétif » quant à l'apparence extérieure. A le voir, il n'y avait rien en lui de particulièrement distingué ; depuis sa conversion, il avait le nom de « Paul », ce qui signifie « Petit ». Maintenant qu'il était loin d'eux, il usait de hardiesse envers eux. Cependant il avait l'intention de les visiter prochainement ; et il les supplie de se comporter de telle manière qu'il n'ait pas besoin d'exercer envers eux une discipline énergique et hardie qui pourrait être à leur déconvenue. Et il leur adresse cette supplication « par la douceur et la débonnaireté du Christ » — un levier à la fois délicat et puissant.
La douceur et la débonnaireté ne sont ni la faiblesse ni cette souplesse versatile qui se laisse tourner dans toutes les directions. Ces vertus font contraste avec l'autoritarisme et la dureté. Le Seigneur Jésus a dit: «Je suis débonnaire et humble de cœur» (Matthieu 11: 29). La douceur et la bienveillance devraient marquer tout à la fois notre caractère et notre comportement. La douceur et la débonnaireté suprêmes ont été réalisées en Christ, et pourtant personne n'était plus hardi que lui quand il s'agissait d'affirmer ce qui est juste ou de s'opposer au mal. Dans une grande mesure, l'apôtre suivait les traces de Jésus ; c'est pourquoi on pouvait voir en lui la hardiesse aussi bien que la douceur et la débonnaireté.
Fidèle à ce caractère, l'apôtre supplie les Corinthiens, au lieu de leur donner des commandements péremptoires. Cependant il y avait parmi eux des hommes qui pensaient qu'il marchait selon la chair. Cela le conduit à nous donner l'enseignement important qui suit, quant au caractère de sa marche et de son combat. Le verset 3 est particulièrement instructif en ce qu'il place ensemble devant nous les deux sens du mot « chair ». Nous marchons dans la chair, c'est-à-dire dans les corps de chair venant d'Adam. Mais nous ne combattons pas selon la chair, c'est-à-dire selon la nature adamique qui est liée à nos corps.
En parlant ainsi, Paul pensait bien sûr à lui-même et à ses collaborateurs. Simultanément, il exprimait ce qui devrait normalement être vrai de tout croyant. Qu'en est-il de nous ? Reconnaissons-nous le vrai caractère de la chair — c'est-à-dire de notre nature adamique — et traitons-nous celle-ci comme une chose condamnée ? Ce qui est normal pour un chrétien, c'est qu'il marche selon l'Esprit (Romains 8: 4). Cela n'est pas exprimé ici, mais sous-entendu.
Cependant, ce qui est en vue ici, ce n'est pas précisément notre marche ; c'est notre guerre. Le croyant est-il donc appelé à la guerre ? Oui, et à une guerre énergique. Mais ses armes, comme sa guerre elle-même, ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles.
Chaque serviteur de Christ est engagé dans le combat. Tout travail évangélique a ce caractère, parce que l'évangile est prêché dans le but d'abattre l'orgueil de l'homme et d'amener celui-ci aux pieds de Christ. Tout l'enseignement donné dans l'assemblée doit mettre à néant les pensées purement humaines. Or, les enseignements erronés ayant envahi la profession chrétienne, il doit nécessairement y avoir une lutte pour la foi, une lutte qui porte le caractère d'un combat. Mais tout combat nous met à l'épreuve, car nous nous laissons facilement aller à utiliser des armes purement naturelles et charnelles. Le politicien expérimenté qui veut amener les gens à sa cause ne manque pas d'armes dans son arsenal: l'argumentation, l'ironie, l'exagération manifeste, etc. Seulement, il n'est en lutte qu'avec d'autres êtres humains, sur un pied d'égalité.
Mais notre guerre est entièrement différente. Nous avons des « forteresses » à détruire. Qui possède ces forteresses ? Le grand adversaire lui-même. C'est lui qui se tient retranché dans des cœurs humains, et qui les amène à être pleins de « raisonnements », à s'élever avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et à être caractérisés par la propre volonté. Toutes ces pensées qui s'élèvent doivent être abaissées et amenées captives à Christ, de sorte que la propre volonté soit remplacée par l'obéissance à Christ. Y a-t-il des armes suffisamment puissantes pour produire un tel résultat ?
Les armes simplement humaines sont parfaitement vaines. Les armes charnelles ne peuvent pas davantage vaincre la chair, que Satan chasser Satan. Les armes spirituelles seules peuvent remporter la victoire. Et pour être efficaces, il faut qu'elles soient utilisées d'une manière qui soit selon Dieu.
Quelles sont les armes spirituelles qui sont à notre disposition ? Dans ce passage, l'apôtre ne s'arrête pas pour le spécifier, bien que les versets qui suivent semblent indiquer qu'il pensait spécialement à l'autorité qu'il possédait comme apôtre pour exercer la discipline — autorité qui lui était propre. Il y a cependant des armes spirituelles que tous peuvent utiliser, par exemple celles qui sont mentionnées par les apôtres à Jérusalem quand ils disent : « Et, pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole » (Actes des Apôtres 6: 4). Chaque croyant peut prier, et chaque croyant peut, d'une manière ou d'une autre, proclamer la Parole.
Les apôtres reconnaissaient l'immense valeur de chacune de ces deux armes, et refusaient de permettre à quoi que ce soit — même à une chose bonne en elle-même — de les distraire de leur utilisation. Maintes fois, les serviteurs de Dieu se sont trouvés en face de quelque forteresse humaine d'orgueil et d'incrédulité, comme Israël devant Jéricho. Et pourtant, lorsque celle-ci a été encerclée par les prières de la foi, le moment est venu où la parole de Dieu a pu résonner comme une trompette : les murailles de l'incrédulité ont alors croulé, et la forteresse a été détruite. Le Seigneur lui-même a indiqué une autre arme spirituelle lorsqu'il a parlé d'une espèce de démons qui ne peuvent être chassés que par la prière et par le jeûne. Le jeûne est une arme qui n'est que très peu utilisée aujourd'hui.
Dieu veuille que nous soyons tous attentifs à ces choses ! Dans la prédication de l'évangile, par exemple, sommes-nous conscients que l'œuvre implique des conflits de cet ordre ? Si nous l'étions vraiment, nous serions zélés, à la réunion de prière, pour intercéder en faveur de ceux qui prêchent — pour autant que nous ayons la gloire de Dieu à cœur et qu'il y ait en nous l'amour pour les âmes qui périssent. L'apôtre fait une application très directe de ces principes aux Corinthiens. La discipline qu'il avait l'autorité d'exercer était une arme spirituelle, comme nous l'avons déjà dit, et il se pouvait qu'ils en éprouvent peu après le tranchant. Si la puissance de Dieu est là pour la destruction des forteresses de l'incrédulité (verset 4), la même puissance peut opérer le jugement des chrétiens charnels et désobéissants (verset 8). Mais l'usage normal et naturel de cette puissance est l'édification des saints.
L'apôtre possédait une autorité que le Seigneur lui avait donnée, et une puissance correspondant à cette autorité. Les Corinthiens, n'étant pas très spirituels, avaient tendance à s'occuper beaucoup de l'apparence extérieure (cf. verset 1). Paul pouvait leur paraître sans attrait aucun, mais qu'ils veuillent bien se souvenir qu'il était « à Christ » (verset 7), et cela au moins tout autant que ceux qui étaient ses opposants et ses détracteurs ! Et il possédait une autorité qu'eux n'avaient pas. Qu'ils sachent aussi que lorsqu'il serait présent au milieu d'eux, ils le trouveraient être exactement tel que le révélaient ses lettres — qu'ils disaient « graves et fortes ». Nous avons ici une indication, insérée incidemment, de l'effet que ses écrits inspirés avaient sur les gens de son époque. Ils étaient la parole de Dieu, et ils s'imposaient eux-mêmes comme étant tels dans les cœurs de ceux qui avaient quelque sensibilité spirituelle. C'est ce qu'ils font aussi aujourd'hui. Nous les reconnaissons comme étant beaucoup trop grands et puissants pour n'être qu'une simple parole d'homme.
En parlant de son autorité, Paul était bien loin de se livrer à une espèce de compétition avec ceux qui s'opposaient à lui. Ils étaient soucieux de se recommander eux-mêmes, et de s'affirmer auprès des Corinthiens. Ainsi un esprit de compétition se développait parmi eux, et ils se mettaient à «se mesurer eux-mêmes par eux-mêmes » et à «se comparer eux-mêmes à eux-mêmes » — ce qui était une façon de faire vraiment inintelligente. En faisant ainsi ils ne s'élevaient pas plus haut qu'eux-mêmes. Il n'y avait que le « moi » qui comptait. Un homme peut se distinguer par telle caractéristique, et un autre homme par telle autre. Mais en se comparant les uns aux autres, ils ne s'élevaient jamais jusqu'à Dieu et à la mesure que lui a fixée.
Au verset 13, Paul continue à utiliser le mot « mesure », mais dans un sens un peu différent, en le liant au mot « règle », qui apparaît encore dans les versets 15 et 16. On pourrait penser qu'il fait allusion à l'œuvre de Dieu en création, comme elle est décrite en Job. Là, Dieu lui-même demande, en parlant de la terre : « Qui lui a établi sa mesure, — si tu le sais ? Ou qui a étendu le cordeau sur elle ?» (38: 5). Notre Dieu opère avec mesure et avec ordre, que ce soit dans la création ou dans l'administration qui se lie à sa grâce. Or Dieu avait réparti les choses et fixé une règle relativement au service apostolique de Paul.
Par d'autres passages nous apprenons quelle était la mesure et la règle du service de Paul. Il pouvait dire : « J'ai été établi prédicateur et apôtre… docteur des nations dans la foi et dans la vérité » (1 Timothée 2: 7). Le champ de travail qui lui était assigné était extrêmement étendu. Tout le monde des Gentils se trouvait à l'intérieur de ce qui constituait sa mesure. Il ne s'était certes pas étendu au-delà de sa mesure en venant jusqu'aux Corinthiens. Sa mesure allait bien jusqu'à eux. Ils étaient sans conteste inclus dans le domaine de sa mission apostolique. De fait, le zèle évangélique de Paul voyait, au-delà de Corinthe, des régions plus éloignées dans lesquelles il se sentait pressé d'aller prêcher la bonne nouvelle. Dans l'épître aux Romains, il rapporte qu'il a « pleinement annoncé l'évangile du Christ » « depuis Jérusalem, et tout alentour, jusqu'en Illyrie » — c'est-à-dire la région que nous connaissons sous le nom d'Albanie, sur les rives de l'Adriatique (15: 19). Et finalement il est allé jusqu'à Rome. Le vrai évangéliste porte toujours son regard sur « les lieux qui sont au-delà ».
Ne manquons pas de remarquer la petite clause du verset 15 : « votre foi s'accroissant ». Il y avait un lien entre l'accroissement de la foi des Corinthiens et l'élargissement du service de Paul, en tout cas en ce qui concerne l'étendue géographique. Aussi longtemps que leur foi serait faible, tout leur état spirituel serait faible, et cela aurait des conséquences sur les activités et sur le service de Paul. Mais s'il les voyait forts dans la foi, il serait plus libre d'aller de chez eux jusque dans des régions plus éloignées. Voilà comment l'état spirituel des croyants affecte l'activité des serviteurs de Dieu. Nous sommes membres les uns des autres ; et un apôtre même ne peut être insensible à l'état des autres. Cela est entièrement vrai pour nous aujourd'hui, bien sûr. Que Dieu nous aide à rechercher consciencieusement en sa présence si notre état contribue à élargir ou à restreindre le champ de travail de ses serviteurs. C'est nécessairement l'un ou l'autre.
Plusieurs des remarques que l'apôtre fait dans ces versets ont pour but de montrer que les hommes qui s'opposaient à lui, et cherchaient à détourner de lui les Corinthiens, travaillaient d'une manière très différente. Ils se glorifiaient de choses qui étaient au-delà de leur mesure. Ils n'avaient pas reçu leur mission du Seigneur ressuscité, comme Paul l'avait reçue. Ils ne cherchaient pas à étendre leur activité à des régions plus éloignées, et n'étaient pas prêts à souffrir les privations et les persécutions qu'impliquaient un tel travail. Ils se glorifiaient « dans les travaux d'autrui », s'ingérant dans son travail (verset 15). Comme le dit le verset 16, ils se glorifiaient « dans la règle d'autrui, des choses déjà toutes préparées ».
Mais l'apôtre ne se glorifiait ni dans l'homme, ni même dans l'œuvre. Comme dans la première épître, il déclare ici : « Que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur !» ( verset 17; cf. 1 Corinthiens 1: 31). Si c'est le Seigneur qui donne la mesure et la règle, tout va bien. Si c'est lui qui fait prospérer l'œuvre de sorte que des hommes sont amenés à la foi en Christ, et qu'en temps utile leur foi augmente, c'est très bien. Mais même lorsqu'il en est ainsi, il ne faut se glorifier que dans le Seigneur, dont nous sommes les serviteurs.
D'un autre côté, la recommandation qui vient du Seigneur est la seule qui ait quelque valeur. Les hommes peuvent se mettre en avant et se glorifier eux-mêmes, comme le faisaient les opposants de Paul, mais tout cela n'a aucune valeur. Il est très naturel pour les hommes de recevoir «de la gloire l'un de l'autre» et de ne pas rechercher «la gloire qui vient de Dieu seul» (cf. Jean 5: 44), mais cela conduit à la ruine. Avoir l'approbation du Seigneur lors du grand jour du tribunal de Christ, c'est cela qui compte. Que nos vies montrent que nos yeux sont fixés sur ce jour-là !