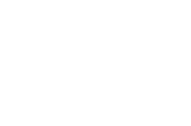L'autorité
Nous désirons simplement considérer quelques passages du Nouveau Testament qui nous parlent de l'autorité et, plus particulièrement, de la manière de l'exercer. Ils sont groupés ici selon le plan suivant:
- l'autorité de Christ,
- l'autorité des apôtres,
- l'autorité dans la société humaine,
- l'autorité parmi les croyants.
L'autorité de Christ
La vie du Seigneur Jésus sur la terre a fait briller, dans une harmonie parfaite, aussi bien la gloire divine qui est la sienne que l'humilité qui convenait à l'humanité qu'il avait prise. Tantôt, il manifeste la puissance de Dieu qui commande aux vents et à la mer, qui connaît les pensées des hommes avant qu'elles s'expriment, qui délivre ceux qui souffrent et qui ressuscite les morts, tantôt, comme homme, il éprouve la fatigue, la faim, la souffrance.
Le plus souvent, dans son humilité, Jésus ne revendique aucun des droits divins qui lui appartiennent. Lorsque sa parole est reçue, c'est une grande joie pour son cœur; et lorsqu'on ne veut pas de lui, il s'en va plus loin. Son humilité et sa douceur, toutefois, ne le conduisent jamais à affaiblir la parole de Dieu qu'il proclame. Le Père lui a commandé ce qu'il devait dire et comment il avait à parler (cf. Jean 12: 49) et il ne fait rien pour éviter l'hostilité que déclencheront ses paroles. C'est pourquoi sa manière d'enseigner, qui fait contraste avec celle des docteurs d'Israël, étonne les foules: «il les enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes» (Matthieu 7: 29). N'est-il pas en cela un exemple pour tous ceux qui enseignent la Parole? Ceux qui «exposent justement la parole de la vérité», pleinement convaincus de ce qu'ils ont reçu par la parole de Dieu, qu'ils l'enseignent avec assurance et hardiesse, avec l'humilité de celui qui se tient devant Dieu!
Dans la manifestation de sa puissance divine, «il commande avec autorité, même aux esprits immondes, et ils lui obéissent» (Marc 1: 27). Son autorité s'exerce dans la guérison des maladies, dans sa suprématie sur les éléments de la nature. Elle s'exerce aussi vis-à-vis de ceux qui l'ont reçu, et qui lui obéissent; mais vis-à-vis de ceux qui s'opposent à lui et le rejettent, il ne revendique rien. «Si mon royaume était de ce monde, dit-il à Pilate, mes serviteurs auraient combattu… mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici» (Jean 18: 36).
Cependant, «Dieu a fait et Seigneur et Christ» ce Jésus qui a été crucifié (Actes des Apôtres 2: 36). Le jour viendra où tous ses droits seront reconnus — ses droits divins auxquels s'ajoutent ses droits de Fils de l'homme. Quand tous ceux qui auront exercé le pouvoir sur la terre auront consommé leur faillite, on verra, selon la prophétie de Daniel, le «fils d'homme» s'avancer jusqu'à l'Ancien des jours, et recevoir «la domination, et l'honneur, et la royauté» (7: 13, 14). «Le Père… a donné tout le jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père» (Jean 5: 22, 23). «Il lui a donné autorité de juger aussi, parce qu'il est Fils de l'homme» (verset 27). Aujourd'hui, Christ est encore rejeté et méconnu de ce monde, et les siens, dans la mesure où ils sont fidèles, partagent son rejet.
Cependant, la foi le voit «couronné de gloire et d'honneur» (Hébreux 2: 8, 9), assis à la droite de Dieu tandis qu'il attend de prendre en main la domination effective de toutes choses. Cette autorité sans conteste, il l'exercera durant le Millénium. Les apôtres y auront une part, «assis sur des trônes, jugeant les douze tribus d'Israël» (Luc 22: 30). Il en sera de même de l'esclave auquel le Maître dira: «Parce que tu as été fidèle en ce qui est très peu de choses, aie autorité sur dix villes» (Luc 19: 17). L'association avec Christ dans son règne concerne aussi l'Église, puisque le Seigneur promet au vainqueur à Laodicée: «je lui donnerai autorité sur les nations» (Apocalypse 2: 26).
Avant de quitter ses disciples, le Seigneur Jésus leur dit: «Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, et faites disciples toutes les nations» (Matthieu 18: 19). L'autorité effective du Seigneur est reconnue dès aujourd'hui par tous les vrais disciples du royaume. Il est le Maître qui les envoie où il trouve bon, et qui leur donne les tâches qu'il veut.
Et c'est aussi en vertu de cette autorité suprême qu'il donne aux siens la vie éternelle. Dans sa prière de Jean 17, le Seigneur dit à son Père: «Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, comme tu lui as donné autorité sur toute chair, afin que, quant à tout ce que tu lui as donné, il leur donne la vie éternelle» (Jean 17: 1, 2).
L'autorité des apôtres
Le Seigneur Jésus avait choisi douze disciples, «pour être avec lui, pour les envoyer prêcher, et pour avoir autorité de guérir les maladies et de chasser les démons» (Marc 3: 14, 15; cf. Luc 9: 1). Plus tard, il en avait envoyé soixante-dix, avec une mission semblable. L'ayant accomplie, ils sont revenus vers lui avec joie en disant: «Seigneur, les démons mêmes nous sont assujettis en ton nom» (Luc 10: 17).
Après l'élévation de Jésus dans le ciel et la descente du Saint Esprit sur la terre, dans ces temps du début de l'Église caractérisés par un grand déploiement de puissance, nous voyons les apôtres exercer l'autorité de la part du Christ glorifié. Ils agissent «au nom de Jésus» (Actes des Apôtres 3: 6; 16: 18).
Dans ses épîtres, Paul parle à plus d'une reprise de l'autorité apostolique qui lui a été confiée. Il la mentionne en particulier lorsqu'il s'adresse aux Corinthiens. Parmi ceux-ci, il y avait des hommes qui s'opposaient à cette autorité, ou qui la contestaient. Pour le bien de ceux qui étaient en danger d'être séduits par ce mouvement d'opposition, l'apôtre est contraint de la rappeler. Mais, point important à souligner, il le fait avec beaucoup de retenue, et comme avec regret. A deux reprises, dans des termes très semblables, il parle de «l'autorité» que le Seigneur lui a «donnée pour l'édification et non pas pour la destruction» (2 Corinthiens 10: 8; 13: 10). Dans la première épître, il avait évoqué la possibilité d'agir avec sévérité «au nom de notre Seigneur Jésus Christ», mais désirait ardemment ne pas y être contraint (5: 4).
L'apôtre n'usera de son autorité qu'en dernier ressort. Il s'emploiera à convaincre, à sensibiliser les cœurs et les consciences, de façon que les croyants fassent d'eux-mêmes et de bon cœur ce qui est juste et bon. C'est ainsi qu'il dit à Philémon: «Ayant une grande liberté en Christ de te commander ce qui convient, à cause de l'amour, je te prie plutôt…» (Philémon 8).
On retrouve des traces de cette autorité apostolique dans le ministère de Timothée et de Tite, qui avaient reçu un mandat particulier de la part de l'apôtre Paul. Timothée devait «ordonner» diverses choses (1 Timothée 1: 3; 4: 11; 5: 7; 6: 16). Et l'apôtre dit à Tite: «Annonce ces choses, exhorte et reprends, avec toute autorité de commander» (Tite 2: 15). Il est à peine besoin de dire qu'il n'y a aujourd'hui ni apôtre, ni délégué d'un apôtre, pour exercer une autorité de ce genre.
L'autorité dans la société humaine
Dans le cadre de la cellule familiale, Dieu a confié une autorité au mari relativement à sa femme, et aux parents relativement à leurs enfants. L'apôtre Paul mentionne explicitement «l'autorité à laquelle la femme est soumise» et défend à la femme «d'user d'autorité sur l'homme» (1 Corinthiens 11: 10; 1 Timothée 2: 12). L'exercice de cette autorité, pour le mari, nécessite un soin et des égards très particuliers, qui se résument par le mot «amour» (Éphésiens 5: 25; Colossiens 3: 19; 1 Pierre 3: 7). De même, l'autorité parentale doit être attentive aux besoins et aux sentiments des enfants, «afin qu'ils ne soient pas découragés» (Colossiens 3: 21).
On peut attendre d'un père chrétien qu'il «conduise bien sa propre maison, tenant ses enfants soumis en toute gravité» (1 Timothée 3: 4). Mais on chercherait vainement dans les Écritures une indication semblable concernant la relation conjugale. Si la femme doit être soumise à son mari, il n'est pas dit que le mari doit tenir sa femme dans la soumission. La façon dont le mari exerce son autorité dans son foyer peut s'inspirer de la manière douce et spirituelle dont l'apôtre Paul exerçait la sienne dans l'Église.
La parole de Dieu ne prescrit rien sur les structures sociales. Elle constate comme un état de fait l'existence des «maîtres» et des «esclaves» — comme il y a aujourd'hui des patrons et des employés — et elle indique à chacun comment il peut être fidèle à Dieu dans le cadre de la structure existante (cf. Éphésiens 6: 5-9; Colossiens 3: 22-25; 4: 1).
Elle constate aussi qu'il y a des «autorités» qui gouvernent les nations et nous enjoint d'être soumis à ceux qui sont au-dessus de nous (Romains 13: 1; 1 Pierre 2: 13). Nous avons même à considérer ces autorités comme «ordonnées de Dieu», «envoyées de sa part», sans nous poser de question sur la légitimité de leur pouvoir. Le magistrat est «serviteur de Dieu pour ton bien» (Romains 13: 4). Que ceux qui sont au pouvoir s'y soient installés par l'ambition, la violence, la tromperie, ou qu'ils y aient été placés autrement, cela n'a guère d'importance pour le chrétien. Il sait que ce monde est gouverné par Satan, que l'injustice y règne, et qu'elle y régnera jusqu'au jour où Christ y exécutera le terrible jugement déjà décrété sur lui.
En observant ce qui se passe dans le monde, nous comprenons facilement qu'un gouvernement, même s'il est mauvais, vaut mieux que l'absence de gouvernement. Le Seigneur dit: «Les rois des nations les dominent, et ceux qui exercent l'autorité sur elles sont appelés bienfaiteurs» (Luc 22: 25). Combien de chrétiens souffrent aujourd'hui dans des pays où il y a l'anarchie, et où la violence de l'homme peut se donner libre cours sans être réprimée! C'est pourquoi nous sommes exhortés à prier «pour les rois et pour tous ceux qui sont haut placés, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté» (1 Timothée 2: 2).
Dans les sphères d'activité de ce monde, par exemple dans les entreprises industrielles et commerciales, nous sommes également habitués aux structures hiérarchiques, et constatons leur utilité et même leur nécessité. Mais en est-il de même dans le peuple de Dieu?
Dans ce monde, le fait de détenir le pouvoir ou une autorité peut résulter de bien des facteurs, souvent difficiles à démêler. Mais selon ce que la parole de Dieu nous en découvre, il y a deux éléments à souligner:
- la part de l'homme (soit au niveau de ses capacités, soit au niveau de son ambition) et
- la part de Dieu (qui est au-dessus de tout, et conduit tout pour l'accomplissement de ses desseins1).
1 Parmi les très nombreux exemples que l'Écriture nous donne, mentionnons:
• l'autorité confiée à Joseph par Potiphar (Genèse 39: 2-4), puis par le chef de la prison (39: 22, 23) et finalement par le Pharaon;
• la place de chef donnée à Jéroboam par Salomon (1 Rois 11: 28), puis la révolte qui le met au pouvoir (1 Rois 12);
• l'usurpation du pouvoir par Absalom (2 Samuel 15) ou par Adonija (1 Rois 1: 5);
• l'onction de Jéhu et sa prise du pouvoir (2 Rois 9);
• l'onction de Hazaël et l'assassinat du roi de Syrie (2 Rois 8: 7-15);
• la domination universelle de Nebucadnetsar (Daniel 2: 37, 38; Habakuk 1: 5-17).
La manière dont ces différents éléments s'interpénètrent nous échappe entièrement. D'ailleurs, nous n'avons pas besoin d'en faire l'analyse. Notre affaire, c'est de voir la main de Dieu en toute chose et de lui faire confiance. D'autre part, si Dieu a jugé bon de mettre à nu devant nous les ressorts de l'âme humaine tels qu'ils sont en activité dans le monde où nous vivons, c'est pour que nous soyons en garde contre les mêmes tendances, prêtes à germer dans nos propres cœurs.
L'autorité parmi les croyants
De façon générale, le désir de dominer est profondément enraciné dans l'homme naturel, de façon peut-être plus marquée chez certains caractères que chez d'autres. Il se manifeste sous des formes très variées. Il est très proche du désir d'être grand, ou le plus grand, ou d'être le premier. Quelques circonstances rapportées par les Évangiles vont retenir maintenant notre attention.
Une première circonstance — A la suite de la scène de la transfiguration, dans laquelle le Seigneur a fait entrevoir à trois disciples privilégiés quelques rayons de sa gloire à venir, Jésus parle aux siens des souffrances et de la mort qui vont bientôt être sa part. Mais ces révélations-là sont au-delà de ce qu'ils peuvent comprendre. Ils ont réellement cru que Jésus est le Christ, le Messie promis, mais la pensée de son rejet, de sa mort et de sa résurrection demeure au-delà de leur compréhension. Pourquoi? — parce qu'ils sont préoccupés de la question de savoir «lequel d'entre eux serait le plus grand», et qu'ils en ont même débattu entre eux (Matthieu 18: 1; Marc 9: 34; Luc 9: 46). Sans leur faire le reproche qu'ils auraient mérité, le Seigneur les enseigne patiemment en plaçant un petit enfant sous leurs yeux. En vérité, les normes de la grandeur sont bien différentes selon les appréciations de Dieu et de l'homme: «Celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui qui est grand» (Luc 9: 48). Et le désir d'être le premier est si peu en harmonie avec ce que Dieu attend des siens que le Seigneur dit: «Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous, et le serviteur de tous» (Marc 9: 35). Le Seigneur l'a dit à une autre occasion: «Quiconque s'élève sera abaissé; et celui qui s'abaisse sera élevé» (Luc 14: 11).
Une deuxième circonstance — Lorsque le voyage du Seigneur vers Jérusalem touche à sa fin, et qu'il parle encore une fois à ses disciples des souffrances qui l'attendent dans cette ville, les deux fils de Zébédée et leur mère présentent à Jésus une singulière requête: Jacques et Jean souhaitent être assis à la droite et à la gauche de Jésus quand il sera dans son royaume (Matthieu 20: 21, 22; Marc 10: 35-37). Les dix autres disciples sont indignés à l'égard des deux frères. Et cette indignation, tableau de ce qui se passe parfois dans nos cœurs lorsque nous estimons que nos frères prennent une place qui ne leur appartient pas, traduit plus le refus de donner à Jacques et à Jean une place supérieure à la leur, qu'un discernement de la peine que cette demande pouvait faire à Jésus.
Alors, le Seigneur les appelle tous auprès de lui et les enseigne. Et il pose ici un principe d'une importance capitale. «Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles, et que les grands usent d'autorité sur elles. Il n'en sera pas ainsi parmi vous» (Matthieu 20: 26).
Une troisième circonstance — L'évangile de Luc nous présente un entretien semblable. La question soulevée par les disciples était encore plus déplacée, venant juste après l'institution de la Cène, la nuit même où le Seigneur fut livré. «Et il arriva aussi une contestation entre eux pour savoir lequel d'entre eux serait estimé le plus grand. Et il leur dit: Les rois des nations les dominent, et ceux qui exercent l'autorité sur elles sont appelés bienfaiteurs; mais il n'en sera pas ainsi de vous» (Luc 22: 24-26).
En conclusion — Plaçons-nous devant le Seigneur, et demandons-nous si, dans le domaine de la maison de la foi, nous n'avons pas laissé s'introduire quelque chose de ce qui est habituel, normal, voire même souhaitable dans ce monde, mais que le Seigneur met ici entièrement de côté. Avoir des qualités de chef, l'esprit d'organisation, la capacité de persuader les autres, la volonté de parvenir à son but… peut être très utile dans le domaine professionnel. Mais cela n'a nullement sa place dans l'assemblée ou parmi les croyants.
Dans l'entretien occasionné par la demande de Jacques et de Jean, le Seigneur conclut: «Le fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs» (Matthieu 20: 28; Marc 10: 45). Dans celui qui suit l'institution de la Cène, le Seigneur dit: «Or moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert» (Luc 22: 27). Quel exemple il nous donne! Lui, qui détient tous les droits à l'autorité, alors que nous n'en possédons pas une parcelle, daigne prendre la place de serviteur. C'est la place qu'il nous engage à prendre: «Que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui conduit comme celui qui sert» (verset 26)!
Le Seigneur reconnaît ici la fonction de «celui qui conduit», fonction que les épîtres mentionnent aussi (cf. Romains 12: 8; 1 Pierre 5: 2, 3). Mais elle est avant tout celle de l'exemple; elle n'a rien d'une domination, et elle ne saurait en rien atténuer le principe que le Seigneur vient de poser. Elle s'accomplit dans la position de serviteur de ses frères et sœurs. Le fait que les jeunes gens aient à être «soumis aux anciens» et que nous devions être «soumis» à des «conducteurs» que Dieu qualifie (Hébreux 13: 17) n'autorise pas ceux-ci, s'ils existent, à user d'autorité sur leurs frères et sœurs.
Soulignons le verbe «vouloir» que le Seigneur utilise dans les entretiens que nous venons de considérer: «Si quelqu'un veut être le premier…» (Marc 9: 35). «Quiconque voudra devenir grand parmi vous…», «Quiconque voudra être le premier parmi vous…» (Matthieu 20: 26, 27; Marc 10: 43, 44). Ce désir est manifestement le produit de la chair et appelle la discipline de Dieu. Jésus dit: «il sera le dernier de tous et le serviteur de tous» (Marc 9: 35).