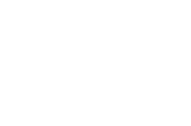Lectures hebdomadaires
Livre de l'Exode
Chapitre 1
1. Exode 1 — Israël en Égypte
Le grand sujet du livre de l’Exode est celui de la rédemption. Dans la Genèse, nous avons la création, puis la chute et l’annonce d’un Libérateur dans la descendance de la femme qui briserait la tête du serpent (Gen. 3:15) — c’est-à-dire la révélation du second Homme, dont Adam était une figure (Rom. 5, 14) et en qui tous les desseins de Dieu seraient établis. Suivent tous les grands principes de base qui se trouvent développés dans l’histoire des relations de Dieu avec l’homme, dont les livres suivants nous donnent le récit. C’est ainsi qu’on a pu dire très justement que le livre de la Genèse contient en germe la Bible tout entière. Mais dans l’Exode, il n’y a qu’un seul sujet — la rédemption avec ses conséquences, des conséquences en grâce et des conséquences judiciaires lorsque le peuple insensible à l’égard de la grâce et ignorant quant à son propre état s’est placé sous la loi. Néanmoins le grand résultat de la rédemption est atteint: l’établissement devant Dieu d’un peuple en relation avec lui; voilà ce qui confère un si grand intérêt à ce livre et le rend si instructif pour le lecteur chrétien.
1.1. Israël en Égypte
Les cinq premiers versets énoncent brièvement les noms des fils de Jacob qui entrèrent en Égypte avec leur père — eux et leurs familles totalisant avec Joseph et les siens déjà établis dans le pays soixante-dix âmes. Le chapitre 46 de la Genèse donne le détail de ce que nous avons ici dans un bref résumé. La famine a été à l’origine directe de leur descente en Égypte; mais par la famine et par la méchanceté des fils de Jacob qui vendirent leur frère aux Ismaélites (Gen. 37:28), Dieu travaillait en fait à l’accomplissement de ses propres desseins. Longtemps auparavant, il avait dit à Abram: «Sache certainement que ta semence séjournera dans un pays qui n’est pas le sien, et ils l’asserviront, et l’opprimeront pendant quatre cents ans. Mais aussi je jugerai, moi, la nation qui les aura asservis; et après cela ils sortiront avec de grands biens» (Gen. 15:13, 14). C’est l’histoire que nous rapportent les douze premiers chapitres de l’Exode. Et nous sommes remplis d’admiration en constatant que tout ce que les hommes font, même dans leur méchanceté et leur rébellion ouverte, concourt à l’établissement des plans de grâce et d’amour divins. Pierre l’a exprimé le jour de la Pentecôte quand il dit, à l’égard de Christ: «Ayant été livré par le conseil défini et par la pré-connaissance de Dieu, — lui, vous l’avez cloué à une croix et vous l’avez fait périr par la main d’hommes iniques» (Actes 2:23). Ainsi la colère de l’homme aussi travaille à son insu à l’accomplissement des décrets de Dieu.
Ce n’est pas sans raison que les enfants d’Israël nous sont montrés en Égypte au début du livre. Dans l’Écriture, l’Égypte représente le monde; Israël en Égypte devient par conséquent une figure de la condition de l’homme naturel. Aussi après la déclaration que «Joseph mourut, et tous ses frères, et toute cette génération-là» (v. 6), le récit passe-t-il rapidement à la description de leurs circonstances et de leur état. Leur croissance, et leur prospérité également, sont mentionnées en premier. Ils «fructifièrent et foisonnèrent, et multiplièrent, et devinrent extrêmement forts; et le pays en fut rempli» (v. 7). Ils étaient les enfants de la promesse, bien qu’ils soient en Égypte, et comme tels, la faveur de Dieu reposait sur eux. D’où ce tableau de prospérité terrestre. Dieu n’oublie jamais son peuple, même si celui-ci en vient à L’oublier.
1.2. Un nouveau roi cruel
Un autre personnage entre maintenant en scène — «un nouveau roi... sur l’Égypte, qui n’avait point connu Joseph» (v. 8). La mention qu’il «n’avait point connu Joseph» est très significative. Joseph en Égypte était une figure de Christ dans sa gloire terrestre; par conséquent, ne pas le connaître caractérise un état moral. En fait, le Pharaon est le dieu de ce monde et, comme tel, il doit nécessairement s’opposer au peuple de Dieu. C’est pourquoi il nous est d’emblée parlé de sa ruse et de sa méchanceté pour ruiner la prospérité du peuple et le réduire à la misère et à l’esclavage (v. 9-12). Et pour quel motif? «De peur qu’il ne se multiplie, et que, s’il arrivait une guerre, il ne se joigne, lui aussi, à nos ennemis, et ne fasse la guerre contre nous, et ne monte hors du pays» (v. 10). Si nous sommes enclins à l’oublier, Satan, lui, sait que le monde ne peut que haïr les enfants de Dieu, et que ceux-ci, s’ils sont fidèles, doivent être opposés au monde; aussi importe-t-il de les réduire à l’impuissance et d’empêcher leur délivrance. C’est pourquoi «ils établirent sur lui (Israël) des chefs de corvées pour l’opprimer par leurs fardeaux. Et il bâtit pour le Pharaon des villes à greniers, Pithom et Ramsès». Ils sont ainsi placés sous l’esclavage du monde: «Les Égyptiens firent servir les fils d’Israël avec dureté, et ils leur rendirent la vie amère par un dur service» (v. 13, 14).
L’autre aspect du tableau, c’est que «selon qu’ils l’opprimaient, il multipliait et croissait» (v. 12). Cela résultait de ce qui a été mentionné plus haut: qu’en dépit de leur condition, ils étaient le peuple de la promesse, compris dans les desseins de Dieu; et comme tel, ils étaient préservés, protégés et bénis; le Pharaon, le dieu de ce monde, ne pouvait donc pas les détruire. Le véritable enjeu, comme le montre la suite de l’histoire, était entre Dieu et le Pharaon; et ce dernier, dans ses machinations contre les enfants d’Israël, combattait en fait contre Dieu. D’où son échec sur tous les plans. D’un autre côté, la condition des Israélites présente un portrait très frappant de la condition du pécheur — plus exactement du pécheur qui a été amené à sentir le joug de fer de son esclavage du péché et de Satan. Comme le fils prodigue qui tombe toujours plus bas, jusqu’à la limite de la mort et de la dégradation totale avant de revenir à lui-même, Dieu amène ici les enfants d’Israël à prendre conscience du poids de leurs fardeaux et à goûter l’amertume de leur dure servitude, pour éveiller en eux le désir de la délivrance, avant de commencer à agir en leur faveur. Il peut arriver que le pécheur soit insensible à sa propre dégradation, et satisfait, sinon heureux, de son éloignement de Dieu; mais pour être sauvé, il doit passer par l’expérience dont nous avons une image dans cette description de la condition d’Israël. Alors seulement il prendra conscience de son véritable état et désirera la délivrance.
1.3. Un décret criminel
Le reste du chapitre (v. 15-22) décrit une nouvelle tentative entreprise pour affaiblir les enfants d’Israël, et finalement les anéantir. Mais de nouveau, Dieu intervient en leur faveur. Le Pharaon était un monarque absolu, et aucun de ses sujets n’osait s’opposer à sa volonté; mais même ces simples femmes sont soutenues dans leur désobéissance, car elles estimaient que leur premier devoir était de craindre Dieu. Le roi le plus puissant du monde est sans pouvoir quand il s’oppose à Dieu ou à ceux qui sont identifiés à Dieu et à son peuple. Aussi Shiphra et Pua «ne firent pas comme le roi d’Égypte leur avait dit» (v. 17), et Dieu fit du bien aux sages-femmes et parce qu’elles craignirent Dieu, il bénit leurs familles (v. 17-21). «Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?» (Rom. 8:31). Nous apprenons par conséquent, premièrement, que l’Ennemi n’a absolument aucune puissance pour s’opposer aux desseins de Dieu; deuxièmement, que ceux qui font confiance à la sagesse de Dieu sont invincibles; troisièmement, que la crainte de Dieu permet aux plus faibles et aux plus humbles de s’élever au-dessus de la crainte de l’homme; et enfin, que le cœur de Dieu sait apprécier toute manifestation de fidélité envers lui au milieu d’une scène où Satan, le dieu de ce monde, règne, et opprime son peuple, cherchant à le détruire.
Mais l’inimitié du Pharaon augmente, et il commande «à tout son peuple, disant: Tout fils qui naîtra, jetez-le dans le fleuve; mais toute fille, laissez-la vivre» (v. 22). Le chapitre suivant nous montrera comment Dieu se sert de ce décret même du roi pour préparer un libérateur pour son peuple.
À suivre
Chapitre 2, versets 1 à 10
La naissance de Moïse
Ce chapitre, si intéressant, est rendu encore plus attrayant par le commentaire divin donné en Hébreux 11 sur les principaux incidents qu’il contient. Ici nous avons le simple récit, du point de vue humain, des faits rapportés; là, c’est plutôt le côté divin, autrement dit l’estimation de Dieu à l’égard des actes de son peuple. Par conséquent, ce n’est qu’en combinant ces deux aspects que nous retirerons l’enseignement qui est présenté. Pas plus que lors de la naissance du Seigneur Jésus à Bethléhem, les parents ou le monde environnant ne comprirent la signification de la naissance du fils d’Amram et de Jokébed. Dieu travaille toujours de cette manière, sans bruit, posant les fondations de ses desseins et préparant ses instruments, jusqu’au moment déterminé d’avance où il va agir; il étend alors son bras et manifeste sa présence et sa puissance à la face du monde.
Les parents de Moïse
Mais revenons à notre chapitre. «Un homme de la maison de Lévi alla, et prit une fille de Lévi; et la femme conçut, et enfanta un fils; et elle vit qu’il était beau; et elle le cacha trois mois» (v. 1, 2). Quelle simplicité et quelle beauté dans cette scène naturelle! Comme nous pouvons comprendre les sentiments de cette mère juive! Le roi avait ordonné que tout fils qui naîtrait soit jeté dans le fleuve (1:22); mais quelle mère consentirait à livrer son enfant à la mort sans une juste révolte de toutes ses affections? Hélas! le décret de ce roi despotique était inexorable; et comment pouvait-elle, femme du peuple, et de plus appartenant à une race méprisée, s’opposer à la volonté d’un monarque absolu? Considérons le commentaire inspiré du Nouveau Testament: «Par la foi, Moïse, étant né, fut caché trois mois par ses parents, parce qu’ils virent que l’enfant était beau, et ils ne craignirent pas l’ordonnance du roi» (Héb. 11:23). Ils devaient certes se soumettre à leur souverain terrestre, mais ils devaient également obéir au Seigneur des seigneurs; c’est pourquoi, se confiant en lui, ils furent libérés de toute crainte à l’égard du commandement du roi, et ils cachèrent pendant trois mois l’enfant que Dieu leur avait donné. Ils comptèrent sur Dieu et ils ne furent pas confus; car jamais il ne laisse ni n’abandonne ceux qui se confient en lui. C’est un acte de foi magnifique: le regard fixé sur Dieu, ils osèrent désobéir au commandement inique du roi, sans craindre les conséquences. Comme plus tard Shadrac, Méshac et Abed-Négo, ils crurent que le Dieu qu’ils servaient pouvait les délivrer de la main du roi (Daniel 3:16, 17). Les dirigeants de ce monde n’ont aucun pouvoir en présence de ceux qui sont liés à Dieu par l’exercice de la foi.
Le coffret de joncs
Le jour arriva cependant où cet enfant qui «était beau» ne put plus être caché (v. 3); preuve de la vigilance accrue de l’ennemi de Dieu et de son peuple. Mais la foi n’est jamais à court de ressource. Aussi voyons-nous que la femme «prit pour lui un coffret de joncs, et l’enduisit de bitume et de poix, et mit dedans l’enfant, et le posa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Et sa sœur se tint à distance pour savoir ce qu’on lui ferait» (v. 3, 4). Pour Moïse, comme pour Isaac et pour Samuel, la mort, en figure du moins, devait être connue par les parents, à la fois pour eux-mêmes et pour leur enfant, avant que celui-ci puisse devenir un instrument utile pour Dieu. À cet égard, il est très remarquable que le mot utilisé ici pour «coffret» ne se trouve nulle part ailleurs dans l’Écriture, sinon pour désigner l’arche dans laquelle Noé et sa maison traversèrent le déluge.
Autre ressemblance: de même qu’en obéissance à une directive divine Noé enduisit l’arche de poix en dedans et en dehors, ainsi Jokébed enduisit le coffret de bitume et de poix. Le mot rendu par poix ici signifie également rançon (Exode 30:12; Job 33:24: propitiation, etc.), préfigurant la vérité qu’il fallait trouver une rançon pour délivrer des eaux du jugement. Toutefois cette mère hébreue emploie aussi le bitume: une sorte différente de poix suggérant qu’elle ne connaissait pas la pleine vérité. Pourtant, elle confessait par là le besoin de rédemption; sa foi le reconnaissait et ainsi son coffret de joncs, avec son précieux contenu, flotta en sécurité parmi les roseaux sur ce fleuve de la mort. L’intelligence divine manquait peut-être, mais il y avait une foi réelle, et celle-ci trouve toujours une réponse dans le cœur de Dieu. Remarquons encore que c’est la sœur, et non pas la mère, qui observe ce qui va se passer. Du point de vue humain, cela pourrait facilement s’expliquer, mais n’y a-t-il pas une autre raison? La mère croyait; elle pouvait par conséquent se reposer paisiblement, bien que l’enfant qui lui était plus cher que la vie même fût exposé sur le fleuve. C’est pour la même raison que nous ne trouvons pas Marie, la sœur de Lazare, au sépulcre dans lequel le Seigneur de gloire avait été déposé: elle était entrée par la foi dans le mystère de sa mort (Jean 12:7).
La fille du Pharaon
Voyons maintenant comment Dieu agit en réponse à la foi de son peuple. «La fille du Pharaon descendit au fleuve pour se laver, et ses jeunes filles se promenaient sur le bord du fleuve; et elle vit le coffret au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante qui le prit» (v. 5). Il est très beau et instructif de voir ainsi Dieu derrière la scène, dirigeant tout pour sa propre gloire. La fille du Pharaon agissait à son gré, et pour son plaisir; elle ignorait qu’elle était un instrument de la volonté divine. Mais chaque détail — le fait qu’elle descende au fleuve pour se baigner, le moment où elle le fait — correspondait au propos de Dieu à l’égard de l’enfant qui devait être le libérateur de son peuple. Ainsi elle vit le coffret, le fit chercher, l’ouvrit, trouva l’enfant; «et voici, c’était un petit garçon qui pleurait» (v. 6). La sœur qui guettait avec anxiété ce qui allait arriver à son petit frère, reçoit à ce moment critique la parole de sagesse. Elle demanda: «Irai-je et appellerai-je auprès de toi une nourrice d’entre les Hébreues, et elle t’allaitera l’enfant? Et la fille du Pharaon lui dit: Va. Et la jeune fille alla, et appela la mère de l’enfant» (v. 7, 8). Le petit Moïse, qui avait été exposé sur le fleuve à cause du décret du roi d’Égypte, est ainsi rendu à sa mère, sous la protection même de la fille du Pharaon. Et il resta là jusqu’à ce qu’il eut grandi; alors Jokébed «l’amena à la fille du Pharaon, et il fut son fils; et elle appela son nom Moïse, et dit: Car je l’ai tiré des eaux» (v. 10). Son nom même devait proclamer la puissance de Celui qui l’avait sauvé de la mort, qui l’avait retiré des eaux du jugement dans sa grâce et son amour souverains. Ainsi l’homme que Dieu avait choisi, celui qu’il avait désigné comme l’instrument de son choix pour la délivrance de son peuple, et pour devenir le médiateur de son alliance avec ce peuple, trouve abri sous le toit du Pharaon. Pendant cette période, il «fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens; et il était puissant dans ses paroles et dans ses actions» (Actes 7:22).
À suivre
Chapitre 2, versets 11 à 25
Moïse et ses frères
Une autre étape de sa vie nous est présentée ensuite. Quarante années se sont écoulées avant l’incident décrit dans les versets 11 et suivants. «Et il arriva, en ces jours-là, que Moïse étant devenu grand, sortit vers ses frères; et il vit leurs fardeaux. Et il vit un homme égyptien qui frappait un Hébreu d’entre ses frères; et il regarda çà et là, et vit qu’il n’y avait personne, et il frappa l’Égyptien, et le cacha dans le sable. Et il sortit le second jour; et voici, deux hommes hébreux se querellaient. Et il dit au coupable: Pourquoi frappes-tu ton compagnon? Et il dit: Qui t’a établi chef et juge sur nous? Est-ce que tu veux me tuer, comme tu as tué l’Égyptien? Et Moïse eut peur, et dit: Certainement le fait est connu. Et le Pharaon apprit la chose, et chercha à tuer Moïse; mais Moïse s’enfuit de devant le Pharaon, et habita dans le pays de Madian. Et il s’assit près d’un puits» (v. 11-15; voir aussi Actes 7:23). La lecture de ce récit pourrait laisser supposer que Moïse, en tuant l’Égyptien, ne faisait qu’agir sous l’impulsion d’un cœur généreux, sensible à l’injustice commise et intervenant pour la venger. Mais comment l’Esprit de Dieu interprète-t-il cet acte? «Par la foi, Moïse, étant devenu grand, refusa d’être appelé fils de la fille du Pharaon, choisissant plutôt d’être dans l’affliction avec le peuple de Dieu, que de jouir pour un temps des délices du péché, estimant l’opprobre du Christ un plus grand trésor que les richesses de l’Égypte; car il regardait à la rémunération. Par la foi, il quitta l’Égypte, ne craignant pas la colère du roi, car il tint ferme, comme voyant celui qui est invisible» (Héb. 11:24-27).
Gardons-nous cependant bien de conclure que l’Esprit de Dieu approuve tout ce qui est rapporté dans l’Exode. Sans nul doute, Moïse a agi dans l’énergie de la chair; il n’avait pas encore appris son propre néant et son insuffisance, mais il désirait néanmoins agir pour Dieu; et c’est l’épître aux Hébreux qui nous apprend le vrai caractère de ses actions devant Dieu. Il est clair qu’il y a eu manquement, mais c’était le manquement d’un homme de foi dont les mobiles étaient précieux aux yeux de Dieu, car dans l’exercice de la foi il a été rendu capable de refuser tout ce qui aurait tenté l’homme naturel, et de s’identifier avec les intérêts du peuple de Dieu.
Mais cet épisode de sa vie réclame une attention plus particulière. Premièrement donc, c’est par la foi qu’il refusa d’être appelé fils de la fille du Pharaon. Quel autre motif aurait pu en effet l’amener à renoncer à une position aussi exceptionnelle? Il aurait d’ailleurs pu arguer qu’il y avait été placé par une providence étrange et remarquable. N’était-ce pas alors le signe qu’il devait l’occuper et user de l’influence qui s’y attachait pour intervenir en faveur de ses frères opprimés? Peut-être parviendrait-il à mettre tout le poids de la cour royale du côté de sa nation; ne serait-ce alors pas faire un affront à la Providence que d’abandonner cette haute position? Mais, comme cela a souvent été remarqué, la Providence n’est pas un guide pour la foi. La foi a affaire avec les choses invisibles et par conséquent elle est rarement d’accord avec les conclusions tirées des événements et des circonstances providentiels. Non, jamais l’influence du dieu de ce monde (le Pharaon) ne peut être employée pour délivrer le peuple de l’Éternel; et jamais la foi ne peut être protégée par une telle influence ni s’assimiler à elle. La foi a Dieu pour objet; elle doit par conséquent s’identifier avec ce qui appartient à Dieu et se dresser contre tout ce qui est opposé à Dieu.
Le choix de la foi
Comme un autre l’a dit: « Que de raisons Moïse aurait-il eues pour rester là où la Providence l’avait placé! Il aurait même eu le prétexte de servir plus utilement les enfants d’Israël; mais c’eût été s’appuyer sur la puissance du Pharaon, au lieu de reconnaître le lien qui unissait Dieu à son peuple. Il en serait résulté pour celui-ci un soulagement, mais c’est le monde qui l’aurait accordé, et le peuple n’aurait pas connu la délivrance accomplie par l’amour et la puissance de Dieu. Moïse aurait été épargné, mais aurait perdu sa vraie gloire; le Pharaon aurait été flatté et son autorité sur le peuple de Dieu aurait été reconnue; Israël serait demeuré en captivité, s’appuyant sur le Pharaon, au lieu de reconnaître Dieu dans les relations glorieuses attachées à son adoption comme peuple. En outre, Dieu lui-même n’aurait pas été glorifié. C’est là ce qui aurait eu lieu, si Moïse était resté dans la position que la Providence lui avait donnée. Le raisonnement humain et les considérations puisées dans les circonstances s’unissaient pour lui donner ce conseil. La foi lui fit quitter cette position» (J.N. Darby). En la refusant, il choisit plutôt d’être dans l’affliction avec le peuple de Dieu. S’identifier avec ce peuple avait plus de prix pour son cœur fidèle que les délices du péché; car la foi considère toutes choses dans la lumière de la présence de Dieu. Moïse alla même plus loin: il estima l’opprobre du Christ — l’opprobre résultant de son identification avec Israël — un plus grand trésor que les richesses de l’Égypte; car il regardait à la rémunération. Ainsi la foi vit dans l’avenir aussi bien que dans l’invisible. Elle est l’assurance des choses qu’on espère, et la conviction de celles qu’on ne voit pas; elle gouvernait, elle contrôlait le cœur et le sentier de Moïse.
C’est donc la foi qui le dirigeait quand il «sortit vers ses frères; et ... vit leurs fardeaux» (v. 11). Et même lorsque «voyant l’un d’eux à qui l’on faisait tort, il le défendit, et vengea l’opprimé, en frappant l’Égyptien», «il croyait que ses frères comprendraient que Dieu leur donnerait la délivrance par sa main» (Actes 7:24, 25). Il devait bien en être ainsi, mais le moment n’était pas encore venu et Dieu ne pouvait pas encore se servir de Moïse — bien que sa foi fût précieuse à ses yeux. Comme Pierre dut apprendre qu’il ne pouvait pas suivre Christ dans l’énergie de la nature, malgré les affections de son cœur (Jean 13:36), Moïse a dû comprendre que nulle autre arme que la puissance de Dieu ne pouvait être employée pour délivrer Israël. Aussi lorsqu’il sortit le second jour et qu’il tenta de réconcilier deux Hébreux qui se querellaient, on lui reprocha d’avoir tué l’Égyptien et il est lui-même rejeté (v. 13, 14). Le Pharaon apprend à son tour ce qu’il a fait et cherche à le tuer. Ainsi, il est à la fois rejeté par ses frères et persécuté par le monde.
Moïse en Madian
À partir de là, il devient un type de Christ dans son rejet; car il est rejeté par le peuple qu’il aimait et, du fait de sa fuite, il est séparé de ses frères. «Par la foi, il quitta l’Égypte, ne craignant pas la colère du roi, car il tint ferme, comme voyant celui qui est invisible». Il marchait encore dans le chemin de la foi, bien que celui-ci le conduisît dans le désert, au milieu d’un peuple étranger. Mais Dieu donna à son serviteur une maison et une femme dans la personne d’une des filles de Jéthro (Rehuel). Séphora est ainsi en figure un type de l’Église, car elle est associée à Moïse pendant le temps de sa réjection par Israël. Mais le cœur de Moïse reste avec son peuple; aussi nomme-t-il son fils Guershom, «car, dit-il, j’ai séjourné dans un pays étranger» (v. 22).
Pour un même motif, Joseph appela ses fils: Manassé — «car Dieu m’a fait oublier toute ma peine, et toute la maison de mon père»; et Éphraïm — «car Dieu m’a fait fructifier dans le pays de mon affliction». La comparaison est très instructive et montre sous quels aspects particuliers Joseph et Moïse sont des figures de Christ. Si Joseph nous parle de Christ, élevé au travers de la mort à la droite du trône sur les Gentils, pour se révéler alors à ses frères et les recevoir, Moïse représente pour nous Christ plus précisément comme le Rédempteur d’Israël; par conséquent, bien qu’il se marie pendant le temps où il est rejeté, et bien qu’il soit ainsi d’une certaine manière une image de Christ et de l’Église dans la dispensation présente, son cœur demeure avec les enfants d’Israël pendant qu’il séjourne dans un pays étranger.
Les trois derniers versets placent devant nous la condition du peuple, tout en révélant la fidélité et la compassion de Dieu. Ces versets se rattachent au chapitre suivant.
Chapitre 3, versets 1 à 6
À l’école de Dieu
Moïse a passé pas moins de quarante ans dans le désert, apprenant les leçons dont il aura besoin pour sa tâche future, et étant formé pour agir pour Dieu comme libérateur de Son peuple. Quel contraste avec les années précédentes à la cour du Pharaon! Là, il était entouré de tout le luxe et de tous les raffinements de son époque; ici il est un simple berger, gardant les troupeaux de Jéthro, son beau-père. Quarante est le nombre de la mise à l’épreuve comme le montre la durée de la traversée du désert par les enfants d’Israël ou aussi les quarante jours de la tentation du Seigneur. Ce fut donc une période de mise à l’épreuve: la manifestation de ce que Moïse était, mais aussi l’occasion pour lui de découvrir ce que Dieu était; ces deux leçons doivent nécessairement être apprises avant que nous puissions être qualifiés pour un service. Aussi Dieu envoie-t-il toujours ses serviteurs dans le désert avant de les employer pour l’accomplissement de ses propos. Nulle part ailleurs nous ne saurions être amenés plus pleinement dans la présence de Dieu. C’est là, seuls avec lui, que nous faisons la découverte de la vanité absolue des ressources humaines et de notre entière dépendance de lui. Quelle bénédiction immense n’y a-t-il pas à être retiré des lieux fréquentés des hommes et de leur agitation, pour être seul avec Dieu et apprendre dans la communion avec lui quelles sont ses pensées pour nous, pour ses intérêts et pour son service! En fait, il est absolument indispensable pour tout vrai serviteur d’être beaucoup seul avec Dieu; et lorsque cette nécessité est oubliée, Dieu l’impose souvent, dans la tendresse de son cœur, par les moyens de sa discipline tendre et fidèle.
Le moment arrive enfin où Dieu peut commencer à intervenir pour son peuple. Mais rappelons brièvement les circonstances. Dans le premier chapitre, le peuple se trouve dans l’esclavage; dans le deuxième, nous avons la naissance de Moïse et son introduction dans la maison du Pharaon. Puis Moïse unit son destin à celui du peuple de Dieu, et dans l’ardeur de ses affections cherche à remédier aux torts que ce peuple subit; mais il est rejeté et s’enfuit dans le désert. Après quarante années, âgé alors de quatre-vingts ans, il va être renvoyé en Égypte. Le troisième et le quatrième chapitres contiennent le récit de la mission que Dieu va lui confier et de sa réticence à la remplir. Mais avant d’en arriver là, une courte préface, à la fin du chapitre 2 — qui en fait se rattache au chapitre 3 de par son contenu — nous révèle le terrain sur lequel Dieu agissait pour la rédemption de son peuple. D’abord, elle nous apprend que le roi d’Égypte mourut, mais que sa mort n’entraîna aucun allégement à la condition des enfants d’Israël. Ensuite elle nous montre ceux-ci qui soupirent et crient à cause de leur service. «Et leur cri monta vers Dieu à cause de leur service».
Ils étaient réduits à la plus grande misère. Mais Dieu n’était pas insensible, car il entendit leur gémissement: «Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac, et avec Jacob. Et Dieu regarda les fils d’Israël, et Dieu connut leur état» (2:23-25). Leur situation toucha le cœur de Dieu, émut ses compassions, mais le terrain sur lequel il agissait était celui de sa propre grâce souveraine, exprimée dans l’alliance qu’il avait faite avec leurs pères. C’est cette même miséricorde, et sa fidélité à sa parole, que Marie et Zacharie célèbrent dans leurs cantiques de louanges, en relation avec la naissance du Sauveur et de Jean son précurseur. «Il a pris la cause d’Israël, son serviteur, pour se souvenir de sa miséricorde (selon qu’il avait parlé à nos pères) envers Abraham et envers sa semence, à jamais». Et encore, il «nous a suscité une corne de délivrance... pour accomplir la miséricorde envers nos pères et pour se souvenir de sa sainte alliance, du serment qu’il a juré à Abraham notre père...» (Luc 1:54, 55, 68-73). Il est impossible que Dieu oublie sa parole, et s’il tarde à l’accomplir, c’est uniquement pour manifester sa grâce et son amour immuables d’une façon plus glorieuse.
Les bases ont été posées par ces quelques mots; la scène qui suit place devant nous la manière dont Dieu va agir envers Moïse.
Chap. 3:1, 2 — Le buisson à épines
Il est très intéressant de considérer les différents aspects sous lesquels Dieu apparaît à son peuple et la correspondance de chacune de ces apparitions avec les circonstances dans lesquelles celui-ci se trouve (voir Gen. 12; 18; 32; Josué 5; etc.). Ici, c’est en rapport avec la mission pour laquelle Moïse allait être envoyé, et cette liaison est particulièrement frappante. Trois éléments caractérisent la vision donnée: l’Éternel, la flamme de feu et le buisson.
Remarquons d’abord qu’il est dit que l’Ange de l’Éternel apparut à Moïse (v. 2); puis l’Éternel vit qu’il se détournait, et Dieu l’appela du milieu du buisson (v. 4. Comparer Gen. 22:15, 16). L’Ange de l’Éternel est ainsi identifié avec l’Éternel, avec Dieu lui-même. Autrement dit, toutes ces apparitions de l’Éternel dans l’Ancien Testament, préfigurent l’incarnation à venir du Fils de Dieu et, par conséquent, dans tous ces cas, il s’agit de la deuxième Personne de la Trinité — Dieu le Fils. La flamme de feu est un symbole de la sainteté de Dieu apparaissant sous différentes formes, entre autres dans le feu sur l’autel, qui consumait les sacrifices. Et dans l’épître aux Hébreux, il est dit expressément que «notre Dieu est un feu consumant», c’est-à-dire qu’il éprouve toute chose selon sa sainteté et consume tout ce qui ne répond pas aux exigences de celle-ci.
Le buisson était une figure d’Israël. Rien n’est plus facilement consumé par le feu qu’un buisson; et c’est bien pour cette raison qu’il a été choisi pour représenter la nation d’Israël dans la fournaise de l’Égypte où le feu faisait rage autour d’elle, sans la détruire toutefois. C’était donc l’assurance consolante pour le cœur de Moïse — s’il savait l’interpréter correctement — que sa nation serait préservée en dépit de l’intensité du feu. Pour reprendre les paroles d’un autre: «Cela devait être une image de ce qui était présenté à l’esprit de Moïse — un buisson dans un désert, qui brûlait sans être consumé. C’était ainsi que Dieu allait opérer au milieu d’Israël. Moïse et le peuple devaient le savoir. Eux aussi, dans leur faiblesse, seraient des vases que dans sa grâce Il a choisis pour déployer sa puissance. Leur Dieu, comme le nôtre, se manifesterait comme un feu consumant. Certes il est un feu consumant; mais le buisson, tout faible et éphémère qu’il soit, subsiste pour prouver que si Dieu doit utiliser le crible et des voies judiciaires, s’il éprouve et sonde l’homme, pourtant lorsqu’il se révèle à la fois en compassion et en puissance (et c’était certainement bien le cas ici), il ne manque pas de soutenir celui qui en est l’objet. Il ne se sert de l’épreuve que pour le bien en même temps que pour sa propre gloire, autrement dit pour les meilleurs intérêts de ceux qui lui appartiennent».
Comment Dieu se révèle
Non sans raison, Moïse est intrigué par «cette grande vision» et se détourne pour la voir (v. 4). C’est alors que Dieu lui parle du milieu du buisson, l’appelant par son nom. Mais il doit être rendu attentif à la sainteté de la présence divine. «N’approche pas d’ici; ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte» (v. 5. Comparer Nomb. 5:1-3; Josué 5:15, etc.). Voilà la première leçon que doivent apprendre tous ceux qui s’approchent de Dieu — la reconnaissance de sa sainteté. Certes, il est un Dieu de grâce, de miséricorde, et il est aussi amour; mais jamais il n’aurait pu se manifester dans ces précieux caractères si, à la croix du Seigneur Jésus Christ, la bonté et la vérité ne s’étaient pas rencontrées, et la justice et la paix embrassées. Mais à moins d’avoir spirituellement les pieds déchaussés — dans la conscience de la sainteté de Celui avec lequel nous avons affaire — nous ne recevrons jamais les communications pleines de grâce de son esprit et de sa volonté. Aussi la première chose que nous trouvons ensuite, c’est qu’il se révèle à Moïse comme le Dieu de son père, «le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, et le Dieu de Jacob» (v. 6). Cette révélation était destinée à agir sur l’âme de Moïse, et ce fut le cas: il «cacha son visage, car il craignait de regarder vers Dieu». (Voir 1 Rois 19:13). L’Éternel annonce alors le motif de sa manifestation à Moïse.
Chapitre 3, versets 7 à 22
Ch. 3:7-10
1) L’ordre dans lequel cette communication est faite est très instructif.
Dieu se révèle comme le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Son caractère est le fondement de tout ce qu’il fait. Cette leçon, à savoir que Dieu trouve toujours en lui-même son motif pour agir, est bien de nature à fortifier l’âme qui l’apprend. Il agit sur la base de ce qu’il est Lui, et non pas de ce que nous sommes, nous (comparer Éph. 1:3-6; 2 Tim. 1:9, 10).
2) Ce qui l’a amené à intervenir, c’est la condition de son peuple. «L’Éternel dit: J’ai vu, j’ai vu l’affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu le cri qu’il a jeté à cause de ses exacteurs; car je connais ses douleurs...» (v. 7). Quelle tendresse de sa part! Rien n’indique que les enfants d’Israël avaient crié à l’Éternel. Ils avaient soupiré et crié à cause de leur esclavage, mais nous ne voyons pas qu’ils se soient tournés vers l’Éternel. Pourtant, leur misère avait touché son cœur, il connaissait leurs douleurs et était descendu pour les délivrer. Ainsi «Dieu constate son amour à lui envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous» (Rom. 5:8).
3) Son propos était de délivrer le peuple d’Égypte, «pour le faire monter de ce pays-là dans un pays bon et spacieux, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans le lieu d’habitation du Cananéen, et du Héthien, et de l’Amoréen, et du Phérézien, et du Hévien, et du Jébusien» (v. 8). Il n’y a ici rien entre l’Égypte et Canaan. Le désert n’est pas mentionné. De la même manière, nous lisons dans les Romains que «ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés». Nous apprenons ainsi, comme cela a souvent été remarqué, que le désert ne fait pas partie du propos de Dieu. Il se rattache à ses voies, non pas à ses plans éternels, car c’est dans le désert que la chair est mise à l’épreuve; c’est là que nous apprenons ce que nous sommes et aussi ce que Dieu est (voir Deut. 8). Mais pour ce qui concerne les plans d’amour de Dieu, il n’y a rien entre la rédemption et la gloire. Et en réalité, il n’y avait que onze journées de chemin depuis Horeb jusqu’à Kadès-Barnéa (Deut. 1:2), mais, à cause de leur incrédulité, il fallut quarante ans aux enfants d’Israël pour parcourir cette distance.
4) Moïse est alors établi pour les délivrer. L’Éternel avait entendu le cri du peuple, bien qu’il ne lui fût pas adressé; il avait vu leur oppression, et ainsi il va envoyer Moïse vers le Pharaon, pour les faire monter d’Égypte (v. 9, 10).
Doutes et craintes
Nous arrivons ici à une très triste défaillance de la part de Moïse. En Égypte, il avait couru avant d’être envoyé; il croyait pouvoir délivrer ses frères, ou du moins redresser les torts qu’ils subissaient, dans l’énergie de sa propre volonté. Mais maintenant, après quarante ans passés dans les solitudes du désert, non seulement il n’est pas disposé à être employé pour la belle mission que l’Éternel veut lui confier, mais il soulève objection sur objection; il va jusqu’à lasser la patience et la miséricorde de l’Éternel et à embraser sa colère contre lui (4:14). Mais chaque nouveau manquement de Moïse devient l’occasion de manifester une grâce plus grande — bien que par la suite, Moïse aura à souffrir tout au long de sa vie de son peu d’empressement à obéir à la voix de l’Éternel. Triste histoire de la chair! Ou elle est impatiente, ou elle est trop lente. Un seul a toujours été à la hauteur de toute la volonté de Dieu, Un seul a toujours fait les choses qui lui plaisent, le parfait Serviteur, le Seigneur Jésus Christ. Considérons cette série de difficultés soulevées par Moïse.
«Et Moïse dit à Dieu: Qui suis-je, moi, pour que j’aille vers le Pharaon, et pour que je fasse sortir hors d’Égypte les fils d’Israël» (v. 11). « Qui suis-je, moi?» Il est tout à fait convenable d’avoir le sentiment de notre néant total. Mais il convient également d’avoir une haute estimation de Dieu. Car quand il envoie, il ne s’agit pas de ce que nous sommes, mais de ce que lui est, et ce n’est pas peu de chose que d’être investis de son autorité et de sa puissance. David a appris cette leçon lorsqu’il s’avance contre Goliath; en réponse à ses insultes, il déclare: «Moi, je viens à toi au nom de l’Éternel des armées, du Dieu des troupes rangées d’Israël, que tu as outragé» (1 Sam. 17:45). Cette objection de Moïse n’était donc rien d’autre que du doute.
Cela paraît clairement dans la réponse qui lui est donnée: «Parce que je serai avec toi; et ceci te sera le signe que c’est moi qui t’ai envoyé: lorsque tu auras fait sortir le peuple hors d’Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne» (v. 12). La présence de l’Éternel serait à la fois le garant de sa mission et la source de sa force. Comme l’Éternel le dira plus tard à Josué: «Je ne te laisserai point et je ne t’abandonnerai point. Fortifie-toi et sois ferme» (Josué 1:5, 6). L’Éternel connaît les besoins de son serviteur et pourvoit à sa faiblesse en donnant un signe qui devrait le rassurer, si la subtilité de son cœur devait l’amener à douter, et lui permettre de dire: «J’ai maintenant une preuve que ma mission est divine». C’était certes suffisant pour dissiper son hésitation et sa crainte. Écoutons sa réponse: «Et Moïse dit à Dieu: Voici, quand je viendrai vers les fils d’Israël, et que je leur dirai: Le Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous, et qu’ils me diront: Quel est son nom? que leur dirai-je?» (v. 13).
JE SUIS CELUI QUI SUIS
Dieu s’était déjà révélé à Moïse comme le Dieu de ses pères; cela aurait dû suffire, mais rien ne satisfait jamais les doutes et les craintes. Et cela trahit incidemment la condition d’Israël: la supposition que le peuple ne connaissait pas le nom du Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob pourrait se concrétiser! Dieu supporte avec grâce son serviteur faible et hésitant; il répond: «JE SUIS CELUI QUI SUIS. Et il ajoute: Tu diras ainsi aux fils d’Israël: JE SUIS m’a envoyé vers vous» (v. 14). C’est l’expression de l’être essentiel de Dieu, son nom comme Celui qui est; et, par conséquent, l’affirmation de l’éternité de son existence. Le Seigneur Jésus a revendiqué ce nom lorsqu’il a dit aux Juifs incrédules: «Avant qu’Abraham fût, JE SUIS» (Jean 8:58). Mais ce n’est pas tout. Après s’être révélé quant à son existence essentielle, il ajoute: «Tu diras ainsi aux fils d’Israël: L’Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, et le Dieu de Jacob, m’a envoyé vers vous: c’est là mon nom éternellement, et c’est là mon mémorial de génération en génération» (v. 15). C’est pure grâce de la part de Dieu. «JE SUIS, est son nom essentiel lorsqu’il se révèle; mais quant à son gouvernement de la terre et ses relations avec elle, son mémorial dans tous les âges est: le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Cela a donné à Israël, visité maintenant par Dieu et reçu sous l’abri de ce nom, une place toute particulière». Nous avons là une allusion à leur élection par la grâce souveraine de Dieu et à leur position de bien-aimés à cause des pères. Nous voyons également une révélation du fait qu’Israël sera à toujours le centre des voies de Dieu et la clé de ses plans par rapport à la terre se trouve révélée. Ainsi, tant qu’Israël est sous le jugement, dispersé à travers le monde, la période de bénédiction terrestre est différée.
C’est par conséquent sous ce nom que Dieu se présente pour les délivrer; car dès qu’il le prend, il admet dans sa grâce que le peuple qu’il a mis en relation avec lui a un droit à sa miséricorde et à sa compassion. D’où les instructions détaillées qui sont maintenant données à Moïse (v. 16-22), dans lesquelles toute l’histoire de la controverse de Dieu avec le Pharaon est développée jusqu’à son résultat final dans la délivrance de son peuple. Moïse doit d’abord assembler les anciens d’Israël pour leur dire que l’Éternel, le Dieu de leurs pères, lui était apparu et lui avait communiqué les desseins de sa grâce envers eux, en les faisant monter hors de l’affliction de l’Égypte dans un pays ruisselant de lait et de miel (v. 16, 17). Il lui est annoncé qu’ils écouteraient sa voix et qu’ensemble, lui et eux, iraient demander au Pharaon la permission d’aller le chemin de trois jours dans le désert, afin de sacrifier à l’Éternel, leur Dieu (v. 18). Il est ensuite prévenu de l’opposition obstinée du Pharaon; mais il lui est aussi déclaré que Dieu s’occuperait lui-même du roi d’Égypte et qu’il le contraindrait à les laisser aller; enfin, que lorsqu’ils s’en iraient, ils ne partiraient pas à vide, mais qu’ils dépouilleraient les Égyptiens (v. 19-22)1. Ces instructions sont importantes pour tous les temps; car elles établissent sans aucun doute possible la préconnaissance exacte de Dieu. Il savait à qui il avait affaire, la résistance qu’il rencontrerait, et comment il en viendrait à bout. Il voyait tout du commencement à la fin. Quel encouragement pour nos faibles cœurs! Aucune difficulté, aucune épreuve ne peut nous surprendre qui n’ait été prévue par notre Dieu, et pour laquelle, dans sa grâce, une ressource n’ait été préparée! Tout a été prévu à l’avance en vue de notre triomphe final et de notre sortie victorieuse de cette scène, par la manifestation de sa puissance en rédemption, pour être avec le Seigneur pour toujours! Moïse allait certainement être satisfait cette fois.
1 Certaines traductions indiquent que les Israélites ont reçu l’ordre d’«emprunter» les biens des Égyptiens, la veille de leur exode, ici (Exode 3:22) et au chapitre 11:2; cela a fait l’objet de controverses. Or le sens du mot hébreu ne renferme pas la pensée d’«emprunter». Il signifie simplement «demander». Le contexte montre que grâce à l’intervention de Dieu, les enfants d’Israël trouveraient «faveur... aux yeux des Égyptiens»; et ceux-ci, amenés à réaliser que les Israélites avaient été maltraités par eux, leur donnèrent volontiers ce qu’ils demandaient — comme une espèce de compensation vraisemblablement — bien que sachant parfaitement qu’ils ne reverraient jamais les Israélites. Il s’agit donc de dons inconditionnels.
Chapitre 4, versets 1 à 17
Trois signes
«Et Moïse répondit, et dit: Mais voici, ils ne me croiront pas, et n’écouteront pas ma voix; car ils diront: L’Éternel ne t’est point apparu» (4:1). Quelle incrédulité et quelle présomption! L’Éternel avait dit: «Ils écouteront ta voix». Moïse répond: «Ils ne me croiront pas». Il n’y aurait rien eu d’étonnant à ce que l’Éternel rejette complètement son serviteur qui osait ainsi le contredire en face. Mais il est lent à la colère et d’une grande bonté; et cette scène est très belle en ce qu’elle révèle les profondeurs de sa tendresse et de sa patience. Il supporte donc son serviteur, va encore plus loin en lui donnant même des signes miraculeux pour le fortifier dans sa faiblesse et pour dissiper son incrédulité. «Et l’Éternel lui dit: Qu’est-ce que tu as dans ta main? Et il dit: Une verge. Et il dit: Jette-la à terre. Et il la jeta à terre, et elle devint un serpent; et Moïse fuyait devant lui. Et l’Éternel dit à Moïse: Étends ta main, et saisis-le par la queue (et il étendit sa main, et le saisit, et il devint une verge dans sa main), afin qu’ils croient que l’Éternel, le Dieu de leurs pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, et le Dieu de Jacob, t’est apparu» (v. 2-5). Deux autres signes sont encore ajoutés. Sa main, qu’il est invité à mettre dans son sein et à retirer, devint «lépreuse, blanche comme neige»; et lorsqu’il répète cet acte, «voici, elle était redevenue comme sa chair» (v. 6, 7).
Puis, un troisième signe est donné pour le cas où ni le premier ni le deuxième ne seraient écoutés. Moïse devait prendre de l’eau du fleuve et la verser sur le sec, et l’eau deviendrait du sang sur le sec (v. 9). Ces signes sont significatifs et, remarquons-le, tout spécialement en relation avec ce qui était en question. Une verge, dans l’Écriture, est le symbole de l’autorité ou de la puissance. Jetée à terre, elle devient un serpent qui est l’emblème bien connu de Satan; c’est donc la puissance devenue satanique et c’est exactement ce qui s’était produit en Égypte avec l’oppression des enfants d’Israël. Mais Moïse étend la main à la parole de l’Éternel, saisit le serpent par la queue, et il redevient une verge. La puissance qui était ainsi devenue satanique, reprise par Dieu, se transforme en verge de châtiment ou de jugement.
Ainsi cette verge, dans les mains de Moïse, sera désormais celle de l’autorité et de la puissance judiciaire de Dieu. La lèpre est une figure du péché dans sa souillure, le péché dans la chair se manifestant et polluant l’homme tout entier. C’est pourquoi le deuxième signe place devant nous le péché et sa guérison effectuée, nous le savons, par la mort de Christ uniquement. Le sang de Jésus Christ, le Fils de Dieu, purifie de tout péché. L’eau représente ce qui rafraîchit — une source de vie et de rafraîchissement venant de Dieu; mais répandue sur la terre, elle se transforme en jugement et en mort. Avec de tels signes, Moïse allait certainement pouvoir convaincre les incrédules les plus endurcis. Eh bien! non; lui-même n’est pas encore convaincu. Que répond-il maintenant? «Ah, Seigneur! je ne suis pas un homme éloquent, — ni d’hier, ni d’avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur; car j’ai la bouche pesante et la langue pesante» (v. 10).
Encore des objections
Cette objection confirme de la manière la plus évidente que le «moi» était la poutre qui, dans son œil, obscurcissait la vision de la foi. Car était-ce son éloquence ou bien la puissance de l’Éternel qui devait effectuer l’émancipation d’Israël? Moïse parle comme si tout dépendait des belles paroles de la sagesse humaine, comme si l’appel qu’il avait à adresser devait être le produit de l’art humain pour l’homme naturel. Une erreur très largement répandue, même dans l’Église de Dieu! C’est ainsi que l’éloquence est recherchée, même par les chrétiens, qui la placent au-dessus de la puissance de Dieu. Les chaires de la chrétienté se trouvent de ce fait occupées par des hommes qui n’ont pas la langue pesante; et même les saints qui, en théorie, connaissent la vérité sont séduits et attirés par des dons brillants, et prennent plaisir à les entendre, indépendamment de la vérité communiquée. Quelle différence avec la pensée de l’apôtre Paul! «Moi-même, quand je suis allé auprès de vous, frères, je ne suis pas allé avec excellence de parole ou de sagesse, en vous annonçant le témoignage de Dieu». Et encore: «Ma parole et ma prédication n’ont pas été en paroles persuasives de sagesse, mais en démonstration de l’Esprit et de puissance» (1 Cor. 2:1, 4). C’est pour cette raison que Dieu se sert souvent beaucoup plus de ceux qui ont «la langue pesante» que des dons éloquents; car alors la tentation de s’appuyer sur la sagesse des hommes n’existe pas: tous constatent qu’il s’agit de la puissance de Dieu. C’est cette leçon que l’Éternel va enseigner maintenant à Moïse, mais en l’accompagnant d’un reproche cuisant. «Qui est-ce qui a donné une bouche à l’homme? ou qui a fait le muet, ou le sourd, ou le voyant, ou l’aveugle? N’est-ce pas moi, l’Éternel? Et maintenant, va, et je serai avec ta bouche, et je t’enseignerai ce que tu diras» (v. 11, 12). Le serviteur ne pouvait pas demander davantage; mais le danger est d’oublier que la manière dont l’Éternel veut nous employer ne nous couvrira pas forcément d’honneur. Au contraire, nous serons peut-être taxés comme l’apôtre l’a été, de faibles dans notre présence personnelle et méprisables dans notre parole (2 Cor. 10:10); mais qu’importe, si nous sommes appelés à être les véhicules de la puissance de Dieu. Le serviteur doit apprendre à n’être rien, afin que l’Éternel seul soit exalté. Mais Moïse désirait manifestement être quelque chose. Accablé par ce qui l’attendait — peut-être aussi dans le sentiment de son incompétence, il désire, en dépit de toute la grâce et de la condescendance de l’Éternel, être dispensé d’une mission aussi difficile. Il dit alors: «Ah, Seigneur! envoie, je te prie, par celui que tu enverras» (v. 13). C’est-à-dire: «Envoie n’importe qui, mais pas moi».
L’assistance d’Aaron
Moïse a soulevé ainsi cinq objections aux commandements de l’Éternel, présumant trop de son support et de sa patience. Mais alors «la colère de l’Éternel s’embrasa contre Moïse, et il dit: Aaron, le Lévite, n’est-il pas ton frère? Je sais qu’il parlera très bien; et aussi le voici qui sort à ta rencontre, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Et tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche; et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous ferez; et il parlera pour toi au peuple, et il arrivera qu’il te sera en la place de bouche, et toi, tu lui seras en la place de Dieu. Et tu prendras dans ta main cette verge, avec laquelle tu feras les signes» (v. 14-17). La résistance de Moïse est ainsi brisée, mais seulement lorsque la colère de l’Éternel s’embrase contre lui à cause de sa réticence à obéir à sa parole; il subit toutefois une perte importante. Aaron devait désormais lui être associé et avoir la prééminence devant les hommes, car il serait le porte-parole de son frère. Dans sa grâce, l’Éternel réserve toutefois la première place devant Lui à son serviteur Moïse, lui accordant l’honneur et le privilège d’être le moyen de communication entre Lui et Aaron. Aaron devait être «en la place de bouche» pour Moïse; Moïse serait pour Aaron «en la place de Dieu», c’est-à-dire, qu’il communiquerait à Aaron le message à délivrer. Les desseins de Dieu ne sauraient être anéantis; mais nous aurons peut-être à souffrir de notre obstination et de notre désobéissance. Ce fut le cas pour Moïse. Combien de fois, par la suite, pendant les quarante années passées dans le désert, n’a-t-il pas dû regretter l’incrédulité qui l’avait conduit à refuser la charge que l’Éternel avait voulu lui confier à lui seul! Enfin la verge de l’autorité est donnée à Moïse — la verge avec laquelle il devait manifester la puissance de Dieu par des signes miraculeux, comme preuve de sa mission. Cette verge jouera un rôle très important dans la carrière de Moïse, et il est intéressant de relever les occasions où elle apparaît ainsi que l’emploi qui en est fait. Ici, elle devient, en quelque sorte, le sceau de sa mission en même temps que le signe de sa fonction; car, en fait, il était investi de l’autorité de Dieu pour faire sortir Son peuple d’Égypte.
Chapitre 4, versets 18 à 31
Retour en Égypte
Moïse va maintenant demander à Jéthro la permission de retourner en Égypte. Dieu avait préparé le chemin, aussi Jéthro donne-t-il son consentement, disant à Moïse: «Va en paix» (v. 18). L’Éternel veille sur son serviteur; il connaît les sentiments de son cœur et anticipe même ses craintes. Il le rassure: «Va, retourne en Égypte; car tous les hommes qui cherchaient ta vie sont morts» (Comparer Matt. 2:20). «Moïse prit sa femme et ses fils, et les fit monter sur un âne, et retourna au pays d’Égypte. Et Moïse prit la verge de Dieu dans sa main» (v. 19, 20). Puis l’Éternel lui donne des instructions et même lui révèle le caractère du jugement final par lequel il contraindrait le Pharaon à laisser aller son peuple. Plus encore, il lui enseigne maintenant la vraie relation dans laquelle il avait introduit Israël par grâce. «Israël est mon fils, mon premier-né»: c’est la première fois que cette révélation est faite; elle détermine le caractère du jugement qui s’abattrait sur l’Égypte. «Et je te dis: Laisse aller mon fils pour qu’il me serve; et si tu refuses de le laisser aller, voici, je tuerai ton fils, ton premier-né» (v. 22, 23; comparer Nomb. 8:14-18).
Le foyer du serviteur
Une chose manque encore à la qualification de Moïse pour sa mission. Avant de pouvoir devenir le canal de la puissance divine, il doit faire preuve de fidélité dans le cercle de sa propre responsabilité. L’obéissance dans son foyer doit précéder la manifestation de puissance devant le monde. Nous avons là l’explication de l’incident qui suit. «Il arriva, en chemin, dans le caravansérail, que l’Éternel vint contre lui, et chercha à le faire mourir. Et Séphora prit une pierre tranchante et coupa le prépuce de son fils, et le jeta à ses pieds, et dit: Certes tu m’es un époux de sang! Et l’Éternel le laissa. Alors elle dit: Époux de sang! à cause de la circoncision» (v. 24-26). Pour une raison que nous ignorons — peut-être sous l’influence de sa femme — Moïse avait négligé de circoncire son fils; aussi l’Éternel a-t-il une controverse personnelle avec lui, qui doit être réglée avant qu’il puisse se présenter devant le Pharaon avec l’autorité divine. L’Éternel l’humilie, s’occupe de lui, lui rappelle son manquement afin qu’il puisse le juger et revenir dans le sentier de l’obéissance. Pour reprendre les paroles de quelqu’un d’autre: «Dieu allait honorer Moïse; mais dans la maison de celui-ci, il était déshonoré. Comment se fait-il que les fils de Moïse n’aient pas été circoncis? Comment se fait-il que le signe de la mortification de la chair fît défaut chez ceux qui étaient les plus proches de Moïse? Comment se fait-il que la gloire de Dieu fût bafouée dans ce qui aurait dû occuper la première place dans le cœur d’un père? Il semble que sa femme n’était pas étrangère à tout cela... En fait, elle est finalement obligée de faire ce qu’elle détestait par-dessus tout, comme elle le dit elle-même dans le cas de son fils. Mais plus encore, Moïse était compromis, car c’est avec lui que Dieu avait la controverse, et non pas avec sa femme. Moïse était la personne responsable, et Dieu maintient l’ordre qu’il a établi».
La phrase que nous avons soulignée contient un principe extrêmement important et explique sur quelle base Dieu agissait envers son serviteur. Il lui fut toutefois accordé la grâce de s’incliner devant la main qui infligeait le châtiment; et quelle bénédiction, lorsqu’il nous est donné de reconnaître, avec l’apôtre Paul: «Nous avions en nous-mêmes la sentence de mort, afin que nous n’eussions pas confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts» (2 Cor. 1:9).
Les deux bases de la qualification de Moïse étaient donc l’autorité divine et l’état personnel; et ces deux éléments ne devraient jamais être séparés. Que ceux qui veulent parler au nom du Seigneur ou être employés par lui à un service quelconque prennent garde de l’oublier: c’est de toute importance. Rien ne saurait se substituer à un mauvais état de l’âme. En fait, le secret de notre faiblesse dans le service réside là. Si notre comportement, ou comme dans le cas de Moïse, si nos foyers, ne sont pas jugés, l’Esprit de Dieu est attristé et, par conséquent, nous ne sommes pas employés pour la bénédiction. Il ne suffit donc pas d’avoir les paroles de Dieu dans la bouche; mais il nous faut marcher sous l’influence de leur puissance dans notre propre âme pour pouvoir parler «en démonstration de l’Esprit et de puissance» (voir 1 Cor. 2:4).
En la montagne de Dieu
Tout est prêt maintenant et ainsi le chapitre se termine sur une scène magnifique, une scène qui doit avoir réjoui le cœur de Moïse et l’avoir, avec la bénédiction de Dieu, fortifié pour le rôle difficile qu’il va avoir à remplir. Mais d’abord l’Éternel envoie Aaron à la rencontre de Moïse, au désert en la montagne de Dieu. «Et Moïse raconta à Aaron toutes les paroles de l’Éternel qui l’avait envoyé, et tous les signes qu’il lui avait commandés» (v. 27, 28). Le lieu de leur rencontre est très significatif. C’est en la montagne de Dieu (3:1), c’est-à-dire en Horeb, que l’Éternel était apparu à Moïse; c’est là maintenant qu’Aaron rencontre Moïse et c’est là aussi que Moïse recevra plus tard les deux tables de pierre avec les dix commandements écrits du doigt de Dieu. Mais laissons ce sujet pour le moment et remarquons — car nous avons là une leçon très pratique — qu’il est toujours extrêmement précieux pour des membres d’une même famille de pouvoir se retrouver en la montagne de Dieu. Comme pour Moïse et Aaron, «les paroles de l’Éternel» seront alors le sujet de la conversation, et la rencontre sera accompagnée de bénédiction. D’un autre côté, si nous descendons à un niveau inférieur, comme cela arrive trop souvent, nous serons davantage occupés de nous-mêmes, de ce que nous faisons, et cela ne tournera ni à la gloire de Dieu ni à notre profit.
Remarquons aussi que c’est de la montagne de Dieu qu’ils partent pour leur mission. Bienheureux les serviteurs qui passent directement de la présence de Dieu à leurs travaux. Arrivés en Égypte, «ils allèrent, et assemblèrent tous les anciens des fils d’Israël; et Aaron dit toutes les paroles que l’Éternel avait dites à Moïse et fit les signes devant les yeux du peuple. Et le peuple crut; et ils apprirent que l’Éternel avait visité les fils d’Israël, et qu’il avait vu leur affliction; et ils s’inclinèrent et se prosternèrent» (v. 29-31). La parole de l’Éternel trouvait ainsi son accomplissement. Moïse avait dit: «Ils ne me croiront pas, et n’écouteront pas ma voix». Mais, selon la parole de l’Éternel, le peuple crut; et, en entendant comment il les avait visités et avait vu leur affliction, touchés par sa grâce, ils s’inclinèrent et se prosternèrent. Il est vrai que plus tard, lorsque les difficultés augmentèrent, ils murmurèrent dans leur incrédulité; mais cela n’enlève rien à la beauté de la scène placée devant nous, où nous voyons la parole de l’Éternel dans toute sa fraîcheur et toute sa puissance toucher le cœur des anciens et les amener à s’incliner et à adorer dans sa présence.
Chapitre 5
4. Exode 5 et 6 — Le premier message au Pharaon
4.1. Jour de grâce pour le Pharaon
Ces deux chapitres occupent une place particulière dans le récit. Ils constituent une sorte de préface, pour introduire les jugements qui constitueront la controverse de l’Éternel avec le Pharaon. Ils sont également très intéressants en ce qu’ils illustrent les manières d’agir de Dieu. Le message est présenté en grâce, l’occasion d’obéir est offerte — Dieu use de patience et de support avant de lever la main pour châtier. Il en va de même pour le monde aujourd’hui. C’est le jour de la patience et de la grâce de Dieu, où le message de sa grâce est proclamé au loin; quiconque veut peut écouter, croire et être sauvé. Mais ce jour de grâce va bientôt prendre fin; et au moment où le Seigneur se lèvera de sa place à la droite du Père, la porte sera fermée et les jugements commenceront à s’abattre sur le monde. Ces deux chapitres décrivent, pour ainsi dire, le jour de grâce pour le Pharaon. D’un autre côté, si le roi d’Égypte était bien un homme, il était également, dans la position qu’il occupait — nous l’avons déjà indiqué — un type de Satan, comme le dieu de ce monde. Sous ce rapport, il y a donc d’autres instructions à retirer de ces chapitres; et c’est en fait cet aspect qui occupe la place principale. Nous le verrons au cours de notre étude.
4.2. Ch. 4:1-5
Souvenons-nous qu’il s’agit de la rédemption d’Israël; par conséquent, le peuple ne pouvait y avoir aucun rôle. Dieu doit agir pour les enfants d’Israël; c’est donc lui qui va avoir une controverse avec le Pharaon. Celui-ci, type de Satan le dieu de ce monde, tient le peuple dans l’esclavage. Le but de Dieu est de l’en délivrer; aussi le message confié à Moïse s’adresse-t-il au roi d’Égypte. Et pourquoi Dieu veut-il libérer Israël? «Afin qu’il me célèbre une fête dans le désert». C’est pour sa propre joie, sa joie dans celle de ses rachetés. C’est pour la satisfaction de son cœur! Quelle pensée admirable: la joie de Dieu est en jeu dans notre salut!
Le message délivré met en évidence le vrai caractère du Pharaon. «Qui est l’Éternel pour que j’écoute sa voix et que je laisse aller Israël? Je ne connais pas l’Éternel, et je ne laisserai pas non plus aller Israël». Il s’oppose ainsi directement et absolument à Dieu. Position solennelle! Et jamais cet antagonisme n’a diminué; au contraire il s’est renforcé jusqu’au moment où il a été brisé par la défaite et la destruction du Pharaon et de ses armées. Voilà certes un avertissement pour ceux qui ne sont pas réconciliés avec Dieu, et aussi une révélation de la corruption terrible de la nature humaine qui ose se dresser de manière impie contre la puissance de Dieu et la défier audacieusement.
4.3. La colère du roi
Il ne s’agissait pas de l’expression passagère d’un esprit irrité. Car en réponse aux appels réitérés de Moïse et d’Aaron, il les accuse d’entraver le travail du peuple. Le dieu de ce monde est l’incarnation de l’égoïsme; il ne peut donc que haïr Dieu. Nous en avons un exemple à Philippes. Dès le moment où, par sa prédication et son intervention, l’apôtre touche au gain des maîtres de la servante possédée d’un esprit de python, il attire leur inimitié féroce sur lui-même et sur son compagnon. Il en va de même pour le Pharaon. La perspective d’être privé du service de ses esclaves enflamme sa colère. Il augmente alors les tâches du peuple, faisant peser un fardeau plus lourd sur eux, afin de renforcer encore leur esclavage. C’est ce qui se produit toujours. Mais malgré sa puissance et sa subtilité, Satan est immanquablement perdant. En fait, il est incapable de rien prévoir. Il ne peut pas voir dans l’avenir davantage que nous, et par conséquent, il ne fait que se tromper. Les Israélites sont paresseux, dit le Pharaon, «c’est pourquoi ils crient, disant: Allons, et sacrifions à notre Dieu» (v. 8). Il commande alors qu’un service plus dur leur soit imposé pour chasser de telles pensées de leur esprit. Ah! Satan remuera ciel et terre pour empêcher un seul de ses misérables esclaves de se soustraire à son service. Aussi lorsqu’une âme est convaincue de péché et commence à soupirer après la liberté et la paix avec Dieu, cherchant à sortir d’Égypte et à être sauvée, Satan l’environnera de tous les pièges, de toutes les séductions et de toutes les entraves possibles. Comme le Pharaon l’a fait avec les enfants d’Israël, il essaiera d’extirper de l’esprit toutes les aspirations de ce genre, par un surcroît d’occupations et un tourbillon d’agitation ou d’activité. Si un de mes lecteurs devait se trouver dans cet état, qu’il prenne garde à ces ruses du Méchant et qu’il tourne résolument le dos à tous ces artifices dont le seul but est de le précipiter dans la destruction. Ah! plutôt, que dans la conscience de ses grands besoins et de sa misère absolue, il lève ses regards vers Celui qui, par la mort, a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable et qui délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient pendant toute leur vie assujettis à la servitude (Héb. 2:14, 15)! En croyant au Seigneur Jésus, ils passeront alors des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu.
4.4. L’oppression s’accentue
Les officiers du Pharaon obéirent et s’acquittèrent impitoyablement de leur devoir (v. 10-14). Le fer de l’oppression pénétra dans l’âme des enfants d’Israël. Dans l’amertume de leur esprit, ils «crièrent au Pharaon, disant: Pourquoi fais-tu ainsi à tes serviteurs?...» (v. 15-18). Mais en vain; car Satan ignore la pitié, lui qui se réjouit même des peines de ses propres esclaves. Déçus de ne pas trouver de soulagement auprès du Pharaon, ils déchargent leur colère sur Moïse et Aaron, les accusant d’être à l’origine du durcissement de leur servitude. «Que l’Éternel vous regarde, et qu’il juge; car vous nous avez mis en mauvaise odeur auprès du Pharaon et auprès de ses serviteurs, de manière à leur mettre une épée à la main pour nous tuer» (v. 21). L’expérience individuelle confirme la vérité de ces paroles. C’est celle du pécheur dont la conscience a été réveillée, dans les profonds exercices par lesquels il passe lorsqu’il est accablé par le sentiment de sa culpabilité, et qu’il éprouve en même temps toute l’animosité de Satan. N’est-il pas alors tenté de soupirer après le jour où il ne connaissait pas ces conflits et ces peines, incapable de voir qu’ils sont le chemin conduisant à la délivrance?
Sur le moment, même Moïse plie sous la tempête. Il est sensible à leurs reproches, lui qui souhaitait sans aucun doute ardemment le bien-être et la rédemption de son peuple, et il se sent envahi par le doute devant cette nouvelle phase de la politique du Pharaon. Perdant patience, il s’écrie: «Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi donc m’as-tu envoyé? Depuis que je suis entré vers le Pharaon pour parler en ton nom, il a fait du mal à ce peuple, et tu n’as pas du tout délivré ton peuple» (v. 22, 23). Moïse éprouvait donc la même déception et la même impatience que le peuple. Il n’avait pas encore appris à marcher par la foi, non par la vue, ni à se reposer sur l’Éternel et à s’attendre patiemment à Lui. Pourtant, sa défaillance résultait aussi de sa sympathie pour les Israélites opprimés; or l’une des premières qualités nécessaires pour aider les autres est bien de s’identifier avec leur situation.
Dans cette mesure, Moïse était en communion avec la pensée de l’Éternel qui comprenait les sentiments de son serviteur. Aussi l’envoie-t-il une nouvelle fois, et lui confirme-t-il ses desseins de grâce et de bonté, lui révélant sa fidélité immuable à son alliance. Il avait déjà accompli deux choses: il avait enseigné tant à Moïse qu’au peuple le caractère de leur oppresseur et la nature de leur joug. Il les avait livrés apparemment en la main du Pharaon et avait produit par là en eux la conviction de leur condition désespérée. C’est toujours ainsi qu’il procède. Jamais il ne se présente comme le Sauveur avant que les hommes reconnaissent leur état de culpabilité et de perdition. Le Seigneur Jésus a dit: «Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance». Dès que l’homme est prêt à admettre qu’il est perdu, le Sauveur se présente à son âme.
C’est ce que nous avons ici. Le cas des enfants d’Israël paraît pire qu’auparavant; ils sont désespérés, et Moïse l’est aussi. Alors nous avons la présentation et la révélation bénies du chapitre 6. Dans le chapitre 5, l’Éternel faisait seulement passer son peuple par une discipline nécessaire. Et cela, pour deux raisons: séparer son peuple des Égyptiens, produire entre eux une brèche irrémédiable; et ouvrir le chemin à la manifestation de sa propre puissance, afin que les enfants d’Israël sachent que seule sa main pouvait les faire sortir du pays d’Égypte. Il déclare d’abord que, contraint par Sa main, le Pharaon les chassera de son pays (v. 1). Puis nous avons une révélation de toute importance: «Et Dieu parla à Moïse, et lui dit: Je suis l’Éternel (Jéhovah). Je suis apparu à Abraham, à Isaac, et à Jacob, comme le Dieu Tout-puissant; mais je n’ai pas été connu d’eux par mon nom d’Éternel (Jéhovah)» (v. 2, 3).
Chapitre 6
4.5. Nouvelles promesses
Cela ne signifie nullement que le nom Éternel n’était pas employé auparavant; au contraire, on le trouve souvent. Mais Dieu ne l’avait encore jamais pris en relation avec ses serviteurs. Il l’adopte maintenant formellement comme son nom de relation avec Israël, et avec Israël seul. Les croyants de la dispensation actuelle connaissent Dieu comme leur Père; et pour eux, utiliser le nom d’Éternel dénoterait à la fois l’ignorance de leur position et de leur relation véritables, et la confusion des dispensations. L’emploi de ce nom est réservé à Israël, et par conséquent, il sera employé à nouveau lorsque le peuple sera ramené à la connaissance de sa relation avec Dieu dans le millénium. Que l’Éternel de l’Ancien Testament soit le Jésus du Nouveau Testament est une tout autre question, une question d’une portée et d’une importance immenses. Il était réellement l’Éternel au milieu d’Israël, et comme tel, il pardonnait leurs iniquités et guérissait leurs infirmités (Ps. 103:3); mais pour les chrétiens, jamais il n’est l’Éternel. Il s’est plu à les introduire dans une relation plus intime; il l’a révélé par ces paroles à Marie, et par elle à ses disciples: «Va vers mes frères, et dis-leur: Je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu» (Jean 20:17).
Après être entré formellement en relation avec les enfants d’Israël, il rappelle les termes de l’alliance qu’il avait établie avec leurs pères (v. 4; comparer Gen. 17:7, 8); puis il indique expressément que c’est en vertu de son alliance (car il est fidèle) qu’il a «entendu le gémissement des fils d’Israël, que les Égyptiens font servir» (v. 5). C’est sur cette base qu’il délivrera; autrement dit, en vertu de ce qu’il est pour eux dans l’alliance faite avec leurs pères. Et le message qu’il donne maintenant est alors très complet et étendu; il embrasse tout son propos pour la nation. La première des choses qu’il révèle, c’est le nom que Dieu a pris, l’Éternel: «Je suis l’Éternel»; il annonce la rédemption: ils seront délivrés et rachetés; ils seront mis en relation avec lui. Ils seront son peuple et lui sera leur Dieu; ils le connaîtront comme leur rédempteur, comme l’Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir de dessous les fardeaux des Égyptiens, et ils seront introduits dans le pays qu’il a juré de donner à Abraham, à Isaac, et à Jacob, et qui deviendra leur possession. Tout dépend de ce qu’Il est, le message se concluant par la répétition de la déclaration: «Je suis l’Éternel». Il est ainsi à la fois le Oui et l’Amen, l’Alpha et l’Oméga de leur rédemption. Un message de toute beauté! Tout est fondé sur ce qu’Il est en lui-même et tout est accompli par ce qu’Il est en lui-même. Par conséquent, tout ce qu’Il est garantit le commencement et aussi l’accomplissement de la rédemption de son peuple.
4.6. Échec apparent
Moïse transmet aux enfants d’Israël le message qu’il vient de recevoir, «mais ils n’écoutèrent pas Moïse, à cause de leur angoisse d’esprit, et à cause de leur dure servitude» (v. 9). Réduits au désespoir le plus complet, l’âme accablée par leur misère, ils sont sourds à la voix pleine de grâce qui proclame la liberté et la bénédiction. Moïse est alors renvoyé auprès du Pharaon pour demander la liberté du peuple; mais déçu de l’échec de sa mission auprès des Israélites, il répond: «Voici, les fils d’Israël ne m’ont point écouté; et comment le Pharaon m’écoutera-t-il, moi qui suis incirconcis de lèvres?» (v. 12). Tout a échoué! Le Pharaon a rejeté la requête de l’Éternel; les enfants d’Israël, accablés par le poids de leur joug, ne veulent pas écouter la bonne nouvelle de la grâce, et Moïse n’est pas disposé à aller de l’avant; il répète en effet son objection d’autrefois, manifestant que tout en étant conscient de son incompétence naturelle, il n’avait pas encore appris que sa capacité devait être recherchée dans l’Éternel. Mesurer les difficultés du service par ce que nous sommes est toujours une erreur fatale. Il s’agit de ce que Dieu est; et les difficultés qui paraissent comme des montagnes émergeant des brumes de notre incrédulité ne sont pour Lui que l’occasion de manifester sa toute-puissance.
Cette partie se termine apparemment par un échec total. Mais l’Éternel ne se laisse pas arrêter par la faiblesse ou la résistance humaines; ses desseins, issus de son propre cœur et accomplis par sa propre puissance, sont immuables. Aussi pouvons-nous nous pencher avec admiration sur ce qui nous est rapporté au verset 13. «Et l’Éternel parla à Moïse et à Aaron, et leur donna des ordres pour les fils d’Israël, et pour le Pharaon, roi d’Égypte, pour faire sortir les fils d’Israël du pays d’Égypte». Nullement arrêté par la surdité de ses enfants, la défaillance de son serviteur ou l’opposition ouverte du Pharaon, il entreprend calmement d’opérer la rédemption de son peuple.
4.7. La mission de Moïse et d’Aaron
On remarquera que les versets 13 à 30 constituent une parenthèse. Elle peut être justifiée par deux raisons. Elle marque d’abord un nouveau point de départ. Comme nous l’avons expliqué, le chapitre 5 et la première partie du chapitre 6 sont préliminaires, une sorte de préface. D’une part la période qu’ils embrassent est comme un jour de grâce pour le Pharaon, considéré simplement comme un homme; d’autre part elle met en lumière le caractère véritable du conflit dans lequel l’Éternel allait entrer et révèle la position et la condition exactes de chacune des parties concernées: le Pharaon, les enfants d’Israël et Moïse. En même temps les bases sur lesquelles l’Éternel allait agir pour son peuple sont posées solidement et profondément dans son caractère et son alliance.
Une fois cette période écoulée, l’Éternel repart à zéro, d’où la répétition du mandat confié à Moïse et à Aaron, avec l’objet et le but de leur mission. Cela permet en second lieu d’introduire la généalogie du peuple qui devait être délivré. Pour nous, l’intérêt réside dans la lignée de Moïse et d’Aaron. «Et Amram prit pour femme Jokébed, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse» (v. 20). «C’est là cet Aaron et ce Moïse auxquels l’Éternel dit: Faites sortir les fils d’Israël du pays d’Égypte, selon leurs armées. Ce sont eux qui parlèrent au Pharaon, roi d’Égypte, pour faire sortir d’Égypte les fils d’Israël: c’est ce Moïse, et cet Aaron» (v. 26, 27). Aaron était donc l’aîné, et il est intéressant de remarquer que les pieux parents, Amram et Jokébed ont été bénis en gardant en vie leurs deux enfants en dépit de l’édit du roi. Quant à la nature, Aaron avait la priorité sur Moïse; mais la grâce ne suit jamais l’ordre de la nature. Elle reconnaît toutes les relations naturelles que Dieu a formées, et là où cette vérité n’est pas fermement maintenue, il ne peut y avoir que difficultés lorsqu’il n’y a pas déshonneur. Mais la grâce étant tout à fait au-dessus et en dehors de la nature, elle agit dans sa propre sphère et selon ses propres lois. Aussi Dieu, dans l’exercice de ses droits souverains, choisit Moïse et non Aaron, même si par suite du manquement de Moïse et en ayant égard avec douceur à sa faiblesse, il lui associe plus tard son frère dans son œuvre. L’ordre divin reste toutefois Moïse et Aaron, tandis que selon l’ordre naturel, c’est Aaron et Moïse, comme nous l’indiquent la généalogie et le verset 26.
Les trois derniers versets ne font que relier le récit au verset 10. En effet, l’objection de Moïse au verset 30 est bien évidemment la même que celle du verset 12. Et pourtant, il y a une raison à cette répétition. Dans les chapitres 3 et 4, Moïse soulève cinq objections dans sa réponse à l’Éternel; ici, au chapitre 6, il y en a deux, donc sept au total. On peut y voir la manifestation parfaite de la faiblesse et de l’incrédulité de Moïse. Combien cela fait ressortir la grâce et la bonté de l’Éternel; car si, dans sa présence, l’homme est mis à nu, ce qu’il est Lui dans toute la perfection de sa grâce, de son amour, de sa bonté et de sa vérité est également révélé. Que son nom soit béni!
Chapitres 7 à 11
5. Exode 7 à 11 — Les jugements sur l’Égypte
Ces chapitres ne peuvent pas être séparés: ils forment un tout — un récit tristement significatif, puisqu’il contient l’énumération des jugements successifs, et de plus en plus sévères, qui se sont abattus sur l’Égypte, jusqu’au moment où par leur moyen Dieu contraignit le Pharaon de libérer les enfants d’Israël du dur esclavage auquel ils avaient été soumis. Aussi avons-nous d’abord la répétition de la mission de Moïse et d’Aaron, du but de l’Éternel et de la manière dont il accomplirait la rédemption de son peuple, malgré l’opposition du Pharaon.
5.1. Ch. 7:1-6 — Avertissement
L’Éternel communiquait ainsi à ses serviteurs ce qu’il allait faire, et comment il le ferait. Il déroule devant leurs yeux le rouleau de l’avenir, afin de les préparer à leur tâche et de fortifier leur foi. De la même manière, il nous a révélé le cours de l’histoire de ce monde, et nous a avertis des jugements à venir, de la destruction certaine du monde et de tous ceux qui en font partie, à moins qu’ils ne prennent garde aux avertissements de sa Parole et aux invitations de sa grâce. En même temps il nous encourage par la sûre perspective d’en être délivrés par sa puissance, lorsque le Seigneur reviendra pour prendre les siens auprès de lui. Son désir pour Moïse et pour Aaron, comme pour nous aussi, était qu’ils entrent dans ses propres desseins d’une part à l’égard du monde et de son dieu, d’autre part à l’égard de ses pauvres et misérables esclaves. Quel réconfort pour le cœur, quel soutien pour l’âme, dans la communion avec les pensées de Dieu! Quelle grâce de sa part de nous les communiquer, afin que nous puissions les transmettre à d’autres avec autorité et puissance!
Avant de nous pencher sur ces chapitres, nous nous arrêterons sur un point qui souvent cause des difficultés au croyant et suscite les attaques de l’Ennemi. Il s’agit de ces paroles: «Et moi, j’endurcirai le cœur du Pharaon» (chap. 7:3). Satan ne manque pas d’insinuer le doute suivant: Quel était le péché du Pharaon, si son cœur était endurci par Dieu? Ou: Comment Dieu peut-il être juste s’il détruit un homme que lui-même a endurci pour qu’il lui résiste? Si l’on avait étudié avec soin l’endroit où ces mots sont rapportés, le problème aurait disparu. Mais, en fait, il est tellement courant de citer des versets de l’Écriture isolément, qu’on crée des difficultés qui seraient résolues en un instant si l’on examinait soigneusement le contexte. Remarquons donc que cela est dit du Pharaon seulement après qu’il a rejeté avec mépris les droits de l’Éternel. Il avait dit: «Qui est l’Éternel pour que j’écoute sa voix et que je laisse aller Israël? Je ne connais pas l’Éternel, et je ne laisserai pas non plus aller Israël» (chap. 5:2). Il a rejeté la parole de l’Éternel, s’est opposé ouvertement à Lui et à son peuple; et alors son cœur est endurci judiciairement. Maintenant encore Dieu agit selon le même principe. C’est ainsi que nous lisons dans la seconde épître aux Thessaloniciens qu’il enverra sur certains une énergie d’erreur pour qu’ils croient au mensonge. Mais pourquoi? Parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. (2 Thess. 2:9-11). Puisse cet avertissement pénétrer profondément dans le cœur de ceux qui ne seraient pas convertis et dont les yeux tomberaient sur ces pages! S’ils persistent à refuser l’évangile de la grâce de Dieu, il y aura pour eux aussi un temps où il leur deviendra impossible d’obtenir le salut. Dieu a fixé une limite à son jour de grâce, comme il en avait mis une pour le Pharaon; une fois cette limite dépassée, il ne reste plus que le jugement. C’est pourquoi, «aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos cœurs» (Héb. 3:15).
Il y a cependant une pause. Moïse et Aaron vont auprès du Pharaon et présentent leur requête, attestée par un miracle: le signe que l’Éternel avait enseigné à Moïse à Horeb. «Aaron jeta sa verge devant le Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent» (chap. 7:10). Les sages d’Égypte, les magiciens, l’imitent avec leurs verges; mais «la verge d’Aaron engloutit leurs verges» (v. 12), l’Éternel accréditant ainsi la mission de ses serviteurs. Pourtant, comme Il l’avait prédit, le Pharaon n’est pas convaincu; «le cœur du Pharaon s’endurcit, et il ne les écouta point, comme avait dit l’Éternel» (v. 13). Dieu entre alors lui-même en scène, et une succession de jugements terribles s’abat sur le Pharaon et son pays, des jugements connus aujourd’hui encore comme «les plaies d’Égypte». Il y en a dix. D’abord, les eaux du Nil sont changées en sang (chap. 7:14-25); puis il y a les plaies des grenouilles (chap.8:1-15), des moustiques (chap.8:16-19), des mouches venimeuses (chap. 8:20-32), de la peste des troupeaux (chap. 9:1-7), des ulcères (chap. 9:8-12), des tonnerres et de la grêle (chap. 9:18-35), des sauterelles (chap. 10:1-20), des ténèbres (chap. 10:21-29), et finalement, celle de la mort du premier-né de l’homme et de la bête (chap. 11; 12). Le psalmiste les mentionne plus d’une fois dans un langage imagé lorsqu’il célèbre les œuvres puissantes de l’Éternel dans un cantique, décrivant comment «il mit ses signes en Égypte, et ses prodiges dans les campagnes de Tsoan» (Ps. 78:43; voir aussi Ps. 105:26-36).
5.2. Plaies sur l’Égypte
Il serait difficile, sinon impossible, de donner une interprétation détaillée de ces différentes plaies. Si nous gardons en mémoire le caractère de la controverse que Dieu avait avec le Pharaon, leur but général est clair. Il avait affaire avec le Pharaon en tant qu’oppresseur de son peuple, comme étant en figure le dieu de ce monde; aussi était-il en conflit avec le Pharaon et tout ce en quoi celui-ci se confiait. C’est la raison pour laquelle nous lisons qu’Il a exécuté des jugements sur les dieux de l’Égypte (Ex. 12:12; Nomb. 33:4). Nous avons donc ici la manifestation éclatante de la puissance victorieuse de Dieu dans la forteresse de Satan; car si Satan entre en conflit avec Dieu, il n’y a qu’une seule issue possible: sa défaite totale. Ainsi, premièrement, les eaux de l’Égypte, surtout celles du Nil sacré, source de vie et de rafraîchissement pour l’Égypte et son peuple, du monarque au plus humble de ses sujets, sont changées en sang, le symbole de la mort et du jugement. Il s’ensuit que «le poisson qui était dans le fleuve mourut; et le fleuve devint puant, et les Égyptiens ne pouvaient boire de l’eau du fleuve; et il y avait du sang dans tout le pays d’Égypte» (chap. 7:21). Ainsi le fleuve dont ils se glorifiaient hautement comme étant un emblème de Dieu, devint un objet de dégoût et de rejet.
La plaie des grenouilles vient ensuite. La grenouille était vénérée par les Égyptiens; elle était au nombre de leurs animaux sacrés. Sous la main judiciaire de Dieu, les grenouilles «montèrent, et couvrirent le pays d’Égypte». Elles devaient même entrer dans la maison du Pharaon, dans la chambre où il couchait, sur son lit, dans la maison de ses serviteurs, et parmi son peuple, dans les fours et dans les huches (chap. 8:3-6). L’objet de leur vénération est transformé en peste — un sujet d’horreur et d’exécration; et sur le moment, le Pharaon est tellement accablé qu’il est contraint d’implorer un répit (v. 8).
Le coup suivant est d’une autre nature; il est dirigé davantage contre la personne même des Égyptiens. Il s’agit de la plaie des moustiques. Les historiens tant anciens que modernes attestent de la propreté scrupuleuse des Égyptiens. Herodote (II, 37) rapporte que les prêtres étaient consciencieux à cet égard jusqu’au point de se raser la tête et le corps tous les trois jours par crainte de la vermine, dans l’exercice de leurs fonctions sacrées. Cette plaie allait donc abattre leur orgueil et ternir leur gloire, faisant d’eux-mêmes des objets de mépris et de dégoût. Viennent ensuite les mouches venimeuses (chap. 8:20-32). Il est pratiquement impossible d’établir avec précision la signification du mot traduit par «mouches»; plusieurs soutiennent qu’il s’agit de scarabées. Quoi qu’il en soit, par l’effet produit, la plaie témoigne d’une sévérité croissante. C’est également en relation avec elle que, pour la première fois, une division formelle est établie entre les enfants d’Israël et les Égyptiens (v. 22, 23).
Ensuite, l’Éternel se tourne vers le bétail: il envoie une mauvaise peste, «et tous les troupeaux des Égyptiens moururent; mais des troupeaux des fils d’Israël, il n’en mourut pas une bête» (chap. 9:6). Le Pharaon vérifie par lui-même l’étendue de la destruction (v. 7); mais son cœur demeure endurci. Ce coup frappait une des sources de la richesse et de la prospérité de l’Égypte. Les souffrances physiques, tant pour l’homme que pour la bête, suivent; elles sont dues à «un ulcère faisant éruption en pustules, dans tout le pays d’Égypte» (v. 9).
5.3. Dernières plaies
La plaie qui succède à celle-ci est l’anéantissement par la grêle et les tonnerres de tout ce qui croît dans les champs. Puis viennent les sauterelles; elles «montèrent sur tout le pays d’Égypte, et se posèrent dans tous les confins de l’Égypte, un fléau terrible; avant elles il n’y avait point eu de sauterelles semblables, et après elles il n’y en aura point de pareilles. Et elles couvrirent la face de tout le pays, et le pays fut obscurci; et elles mangèrent toute l’herbe de la terre, et tout le fruit des arbres que la grêle avait laissé; et il ne demeura de reste aucune verdure aux arbres, ni à l’herbe des champs, dans tout le pays d’Égypte» (chap. 10:14, 15). Ce coup s’abattait sur les ressources nécessaires aux besoins physiques.
Sur la requête du roi d’Égypte, les sauterelles disparaissent; mais son cœur étant toujours endurci, il y a maintenant «d’épaisses ténèbres dans tout le pays d’Égypte, trois jours. On ne se voyait pas l’un l’autre, et nul ne se leva du lieu où il était pendant trois jours; mais pour tous les fils d’Israël il y eut de la lumière dans leurs habitations» (v. 22, 23). «En Égypte, le soleil était vénéré sous le nom de Rê ou Ra: cela paraît visiblement dans le titre des rois, Pharaon, ou plutôt Phra, signifiant le soleil». Ainsi non seulement les Égyptiens avaient perdu la source de la lumière et de la chaleur; mais le Dieu qu’ils adoraient était obscurci — et son impuissance démontrée — une preuve, s’ils avaient été capables de la voir, que Celui qui est plus puissant que le soleil, le Créateur du soleil, s’occupait d’eux pour les juger.
La mort des premiers-nés est le coup final. Nous en parlerons lorsque nous arriverons au chapitre 12. Mais si nous considérons ces plaies dans leur ensemble, nous ne pouvons manquer d’être frappés par leur correspondance avec celles qui visiteront le monde dans un jour à venir, sous le règne de l’antichrist (voir Apoc. 16:1-14). En fait, le Pharaon est une image, et pas la moindre, de ce dernier adversaire de Dieu et de son Christ. Mais de même que Dieu a été glorifié dans sa controverse avec le premier, il le sera dans celle qu’il aura avec le second; car si le Pharaon s’est précipité au-devant de son jugement et a été englouti avec toutes ses armées dans les eaux de la mer Rouge, l’antichrist, s’élevant encore plus haut dans son impiété et son audace, avec «la bête» dont il a été le faux prophète, seront «jetés vifs dans l’étang de feu embrasé par le soufre» (Apoc. 19:20). Aussi le psalmiste pouvait bien s’écrier: «Baisez le Fils, de peur qu’il ne s’irrite, et que vous ne périssiez dans le chemin, quand sa colère s’embrasera tant soit peu» (Ps. 2:12). Il serait insensé en effet de rester sourd aux leçons proclamées si hautement par la controverse de Dieu avec le Pharaon. «La pensée de la chair est inimitié contre Dieu» (Rom. 8:7). Chaque inconverti se trouve ainsi en opposition ouverte contre Dieu — est en fait un ennemi de Dieu. Quelle grâce de multiplier comme il le fait ses messages d’amour, pour supplier par l’évangile les pécheurs d’être réconciliés avec lui! Il a livré son Fils unique à la mort et, sur le fondement de l’expiation du péché que celui-ci a accomplie par sa mort, il peut sauver avec justice quiconque croit. Mais «comment échapperons-nous, si nous négligeons un si grand salut» (Héb. 2:3), en refusant sa grâce. Quelle folie de la part du pécheur de demeurer un seul jour de plus dans son état de perdition, alors qu’il ignore le moment, peut-être tout proche, où il sera appelé à connaître un jugement aussi irrévocable que celui qui s’est abattu sur le roi d’Égypte!
Chapitres 7 à 11 (compléments)
5.4. Les devins
Il est également intéressant de s’arrêter un instant sur l’opposition des magiciens d’Égypte à la puissance miraculeuse de Moïse et d’Aaron dans la présence du Pharaon. Les noms des principaux d’entre eux sont mentionnés dans le Nouveau Testament. «Or de la même manière dont Jannès et Jambrès résistèrent à Moïse, ainsi aussi ceux-ci résistent à la vérité» (2 Tim. 3:8). Cette indication est très importante: elle montre qu’un principe des agissements de Satan est incarné dans la conduite des magiciens. On peut se demander alors: quel est donc leur caractère particulier? Il se résume en un mot: l’imitation. Ainsi, lorsque Aaron jeta sa verge et qu’elle devint un serpent, «eux aussi... firent ainsi par leurs enchantements: ils jetèrent chacun sa verge, et elles devinrent des serpents» (chap. 7:11, 12). Et lorsque les eaux d’Égypte furent frappées par la verge de Dieu et qu’elles furent changées en sang, «les devins d’Égypte firent de même par leurs enchantements» (v. 22). Dans le cas des grenouilles, également (chap. 8:7). Ils imitaient Moïse et Aaron. Dans l’épître à Timothée aussi, ceux dont il est dit qu’ils résistent à la vérité comme Jannès et Jambrès résistèrent à Moïse, sont décrits comme «ayant la forme de la piété, mais en ayant renié la puissance» (chap. 3:5). C’est un des pièges les plus subtils de Satan. S’il réussit à s’opposer ouvertement à la vérité, il ne se cachera pas; mais si ce genre d’antagonisme lui est fermé, il se transformera en ange de lumière. C’est ce qu’il fit aux jours de l’apôtre Paul; et c’est ce qu’il fait tout spécialement aujourd’hui. Les chrétiens de nom ne se laisseraient pas facilement entraîner par une manifestation évidente de la puissance satanique; mais combien d’entre eux sont séduits lorsque extérieurement elle est une imitation de la puissance divine. Il n’existe pas une seule opération de l’Esprit de Dieu, pas une seule forme de son travail, que Satan n’imite pas. Ses contrefaçons nous environnent de toute part, intérieurement et extérieurement. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a donné tout ce qu’il fallait pour être préservés et aussi pour détecter chaque phase de ses séductions. L’apôtre Jean dit: «Je vous ai écrit ces choses touchant ceux qui vous égarent; et, pour vous, l’onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n’avez pas besoin que personne vous enseigne; mais comme la même onction vous enseigne à l’égard de toutes choses, et qu’elle est vraie et n’est pas mensonge, — et selon qu’elle vous a enseignés, vous demeurerez en lui» (1 Jean 2:26, 27). L’Esprit et la parole de Dieu suffisent pour nous mettre à l’abri des simulations de la vérité les plus dangereuses que Satan puisse présenter à nos âmes.
Plus encore, s’il y a un attachement ferme à Dieu et à sa vérité, les agissements de Satan seront, le moment venu, mis à découvert. À trois reprises, ses instruments «résistent» à Moïse. Mais lorsque survient la plaie des moustiques — lorsqu’il s’agit de produire la vie à partir de la poussière de la terre — les devins sont impuissants, et ils sont contraints de reconnaître: «C’est le doigt de Dieu» (chap. 8:18, 19). La vie appartient à Dieu. Lui seul en est la source; aussi les efforts de Satan sont-ils vains ici, et il n’est dès lors plus fait mention de tentatives de leur part d’intercepter la force des signes divins. Dans le chapitre suivant, nous lisons qu’ils «ne purent se tenir devant Moïse, à cause de l’ulcère» (chap. 9:11). Ils sont eux-mêmes frappés par la main punitive de Dieu. Nous pouvons donc rester confiants quels que soient les succès apparents momentanés du Méchant, car «le Dieu de paix brisera bientôt Satan sous vos pieds» (Rom. 16:20).
5.5. Un cœur endurci
L’examen de l’effet de ces plaies judiciaires sur l’esprit du Pharaon contribuera également à donner une vue plus complète de ces chapitres. Le châtiment des grenouilles produit une impression momentanée. «Le Pharaon appela Moïse et Aaron, et dit: Suppliez l’Éternel, afin qu’il retire les grenouilles de moi et de mon peuple; et je laisserai aller le peuple, et ils sacrifieront à l’Éternel» (chap. 8:8). Moïse répond à cette requête, et fixe le moment où il suppliera, afin que le Pharaon puisse reconnaître aussi sûrement la main de l’Éternel dans la réponse divine à sa demande que dans le jugement infligé. Qu’il est beau de considérer la patience et la grâce de Dieu envers le pécheur même le plus endurci! Au moindre mouvement du cœur vers Lui, et bien qu’Il sache que la réalité n’y est pas, Il est prêt à écouter — un témoignage frappant au fait qu’il ne veut pas la mort du pécheur, qu’il ne veut pas qu’aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance (2 Pierre 3:9). Aussi l’Éternel entendit; il «fit selon la parole de Moïse. Et les grenouilles moururent dans les maisons, dans les cours et dans les champs» (chap. 8:13). Mais quel fut le résultat? «Le Pharaon vit qu’il y avait du relâche, et il endurcit son cœur, et ne les écouta pas, comme avait dit l’Éternel» (v. 15).
Quelle image du cœur mauvais de l’homme! Courbé sous la main de Dieu, redoutant les conséquences, il implore la délivrance et promet de se conformer aux commandements divins si elle lui est accordée. Il obtient le soulagement et oublie aussitôt et ses craintes et ses promesses. De la même manière, plus d’un pécheur, amené aux portes de la mort par une maladie soudaine, a supplié pour obtenir miséricorde. Dieu a entendu sa prière et lui a rendu la santé. Mais au lieu de se consacrer alors au service de Dieu, comme il en avait eu l’intention, il retombe dans sa vie d’insouciance et de péché. Dans tous ces cas, la conscience n’a en fait jamais été réellement touchée; il n’y a pas eu de sentiment de culpabilité devant Dieu; son témoignage à l’état de perdition de l’homme n’a pas été reçu et, par conséquent, il n’y a pas eu le besoin de recourir à sa grâce en salut, révélée en Jésus Christ le Sauveur; les promesses faites n’étaient en réalité qu’une sorte d’offrande compensatoire pour obtenir que Dieu retire sa main.
Aussi, une fois le soulagement obtenu, et parce qu’il n’y a pas eu de changement, pas de conversion à Dieu, le courant de leur vie, dévié pendant un moment, retourne naturellement à ses canaux antérieurs. Oh! qu’ils sont nombreux à être dans ce cas! qu’ils sont nombreux ceux dont il peut être dit que, voyant qu’il y avait du répit, ils ont endurci leur cœur! Si ces lignes devaient tomber sous les regards de l’un d’eux, puissent-elles toucher profondément son cœur; et alors, si ses yeux étaient ouverts sur son état véritable, qu’il puisse pendant qu’il en est encore temps, confesser devant Dieu qu’il est un pécheur coupable et perdu, et se tourner vers le Seigneur Jésus Christ seul pour obtenir le salut. «Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, et de sa patience, et de sa longue attente, ne connaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais, selon ta dureté et selon ton cœur sans repentance, tu amasses pour toi-même la colère» (comme le Pharaon) «dans le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu» (Rom. 2:4, 5).
5.6. Pas de sacrifices dans le pays
La quatrième plaie, celle des mouches venimeuses, semble produire une impression plus profonde. «Le Pharaon appela Moïse et Aaron, et dit: Allez, sacrifiez à votre Dieu dans le pays». C’était une offre très subtile; Moïse et Aaron auraient facilement pu s’y laisser prendre s’ils n’avaient pas connu le caractère et la pensée de Dieu. Satan n’a pas d’objection à ce que ses serviteurs soient religieux, pourvu qu’ils demeurent sous sa domination. Qu’ils professent aussi haut qu’il leur plaît servir Dieu, pourvu qu’ils reconnaissent son autorité à lui. Comme dans la tentation qu’il a présentée au Seigneur dans le désert (Matt. 4), il leur accordera tous les désirs de leur cœur, si seulement ils se prosternent devant lui et lui rendent hommage. Qu’ils restent du monde, et le monde et son dieu les aimeront. Aussi Satan conseillera-t-il toujours de le servir lui et de servir Dieu; «sacrifiez à votre Dieu, mais restez dans le pays». Un verset de l’Écriture nous fournit la réponse à tous les raisonnements spécieux de ce genre: «Nul ne peut servir deux maîtres; car, ou il haïra l’un et aimera l’autre, ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre: vous ne pouvez servir Dieu et Mammon» (Matt. 6:24).
Moïse a le discernement véritable, parce qu’il a la pensée de Dieu; aussi perçoit-il le piège. Il répond: «Il n’est pas convenable de faire ainsi; car nous sacrifierions à l’Éternel, notre Dieu, l’abomination des Égyptiens. Est-ce que nous sacrifierions l’abomination des Égyptiens devant leurs yeux, sans qu’ils nous lapidassent! Nous irons le chemin de trois jours dans le désert, et nous sacrifierons à l’Éternel, notre Dieu, comme il nous a dit» (chap. 8:26, 27). Moïse voyait clair; il savait que Christ était et devait être un objet de mépris pour les Égyptiens [«aux Juifs occasion de chute, aux nations folie» (1 Cor. 1:23)] et qu’il doit y avoir antagonisme irréconciliable entre eux et Son peuple. «S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi» (Jean 15:20).
L’Égypte ne pouvait donc pas être un lieu convenable pour le peuple de Dieu. Moïse ajoute alors deux choses: d’abord, ils doivent aller le chemin de trois jours dans le désert. Le nombre trois est significatif dans ce contexte — le chemin de trois jours parle du temps que Jésus a passé dans la mort. (Comparer Nomb. 10:33). Ensuite ils doivent sacrifier à l’Éternel, leur Dieu, comme il leur a dit. Voilà certainement des principes importants et fondamentaux. Rien sinon la mort — la mort avec Christ — ne peut nous séparer de l’Égypte. L’apôtre Paul dit ainsi: «Qu’il ne m’arrive pas à moi de me glorifier, sinon en la croix de notre Seigneur Jésus Christ, par laquelle le monde [l’Égypte] m’est crucifié, et moi au monde [l’Égypte]» (Gal. 6:14). Aucun changement ni aucune réforme extérieurs ne nous feront sortir de la maison d’esclavage, rien sinon la croix — la mort de Christ, faite nôtre par la foi en son nom. Deuxièmement, il doit y avoir obéissance à l’Éternel. Nulle autre autorité que la sienne ne doit jamais être admise ni acceptée. L’obéissance est le premier devoir, et couvre tout le terrain de la responsabilité du croyant. D’où la nécessité d’une cassure totale avec le monde, d’une séparation (par la mort). Si Moïse avait consenti à rester en Égypte, il aurait reconnu le gouvernement du Pharaon, et cela aurait été incompatible avec les droits absolus et entiers de l’Éternel.
Ces deux principes, la séparation du monde et l’obéissance à Christ, devraient être gravés sur le cœur des enfants de Dieu. Car ils sont la base de leur position et de leur responsabilité véritables. Tout découle en fait de ces deux sources. Ces paroles de Moïse nous enseignent encore une chose. Dieu ne peut accepter de notre part aucun service ou prétendu service qui ne soit pas selon sa Parole, lorsque celle-ci est connue. L’adoration et le service doivent être dirigés par la pensée du Seigneur. Il ne s’agit donc pas de ce que nous estimons bon et pieux, ni de ce que nous pouvons appeler culte ou bonnes œuvres, mais de ce que Lui considère comme tel. La parole de Dieu est par conséquent pour nous le critère absolu; elle doit occuper la première place dans le cœur et dans la conscience du chrétien et diriger sa vie entière. Toute la corruption de la chrétienté, tous les manquements et la ruine de l’église, viennent de la négligence de ce principe vital. La parole de Dieu est la seule lampe à nos pieds, la seule lumière à notre sentier (Ps. 119:105). Dès le moment où un simple règlement humain est accepté, par un individu ou par l’église, le déclin et la corruption menacent; car une autre autorité est mise à côté de celle de Christ. La responsabilité nous incombe dès lors d’éprouver toute chose par la parole de Dieu. «Que celui qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux assemblées» (Apoc. 2:11, etc.).
5.7. La patience de Dieu
Le Pharaon ne rejette pas ouvertement la demande de Moïse; il temporise, fait l’hypocrite, pour obtenir le retrait de la plaie. Il s’écrie: «Priez pour moi» (chap. 8:28). Moïse accepte, mais pour montrer qu’il n’est pas dupe, il ajoute l’avertissement solennel: «Seulement, que le Pharaon ne continue pas à se moquer, en ne laissant pas aller le peuple pour sacrifier à l’Éternel» (v. 29). Pourtant une fois la plaie retirée, la constatation habituelle est répétée: «Et le Pharaon endurcit son cœur aussi cette fois, et ne laissa point aller le peuple» (v. 32). Un autre jugement s’abat alors; mais le Pharaon y est insensible. Du moins, il n’y a de sa part aucun signe extérieur de repentir. Il en résulte un message extrêmement solennel et, nous pouvons même dire terrible, en guise de préface au jugement suivant: la plaie des tonnerres et de la grêle (chap. 9:13-19). Le roi fléchit sous le coup et, de nouveau, supplie pour obtenir la délivrance. Il confesse même qu’il a péché, et que l’Éternel est juste... et il promet une nouvelle fois de laisser aller le peuple, pourvu que les tonnerres et la grêle effroyables cessent (v. 27, 28).
L’iniquité du Pharaon se trouve ainsi démontrée. Il voit et reconnaît sa culpabilité, et pourtant il persiste dans son opposition ouverte contre l’Éternel. Car malgré sa confession, à peine l’Éternel a-t-il répondu à la supplication de Moïse qu’il s’endurcit à nouveau. Mais chaque fois il nous est rappelé que Dieu n’en est pas surpris. Tout cela s’est passé «comme l’Éternel avait dit par Moïse» (v. 35). Il voit la fin dès le commencement; et cependant, sur l’intercession de Moïse en faveur du roi égyptien, il retire sa main. Dieu n’est jamais impatient, même en présence de la rébellion ouverte. Il attend son moment, supportant avec patience et avec grâce la méchanceté et l’impiété des hommes. S’il use d’un tel support, nous devrions certes apprendre nous aussi à être patients, nous attendant à lui, dans la confiance qu’en son propre temps il revendiquera son juste gouvernement devant les yeux du monde. «Demeure tranquille, appuyé sur l’Éternel, et attends-toi à lui» (Ps. 37:7).
En relation avec la menace des sauterelles, un fait nouveau se produit. Les serviteurs du Pharaon, inquiets, interviennent cette fois. Ils disent: «Jusques à quand celui-ci sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces hommes, et qu’ils servent l’Éternel, leur Dieu. Ne sais-tu pas encore que l’Égypte est ruinée?» (chap. 10:7). À leur requête, «on fit venir Moïse et Aaron vers le Pharaon; et il leur dit: Allez, servez l’Éternel, votre Dieu. Qui sont ceux qui iront?» (v. 8). Cela révèle une fois de plus le cœur mauvais de ce misérable roi. Sous la contrainte, il relâchera son étreinte, mais même alors, il retiendra tout ce qu’il peut. Il s’accroche avec ténacité à ce qu’il a; il y tient tellement qu’il essaiera de marchander avec Moïse au sujet de ceux qui iront. «Et Moïse dit: Nous irons avec nos jeunes gens et avec nos vieillards, nous irons avec nos fils et avec nos filles, avec notre menu bétail et avec notre gros bétail; car nous avons à célébrer une fête à l’Éternel. Et il leur dit: Que l’Éternel soit ainsi avec vous, comme je vous laisserai aller avec vos petits enfants! Regardez, car le mal est devant vous. Il n’en sera pas ainsi; allez donc, vous les hommes faits, et servez l’Éternel: car c’est là ce que vous avez désiré. Et on les chassa de devant la face du Pharaon» (v. 9-11). C’était une ruse adroite de ce roi qui représente Satan: consentir à laisser aller les hommes faits à condition qu’ils laissent leurs petits enfants derrière eux en Égypte. Il aurait par là falsifié le témoignage des rachetés de l’Éternel et exercé une emprise très forte sur eux par le biais de leurs affections naturelles. Car comment auraient-ils pu en avoir fini avec l’Égypte tant que leurs enfants y étaient? L’ennemi le savait bien, d’où le caractère subtil de cette tentation. Mais combien de chrétiens se laissent prendre dans ce piège! Ils professent appartenir au Seigneur, avoir quitté l’Égypte, et ils permettent à leur famille d’y rester. Comme un autre l’a dit: «Les parents au désert et les enfants en Égypte, quelle affreuse anomalie! Ce n’aurait été qu’une demi-délivrance, à la fois inutile pour Israël et déshonorante pour le Dieu d’Israël. Il n’était pas possible qu’il en fût ainsi. Si les enfants étaient restés en Égypte, on n’aurait pas pu dire des parents qu’ils avaient quitté l’Égypte, attendu que leurs enfants étaient une partie d’eux-mêmes. Tout ce qu’on aurait pu dire d’eux en pareil cas, c’est qu’ils servaient en partie l’Éternel et en partie le Pharaon. Mais l’Éternel ne pouvait avoir aucune part avec le Pharaon, il fallait qu’il eût tout ou rien. C’est ici un principe important pour des parents chrétiens... C’est notre heureux privilège de compter sur Dieu pour nos enfants et de les élever «dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur» (Éph. 6:4).
Ces paroles remarquables devraient être méditées avec sérieux dans la présence de Dieu. Car notre témoignage n’est nulle part aussi en danger de manquer que dans nos familles. Des parents pieux, ayant une marche irréprochable, sont parfois tentés de laisser leurs enfants faire des choses qu’eux-mêmes ne se permettraient sous aucun prétexte, introduisant ainsi dans leurs maisons les spectacles et les sons de l’Égypte. Tout vient de ce que, contrairement à Moïse, ils ne reconnaissent pas que les enfants, avec leurs parents, appartiennent à Dieu et constituent son peuple sur la terre; et que, par conséquent, les laisser dans le lieu dont, par la grâce de Dieu, eux-mêmes ont été délivrés par la mort et la résurrection de Christ, serait renier cette précieuse vérité. On ne saurait, par conséquent, trop insister sur le fait que la responsabilité des parents s’étend à la famille tout entière; ils sont tenus, devant Dieu, de considérer leurs enfants comme appartenant au Seigneur, sinon jamais ils ne pourront les élever dans la voie qu’ils devraient suivre, comptant sur Lui pour montrer qu’ils sont manifestement siens par l’œuvre de sa grâce et de son Esprit. Ces requêtes irritent le Pharaon, et Moïse et Aaron sont chassés de devant sa présence. Par la puissance de Dieu les sauterelles sont alors rassemblées et «elles couvrirent la face de tout le pays, et le pays fut obscurci» (v. 15). Accablé par ce coup terrible, le Pharaon convoque une nouvelle fois Moïse et Aaron, confesse son péché contre l’Éternel, leur Dieu, et contre eux-mêmes, implore le pardon et leur demande de supplier l’Éternel, leur Dieu «afin seulement» dit-il «qu’il retire de dessus moi cette mort-ci» (v. 16, 17). L’Éternel entend l’intercession de Moïse: les sauterelles sont enlevées et enfoncées dans la mer Rouge; «il ne resta pas une sauterelle dans tous les confins de l’Égypte» (v. 19).
5.8. Pas de compromis
Le Pharaon oublie aussitôt sa terreur et sa promesse; et d’épaisses ténèbres sont amenées sur le pays d’Égypte pendant trois jours (v. 22, 23). De nouveau, «le Pharaon appela Moïse, et dit: Allez, servez l’Éternel; seulement que votre menu et votre gros bétail restent; vos petits enfants aussi iront avec vous. Et Moïse dit: Tu nous donneras aussi dans nos mains des sacrifices et des holocaustes, et nous les offrirons à l’Éternel, notre Dieu; nos troupeaux aussi iront avec nous; il n’en restera pas un ongle, car nous en prendrons pour servir l’Éternel, notre Dieu; et nous ne savons pas comment nous servirons l’Éternel, jusqu’à ce que nous soyons parvenus là» (v. 24-26).
C’était pour servir l’Éternel qu’il fallait quitter l’Égypte. Par conséquent, Il ne revendiquait pas seulement le peuple comme étant sien, mais aussi tout ce qui lui appartenait. Et c’est pour cela que Moïse rejette le droit du Pharaon à quoi que ce soit. Agir différemment aurait été reconnaître son autorité. Le Pharaon était en fait l’ennemi du peuple de Dieu qu’il retenait en captivité, s’opposant à la volonté de Dieu. Et Moïse le traite comme tel en rejetant ses prétentions. D’ailleurs, ils sortaient pour sacrifier à l’Éternel leur Dieu et tant qu’ils étaient retenus en Égypte, ils ne savaient pas comment ils devaient le servir. Aussi ne pouvaient-ils en aucun cas se plier à l’exigence du Pharaon.
Les paroles de Moïse renferment un principe de toute importance, à savoir que, outre ses droits sur nous-mêmes, Dieu revendique tout ce que nous possédons. À cet effet, tout doit être mis à sa disposition. Il donne, et il redemande. Un très bel exemple nous en est présenté dans le cas de David, lorsqu’il prépare les matériaux pour le temple. «Ce qui vient de ta main, nous te le donnons» (1 Chron. 29:14). Comme peuple de Dieu, nous ne devons pas être redevables au monde, imitant Abraham qui refusa d’être enrichi par le roi de Sodome (Gen. 14:22, 23); nous ne devons pas davantage reconnaître les revendications du monde sur ce que l’Éternel nous a donné. Pas un ongle ne doit être laissé en arrière, car ce pourrait être cela précisément que l’Éternel demandera comme sacrifice. Il est aussi frappant de remarquer que, selon les paroles de Moïse, la pensée de l’Éternel ne pouvait pas être discernée en Égypte. Les Israélites devaient être rachetés hors d’Égypte, et séparés pour Dieu, par la mort et la résurrection, avant de pouvoir être instruits quant à la nature de son service. Bien que le Pharaon s’oppose à toutes les demandes qui lui sont faites pour le peuple de l’Éternel, nous le voyons temporiser par ses ruses; car la main de l’Éternel est levée en jugement, et s’abat sur le Pharaon et son pays par des coups successifs auxquels il voudrait bien échapper. Mais maintenant il est arrivé au point culminant de son entêtement et se précipite tête baissée vers sa ruine, malgré la grâce, les avertissements et les jugements. «Et l’Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et il ne voulut pas les laisser aller. Et le Pharaon lui dit: Va-t’en d’auprès de moi; garde-toi de revoir ma face! car, au jour où tu verras ma face, tu mourras. Et Moïse dit: Comme tu l’as dit, je ne reverrai plus ta face!» (v. 27-29).
5.9. Instructions pour le départ
L’Éternel se met alors à instruire Moïse en vue de leur sortie d’Égypte. «Je ferai venir encore une plaie sur le Pharaon et sur d’Égypte; après cela il vous laissera aller d’ici; lorsqu’il vous laissera aller complètement, il vous chassera tout à fait d’ici. Parle donc aux oreilles du peuple: Que chaque homme demande (voir la note à propos du verset 3:22) à son voisin, et chaque femme à sa voisine, des objets d’argent et des objets d’or. Et l’Éternel fit que le peuple trouva faveur aux yeux des Égyptiens; l’homme Moïse aussi était très grand dans le pays d’Égypte, aux yeux des serviteurs du Pharaon et aux yeux du peuple» (chap. 11:1-3).
Tout étant ainsi préparé, Moïse délivre son dernier message, un message très solennel et digne, en harmonie avec la majesté de Celui dont il était l’envoyé. Nous considérerons le contenu du message dans le chapitre suivant. Sa mission étant terminée, Moïse «sortit d’auprès du Pharaon dans une ardente colère» (v. 8). Il était maintenant en pleine communion avec la pensée de Dieu, rempli d’une sainte indignation contre le péché du Pharaon (comparer Marc 3:5). Toute sa timidité a disparu; il est là devant le roi, calme et sans crainte, conscient d’être investi de l’autorité de l’Éternel. Mais le Pharaon ne cédera pas; l’Éternel l’avait prédit et il le répète ici: «Le Pharaon ne vous écoutera point, afin de multiplier mes miracles dans le pays d’Égypte. Et Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant le Pharaon. Et l’Éternel endurcit le cœur du Pharaon , et il ne laissa point aller de son pays les fils d’Israël» (v. 9, 10).
Chapitre 12, versets 1 à 13
6. Exode 12 — L’agneau pascal
Nous pouvons rappeler deux points mentionnés dans le chapitre 11. D’abord, l’annonce du jugement des premiers-nés, puis la distinction établie «entre les Égyptiens et Israël» (chap. 11:4-7). L’agneau pascal concilie ces deux choses. Car Dieu soulève ici la question du péché, et alors nécessairement, il se présente sous le caractère de Juge. Mais dès ce moment, les Égyptiens aussi bien que les Israélites sont placés sous le jugement de Dieu, parce que les uns et les autres sont pécheurs à ses yeux. Il est vrai que son dessein était de délivrer Israël hors d’Égypte, et il est tout aussi vrai que dans l’exercice de ses droits souverains, il peut faire une différence. Mais Dieu ne peut jamais cesser d’être Dieu, et tous ses actes doivent être l’expression de ce qu’il est, dans tel ou tel de ses aspects ou caractères. Si donc il épargne Israël, un peuple tout aussi coupable que les Égyptiens, tandis qu’il détruit ceux-ci, il ne peut le faire qu’en harmonie avec sa propre nature. En d’autres termes, sa justice doit être manifestée autant dans le salut des uns que dans la destruction des autres. Et il est extrêmement important de comprendre que la grâce elle-même ne peut régner que par la justice (Rom. 5:21). C’est là le problème résolu dans ce chapitre: comment Dieu pouvait en justice épargner Israël, alors qu’il détruisait les premiers-nés d’Égypte. Il se présente à tous deux comme Juge; et on verra que cette différence se fonde non pas sur quelque supériorité morale d’Israël vis-à-vis de l’Égypte, mais uniquement sur le sang de l’agneau pascal. C’est la grâce qui avait fait l’alliance avec Abraham, Isaac et Jacob; c’est la grâce aussi qui fournit l’agneau; mais le sang de cet agneau, type de l’Agneau de Dieu, Christ notre pâque (1 Cor. 5:7), a répondu à toutes les exigences de Dieu à l’égard des Israélites à cause de leurs péchés. C’est pourquoi il pouvait en restant juste, les mettre à l’abri tandis que le destructeur apportait la mort dans tous les foyers des Égyptiens. C’était en vertu du sang de l’agneau que la grâce et la vérité pouvaient se rencontrer, la justice et la paix s’embrasser. Nous le verrons clairement au cours de l’étude de ce chapitre.
6.1. Le jugement des premiers-nés
6.1.1. Ch. 12:1-2
Aussi longtemps que le pécheur est dans ses péchés, le temps ne compte pas aux yeux de Dieu. Pour lui, nous n’avons pas commencé à vivre avant d’être à l’abri du sang de Christ. Il se peut que nous ayons vécu trente, quarante ou cinquante ans, mais si nous ne sommes pas nés de nouveau, ce n’est que du temps perdu. Perdu dans la mesure où cela concerne Dieu; mais, avec quels terribles résultats pour l’éternité si nous persistons dans cette condition! Chaque journée de cette période d’éloignement de Dieu a ajouté à notre culpabilité, au nombre de nos péchés, qui tous sont inscrits dans le livre qui sera ouvert au jugement du grand trône blanc, si nous devions passer inconvertis dans l’éternité. Quelle condamnation portée sur les efforts et les activités du monde, sur les espoirs et les ambitions des hommes! On nous parle de noblesse de vie; d’exploits glorieux et célèbres, et on cherche à insuffler à notre jeunesse le désir d’imiter ceux dont les noms sont inscrits dans l’histoire. Mais quand Dieu parle, il chasse l’illusion par une seule parole, en déclarant que de tels hommes n’ont pas encore commencé à vivre. Quelque grande qu’une vie puisse paraître aux yeux des hommes, celui qui n’a pas la vie de Dieu est mort à ses yeux, sa vraie histoire n’a pas encore commencé. Il en était ainsi des Israélites. Jusqu’à ce moment, ils avaient été les serviteurs du Pharaon, les esclaves de Satan; ils n’avaient pas encore commencé à servir l’Éternel; et ainsi, le mois de leur rédemption devait être pour eux le premier mois de l’année. L’histoire de leur vie véritable commençait là.
6.1.2. Ch. 12:3-20
Au milieu du jugement, Dieu se souvient de la miséricorde. Il va frapper les Égyptiens et ne peut pas sans être inconséquent avec ses propres attributs, épargner les Israélites à moins que ses exigences à leur égard ne soient pleinement et parfaitement satisfaites. Aussi agissant dans l’exercice de ses droits souverains, selon les richesses de sa grâce, Il se pourvoit de l’agneau dont le sang va être la base sur laquelle il pourra sauver en justice son peuple du jugement, et le faire sortir de la maison de son esclavage. Remarquez bien que lorsqu’il s’agit de notre salut, comme pour la rédemption d’Israël, il n’est pas question de ce que nous sommes, mais de ce que Dieu est. Tout est fondé sur la base immuable de son propre caractère; et ainsi, aussitôt l’expiation accomplie comme nous le verrons dans la suite du chapitre, tout ce que Dieu est constitue le garant de notre sécurité.
6.2. Un agneau
Plusieurs points, dans ce passage, demandent une remarque distincte et spéciale. D’abord l’agneau. Comme cela a déjà été mentionné, toute la valeur de cet agneau pascal réside dans le fait qu’il est un type, une figure de Christ. L’apôtre Paul dit: «Notre pâque, Christ, a été sacrifiée: c’est pourquoi célébrons la fête» (1 Cor. 5:7, 8). Nous sommes donc fondés d’autorité divine à voir l’Agneau de Dieu sous l’ombre de ce type remarquable; et c’est pour cette raison que chaque détail de ce chapitre présente un si grand intérêt. Au dixième jour du mois, il fallait prendre un agneau — mâle, âgé d’un an, et sans défaut — et il fallait le tenir en garde jusqu’au quatorzième jour de ce même mois. On dit généralement que le dixième jour correspondait à la mise à part de l’Agneau dans les plans de grâce de Dieu, et le quatorzième jour au sacrifice effectif dans le temps. Mais une autre suggestion a été faite; nous la présentons et la soumettons au jugement du lecteur. Selon cette dernière, le dixième jour correspondrait à l’entrée de Christ dans son ministère public, lorsque Jean le Baptiseur le désigne d’une façon très frappante comme «l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde» (Jean 1:29). Dès lors, si le ministère du Seigneur s’est étendu sur une période de trois ans, composés de deux années entières et de parties de deux autres, cela donnerait, selon la manière de compter des Juifs, quatre ans, et le moment de la mort du Seigneur correspondrait ainsi au quatorzième jour. Mais on peut demander pourquoi le nombre dix est choisi pour la mise à part de l’agneau? Peut-être parce que c’est le nombre de la responsabilité envers Dieu, et cela nous enseigne alors que, avant que notre Seigneur fût publiquement reconnu comme l’Agneau de Dieu, il avait répondu à toutes les exigences de Dieu, et avait ainsi été manifesté comme étant sans défaut, propre par ce qu’il était en lui-même à être le sacrifice pour le péché. Il était l’Agneau de Dieu, et le fait que l’agneau était fourni par Dieu est riche de consolations bénies. L’homme n’aurait jamais pu savoir quel sacrifice serait acceptable. Les Israélites seraient restés dans l’esclavage jusqu’à ce jour, s’ils avaient été laissés à eux-mêmes pour trouver un moyen de satisfaire aux exigences de Dieu quant à leurs péchés. Alors Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, a pourvu à un agneau dont le sang suffirait à ôter le péché du monde. Il ne peut donc y avoir aucun autre mode de purification du péché, aucune autre manière d’être à l’abri du juste jugement de Dieu: le sang de Christ, parce qu’il est donné de Dieu, est le seul moyen.
L’agneau devait être égorgé au quatorzième jour du mois. «Toute la congrégation de l’assemblée d’Israël l’égorgera entre les deux soirs» (v. 6). Tous doivent s’identifier à l’agneau égorgé. C’était pour toute la congrégation qu’il devait être tué. En fait, chaque maison avait son agneau, car chaque famille, à part, devait se placer sous sa protection; et d’un autre côté, «la congrégation de l’assemblée» est considérée comme un tout. Ces deux unités — celle de la congrégation et celle de la maison — ont toujours subsisté sous l’économie juive. Celle de la famille domine l’époque des patriarches, mais elle subsiste maintenant que Dieu appelle pour lui un peuple hors d’Égypte et qu’il établit l’unité de l’ensemble. Les deux sont réunies dans l’ordonnance de la pâque — les familles séparément, et l’assemblée comme un tout.
Chapitre 12, versets 1 à 13 (compléments)
6.3. À l’abri du sang
Nous trouvons ensuite la nécessité de l’aspersion du sang. Le seul fait d’avoir égorgé l’agneau n’aurait assuré la protection d’aucune maison. Si le peuple s’était reposé sur le fait que l’agneau avait été tué, le destructeur n’aurait rencontré aucun obstacle pour entrer dans les maisons. Il n’y aurait pas eu une seule maison, parmi toutes les tribus, qui n’aurait pas eu son mort, comme dans les maisons des Égyptiens. Non, ce n’était pas la mort de l’agneau, mais l’aspersion du sang qui assurait leur sécurité (v. 7, 13, 23). Que le lecteur y prenne bien garde! N’y a-t-il pas un danger à se reposer, pour être à l’abri, sur le fait que Christ est mort, sans se soucier de savoir si l’on est personnellement devant Dieu sous l’efficacité et la valeur bénies de cette mort? Ce n’est pas le seul fait de la mort de Christ, sans la foi en Lui, qui sauve une âme (nous ne parlons pas des petits enfants). Il est tout à fait vrai qu’il a fait propitiation pour le péché — une propitiation qui a glorifié Dieu dans tous les attributs de son caractère, et sur la base de laquelle il peut en justice, et à sa gloire, accorder un salut plein, complet et éternel à chaque pécheur qui s’approche de lui par la foi en sa valeur. Car Dieu a présenté Christ «pour propitiatoire, par la foi en son sang, afin de montrer sa justice à cause du support des péchés précédents dans la patience de Dieu, afin de montrer... sa justice dans le temps présent, en sorte qu’il soit juste et justifiant celui qui est de la foi de Jésus» (Rom. 3:25, 26). Mais il doit y avoir une identification personnelle, par la foi, avec le sang répandu; sinon, pour ce qui concerne un tel homme, il aura été versé en vain.
Considérons alors comment les Israélites se plaçaient sous la protection et la valeur de ce sang. C’était simplement et uniquement par l’obéissance de la foi. Il leur avait été dit de prendre du sang de l’agneau et d’en mettre sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte de leurs maisons; «vous prendrez un bouquet d’hysope, et vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin; et du sang qui sera dans le bassin, vous aspergerez le linteau et les deux poteaux; et nul d’entre vous ne sortira de la porte de sa maison, jusqu’au matin» (v. 7, 22). Ils n’avaient ainsi rien d’autre à faire qu’à croire et à obéir. Il ne leur appartenait pas de discuter la méthode qui leur était donnée, ni son caractère raisonnable ou non, ni sa valeur probable. Tout dépendait de leur obéissance à la parole de Dieu. De même, maintenant, Dieu ne demande rien du pécheur, sinon la foi — foi dans le témoignage de Dieu sur la condition et la culpabilité de l’homme, un état qui l’expose au jugement, et foi dans la ressource préparée par la mort de Christ. Si un Israélite, sous quelque prétexte que ce soit, avait méprisé le commandement divin, il n’aurait pas échappé aux coups du destructeur. Pareillement maintenant, si un pécheur refuse, pour quelque motif que ce soit, de s’incliner devant la parole de Dieu, quant à son propre état et aussi quant à Christ, rien ne pourra détourner de lui la sentence du jugement éternel. Mais dès le moment où l’Israélite, obéissant simplement, aspergeait de sang sa maison, il était dans une sécurité inviolable durant cette nuit de terreur et de mort. Dès le moment aussi où un pécheur reçoit Christ, il est à l’abri pour l’éternité, car il est sous la protection de la valeur infinie du sang précieux de Christ.
6.4. La sécurité du peuple
Remarquons aussi, pour souligner davantage encore cette vérité, que la sécurité du peuple ne dépendait nullement de son propre état moral, ni de ses pensées, de ses sentiments ou de ses expériences. La seule question était: le sang avait-il été mis sur la porte comme cela avait été prescrit? S’il l’avait été, les Israélites étaient en sécurité; sinon, ils étaient exposés au jugement qui s’abattait alors sur tout le pays d’Égypte. Il est possible qu’ils aient été timides, craintifs et accablés; ils ont peut-être passé toute la nuit à se poser des questions: pourtant, si le sang était sur leur maison, ils étaient effectivement à l’abri des coups du destructeur. C’était la valeur du sang, et elle seule, qui leur garantissait cette protection. Encore une fois, même si les Israélites avaient été le meilleur peuple du monde, pour parler à la manière des hommes, sans l’aspersion du sang, ils auraient péri comme les Égyptiens idolâtres. Le fondement de leur sécurité, répétons-le, reposait uniquement sur le sang de l’agneau pascal. Il en est de même aujourd’hui. Bientôt des jugements, surpassant de très loin ceux de l’Égypte, s’abattront sur ce monde; et ils ne seront que les précurseurs du jugement dernier devant le grand trône blanc, dont l’issue certaine est la seconde mort (Apoc. 20); personne n’échappera à ces jugements, à moins d’être à l’abri du sang de Christ. Le lecteur s’étonnera-t-il alors que nous lui posions avec sérieux et insistance cette question pressante: Êtes-vous à l’abri par le sang de Christ? Ne vous accordez aucun repos, ni jour ni nuit, jusqu’à ce que cette question soit réglée, jusqu’à ce que vous ayez l’assurance, fondée sur l’immuable parole de Dieu, que vous êtes aussi bien à l’abri que l’étaient les Israélites dans leurs maisons aspergées de sang, durant cette terrible nuit.
6.5. Valeur de nos sentiments
Remarquons en outre que le sang dont il était fait aspersion était pour Dieu. Comme un autre l’a souligné, «il n’est pas dit: «vous verrez», mais «je verrai». Il arrive souvent que l’âme d’une personne réveillée ne se repose pas sur sa propre justice, mais sur la manière dont elle voit le sang. Ce n’est pas là le fondement de la paix, quelque précieux qu’il puisse être pour le cœur d’en être profondément impressionné. La paix véritable est fondée sur le fait que Dieu voit le sang. Lui ne peut manquer de l’estimer à sa pleine et parfaite valeur, comme ôtant le péché. C’est Lui qui abhorre le péché et qui a été offensé par lui; c’est Lui qui connaît la valeur du sang pour ôter le péché. Mais quelqu’un dira peut-être: Ne faut-il pas au moins que j’aie foi en sa valeur? C’est avoir foi en sa valeur, de voir que Dieu le regarde comme ôtant le péché; votre estimation de cette valeur n’est que la mesure de vos sentiments, tandis que la foi regarde aux pensées de Dieu»1. Les personnes anxieuses s’épargneraient bien des jours et des nuits épuisants de perplexité et d’angoisse, si elles s’en souvenaient. La seule chose à faire est d’accepter le propre témoignage de Dieu quant à la valeur du sang. «Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n’y aura point de plaie à destruction au milieu de vous, quand je frapperai le pays d’Égypte». Tout ce que Dieu est s’oppose au péché; et, par conséquent, tout ce qu’il est se trouve satisfait par le sang de Christ, sinon il devrait encore punir le péché. Aussi le fait que Dieu déclare qu’il épargnera le coupable lorsqu’il verra le sang est un témoignage clair au fait que le sang a pleinement et parfaitement expié le péché. Et si Dieu est satisfait par le sang de Christ, le pécheur ne peut-il pas l’être aussi? Souvenons-nous que l’indignité du pécheur ne peut pas constituer un empêchement à l’efficacité du sang. Si c’était le cas, le sang seul ne serait alors pas suffisant. Au moment où Dieu voit le sang, toute sa nature morale est satisfaite; et il agit avec tout autant de justice en épargnant ceux qui sont placés sous la protection et la valeur du sang, qu’en frappant les Égyptiens.
1 Études sur la Parole de Dieu, par J.N. Darby.
On peut toutefois préférer poser la question autrement: De quelle manière pouvons-nous maintenant être placés sous la protection du sang de Christ? Les Israélites étaient mis à l’abri du sang de l’agneau pascal par la foi. Ils avaient reçu le message, avaient cru à ce qu’il contenait, avaient fait aspersion du sang selon les directions reçues et avaient ainsi été épargnés du jugement. Maintenant, c’est plus simple. La bonne nouvelle de la rédemption par le sang de Christ est proclamée, le message est reçu; et aussitôt qu’il est reçu, Dieu voit l’âme sous toute l’efficacité et la valeur du sang. De sorte que quiconque croit au Seigneur Jésus Christ est délivré de la colère qui vient. La paix avec Dieu est ainsi fondée sur le seul sang de Christ. Car «le sang de la Pâque nous parle du jugement moral de Dieu, et de la satisfaction pleine et entière de tout ce qu’il est dans son Être. Dieu, tel qu’il est dans sa justice, dans sa sainteté, dans sa vérité, ne pouvait pas moralement toucher à ceux qui étaient abrités par ce sang. Son amour envers son peuple avait trouvé ce moyen de satisfaire aux exigences de sa justice contre le péché; et à la vue de ce sang qui répondait à toutes les perfections de son Être, il avait passé par-dessus les enfants d’Israël, selon sa justice et sa vérité même»1. Répétons-le donc: la paix avec Dieu est fondée sur le seul sang de Christ.
1 Études sur la Parole de Dieu, par J.N. Darby.
6.6. Comment manger la pâque
Il y a cependant encore un autre aspect à considérer. L’agneau pascal dont le sang avait été mis sur les demeures des Israélites devait être mangé dans des conditions spéciales, avec ce qui l’accompagnait, et dans une attitude prescrite. Chacun de ces points a son intérêt et son instruction. «Ils en mangeront la chair cette nuit-là; ils la mangeront rôtie au feu». On ne devait pas en manger qui soit à demi cuit ou qui ait été cuit dans l’eau, mais «rôti au feu: la tête, et les jambes, et l’intérieur» (v. 9). Le feu est un symbole de la sainteté de Dieu appliquée en jugement; et ainsi l’agneau dont les Israélites se nourrissaient parlait, en figure, d’un Autre qui, passant par le feu du jugement, le traverserait à leur place. Qu’il ait été «rôti au feu» nous parle ainsi de Christ, qui lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, et a été fait péché pour nous, lorsqu’il a été exposé à l’action complète, inexorable et pénétrante du feu, image du jugement de Dieu contre le péché. Si Dieu pouvait donc épargner les Israélites, c’était uniquement sur la base du fait qu’un autre prendrait sur Lui ce qui leur était justement dû. Quel amour Dieu n’a-t-il pas manifesté en livrant son Fils à une telle mort! L’Esprit de Dieu pouvait dire à juste titre: Il n’a pas épargné son propre Fils, mais l’a envoyé pour recevoir le jugement dû au pécheur.
«Oui, ton divin amour, dans ses plans adorables,
Pour nous soustraire à notre sort
Abandonna ton Fils aux coups inexorables
Du jugement et de la mort».
Avec quelle reconnaissance les enfants d’Israël ne devaient-ils pas se nourrir de cet agneau rôti au feu. Si leurs yeux avaient été ouverts, ils auraient certainement dit: «Le sang de cette victime nous met à l’abri du terrible jugement qui tombe sur les Égyptiens; la chair que nous mangeons a passé par le feu auquel nous aurions dû être exposés». Et cette pensée, exprimée par eux, n’aurait pas manqué de faire monter de leurs cœurs la reconnaissance et la louange à Celui qui, dans sa grâce, avait pourvu à un tel moyen de salut et de sécurité.
Deux choses devaient être mangées avec l’agneau: des pains sans levain et des herbes amères. Le levain est un type du mal, et les pains sans levain nous parlent d’une part de l’absence du mal et de l’autre de pureté et de sainteté. L’apôtre Paul mentionne les pains sans levain de sincérité et de vérité. Nous verrons cela plus en détail lorsque nous traiterons de la fête des pains sans levain en rapport avec la Pâque (v. 14-20). Il suffira pour le moment d’en avoir relevé le caractère. Les «herbes amères» représentent le résultat produit par le fait d’entrer dans les souffrances de Christ pour nous, savoir la repentance, le jugement de soi-même dans la présence de Dieu. Pains sans levain et herbes amères nous dépeignent donc le seul état d’âme dans lequel nous puissions véritablement nous nourrir de l’agneau rôti au feu. Et il est magnifique de considérer comment Celui qui a porté le juste jugement de Dieu contre les péchés des Israélites devient maintenant la nourriture de son peuple. Remarquons aussi que rien ne devait être laissé de reste jusqu’au lendemain. Ce qui restait devait être brûlé au feu (v. 10). Plus tard, cette même directive fut donnée pour la plupart des sacrifices qui devaient être mangés (voir Lév. 7:15). C’était sans doute une mise en garde contre le danger de le manger comme un aliment commun. Il ne pouvait être pris qu’en association avec le jugement dont il était l’image. La «chair» de Christ ne peut être mangée qu’en relation avec sa mort. De même ici pour la nuit de la pâque: au matin, alors que le jugement était passé, les Israélites auraient pu oublier la valeur de l’agneau rôti au feu; mais le commandement de brûler ce qui restait leur rappellerait son caractère, tout en les gardant d’en faire un aliment commun. Ce n’était qu’autour de la table pascale qu’ils pouvaient se nourrir d’une façon appropriée de l’agneau de la pâque.
6.7. Prêts à partir
Leur attitude devait être en harmonie avec la position dans laquelle ils avaient été introduits. «Vous le mangerez ainsi: vos reins ceints, vos sandales à vos pieds, et votre bâton en votre main; et vous le mangerez à la hâte. C’est la pâque de l’Éternel» (v. 11). Tout cela nous parle du caractère qui devait être le leur en conséquence de leur rédemption — car ils allaient quitter l’Égypte pour toujours pour traverser le désert comme des pèlerins et se diriger vers l’héritage promis. Leurs reins étaient ceints: ils étaient prêts pour le service, détachés du pays dans lequel ils avaient pendant si longtemps été retenus captifs, afin que rien ne les retienne ou ne les arrête lorsque le signal de départ pour le voyage serait donné. Leurs sandales à leurs pieds: ils étaient préparés, chaussés pour la marche; leur bâton en leur main: signe de leur caractère de pèlerins, car ils quittaient ce qui avait été leurs maisons, pour devenir des étrangers dans le désert. Enfin ils devaient manger la pâque à la hâte, car ils ne savaient pas à quel moment le commandement serait donné et ainsi ils devaient être prêts. — Veiller et être prêts: vraie image de l’attitude du croyant dans ce monde! Puissions-nous tous y répondre mieux!
À bien des reprises nous sommes exhortés à avoir nos reins ceints. Et avoir nos pieds chaussés de la préparation de l’évangile de paix (Éph. 6) est indispensable pour être revêtus de l’armure complète de Dieu. Garder véritablement le caractère de pèlerin, avec la conscience que pour nous le repos n’est pas là, est une des premières leçons de notre vie chrétienne. Attendre Christ se rattache à l’espérance de son retour. La question est de savoir si ces traits caractérisent maintenant les croyants comme ils le devraient. Ce qui nous manque, c’est une réalisation plus profonde du caractère de la scène que nous traversons — scène jugée, Dieu l’ayant déjà jugée dans la mort de Christ. «Maintenant, dit-il, est le jugement de ce monde». Si, dans notre âme, nous en étions profondément convaincus, nous ne serions pas tentés de nous attarder dans ce monde; mais tels de vrais pèlerins, nos reins ceints et nos lampes allumées, nous serions nous-mêmes semblables à des hommes qui attendent leur maître (Luc 12:35, 36).
Chapitre 12, versets 14 à 51
6.8. La fête des pains sans levain
La fête des pains sans levain est mentionnée en rapport avec la pâque (v. 14-20). Elle ne fut pas célébrée dans le pays d’Égypte, car la nuit même où Dieu frappa les premiers-nés, les enfants d’Israël commencèrent leur voyage. Mais la liaison est conservée pour souligner la vraie signification typique de cette fête. Il en est de même en 1 Corinthiens 5: «Notre pâque, Christ, a été sacrifiée: c’est pourquoi célébrons la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de sincérité et de vérité» (v. 7, 8). Le levain, comme cela a déjà été dit, est un type du mal, qui s’étend et qui communique ses propriétés à la masse dans laquelle il opère. «Un peu de levain fait lever la pâte tout entière» (1 Cor. 5:6). Manger des pains sans levain signifie donc: séparation du mal, sainteté pratique. Remarquons aussi que la fête devait durer sept jours, c’est-à-dire une période de temps complète. La leçon que nous avons à en tirer, c’est que cette sainteté incombe à tous ceux qui sont à l’abri du sang de l’Agneau pascal, durant la période entière de leur vie sur la terre. Voilà ce qu’exprime la fête des pains sans levain liée avec la pâque. Une fois sauvés par la grâce de Dieu, en vertu de l’aspersion du sang de Christ, nos méchants cœurs pourraient dire: demeurons dans le péché afin que la grâce abonde. «Non!» répond l’Esprit de Dieu; «dès le moment où vous êtes sous l’efficace de la mort de Christ, vous avez la responsabilité de vous séparer du mal». Dieu cherche ainsi en nous, dans notre marche et notre comportement, une réponse à ce qu’il est et à ce qu’il a fait pour nous. C’était pour mettre cela en évidence qu’il était enjoint aux Israélites de garder cette fête «comme un statut perpétuel». D’abord, il est vrai, pour les faire se souvenir qu’en ce même jour Dieu avait fait sortir leurs armées du pays d’Égypte, et ensuite, pour leur enseigner l’obligation qui était la leur maintenant d’avoir une marche en accord avec leur nouvelle position. Et n’est-il pas bien nécessaire de rappeler cette obligation à l’esprit des croyants du temps présent? La chose importante à placer sur toutes les consciences aujourd’hui est la responsabilité de garder cette fête des pains sans levain. Le relâchement dans la marche, les mauvaises associations et la mondanité sapent, de tous côtés, le témoignage des enfants de Dieu. «Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité; ta parole est la vérité» (Jean 17:16, 17). Puisse cette prière du Seigneur trouver une réponse plus évidente dans une séparation et une consécration croissantes de la part des siens.
Dans les versets 21 à 28, nous voyons comment Moïse rassemble tous les anciens d’Israël, pour leur donner les directives que nous venons de considérer. À l’ouïe de ce message, «le peuple s’inclina, et ils se prosternèrent. Et les fils d’Israël s’en allèrent, et firent comme l’Éternel l’avait commandé à Moïse et à Aaron; ils firent ainsi» (v. 27, 28). Un détail intéressant est ajouté. Il est pourvu à ce que les enfants soient instruits quant à la signification de la pâque (v. 26, 27); et ainsi, le récit de la grâce et de la puissance de l’Éternel en délivrance lorsqu’il frappa les Égyptiens, devait être transmis de génération en génération.
L’Éternel ayant ainsi dans sa grâce séparé son peuple, et ayant assuré sa mise à l’abri du jugement par l’aspersion du sang, va frapper l’Égypte comme il l’avait déclaré.
6.9. Ch. 12:29-36
Le coup menaçant depuis si longtemps, mais différé avec beaucoup de patience et de miséricorde, s’abat finalement, et s’abat d’une manière inexorable sur tout le pays; car «l’Éternel frappa tout premier-né dans le pays d’Égypte, depuis le premier-né du Pharaon qui était assis sur son trône, jusqu’au premier-né du captif qui était dans la maison de la fosse, et tout premier-né des bêtes». Tous les cœurs furent bouleversés par ce coup terrible qui endeuillait chaque maison du pays; «et il y eut un grand cri en Égypte, car il n’y avait pas de maison où il n’y eût un mort». Le cœur endurci du Pharaon fut atteint, et s’inclina sur le moment devant le jugement manifeste de Dieu. «Le Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et toute l’Égypte», et envoyant chercher Moïse et Aaron, leur dit de s’en aller. Il ne posait maintenant plus aucune condition, mais leur accordait tout ce qu’ils avaient demandé, et cherchait même une bénédiction de leur part. Les Égyptiens allaient plus loin; ils avaient hâte de renvoyer les enfants d’Israël; car ils disaient: «Nous sommes tous morts». Aussi donnèrent-ils aux Israélites tout ce que ceux-ci désiraient; et selon la parole de l’Éternel, les fils d’Israël «dépouillèrent les Égyptiens».
6.10. Un grand amas de peuple — ch. 12:37-42
Ainsi, Dieu délivra son peuple de l’esclavage de l’Égypte; et les Israélites partirent pour la première étape de leur voyage, de Ramsès pour Succoth, environ six cent mille hommes de pied, les hommes faits, sans les petits enfants. Mais hélas! ils n’étaient pas seuls. Ils étaient accompagnés par «un grand amas de gens». C’est là ce qui, dans tous les temps, a été un fléau pour les enfants de Dieu, une source de faiblesse, de manquements, et parfois d’apostasie ouverte. L’apôtre Paul met en garde les croyants de son époque contre ce danger spécial (1 Cor. 10); les apôtres Pierre (2 Pierre 2) et Jude le font également. L’Église, de nos jours, est atteinte de ce même mal; sous un certain aspect, elle comprend aussi ce «grand amas de gens». D’où l’importance des paroles de l’apôtre Paul à Timothée: «Le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau: Le Seigneur connaît ceux qui sont siens, et: Qu’il se retire de l’iniquité, quiconque prononce le nom du Seigneur. Or, dans une grande maison, il n’y a pas seulement des vases d’or et d’argent, mais aussi de bois et de terre; et les uns à honneur, les autres à déshonneur. Si donc quelqu’un se purifie de ceux-ci, il sera un vase à honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre» (2 Tim. 2:19-21). Les Israélites partirent à la hâte, parce qu’ils furent chassés d’Égypte et ne purent pas tarder, ni se faire des provisions. Ils étaient rejetés entièrement sur Dieu qui les avait séparés des Égyptiens, mis à l’abri du sang de l’agneau, et maintenant allait les conduire et pourvoir à leur nourriture en chemin. Ils ne devaient pas emporter de levain avec eux.
Dieu attendait ce moment depuis des siècles (voir Gen. 15:13, 14); et en ce même jour, le jour qu’il avait déterminé d’avance, son peuple sortit d’Égypte. Les Israélites n’ont pas encore traversé la mer Rouge; mais dans la constatation que «toutes les armées de l’Éternel sortirent du pays d’Égypte», l’Esprit de Dieu anticipe leur délivrance pleine et parfaite. Le sang qui mettait à l’abri était la base de leur complète rédemption. Rien d’étonnant alors qu’il soit ajouté que la nuit de leur exode devait être une nuit à garder pour l’Éternel, comme un statut perpétuel. Elle devait être gardée, remarquons-le, pour l’Éternel, afin de rappeler continuellement à leur esprit la source de cette grâce et de cette puissance en délivrance, qui les avaient fait sortir d’Égypte. Il en est de même aujourd’hui, quoique d’une manière différente. La nuit même où le Seigneur Jésus fut livré, il prit un pain et rendit grâces, instituant pour les siens le précieux mémorial de sa mort; afin que toutes les fois que nous mangeons le pain et que nous buvons la coupe, nous annoncions la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne. Tout au long de notre pèlerinage, il désire que nous nous souvenions de lui que nous nous souvenions de lui dans cette nuit terrible où il fut livré, lorsque, comme notre Pâque, il a été sacrifié pour nous.
6.11. Qui pouvait manger la pâque?
Le chapitre se termine par «le statut de la Pâque», qui souligne principalement deux instructions. La première concernait les personnes qui pouvaient y participer: «Aucun étranger n’en mangera; mais tout esclave, homme acheté à prix d’argent, tu le circonciras; alors il en mangera. L’habitant et l’homme à gages n’en mangeront point». Mais «toute l’assemblée d’Israël la fera. Et si un étranger séjourne chez toi, et veut faire la Pâque à l’Éternel, que tout mâle qui est à lui soit circoncis; et alors il s’approchera pour la faire, et sera comme l’Israélite de naissance; mais aucun incirconcis n’en mangera» (v. 43-45, 47, 48).
Il y avait donc trois classes de personnes qui pouvaient garder la pâque. 1 ° Les Israélites; 2° leurs serviteurs achetés à prix d’argent, et 3° l’étranger séjournant chez eux. Mais pour chacune de celles-ci la condition était la même: la circoncision. Aucun ne pouvait prendre place à la table de la pâque à moins d’avoir été circoncis. Ce n’est que de cette manière qu’ils pouvaient être introduits dans les termes de l’alliance que Dieu avait faite avec Abraham (voir Gen. 17:9-14) et sur la base de laquelle il agissait maintenant en les faisant sortir d’Égypte et en les prenant pour lui, comme peuple. La circoncision est un type de la mort à la chair; elle a son antitype, quant à la chose signifiée, dans la mort de Christ. Aussi l’apôtre Paul écrit-il aux Colossiens: «Christ... en qui aussi vous avez été circoncis d’une circoncision qui n’a pas été faite de main, dans le dépouillement du corps de la chair par la circoncision du Christ, étant ensevelis avec lui dans le baptême, dans lequel aussi vous avez été ressuscités ensemble par la foi en l’opération de Dieu qui l’a ressuscité d’entre les morts» (Col. 2:11, 12). À moins donc que toutes ces classes distinctes n’aient été amenées sur le terrain de l’alliance, elles ne pouvaient jouir du privilège de cette fête bénie entre toutes, une fête qui tirait toute sa signification du sang versé de l’agneau pascal. Il est extrêmement intéressant de noter la disposition spéciale prévue pour deux de ces classes. Les Israélites, comme tels, avaient droit à la pâque s’ils étaient circoncis. Mais à côté d’eux il y avait deux autres classes. Un homme à gages ne pouvait pas célébrer la fête, mais un serviteur acheté à prix d’argent le pouvait s’il était circoncis. Il faut se souvenir que cette fête a essentiellement un caractère familial: un serviteur acheté à prix d’argent était, pour ainsi dire, incorporé à la famille, devenait une partie intégrante de la maison et, par là, pouvait participer à la fête, tandis qu’un homme à gages n’avait pas une telle place ou position et, par conséquent, il était exclu. Dans «l’étranger qui séjourne parmi vous», nous pouvons voir une promesse de grâce pour les Gentils, lorsque le mur mitoyen de clôture serait détruit, et l’évangile proclamé au monde entier.
Enfin, il y a une disposition quant à l’agneau lui-même. «Elle [la pâque] sera mangée dans une même maison; tu n’emporteras point de sa chair hors de la maison, et vous n’en casserez pas un os» (v. 46). Tant la signification du type que l’unité de la famille, ou d’Israël si l’on considère toute l’assemblée, auraient été perdues si cette injonction avait été méprisée. Le sang était sur la maison, et l’agneau pascal n’était que pour ceux qui se trouvaient à l’abri du sang. De ce fait sa chair ne devait pas être portée hors de la maison. Le sang d’aspersion est indispensable pour que l’on puisse se nourrir de l’agneau rôti au feu. Et pas un os ne devait en être cassé, parce que c’était une image de Christ. C’est pourquoi l’apôtre Jean dit: «Ces choses sont arrivées afin que l’écriture fût accomplie: «Pas un de ses os ne sera cassé» (Jean 19:36). Il est donc clair que dans l’agneau pascal, l’Esprit avait Christ en vue; et combien il est précieux pour nous, lorsque nous lisons ce récit, d’avoir communion avec ses propres pensées, et de ne discerner rien d’autre que Christ. Puisse-t-il ouvrir nos yeux, toujours plus, de telle manière que Christ seul remplisse notre âme, lorsque nous lisons sa Parole!
Chapitre 13, versets 1 à 16
7. Exode 13 — Les droits de Dieu
Le récit de la sortie d’Égypte est interrompu par la mention de certaines conséquences découlant du rachat des enfants d’Israël hors d’Égypte et entraînant des responsabilités pour eux. Car bien qu’ils soient encore dans le pays, l’enseignement de ce chapitre est fondé sur le fait que Dieu les en a fait sortir, et anticipe en réalité leur établissement en Canaan. Si Dieu agit en grâce pour son peuple, il a par là des droits sur lui, et ce sont ces droits qui sont présentés ici. Un peuple racheté devient la propriété de son Rédempteur. C’est ainsi que nous lisons: «Vous n’êtes pas à vous-mêmes; car vous avez été achetés à prix» (1 Cor. 6:19, 20). L’Éternel déclare ici à Moïse selon le même principe: «Sanctifie-moi tout premier-né, tout ce qui ouvre la matrice parmi les fils d’Israël, tant des hommes que des bêtes; il est à moi» (v. 1). Mais un autre élément est introduit en rapport avec cela. Dans le chapitre précédent, la fête des pains sans levain est instituée immédiatement après l’aspersion du sang. Il s’agissait de montrer que les deux choses — la protection par le sang et l’obligation d’une vie sainte — ne peuvent jamais être séparées. Cette fête est mentionnée maintenant à nouveau, avec des instructions quant à la manière de l’observer lorsque l’Éternel les aurait introduits dans le pays du Cananéen (v. 5), en relation avec la sanctification des premiers-nés.
7.1. Ch. 13:3-16 — Une vie sainte
Nous ajouterons deux ou trois remarques au sujet de la fête des pains sans levain, en relation avec les détails supplémentaires donnés ici. Elle devait être liée pour toujours avec le souvenir de deux faits. D’abord, avec le jour de leur rédemption. «Souvenez-vous de ce jour, auquel vous êtes sortis d’Égypte, de la maison de servitude» (v. 3). Le Seigneur désire que les siens se souviennent éternellement du jour de leur délivrance, du jour où ils ont été amenés des ténèbres à la lumière, soustraits au jugement dû à leurs péchés et introduits dans la faveur parfaite de Dieu en Christ. Deuxièmement, ils ne devaient pas oublier la source de leur délivrance. «Car l’Éternel vous en a fait sortir à main forte» (v. 3). C’est à lui seul qu’ils la devaient. Nul autre bras n’aurait pu briser leurs fers, frapper leur oppresseur, les protéger du destructeur et leur donner la délivrance. Lui seul pouvait les racheter de la main de l’ennemi. N’est-ce pas ce qu’a lu le Seigneur Jésus dans la synagogue à Nazareth: «L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres; il m’a envoyé pour publier aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue; pour renvoyer libres ceux qui sont foulés, et pour publier l’an agréable du Seigneur» (Luc 4:18, 19)? Aussi est-ce très significatif de trouver, immédiatement après que ces deux points ont été rappelés à leur mémoire, l’adjonction: «On ne mangera point de pain levé». Si le Seigneur agit en faveur des siens, c’est afin de les racheter de toute iniquité et de purifier pour lui-même un peuple acquis, zélé pour les bonnes œvres (Tite 2:14). Parce que lui-même est saint, il attend de ses rachetés qu’ils soient saints, et cela pour la période complète (sept jours) de leur vie. Il ne devait pas se voir de levain dans tous leurs confins.
Plus que cela, chaque père reçoit l’instruction d’enseigner d’année en année à son fils la signification de cette fête. Ayant la responsabilité de ses enfants, il doit leur expliquer avec soin pourquoi le levain n’a pas place dans sa maison. Ce serait incompatible avec le fondement de la rédemption sur lequel il se trouvait. Il devait dire: «C’est à cause de ce que l’Éternel m’a fait quand je sortis d’Égypte. Et cela te sera un signe sur ta main...» (v. 8, 9). Tout ceci afin que la loi de l’Éternel soit en sa bouche. Nous avons ici le secret de la séparation à la fois du mal et pour Dieu. «Comment un jeune homme rendra-t-il pure sa voie? Ce sera en y prenant garde selon ta parole». «J’ai caché ta parole dans mon cœur, afin que je ne pèche pas contre toi». (Ps. 119:9, 11). C’est en prenant garde à la parole de Dieu et en y obéissant que les croyants peuvent aujourd’hui garder en vérité la fête des pains sans levain.
7.2. Dévouement et consécration
Suivent les directives pour la sanctification des premiers-nés. Le dévouement, la consécration doivent également caractériser les rachetés et seront toujours un fruit de la vraie séparation; c’est la raison pour laquelle la fête des pains sans levain précède la mise à part des premiers-nés. Remarquons d’abord l’exception à cette loi générale. «Tout premier fruit des ânes, tu le rachèteras avec un agneau; et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Et tout premier-né des hommes parmi tes fils, tu le rachèteras» (v. 13). La liaison du premier-né d’un âne avec le premier-né des hommes est d’autant plus frappante que l’un et l’autre devaient être rachetés. Il y a encore un autre point: le premier-né de l’âne devait être racheté avec un agneau de même que les premiers-nés d’Israël le furent par un agneau, la nuit de la Pâque. Ajoutons que s’il n’était pas racheté, l’âne devait être tué comme les Israélites l’auraient certainement été lorsque l’Éternel frappa les Égyptiens, et le parallélisme est complet. Que nous enseigne-t-il? Que l’homme, de par sa naissance dans le monde, est mis au rang du premier-né de l’âne; que l’un et l’autre sont impurs et, comme tels, voués à la destruction, à moins qu’ils ne soient rachetés avec un agneau.
Quel coup porté à l’orgueil de l’homme naturel! Au lieu de se vanter de ce qu’il est et de ses capacités intellectuelles, qu’il considère ici l’estimation de Dieu quant à sa condition. On ne saurait faire une comparaison plus humiliante, et pourtant tout croyant est prêt à y souscrire comme étant divinement vraie. Car tel était notre état par nature — perdus et misérables — et nous aurions certainement péri si, selon les richesses de la grâce de Dieu, nous n’avions pas été rachetés par le sang de l’Agneau. D’un autre côté quelle grâce immense Dieu nous a faite de se pencher sur des êtres tels que nous étions, de venir à nous lorsque nous étions dans cet état pour nous amener à lui et nous associer pour toujours à l’Agneau par lequel nous avons été rachetés! Si par nature nous ne pouvions pas être tombés plus bas, nous ne pouvions pas non plus être élevés plus haut par la grâce; car il nous a prédestinés «à être conformes à l’image de son Fils, pour qu’il soit premier-né entre plusieurs frères» (Rom. 8:29).
7.3. Droits de Dieu sur les premiers-nés
Il est important de considérer la raison pour laquelle Dieu réclamait les premiers-nés en Israël. Elle est expressément liée à la destruction des premiers-nés dans le pays d’Égypte (v. 15). Nous avons vu que le peuple a été épargné, cette nuit terrible, uniquement sur le fondement de l’aspersion du sang de l’agneau mis à mort, autrement dit sur le fondement de la mort d’un autre. C’était donc sur le principe de la substitution; et c’est là le motif du droit de Dieu dans ce chapitre. Si Dieu épargnait les premiers-nés à cause de l’agneau pascal, c’était pour les réclamer ensuite pour Lui. N’en est-il pas ainsi aujourd’hui? Nous appartenons à Celui qui nous a rachetés, parce qu’il a pris notre place et a porté nos péchés en son corps sur le bois. «Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité» (2 Cor. 5:15). Il est bon de nous demander souvent si nous reconnaissons ses droits: ses droits sur nous, sur tout ce que nous sommes et sur tout ce que nous possédons.
C’est cette vérité aussi que le père devait inculquer à son fils (v. 14-16); car il apprendrait ainsi les droits de l’Éternel sur lui comme sur son père. L’un et l’autre, en tant que rachetés, devaient servir le Rédempteur. Un très grand pas est fait lorsque le croyant est conscient d’appartenir au Seigneur avec sa famille. Que chacun individuellement reconnaisse ce droit est une autre question, et on ne saurait trop insister sur le fait qu’il n’y a pas de salut sans la foi individuelle; mais il est de toute importance que le chef de famille garde continuellement en mémoire que lui et tous les siens appartiennent de droit au Seigneur. Alors seulement, par la bénédiction de Dieu, il sera en mesure d’élever ses enfants dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur, de les instruire pour Lui, et comme sous son regard. Ce n’est que si cette vérité est perçue par eux que les enfants verront dans l’éducation parentale l’expression de l’autorité du Seigneur. Que les croyants ne se lassent donc pas de rappeler à leurs enfants les droits du Seigneur sur la base de la rédemption.
Chapitre 13, versets 17 à 22
7.4. Ch. 13:17-22
Le récit reprend ici. La première chose que cette partie de notre chapitre place devant nous est le choix effectué par Dieu du chemin que son peuple suivra dans le désert. Et en effet, s’il fait sortir les siens dans le désert, soyons certains qu’il pourvoira à tous leurs besoins. La seule chose qu’il leur demande est d’obéir à sa parole. Remarquons aussi la tendresse qu’il met dans ce choix. Il a des égards pour leur faiblesse et leurs craintes. Il «ne les conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, qui est pourtant proche; car Dieu dit: De peur que le peuple ne se repente lorsqu’ils verront la guerre, et qu’ils ne retournent en Égypte». Quelle manifestation merveilleuse de ses tendres compassions! Nous y apprenons combien pleinement il s’identifie à son peuple et sympathise avec lui dans sa faiblesse et ses craintes. Il avait certes d’autres intentions à leur égard; mais il est doux de penser qu’il a choisi le chemin exact par lequel il les conduirait compte tenu de leur état. «Comme un père a compassion de ses fils, l’Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière»1 (Ps. 103:13, 14).
1 La mention que les fils d’Israël montèrent en ordre de bataille hors du pays d’Égypte (v. 18) a suscité de nombreuses discussions — comme si cette expression devait nécessairement signifier: avec leurs armes comme des guerriers. C’est une erreur. Cela ne semble pas vouloir dire autre chose qu’ils marchaient en rang, un ordre indispensable pour le déplacement d’une si grande multitude.
7.5. Les os de Joseph
Après la mention de leur ordre de marche, nous trouvons celle des os de Joseph. C’est de toute beauté. À la fin du livre de la Genèse, nous lisons que Joseph, sur son lit de mort «fit jurer les fils d’Israël, disant: Certainement Dieu vous visitera, et vous ferez monter d’ici mes os» (Gen. 50:25). Dans l’épître aux Hébreux, l’appréciation de Dieu quant à cette action nous est rapportée: «Par la foi, Joseph, en terminant sa vie, fit mention de la sortie des fils d’Israël et donna un ordre touchant ses os» (Héb. 11:22). Dans notre chapitre, nous avons la réponse de Dieu à la foi de son serviteur. Cette fameuse nuit de la pâque, Moïse avait certainement suffisamment de préoccupations pour organiser le départ d’une telle multitude. Comment aurait-il pu penser encore aux os de Joseph? Mais, dans la dépendance de Dieu, celui-ci avait fait jurer les fils d’Israël. Il croyait, c’est pourquoi il parlait; et ayant mis sa confiance en Dieu, il était impossible qu’il soit confus. Pour l’œil naturel, il était hautement improbable, au moment de la mort de Joseph, que le peuple quitte jamais l’Égypte. Mais le saint qui allait mourir se confiait dans la parole et la promesse infaillibles de Dieu, et ainsi avec une pleine assurance, il «donna un ordre touchant ses os». Environ quatre cents ans s’écoulèrent (car les Israélites séjournèrent quatre cent trente ans en Égypte comme nous le voyons au chapitre 12:41) et Dieu visita les siens. Le serment leur est rappelé et ainsi les os du patriarche les accompagnèrent dans leur exode. N’avons-nous pas là un exemple remarquable de la fidélité de Dieu et du prix qu’avait pour lui la foi de son serviteur?
7.6. Conduits par la nuée
Au verset suivant (v. 20) nous trouvons les noms des premiers endroits où ils campèrent: «Et ils partirent de Succoth, et campèrent à Etham, à l’extrémité du désert». Ils étaient partis de Ramsès (chap. 12:37) pour Succoth... comme nous en avons la description ici. Tous ces lieux étaient situés en Égypte, et malgré les nombreuses études et recherches effectuées à leur sujet, leur localisation ne dépasse pas les limites des suppositions. Le point à souligner, c’est qu’ils étaient divinement conduits dans leur marche. Celui qui avait choisi leur chemin les y guidait, allant devant eux, de jour dans une colonne de nuée, et de nuit dans une colonne de feu, dans tous leurs déplacements. Jamais il ne leur retira ces précieux symboles de sa présence tant qu’ils furent dans le désert. N’est-ce pas une belle illustration de la vérité que l’Éternel reste toujours le guide de son peuple? Celui qui les a fait sortir d’Égypte sera toujours visible devant eux sur le chemin qu’ils suivent. Jamais il ne dit: «allez»; mais toujours sa parole est: «suivez-moi».
Il nous a laissé un modèle, afin que nous suivions ses traces (1 Pierre 2:21). Il est, lui, le Chemin, et aussi la Vérité et la Vie (Jean 14:6). Nous n’avons pas la direction visible dont jouissaient les enfants d’Israël: c’est tout à fait vrai; mais elle ne demeure pas moins discernable et réelle pour l’œil spirituel. La Parole est une lampe à notre pied, et une lumière à notre sentier (Ps. 119:105).
Il est intéressant de relever qu’il n’y avait pas de direction semblable en Égypte et qu’il n’y en aura pas non plus dans le pays. Voilà qui met en évidence une vérité importante: ce n’est que dans le désert que l’indication du chemin est nécessaire. C’est là que, dans sa tendresse et dans sa miséricorde, l’Éternel prend la direction des siens, leur montrant le chemin qu’ils doivent suivre, où ils doivent se reposer et quand ils doivent marcher. Rien n’est laissé à leur propre initiative; Dieu entreprend, lui-même, tout pour eux, leur demandant uniquement d’avoir les yeux fixés sur leur Guide. Bienheureux ceux qui sont conduits ainsi et qui sont prêts à le suivre!
Chapitre 14, versets 1 à 9
8. Exode 14 — Dieu, le Rédempteur de son peuple.
Au chapitre 12, Dieu apparaît comme un juge, car une fois que la question du péché a été soulevée, la sainteté de sa nature exige qu’il s’en occupe, et qu’il le traite en justice. Ainsi Dieu était là contre son peuple, à cause de leur péché, bien que, dans sa grâce et selon ses directives, un moyen ait été trouvé de satisfaire à ses justes exigences par le sang de l’agneau pascal. Mais dans ce chapitre, celui qui était contre le peuple à cause de ses péchés, est pour lui maintenant en vertu du sang. Sa justice, sa vérité, sa majesté — tout ce qu’il est, avait été satisfait par le sang dont il avait été fait aspersion. Une propitiation1 a été faite sur la base de laquelle Dieu peut prendre en main la cause de ceux qui ont été placés sous sa valeur. Il se présente ici par conséquent comme un Sauveur, un Rédempteur. Historiquement un intervalle sépare ces deux caractères. Il a été un Juge la nuit de la Pâque, et un Rédempteur à la mer Rouge; et c’est dans cet ordre que la majorité des âmes réveillées apprennent à le connaître. Lorsque quelqu’un est amené à la conviction de son état de péché, quand c’est véritablement l’œuvre de l’Esprit de Dieu, Dieu lui apparaît comme un Juge à cause de sa culpabilité. Mais quand la conscience est en paix après avoir compris par la foi que le sang de Christ a répondu à toutes les exigences de Dieu et l’a purifiée de toute culpabilité, l’âme discerne que Dieu lui-même est de son côté et en trouve la preuve dans le fait qu’il a ressuscité le Seigneur Jésus d’entre les morts.
1 Par «propitiation», on comprendra que nous entendons la valeur figurée du sang. La propitiation à proprement parler a été faite par le sang dont il a été fait aspersion sur le propitiatoire (Comparer Lev. 16:14 et Rom. 3:25).
8.1. Dieu est pour nous
Ces deux étapes sont clairement distinguées en Romains 3 et 4. Ainsi, au chapitre 3, il s’agit de la foi dans le sang, la foi en Jésus (v. 25, 26); tandis qu’au chapitre 4, il est question de la foi en Dieu (v. 24). Et il n’y a pas de paix véritable avant que cette deuxième étape soit atteinte. Mais si ces deux points sont séparés historiquement en relation avec les enfants d’Israël, et s’ils le sont généralement dans l’expérience des âmes, n’oublions pas qu’ils ne sont que deux côtés d’une seule et même œuvre. Ainsi, sous cet aspect, la mer Rouge, tout en manifestant la puissance de Dieu, d’une part dans la rédemption de son peuple et d’autre part dans la destruction du Pharaon et de ses armées, n’est que la conséquence du sang dont il a été fait aspersion la nuit de la Pâque. Le sang était la base de toutes les interventions subséquentes de Dieu pour Israël. Si donc il est parfaitement exact que la rédemption ne pouvait pas être connue avant la traversée de la mer Rouge, l’aspersion du sang était une œuvre plus profonde, car c’était par elle que Dieu était glorifié en relation avec le péché du peuple, et c’était elle aussi qui lui permettait d’opérer leur délivrance complète, en harmonie avec chacun des attributs de Son caractère. Nous ne pourrons comprendre ce chapitre que si nous gardons en mémoire la distinction, et en même temps la relation, entre ces deux aspects d’une même œuvre. Alors seulement nous aurons la clé de son interprétation, et nous verrons que tout ce qui y est rapporté est lié à cette vérité.
8.2. Une situation désespérée
8.2.1. Ch. 14:1-4
La première chose que fit l’Éternel fut de placer son peuple dans une position absolument désespérée à vue humaine. Arrivé près de la mer et encerclé par le désert, il est mis dans une situation n’offrant apparemment aucune échappatoire, si, comme Dieu l’avait déterminé, le Pharaon se lançait à sa poursuite. Son but était d’entraîner le Pharaon à sa destruction et de rejeter sur Lui les enfants d’Israël dans une dépendance entière. Les deux choses se réalisèrent, car les Égyptiens devaient apprendre qu’il était l’Éternel, et les Israélites devaient reconnaître qu’il était leur salut. C’est ce qui va être placé devant nous dans la suite du récit.
8.2.2. Ch. 14:5-9
Quelle révélation de l’aveuglement du cœur humain n’avons-nous pas dans le cas du Pharaon! L’Éternel avait étendu son bras en jugements successifs et avait finalement arraché un cri d’angoisse à chaque maison dans le pays d’Égypte. Malgré cela le roi et ses serviteurs se relèvent du coup qui sur le moment les a accablés, se repentent d’avoir laissé partir les Israélites et se lancent audacieusement à leur poursuite pour les réduire à nouveau à la servitude. Ils les poursuivent donc, «tous les chevaux, les chars du Pharaon, et ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, près de Pi-Hahiroth, devant Baal-Tsephon». Comme nous l’avons expliqué, c’est l’Éternel qui avait disposé les choses ainsi. Pour le Pharaon et son armée, se placer dans une telle position pouvait sembler une pure folie, et peut-être même une preuve qu’ils étaient dirigés par la folie humaine plutôt que par la sagesse divine. Aussi les Égyptiens marchent-ils dans la pleine assurance d’une victoire facile. Car comment un peuple de fugitifs, encombré de femmes et d’enfants, pourrait-il échapper à leur poursuite? Les Israélites incrédules avaient la même pensée. Ils étaient à l’abri du sang, ils étaient guidés par la colonne de nuée, ils allaient sans doute dire: «Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?» Mais la vue fut plus forte que la foi. La mer était devant eux, le Pharaon et ses armées, derrière. Pour l’œil naturel, il n’y avait pas d’échappatoire; la captivité ou la mort étaient certaines. Voilà l’effet produit sur leurs esprits.
Chapitre 14, versets 10 à 20
8.3. Effroi et incrédulité
8.3.1. Ch. 14:10-12
Chacune de leurs paroles porte la marque de l’incrédulité, et cela parce qu’ils jugent selon ce que leurs yeux voient. Ils ont une grande peur; ils sont sur le point de mourir dans le désert; ils avaient bien dit qu’il en serait ainsi et que la servitude en Égypte valait infiniment mieux que la mort qui les attendait maintenant. Leur erreur était de laisser l’Éternel en dehors de leurs prévisions — ce que l’incrédulité fait toujours — et d’en faire ainsi une affaire entre eux et les Égyptiens. Mais Moïse est soutenu; sa foi ne fléchit pas et il peut alors les encourager et censurer leur incrédulité.
8.3.2. Ch. 14:13, 14
En fait une œuvre double devait être accomplie ce jour-là, une œuvre à laquelle le peuple ne pouvait avoir aucune part. Ils devaient en effet être débarrassés d’une part de la puissance de Satan, représentée par le Pharaon et ses armées, d’autre part de la mort et du jugement, figurés par la mer Rouge. Et les deux sont liés. Car par le péché de l’homme, Satan a acquis des droits et brandit la mort comme le juste châtiment de Dieu. Il est tout à fait vrai que les enfants d’Israël étaient déjà à l’abri par le sang de l’agneau pascal et qu’ils auraient dû par conséquent jouir d’une paix parfaite. Mais ils ignoraient la valeur de ce sang. Ils savaient qu’il les avait sauvés des coups du jugement, que leurs maisons avaient été épargnées lorsque Dieu avait frappé les premiers-nés d’Égypte; mais ils n’avaient pas encore appris que ce même sang était à la base d’une œuvre complète en leur faveur, la délivrance de leurs ennemis, la direction à travers le désert et même la possession de l’héritage promis.
Aussi, lorsqu’ils virent le Pharaon, ils «eurent une grande peur» et ils «crièrent à l’Éternel». L’Éternel vient au-devant de leur faiblesse et de leurs doutes; par ce message que Moïse leur délivre, il leur rappelle que c’est Lui qui va opérer pour les délivrer à la fois du pays du roi d’Égypte et des eaux de la mer Rouge. Eux-mêmes sont invités à ne pas craindre, à se tenir là et à voir la délivrance de l’Éternel; car leurs ennemis allaient disparaître pour toujours de devant leurs yeux; l’Éternel combattrait pour eux et eux n’auraient qu’à demeurer tranquilles. Le salut est à l’Éternel! Précieuse vérité, que nous sommes pourtant lents à apprendre! Combien de personnes se laissent embarrasser par la pensée qu’elles doivent faire quelque chose. Eh bien non! Celui qui a fourni l’agneau pascal dont le sang nous purifie de tout péché fera tout le reste. Le salut est son œuvre à Lui, parfaite et achevée. Vouloir y ajouter quoi que ce soit par nos propres actes ou nos efforts ne fait que gâter sa beauté et sa perfection. Que peut faire l’homme quand Satan et la mort sont en question? Face à de tels ennemis, il est sans défense. Il ne peut ni leur échapper ni les vaincre; sa seule issue consiste à se tenir tranquille pour voir la délivrance de l’Éternel. Quel réconfort pour le cœur craintif et anxieux! Puissent les âmes terrifiées par la puissance de Satan en présence de la mort entrer dans la pleine jouissance de ce précieux message: «L’Éternel combattra pour vous, et vous, vous demeurerez tranquilles». La suite du récit nous montrera comment se vérifièrent les paroles de l’Éternel par son serviteur.
8.3.3. Ch. 14:15-18
Il n’y a pas d’incompatibilité entre le commandement de Moïse: «Tenez-vous là», et celui qui est donné maintenant: «Qu’ils marchent». Il convenait bien de leur rappeler qu’ils ne pouvaient rien faire; mais la foi aurait dû comprendre que l’œuvre était accomplie, et aurait dû marcher hardiment à travers la mer qui semblait arrêter l’avance du peuple. La mort et le pouvoir de la mort avaient été vaincus, la délivrance avait été opérée; aussi devaient-ils aller de l’avant. Tant l’ordre que l’enseignement qu’il apporte sont très beaux. L’Éternel accomplit l’œuvre, et par l’œuvre achevée du salut, une voie pour échapper au pouvoir de Satan a été ouverte au travers de la mort. Elle reste ouverte, et il appartient au croyant de s’y engager, d’avancer d’un pas assuré, dans la confiance que Celui qui était son Juge est devenu maintenant son Sauveur. C’est ce que l’Éternel va placer devant les Israélites dans le nouveau commandement qu’il donne à Moïse. Il manifestera sa puissance sur la mer devant les yeux du peuple pour apaiser ses craintes, et lui garantir sa protection et ses soins. Mais cela réclame des explications plus précises. Si Moïse doit commander aux enfants d’Israël de marcher, il reçoit en même temps l’ordre de lever sa verge, d’étendre sa main sur la mer et de la fendre pour que les fils d’Israël entrent au milieu de la mer à sec. Les Égyptiens dont le cœur aura été endurci, entreront après eux, ils les suivront pour leur propre destruction, et Dieu sera glorifié à la fois dans le salut de son peuple et dans l’anéantissement de leurs ennemis. Après avoir donné ces instructions à Moïse, l’Éternel passe à l’action.
8.4. Ch. 14:19, 20 — Sous la protection de l’Ange
Les différentes étapes de cette délivrance miraculeuse réclament notre attention. D’abord, l’Ange de l’Éternel part pour se placer «entre le camp des Égyptiens et le camp d’Israël». Dieu se met ainsi entre le peuple racheté par le sang et ses poursuivants. Car en fait, tout ce qu’il est, dans chacun des attributs de son caractère, est engagé en leur faveur. Cette multitude paniquée peut bien être l’objet des moqueries de l’élite de la cavalerie de l’Égypte, elle est sous la protection du Tout-Puissant; avant qu’elle puisse être atteinte, il fallait rencontrer et vaincre Dieu lui-même. Oh! quelle force et quelle consolation dans cette précieuse vérité: Dieu prend en main la cause du plus faible de ceux qui sont à l’abri du sang de Christ! Satan peut ranger toutes ses légions en ordre de bataille et chercher à terrifier l’âme par le déploiement de sa puissance, mais ses vanteries et ses menaces peuvent être ignorées, car la bataille est à l’Éternel. Il ne s’agit donc pas de ce que nous sommes, mais de ce que Dieu est. Et remarquons que celui qui est pour le croyant est contre l’ennemi. Ce qui éclairait les enfants d’Israël était pour le Pharaon et son armée une nuée et des ténèbres. La présence de l’Éternel terrifie tous ceux qui ne sont pas purifiés du péché par le précieux sang. Aussi le camp des Égyptiens fut-il coupé de celui d’Israël, et «l’un n’approcha pas de l’autre de toute la nuit» (v. 20). Ne devrions-nous pas être remplis d’assurance quand cette vérité — Dieu pour nous — est si pleinement révélée? Élisée en connaissait la puissance lorsque, pour répondre aux craintes exprimées par son serviteur, il affirma: «Ne crains pas; car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux». Alors, en réponse à la prière du prophète, le jeune homme eut les yeux ouverts, «et il vit: et voici la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d’Élisée» (2 Rois 6:15-17). Mais répétons-le, si Dieu est pour nous, c’est uniquement sur le fondement du sang précieux de Christ. C’est la première chose qui est enseignée ici: Dieu protège son peuple contre la puissance de Satan.
Chapitre 14, versets 21 à 31
8.5. Ch. 14:21-22 — Un passage à travers la mer
La division des eaux de la mer Rouge est le second point à relever. Moïse devait lever sa verge et étendre sa main sur la mer (v. 16). La verge est un symbole de l’autorité et de la puissance de Dieu; et ainsi c’est devant elle que les eaux se fendirent. Le fort vent d’orient est un instrument employé, mais en relation avec le commandement de Sa puissance exprimé dans l’emploi de la verge. Ainsi Dieu ouvrait à son peuple un chemin au travers de la mort. Comme d’un côté il les mettait à l’abri de la puissance de Satan, de l’autre, par la mort il les délivrait de la mort. Voilà la signification typique de la mer Rouge — la mort et aussi la résurrection — dans la mesure où le peuple fut amené sur l’autre rive. Pour reprendre les paroles d’un autre: «Quant au sens moral du type de la mer Rouge, c’est évidemment la mort et la résurrection de Jésus et de son peuple en Lui, sous l’aspect de l’accomplissement réel de l’œuvre, de sa propre efficace comme délivrance par rédemption. Dieu y agit pour faire sortir ce peuple, par la mort, du péché et de ce présent siècle, le délivrant absolument de l’un et de l’autre par la mort dans laquelle Il avait amené Christ, à l’abri, par conséquent, de toute atteinte de l’ennemi»1.
1 Études sur la Parole de Dieu, par J.N. Darby.
Deux détails illustrent cela d’une manière très belle. Ils «entrèrent au milieu de la mer à sec». Pourquoi? Parce que — nous parlons de l’enseignement symbolique — Christ était descendu dans la mort et en avait épuisé la puissance. Par sa mort il a vaincu la mort et dans la mort il a rencontré et aboli toute la puissance de Satan. Par la mort, il a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable, et a délivré tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient pendant toute leur vie, assujettis à la servitude (Héb. 2:14, 15).
Toute la force et la puissance de la mort se sont déversées sur Christ et, par conséquent, les croyants la «traversent à sec». De plus, nous lisons que «les eaux étaient pour eux un mur à leur droite et à leur gauche» (v. 22). Non seulement la mort n’avait plus de pouvoir sur eux, mais elle devenait une protection. Ainsi la mer qu’ils redoutaient et qui paraissait les livrer en la main du Pharaon, devient le moyen de leur salut. C’est par elle qu’ils furent délivrés d’Égypte; au lieu d’être leur ennemie, elle était devenue leur alliée.
L’accomplissement béni que tout cela a trouvé dans la mort et la résurrection de Christ devrait être familier à tout croyant. Non seulement nous avons été mis à l’abri du jugement par l’aspersion du sang, mais par la mort et la résurrection de Christ, et par notre mort et notre résurrection avec Lui, nous avons été conduits hors d’Égypte et délivrés de la puissance et de Satan et de la mort. Nous sommes déjà passés de la mort à la vie; nous avons été arrachés à notre ancienne condition et placés sur un terrain nouveau dans le Christ Jésus. Nous pouvons même faire un pas de plus et indiquer un accomplissement différent de ce type. La mort, qui est l’ennemie du pécheur, est devenue l’amie du croyant; c’est par elle que nous serons introduits dans la présence du Seigneur, si nous devons mourir avant Son retour.
8.6. Ch. 14:31 — La destruction des ennemis
Le dernier point à relever est la destruction des Égyptiens. Dans leur témérité et leur présomption audacieuse ils les «poursuivirent, et entrèrent après eux, tous les chevaux du Pharaon, cavaliers, au milieu de la mer». Même la colonne de feu ne les arrêta pas. Dans une vaine confiance en leur propre force, ils se précipitèrent au-devant d’un jugement sûr et certain. «Et il arriva, sur la veille du matin, que l’Éternel, dans la colonne de feu et de nuée, regarda l’armée des Égyptiens, et mit en désordre l’armée des Égyptiens. Et il ôta les roues de leurs chars, et fit qu’on les menait difficilement». Ils sont maintenant convaincus de l’inutilité de leur contestation, et voudraient bien s’enfuir: mais c’est trop tard.
Sur le commandement de l’Éternel, Moïse étendit une fois encore sa main sur la mer, et les eaux retournèrent et couvrirent toute l’armée des Égyptiens, de sorte qu’il «n’en resta pas même un seul» (v. 28). «Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche, ce que les Égyptiens ayant essayé, ils furent engloutis» (Héb. 11:29). Une leçon solennelle est ainsi enseignée: affronter la puissance de la mort dans la confiance humaine, c’est aller au-devant d’une destruction certaine. Seul le peuple racheté par le sang peut traverser en sécurité. Tous les autres seront infailliblement engloutis; et pourtant que d’âmes croient pouvoir rencontrer la mort et le jugement par leur propre force. Qu’elles pèsent l’avertissement donné par le sort du Pharaon et de son armée. Il ne peut pas y avoir de délivrance en dehors de Christ. Lui seul est le chemin du salut, car lui seul a rencontré la mort et l’a vaincue: il est celui qui a été mort, qui est ressuscité, qui est vivant aux siècles des siècles et qui tient les clés de la mort et du hadès.
Trois éléments viennent conclure ce chapitre. Il y a d’abord la répétition du fait qu’Israël a marché à sec au milieu de la mer, et que les eaux ont été pour eux un mur à leur droite et à leur gauche. L’accent est mis sur le contraste entre la délivrance d’Israël et la destruction des Égyptiens. Il y a donc deux classes de personnes et deux seulement: les perdus (les Égyptiens) et les sauvés (les Israélites). Les premiers furent engloutis dans la mort et le jugement; les seconds traversèrent en sécurité, parce qu’ils étaient protégés par la valeur du sang de l’agneau. Nous lisons ensuite que «l’Éternel délivra en ce jour-là Israël de la main des Égyptiens» (v. 30). Il les avait mis à l’abri du jugement, mais maintenant il les délivrait de la main de l’ennemi. La puissance de celui-ci était anéantie, et par conséquent ils étaient délivrés. Le chapitre suivant montrera la pleine signification de ce terme; mais remarquons que c’est ici pour la première fois que le mot «délivrés» prend son sens complet.
Enfin, l’effet produit sur l’âme des enfants d’Israël, est relevé. «Israël vit la grande puissance que l’Éternel avait déployée contre les Égyptiens; le peuple craignit l’Éternel, et ils crurent à l’Éternel, et à Moïse son serviteur». Un tel déploiement de puissance, en destruction d’une part et en rédemption de l’autre, avait touché leur cœur et produit en eux une sainte crainte. En Égypte, ils avaient sans doute craint l’Éternel, ils l’avaient redouté comme un Juge saint; mais maintenant, c’était une crainte d’un genre différent, suscitée par la manifestation de sa puissance en miracles, et qui les amenait à considérer comme leur Seigneur. C’était la crainte résultant d’une relation intime, la crainte de déplaire à celui qui en est l’objet. Elle découlait de ce qu’ils reconnaissaient la sainteté de Dieu dans leur salut. Le fait qu’eux aussi crurent à l’Éternel, et à Moïse son serviteur l’indique. Le témoignage de ce qu’Il était et de qui Il était avait été manifesté devant leurs yeux. Ils l’avaient reçu, et maintenant non seulement l’Éternel les avait choisis pour être son peuple, mais eux également, par la foi, le reconnaissaient et le recevaient comme leur Seigneur. Ils crurent aussi à Moïse, leur conducteur établi par Dieu. Ils ont effectivement été baptisés pour Moise dans la nuée et dans la mer (1 Cor. 10:2). Un travail avait donc été opéré à la fois pour eux et en eux, et tant l’un que l’autre procédaient de la puissance et de la grâce de Dieu. Celui qui, d’une manière si merveilleuse, les avait fait sortir d’Égypte et les avait conduits au travers de la mer Rouge, produisit dans leur cœur une réponse à ce qu’il était et à ce qu’il avait fait pour eux. Le salut n’est jamais compris ni goûté avant que ces deux points ne soient unis. Ainsi l’œuvre sur la base de laquelle Dieu peut sauver les pécheurs est achevée depuis longtemps; mais le pécheur n’est sauvé que lorsqu’il croit. «En vérité, en vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole, et qui croit celui qui m’a envoyé,a la vie éternelle et ne vient pas en jugement; mais il est passé de la mort à la vie» (Jean 5:24).
Chapitre 15, versets 1 à 21
Ce chapitre occupe une place très importante; d’une part il marque la position nouvelle dans laquelle les enfants d’Israël sont maintenant introduits, et d’autre part il exprime les sentiments, produits en eux sans aucun doute par le Saint Esprit, qui conviennent à cette position. C’est un véritable cantique de la délivrance; et, en même temps, il a un caractère prophétique, puisqu’il embrasse les conseils de Dieu envers Israël jusqu’au millénium, lorsque «l’Éternel régnera à toujours et à perpétuité» (v. 18). Ce cantique a donc un double caractère: d’abord en rapport avec Israël, et puis, dans la mesure où le passage de la mer Rouge a un caractère essentiellement symbolique en rapport aussi avec la position du croyant. Si nous gardons cela à l’esprit, nous comprendrons plus facilement la portée de ce chapitre.
9.1. Ch. 15:1-19 — Le premier cantique1
1 Au verset 2, la traduction: «et je lui préparerai une habitation» est plus que douteuse. Les Septante, la Vulgate et Luther le rendent tous: Il est mon Dieu, et je le célébrerai (ou: glorifierai), le Dieu de mon père, et je l’exalterai». (Ed.)
Le premier point à remarquer au sujet de cette explosion de joie, c’est que, dans les Écritures, nous ne trouvons aucun cantique qui ne soit plus ou moins directement en relation avec la rédemption. Même des anges, il n’est jamais dit qu’ils chantent. À la naissance du Seigneur, «il y eut avec l’ange une multitude de l’armée céleste, louant Dieu, et disant: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts; et sur la terre, paix; et bon plaisir dans les hommes!» (Luc 2:13, 14). De même, dans l’Apocalypse, Jean dit: J’entendis «une voix de beaucoup d’anges à l’entour du trône et des animaux et des anciens; et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers, disant à haute voix: Digne est l’Agneau qui a été immolé, de recevoir la puissance, et richesse, et sagesse, et force, et honneur, et gloire, et bénédiction» (Apoc. 5:11, 12). Ce sont donc seulement des êtres rachetés qui peuvent chanter et nous apprenons par là quel est le vrai caractère du chant chrétien. Il devrait être l’expression de la joie du salut, des accents de louange et de bonheur produits dans l’âme par la connaissance de la rédemption. «Quelqu’un est-il joyeux», dit Jacques, «qu’il chante des cantiques» (Jacq. 5:13). Autrement dit si quelqu’un est débordant d’une vraie joie, une joie découlant d’une rédemption connue, une joie dans le Seigneur comme Rédempteur, il devrait l’exprimer par la louange à Dieu. «Alors Moïse et les fils d’Israël chantèrent ce cantique à l’Éternel». Ce fut à ce moment-là, en contemplant pour la première fois ce qu’était la rédemption, qu’ils exprimèrent dans un cantique le bonheur de leur cœur. Il ne devrait y avoir, et en fait il n’y a pas d’autre cantique véritable pour le croyant. En avoir un autre sur ses lèvres, ce serait oublier son vrai caractère de chrétien, comme aussi l’unique source de sa joie.
9.2. La joie du salut
Le cantique lui-même peut être considéré sous deux aspects: son sujet général, et les vérités qu’il contient. Quant au sujet, c’est simplement l’Éternel lui-même et ce qu’il a fait. Mais cela embrasse beaucoup de choses. C’est l’Éternel lui-même révélé et connu dans la rédemption. «Jah est ma force et mon cantique, et il a été mon salut» (v. 2). Car c’est seulement dans la rédemption qu’il peut être connu. Ainsi jusqu’à la croix de Christ, il n’était pas, il ne pouvait pas être pleinement révélé. Il se manifesta aux enfants d’Israël dans le caractère de la relation dans laquelle ils furent amenés, mais c’est seulement après que fut accomplie la rédemption, dont le récit que nous avons ici n’était qu’un type, qu’il se révéla pleinement, dans tous les attributs de son caractère. Mais quel que fût, dans chacune des dispensations qui se succédèrent, le degré de sa manifestation, il ne pouvait être connu autrement que par la rédemption, en type ou réelle, et par la relation dans laquelle elle introduit les rachetés. Les enfants d’Israël le connaissaient comme l’Éternel; par grâce, nous le connaissons comme notre Dieu et Père, parce qu’il est le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ. Mais, quelle que soit la dispensation, il est toujours, Lui, tel qu’il se révèle, le sujet des cantiques des siens, car dans tous les âges, c’est en Lui seul qu’ils se réjouissent. Il y a cependant, comme nous l’avons fait remarquer, une autre chose: ce qu’il a fait; et cela paraît très clairement dans le cantique de Moïse et des fils d’Israël.
9.3. Deux motifs de louange
Il y a nécessairement deux aspects de cette œuvre: le salut de son peuple, et la destruction de leurs ennemis. Cela est exprimé de diverses manières et avec toute la grandeur qui convenait à la majesté de Celui qui avait opéré ainsi en leur faveur. Il ne s’agit pas de ce qu’ils avaient accompli, mais de ce que l’Éternel a fait. Ils ne célébraient pas leur triomphe, mais le sien. En présence d’un si merveilleux déploiement de puissance rédemptrice, ils s’oublient eux-mêmes. «Je chanterai à l’Éternel, car il s’est hautement élevé; il a précipité dans la mer le cheval et celui qui le montait» (v. 1). Ils magnifient l’Éternel, car, comme divinement inspirés, ils comprennent que l’œuvre que l’Éternel a accomplie était à sa propre gloire. «Ta droite, ô Éternel! s’est montrée magnifique en force»; et encore, «Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, terrible en louanges, opérant des merveilles» (v. 6, 11). Les croyants de la dispensation actuelle auraient certes beaucoup à apprendre de ce premier cantique de la rédemption, quant au caractère que devrait avoir leur louange lorsqu’ils sont rassemblés pour l’adoration, dans la puissance du Saint Esprit. Ce cantique de la rédemption, étant le premier, contient les principes de la louange pour toutes les générations à venir. Il mérite donc d’être examiné avec prières par chaque croyant.
C’est en considérant les vérités contenues dans ce cantique que nous en découvrons la plénitude et la variété. La première de ces vérités, c’est que maintenant les enfants d’Israël sont rachetés, la rédemption étant, comme nous l’avons fait remarquer, le refrain de leur cantique. «Jah est ma force et mon cantique, et il a été mon salut». Et encore: «Tu as conduit... ce peuple que tu as racheté». Jusqu’à ce moment, les Israélites n’étaient pas rachetés, ils ne connaissaient pas le salut. Ils avaient été mis, d’une manière parfaite, à l’abri du destructeur en Égypte, mais on ne pouvait pas dire qu’ils étaient sauvés avant qu’ils aient été conduits hors d’Égypte et délivrés du Pharaon, autrement dit de la puissance de Satan. La même distinction peut être faite aujourd’hui quant aux exercices d’une âme. Il y a beaucoup de personnes qui savent que leurs péchés leur sont pardonnés par le sang de Christ, mais qui ensuite, ne connaissant ni la nature de la chair qui est en elles ni la puissance de Satan en activité pour harceler et troubler, non seulement perdent la joie que leur avait apporté le pardon, mais parfois sont réduites, par les difficultés qui les assaillent de tous côtés, à un état d’abattement et de crainte. La prise de conscience de leur incapacité complète à faire quelque chose ou à résister à l’Ennemi les pousse à s’écrier, comme en Romains 7: «Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort?» (v. 24).
C’est alors que ces personnes apprennent que le Seigneur Jésus n’a pas seulement pourvu au lavage de leurs péchés par son précieux sang, mais que, par sa mort et sa résurrection, il les a tirées de leur ancienne condition et les a placées dans une position nouvelle en lui, au-delà de la mort et du jugement. Leurs yeux étant maintenant ouverts, elles voient qu’en lui elles ont été entièrement délivrées de tout ce qui était contre elles; que Satan a perdu ses droits sur elles et que, par conséquent, il n’a plus aucun pouvoir sur elles. Elles sont ainsi libérées; leur mauvaise nature a déjà été jugée; la puissance de Satan a été vaincue dans la mort de Christ; et, délivrées, elles ont maintenant le cœur rempli de reconnaissance et de louange.
Il n’est malheureusement que trop vrai que cette pleine bénédiction échappe à beaucoup, mais elle n’en est pas moins la portion de chaque croyant. Et il ne peut jamais y avoir une pleine assurance de salut, une paix ferme et inébranlable, tant que cette délivrance totale n’est pas connue. Elle doit, sans doute, être apprise par l’expérience, mais elle dépend entièrement et uniquement de ce que Christ est et a fait; aussi, cette bénédiction dans sa totalité est présentée aux pécheurs dans l’évangile de la grâce de Dieu. Il se peut que l’âme apprenne d’abord à connaître le pardon des péchés; mais il n’en reste pas moins qu’une complète rédemption est acquise et annoncée à tous ceux qui veulent recevoir le message de l’évangile. Il est de toute importance que cette vérité soit connue; car son ignorance fait de milliers de personnes la proie du doute et de la crainte, les empêchant de se réjouir dans le Seigneur, comme le Dieu de leur salut. Les âmes qui sont dans un tel état ont peu de liberté dans la prière, l’adoration ou le service; mais une fois que la vérité de la rédemption leur devient claire, elles sont contraintes, comme les enfants d’Israël dans la scène qui nous occupe, à donner libre cours à leur joie retrouvée, dans des cantiques de louange.
À suivre
Chapitre 15, versets 1 à 21 (suite)
9.4. Une position nouvelle
Mais il y a plus. Leur position est changée. «Tu l’as guidé [ce peuple] par ta force jusqu’à la demeure de ta sainteté». Ils étaient amenés à Dieu quant à la nouvelle position qu’ils occupaient. Au moment même où ils entraient dans le désert (et cela souligne leur caractère de pèlerins), ils étaient amenés à la demeure de la sainteté de Dieu. Cela correspond à notre position de croyants dans le Seigneur Jésus. Il «a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu’il nous amenât à Dieu». Voilà notre place comme ses rachetés. C’est-à-dire que nous sommes amenés à Dieu, en plein accord avec tout ce qu’il est; Dieu dans toute sa nature morale, ayant été parfaitement satisfait dans la mort de Christ, peut maintenant trouver en nous une parfaite satisfaction.
Cette place, il est vrai, nous est accordée en grâce, mais elle ne l’est pas moins en justice; de sorte que non seulement tous les attributs du caractère de Dieu sont engagés en nous y amenant, mais il est lui-même glorifié en le faisant. C’est une pensée très solennelle, et bien propre, si nous nous y arrêtons, à fortifier et encourager notre âme, de savoir que maintenant déjà nous sommes amenés à Dieu. Toute la distance qui nous séparait de Dieu, distance dont la mesure nous est donnée par la mort de Christ sur la croix lorsqu’il fut fait péché pour nous, a été franchie, et notre position de proximité est garantie par la place qu’il occupe maintenant, glorifié à la droite de Dieu. Même dans le ciel, nous ne serons pas plus près de Dieu que maintenant quant à notre position, car elle est en Christ. N’oublions cependant pas que notre jouissance de cette vérité, et même notre faculté de la comprendre, dépendront de notre état pratique. Dieu attend un état qui corresponde à notre position, c’est-à-dire que notre responsabilité est à la mesure de nos privilèges. Mais jusqu’à ce que nous connaissions notre position, il ne peut y avoir un état qui y corresponde. Il nous faut d’abord apprendre que nous sommes amenés à Dieu pour pouvoir, en quelque mesure, marcher en accord avec cette position. L’état et la marche doivent toujours découler d’une relation connue. À moins donc que la vérité de notre position devant Dieu ne nous soit enseignée, nous n’y répondrons jamais dans notre âme, ni dans notre conduite.
9.5. Un héritage assuré
Le troisième aspect de la vérité, c’est que la position présente des Israélites garantissait l’accomplissement de tout le reste. «Tu les introduiras et tu les planteras sur la montagne de ton héritage, le lieu que tu as préparé pour ton habitation, ô Éternel! le sanctuaire, ô Seigneur! que tes mains ont établi. L’Éternel régnera à toujours et à perpétuité» (v. 17, 18). La puissance que Dieu avait déployée à la mer Rouge était la garantie que, premièrement, il accomplirait tous ses propos envers Israël; et secondement, que cette puissance aurait sa manifestation finale dans son règne éternel. La foi, produite par la connaissance de la rédemption, s’empare de ces faits; elle comprend toute l’étendue des propos de Dieu et les considère comme s’ils étaient déjà accomplis. C’est ce que nous avons dans l’épître aux Romains. «Ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés» (Rom. 8:30).
Dieu ne serait pas Dieu si ses desseins pouvaient être déjoués. Il peut y avoir des ennemis dans le chemin, et ceux-ci peuvent chercher à s’opposer à l’exécution de la volonté déclarée de Dieu. Mais la foi s’écrie: «Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?» Ainsi, Israël pouvait chanter: «Les peuples l’ont entendu, ils ont tremblé; l’effroi a saisi les habitants de la Philistie. Alors les chefs d’Edom ont été épouvantés; le tremblement a saisi les forts de Moab; tous les habitants de Canaan se sont fondus. La crainte et la frayeur sont tombées sur eux: par la grandeur de ton bras ils sont devenus muets comme une pierre, jusqu’à ce que ton peuple, ô Éternel, ait passé, jusqu’à ce qu’ait passé ce peuple que tu t’es acquis» (v. 14-16). De la même manière, l’apôtre s’écrie: «Qui est-ce qui nous séparera de l’amour du Christ? Tribulation, ou détresse, ou persécution, ou famine, ou nudité, ou péril, ou épée?» Non, rien, car il est «assuré que ni mort, ni vie, ni anges, ni principautés, ni choses présentes, ni choses à venir, ni puissances, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu, qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur» (Rom. 8:35-39). L’efficacité du sang assure l’accomplissement de tous les propos de Dieu, introduit tout ce qu’il est: sa majesté, sa vérité, sa miséricorde, son amour, sa toute-puissance, en faveur des siens.
Ce n’est donc pas de la présomption, mais c’est la simplicité de foi, que d’anticiper le plein résultat de notre rédemption. Ce n’est pas mésestimer le caractère et la force de nos ennemis; mais, les mesurant à ce que Dieu est, l’âme est aussitôt assurée d’être plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. C’est faire ressortir la consolation pleine et bénie de la vérité que Dieu agit par sa propre puissance, en dehors de nous, et pour sa propre gloire. Les armées de Satan (les chefs d’Edom, les forts de Moab, et les habitants de Canaan) peuvent bien chercher à barrer le chemin de l’héritage, mais quand Dieu se lève dans sa puissance, en faveur de son peuple placé sous l’aspersion du sang, elles sont dispersées, comme la paille par le vent. Ainsi, l’issue est certaine dès le commencement, et le chant triomphant de la victoire peut s’élever avant que nous ayons fait un seul pas dans le chemin du désert. Le dénouement sera à la gloire de Celui qui nous a rachetés. «L’Éternel régnera à toujours et à perpétuité». Aussi lisons-nous dans l’épître aux Philippiens que c’est selon le propos et le décret de Dieu, «qu’au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes, et terrestres, et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père» (Phil. 2:9-11).
Quelle joie pour le cœur du croyant de savoir que le résultat de la rédemption, qui l’introduit dans une bénédiction inexprimable, est l’exaltation du Rédempteur. Dans ce passage, le règne mentionné s’applique indubitablement en premier lieu à la terre. C’est le royaume éternel de Jéhovah, le règne millénaire du Messie qui doit dominer jusqu’à ce qu’il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Mais, quant au principe, cela va plus loin, car il régnera à toujours et à perpétuité; et cela aussi sera le fruit de l’œuvre de la croix. Là, il s’est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu’à la mort, et à la mort de la croix, et la conséquence en est que maintenant il est exalté et qu’il le sera pour l’éternité.
À suivre
Chapitre 15, versets 1 à 21 (suite)
9.6. Une habitation pour Dieu
Jusqu’ici, tout ce que nous avons considéré est en rapport avec les desseins de Dieu. Mais, au verset 2, il y a une exception. Aussitôt que les Israélites peuvent dire: «Jah est ma force et mon cantique, et il a été mon salut», ils ajoutent: «Il est mon Dieu, et je lui préparerai une habitation1, — le Dieu de mon père, et je l’exalterai». C’est une chose différente du «sanctuaire... que tes mains ont établi», du verset 17. Celui-ci se rapporte à l’accomplissement des conseils de Dieu dans l’établissement du royaume et du temple à Jérusalem. Tandis que celui-là devait être une chose présente: «Je lui préparerai une habitation». C’est, en fait, le tabernacle. Cela sera placé devant nous d’une façon plus claire dans les chapitres suivants; mais nous pouvons remarquer que c’est ici la première fois qu’il est fait mention d’une habitation pour l’Éternel au milieu de son peuple. Dieu avait des saints auparavant, mais pas un peuple; et il n’habita jamais sur la terre avant que la rédemption ne fût accomplie. Il visitait ses saints, se manifestait à eux de différentes manières, mais jamais il n’a eu son habitation au milieu d’eux. Cependant aussitôt l’expiation du péché accomplie par le sang de l’agneau, et aussitôt le peuple conduit hors d’Égypte, après avoir été sauvé par la mort et la résurrection, Dieu met au cœur des siens de lui préparer une habitation2. Dès le début de leur exode, l’Éternel les conduisit, allant devant eux, de jour dans une colonne de nuée et de nuit, dans une colonne de feu. Mais il ne pouvait avoir un lieu d’habitation en Égypte, sur le territoire de l’ennemi. Une fois les Israélites placés sur un terrain nouveau, l’Éternel peut s’identifier avec eux, habiter au milieu d’eux, être leur Dieu, et eux, son peuple.
1 On peut certes se demander si le mot hébreu est traduit correctement ici (voir la note plus haut). Mais les commentaires faits sur le texte français peuvent être maintenus; car la vérité est de toute importance. (Ed.)
2 La pensée de bâtir un sanctuaire venait de Dieu, et non pas d’Israël (voir chap. 25:8). C’était le désir de l’Éternel d’habiter au milieu de ses rachetés.
Il en est de même dans la chrétienté. Ce n’est que lorsque l’expiation eut été accomplie et que Christ fut ressuscité d’entre les morts et monté en haut, que Dieu établit son habitation actuelle sur la terre par l’Esprit (Actes 2; Éph. 2). Et il en est de même encore pour le croyant individuellement. C’est seulement après qu’il a été lavé par le sang de Christ que son corps devient le temple du Saint Esprit. La vérité qui se dégage est donc que l’habitation de Dieu sur la terre est fondée sur une rédemption accomplie. Et quel privilège immense! Bien que le désert ne fasse pas partie des propos de Dieu, cependant, dans sa manière d’agir envers les siens, il les y fit marcher quarante ans. Quel privilège alors, pour ces pèlerins fatigués avançant vers l’héritage, d’avoir au milieu d’eux l’habitation de Dieu; un lieu où ils pouvaient s’approcher de lui par les sacrificateurs désignés, avec des sacrifices et de l’encens; le centre également de leur camp. Combien les Israélites pieux devaient être encouragés à la vue de ce tabernacle sur lequel reposait la nuée, symbole de la présence divine! On comprend ainsi le cri d’angoisse de Moïse, après la chute de ce peuple: «Si ta face ne vient pas, ne nous fais pas monter d’ici; car à quoi connaîtra-t-on que j’ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas en ce que tu marcheras avec nous?» (Ex. 33:15, 16).
Nous ne devrions pas oublier que maintenant aussi Dieu a son habitation sur la terre. Cette vérité risque d’être ignorée au milieu de la confusion de la chrétienté. Mais, malgré nos manquements, Dieu habite dans la maison qu’il a établie, et il y demeurera jusqu’au retour du Seigneur. Cette vérité devrait aussi nous encourager et nous consoler; car ce n’est pas peu de chose que d’être retirés de la sphère et du pouvoir de Satan pour être introduits dans la scène de la présence et de la puissance de Dieu. C’est le seul lieu de bénédiction sur la terre, et bienheureux ceux qui en ont été rendus participants par la grâce de Dieu, dans la puissance du Saint Esprit.
9.7. Marie et son tambourin
Ce n’était pas une joie ordinaire qui était exprimée dans ce cantique de louange triomphante. Tout le camp en était pénétré; car «Marie, la prophétesse, sœur d’Aaron, prit un tambourin en sa main, et toutes les femmes sortirent après elle, avec des tambourins et en chœurs» (v. 20). Et Marie, dirigeant le chant, leur répondait: «Chantez à l’Éternel, car il s’est hautement élevé; il a précipité dans la mer le cheval et celui qui le montait» (v. 21). C’est la première fois que Marie est mentionnée par nom, et il est extrêmement intéressant de remarquer qu’elle était prophétesse. C’était elle, très probablement, qui avait veillé sur le coffret de joncs lequel son petit frère Moïse avait été placé, et qui avait été le moyen par lequel l’enfant avait été rendu à sa mère. Elle a ainsi une place d’honneur en Israël, non seulement à cause de ses liens avec Moïse, mais aussi par son propre don distinct. C’est la manière de Dieu de bénir tous ceux qui sont liés à l’homme de son conseil; et cela nous révèle en même temps combien le lien de la famille est sacré à ses yeux. Mais dans la scène qui nous occupe, Marie eut l’honneur et le privilège d’être à la tête des femmes en Israël et d’être l’interprète de leur joie. Tous les cœurs étaient pleins de joie et trouvaient leur expression dans la musique, les danses et les chœurs. Le peuple était racheté et il le savait en cette heureuse journée; débordant de la joie de son salut, il l’exprimait par ces accents de reconnaissance et de louange.
10. Exode 15:22-27 — Mara et Élim
Les chapitres 15:22 à 18:27 forment une partie distincte du livre. Pour bien la comprendre, il faut se souvenir que jusqu’à ce moment, Israël n’était pas encore sous la loi, mais sous la grâce; c’est ainsi que cette brève période prend fin, en figure, avec le millénium. Le lecteur attentif trouvera dans cette constatation la clé de la plupart des événements rapportés ici. Par exemple, l’Éternel supporte avec patience et indulgence les murmures mentionnés aux chapitres 15; 16 et 17, et la plénitude de son inlassable amour répond aux besoins du peuple. Mais après Sinaï, des murmures du même caractère attirent le jugement, pour la simple raison que le peuple a été placé sous la loi à sa propre requête. Les enfants d’Israël étant alors sous le règne de la justice, les transgressions et la rébellion sont aussitôt traitées selon les exigences de la loi qui était à la base du juste gouvernement de l’Éternel. Tandis qu’avant Sinaï, les Israélites étant sous le règne de la grâce, l’Éternel les supporte, et leurs péchés et leurs iniquités sont couverts.
Pour Israël, la traversée du désert allait maintenant commencer. Les accents de leur cantique s’étaient à peine tus, qu’ils se mettaient en route pour leur pèlerinage.
Chapitre 15, versets 22 à 27
10.1. Ch. 15:22-27 — Trois jours sans eau
Ce fut donc là leur première expérience: «Ils marchèrent trois jours dans le désert, et ne trouvèrent point d’eau». L’expression «trois jours», dans les Écritures, est toujours significative. Très souvent, elle est associée à la mort; et ainsi, dans ce verset, les trois jours nous parlent de la distance de la mort. Les Israélites avaient passé, en figure, par la mort; maintenant, ils doivent l’apprendre pratiquement. Si Dieu, dans sa grâce, nous donne une position parfaite devant lui, s’il nous associe à Christ dans sa mort et sa résurrection, le but de toutes ses voies envers nous sera de nous amener dans une conformité pratique à notre nouvelle position. Les enfants d’Israël devaient ainsi apprendre qu’en conséquence de leur délivrance d’Égypte, le monde était devenu un désert pour eux, et que cela devait être réalisé par l’acceptation de la mort. C’est une nécessité fondamentale pour tout croyant. Il ne peut pas y avoir de progrès, pas de véritable rupture avec le passé, avant que la mort soit acceptée, avant que le croyant se reconnaisse comme mort au péché (Rom. 6), mort à la loi (Rom. 7) et mort au monde (Gal. 6).
D’où le caractère des voies de Dieu envers les âmes. Il veut les enseigner par l’expérience, comme dans le cas d’Israël qui est placé devant nous, et les rendre ainsi capables de comprendre le vrai caractère du chemin sur lequel ils sont engagés. Et quelle fut la première expérience d’Israël? Ils ne trouvèrent point d’eau. Comme le psalmiste, ils se trouvaient dans une terre aride et altérée, sans eau (Ps. 63). Toutes les sources de la terre sont taries pour ceux qui ont été rachetés d’Égypte. Il n’y a pas une seule source de vie, rien qui puisse servir en aucune manière à la vie que nous avons reçue en Christ. Quel progrès pour l’âme qui saisit cette vérité. Au début de notre pèlerinage, tout à la joie de notre salut, combien souvent ne sommes-nous pas surpris de découvrir que les sources auxquelles nous avions bu auparavant, et bu avec délices, étaient maintenant sèches. Nous devions nous y attendre; mais la leçon n’est jamais comprise avant que nous soyons allés le chemin de trois jours dans le désert. Découvrir que les ressources de la terre sont épuisées est une expérience vraiment saisissante, mais elle est absolument indispensable pour que nous connaissions la bénédiction renfermée dans cette vérité: «Toutes mes sources sont en toi!»
10.2. Mara
Les Israélites marchèrent et arrivèrent à Mara. Là, il y avait de l’eau; mais ils ne pouvaient boire des eaux de Mara, car elles étaient amères. C’est une autre application du même principe. D’abord, il n’y avait point d’eau à boire; et ensuite, lorsqu’elle est trouvée, elle est si amère qu’on ne peut la boire. C’est l’application à l’âme de la puissance de cette mort par laquelle les enfants d’Israël avaient été délivrés. La chair recule devant cette application et aimerait la mettre tout à fait de côté. Mais elle est absolument nécessaire à ceux qui ont été délivrés d’Égypte, et qui sont des pèlerins en route vers l’héritage. Certes, c’est Mara — amertume; et ainsi le peuple en est troublé, et il murmure contre Moïse, disant: Que boirons-nous? Quel contraste! Quelques jours auparavant, d’un seul cœur, les Israélites, remplis de joie, chantaient les louanges de leur Rédempteur; maintenant le cantique s’est tu, et des murmures discordants s’élèvent à sa place. Il en est de même du croyant: pendant un moment son cœur déborde de louanges, et un instant après la chair se plaint et murmure à cause des épreuves du désert. Mais Moïse intercède pour le peuple; et l’Éternel lui enseigne un bois qui, une fois jeté dans les eaux, les rend douces. C’est une image magnifique de la croix de Christ, qui change entièrement le caractère des eaux amères. «De celui qui mange est sorti le manger, et du fort est sortie la douceur» (Juges 14:14). Ou, comme le dit l’apôtre Paul: «Qu’il ne m’arrive pas à moi de me glorifier, sinon en la croix de notre Seigneur Jésus Christ, par laquelle le monde m’est crucifié, et moi au monde» (Gal. 6:14). Introduisez la croix dans l’amertume des eaux de Mara, et aussitôt elles deviendront douces au palais, elles sont accueillies comme le moyen de la délivrance et de la bénédiction.
Un principe extrêmement important vient ensuite — principe qui est toujours applicable à la marche du croyant et qui se retrouve tout au long des Écritures, et dans chaque dispensation: c’est que la bénédiction dépend de l’obéissance. Donc, la bénédiction des croyants (car les enfants d’Israël étaient maintenant des rachetés) dépend de leur marche. Les Israélites seraient préservés des maladies de l’Égypte, s’ils écoutaient attentivement la voix de l’Éternel, leur Dieu, et faisaient ce qui est droit à ses yeux, etc. (v. 26). Le Seigneur dit pareillement: «Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera; et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui» (Jean 14:23). On ne peut pas assez insister sur ce principe. Il y a de nombreux croyants qui ont connu la joie du salut, et qui pourtant ont perdu la jouissance consciente de leur bénédiction. La raison en est qu’ils sont négligents quant à leur conduite. Ils n’étudient pas la Parole, ou ne prêtent pas l’oreille à ses commandements, et marchent, par conséquent, comme bon leur semble. Quoi d’étonnant alors à ce qu’ils soient froids et indifférents, qu’ils ne jouissent pas consciemment de l’amour de Dieu, de la communion avec le Père et avec son Fils Jésus Christ?
C’est à ceux qui obéissent que Dieu se plaît à venir, dans les plus douces manifestations de son amour immuable. C’est de ceux qui prêtent attention à chaque précepte de la Parole, de ceux qui cherchent, par la puissance de l’Esprit, à être trouvés dans un chemin d’obéissance pour chaque détail, de ceux dont les délices sont de faire la volonté de leur Seigneur et dont le seul but est de lui être agréables en tout temps, qu’il peut s’approcher, et c’est eux qu’il peut bénir selon sa pensée d’amour. Rien ne peut compenser l’absence d’une marche d’obéissance. Toute notre bénédiction, quant à sa réalisation et à sa jouissance, dépend de cela. Plus encore, elle est le moyen de notre croissance et la condition de notre communion.
10.3. Élim
C’est pour cela qu’il est aussitôt ajouté: «Puis ils vinrent à Élim, où il y avait douze fontaines d’eau et soixante-dix palmiers; et ils campèrent là, auprès des eaux». Tout de suite ils trouvèrent du rafraîchissement, du repos et de l’ombre — les fontaines et les palmiers étant, comme l’a dit quelqu’un, «des figures... de ces sources vivantes et de cet ombrage qui ont été fournis pour la consolation du peuple par les instruments choisis de Dieu»1. Combien le repos était bienvenu pour ces pèlerins déjà fatigués! et quelle grâce du Seigneur de préparer un rafraîchissement si agréable pour les siens dans le désert! Comme berger d’Israël, il les conduisit, pour ainsi dire, dans de verts pâturages et les fit reposer à des eaux paisibles pour consoler et réconforter leur cœur2.
1 Études sur la Parole de Dieu, par J.N. Darby.
2 Sans aucun doute, les nombres douze et soixante-dix sont significatifs. Douze, c’est la perfection administrative en gouvernement dans l’homme (Israël). Soixante-dix n’est pas aussi clair. Mais souvenons-nous que le Seigneur a choisi ces deux nombres, dans les douze disciples et dans les soixante-dix (Luc 9; 10); ainsi, il semblerait que ce soit une allusion au fait que par leur moyen, il annoncerait ces bénédictions à Isræl.
Chapitre 16, versets 1 à 12
11. Exode 16 — La manne
Les rafraîchissements d’Élim, expression de l’amour et de la tendresse de l’Éternel, n’étaient cependant que passagers. Les enfants d’Israël étaient des pèlerins; et comme tels, leur vocation était de voyager, non pas de se reposer. Aussi l’étape suivante de leur marche est-elle aussitôt rapportée.
11.1. Ch. 16:1-3 — Murmures
Le désert de Sin s’étend «entre Élim et Sinaï». Il occupait donc, comme cela a d’ailleurs déjà été indiqué, une place très spéciale dans l’histoire des fils d’Israël. Élim leur rappellerait toujours une de leurs expériences les plus bénies, de même que le trajet jusqu’à Sinaï replacerait devant leur esprit la longue patience et la grâce de Dieu. Sinaï, en revanche, resterait gravé à jamais dans leur mémoire en relation avec la majesté et la sainteté de la loi. Jusqu’à Sinaï, nous avons ce que Dieu était pour les Israélites, dans sa miséricorde et son amour; mais dès ce moment, et par leur propre volonté, le fondement change et devient ce qu’ils étaient, eux, pour Dieu. C’est là la différence entre la grâce et la loi, d’où l’intérêt particulier se rattachant aux étapes des Israélites entre Élim et Sinaï. Mais, sous la grâce comme sous la loi, la chair restait la même, et ne perdait pas une occasion de manifester son caractère corrompu et incurable. De nouveau, toute l’assemblée des fils d’Israël murmura contre Moïse et contre Aaron dans le désert (v. 2). Ils avaient murmuré à Pi-Hahiroth, lorsqu’ils avaient vu l’armée du Pharaon s’approcher; ils étaient retombés dans le même péché à Mara, parce que les eaux étaient amères; et maintenant, ils se plaignaient encore, à cause de leur condition de pèlerins. «Ils oublièrent vite ses œuvres, ils ne s’attendirent point à son conseil. Et ils furent remplis de convoitise dans le désert, et ils tentèrent Dieu dans le lieu désolé» (Ps. 106:13, 14).
Le souvenir de l’Égypte et de la nourriture de l’Égypte occupait leur cœur, et oubliant le dur esclavage auquel tout cela était lié, ils regardaient avec regret en arrière. Combien souvent n’est-ce pas le cas pour les âmes nouvellement délivrées! Dans le désert; la faim doit toujours être ressentie: car la chair ne peut trouver aucune satisfaction à ses propres désirs, aucun plaisir dans les peines et les fatigues qu’il offre. C’est le lieu où la chair doit être mise à l’épreuve. L’Éternel «t’a humilié, et t’a fait avoir faim; et il t’a fait manger la manne que tu n’avais pas connue et que tes pères n’ont pas connue, afin de te faire connaître que l’homme ne vit pas de pain seulement, mais que l’homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de l’Éternel» (Deut. 8:3). C’est là qu’est le conflit. La chair languit après ce qui répondra à ses désirs, mais si nous sommes délivrés d’Égypte, nous ne pouvons pas lui céder: la chair doit être tenue pour morte, considérée comme déjà jugée dans la mort de Christ: c’est pourquoi nous sommes débiteurs, non pas à la chair pour vivre selon la chair; car si nous vivons selon la chair, nous mourrons; mais si par l’Esprit nous faisons mourir les actions du corps, nous vivrons (Rom. 8:12, 13).
Mais, comme nous l’avons vu dans le Deutéronome, Dieu a un but en permettant que nous ayons faim; c’est de nous détacher des «pots de chair» de l’Égypte, et de nous attirer à lui, pour nous enseigner que la vraie satisfaction, la vraie nourriture ne peuvent être trouvées qu’en lui et en sa Parole. Le contraste est donc établi entre les aliments de l’Égypte et Christ; et quel bonheur lorsqu’une âme apprend que Christ suffit à tous ses besoins! Dans leur incrédulité, les enfants d’Israël accusaient Moïse de vouloir les faire mourir de faim. Mais leur faim avait pour but de susciter en eux un autre appétit, par lequel seul leur vraie vie pourrait être entretenue. L’Éternel, cependant, répondit à leur requête, bien qu’il envoyât la misère dans leurs âmes. Car comme nous le verrons, il leurs donna les cailles aussi bien que la manne.
11.2. Ch. 16:4-12 — La grâce et ses réponses
Avant de parler de la manne, nous désirons attirer l’attention sur deux ou trois points. Le premier est la grâce avec laquelle Dieu répond aux désirs du peuple. En Nombres 11, il répond aussi à leur désir, dans des circonstances analogues; mais «la colère de l’Éternel s’embrasa contre le peuple, et... l’Éternel frappa le peuple d’un fort grand coup» (v. 33). Ici, il n’y pas trace de jugement — seulement la grâce, pleine de patience et de support. La différence provient, si nous pouvons l’énoncer ainsi, de la dispensation. Dans les Nombres, les Israélites étaient sous la loi, et Dieu agit envers eux en conséquence. Ici ils sont sous la grâce, et celle-ci règne malgré leur péché. Deuxièmement, leurs murmures furent l’occasion de la manifestation de la gloire de l’Éternel (v. 10). Ainsi, la manifestation de ce qu’est l’homme fait jaillir du cœur de Dieu la révélation de ce qu’il est Lui. Ce fut le cas dans le jardin d’Eden, et cela se retrouve tout au long de ses voies avec l’homme. Ce principe apparaît en perfection à la croix, où l’homme se manifesta dans toute l’horrible corruption de sa mauvaise nature, et où Dieu fut pleinement révélé. La lumière luit dans les ténèbres, même si les ténèbres ne la comprennent pas et, en fait, la gloire du Seigneur brille d’un éclat d’autant plus grand que sont profondes les ténèbres de l’iniquité de l’homme, iniquité qui devient l’occasion du déploiement de cette gloire. Remarquons encore que murmurer contre Moïse et Aaron, c’était murmurer contre l’Éternel (v. 8). Tout péché est, en fait, contre Dieu (voir Ps. 51:4; Luc 15:18-21). C’est pour cela que l’Éternel dit: «J’ai entendu les murmures des fils d’Israël» (v. 12). Nous ne nous souvenons pas assez que toutes nos plaintes, nos expressions d’incrédulité, nos murmures, sont en fait contre Dieu et parviennent aussitôt à ses oreilles.
11.3. Convoitise
Combien souvent nos paroles coupables ne mourraient-elles pas sur nos lèvres si cette pensée occupait notre esprit! Si le Seigneur était présent à nos yeux, nous n’oserions pas exprimer ce que souvent, dans l’emportement de notre incrédulité, nous nous permettons de dire. Et pourtant, nous sommes réellement devant Lui; ses yeux sont sur nous, et il entend chacune de nos paroles (voir par exemple Jean 20:26, 27). Remarquons enfin la différence entre les cailles et la manne. Aucun enseignement particulier ne se rattache aux cailles, tandis que nous verrons que la manne est un type très frappant du Seigneur Jésus. Les cailles furent donc données pour satisfaire les désirs du peuple, mais elles n’apportaient aucune bénédiction. À propos de celles de Nombres 11, le psalmiste dira: «Il leur donna ce qu’ils avaient demandé, mais il envoya la consomption dans leurs âmes». Dieu peut écouter le cri de son peuple, même le cri d’incrédulité, et il peut leur accorder leurs désirs, mais comme discipline plutôt que comme bénédiction présente. Ainsi, plus d’un croyant, oubliant sa vraie part en Christ, a désiré les choses de ce monde, les «pots de chair» de l’Égypte; il lui a été accordé de parvenir à son but, mais la conséquence en a été le dénuement, et un dénuement tel que son âme n’a été restaurée que par les épreuves disciplinaires envoyées par la main d’amour du Seigneur. Si, de cœur, nous retournons en Égypte, et qu’il nous est accordé de satisfaire nos désirs, cela ne nous conduira qu’aux larmes dans des jours à venir. Comme par exemple l’apôtre Paul l’écrit à Timothée: «Ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans un piège, et dans plusieurs désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition; car c’est une racine de toutes sortes de maux que l’amour de l’argent: ce que quelques-uns ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi et se transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs» (1 Tim. 6:9, 10). Ce n’est là qu’un exemple de retour en Égypte, mais le principe s’applique à tout objet que la chair peut désirer.
Chapitre 16, versets 13 à 36
Nous arrivons maintenant au récit du don effectif des cailles et de la manne.
11.4. Ch. 16:13-21 — Les cailles et la manne
Remarquons que les cailles sont à peine mentionnées, et la signification de ce fait a déjà été indiquée, tandis qu’il y a une description complète de la manne. C’est donc la manne qui nous concerne plus particulièrement. Lorsque la couche de rosée se leva, «voici sur la surface du désert quelque chose de menu, de grenu, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Et les fils d’Israël le virent, et se dirent l’un à l’autre: Qu’est-ce que cela? Car ils ne savaient ce que c’était. Et Moïse leur dit: C’est le pain que l’Éternel vous a donné à manger» (v. 14, 15). Voilà donc la signification de la manne: le pain que Dieu a donné à manger aux Israélites dans le désert. Autrement dit la nourriture propre au désert pour le peuple de Dieu. Ainsi, lorsque les Juifs dirent au Seigneur: «Nos pères ont mangé la manne au désert, ainsi qu’il est écrit: «Il leur a donné à manger du pain venant du ciel», il leur répondit: «En vérité, en vérité, je vous dis: Moïse ne vous a pas donné le pain qui vient du ciel, mais mon Père vous donne le véritable pain qui vient du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel, et qui donne la vie au monde» (Jean 6:32, 33. Lire spécialement les versets 48 à 58). Il est donc clair que la manne est un type de Christ, de Christ tel qu’il était dans ce monde, comme celui qui est descendu du ciel et qui, comme tel, devient la nourriture des siens durant la traversée du désert. Il faut bien remarquer que nous ne pouvons pas nous nourrir de Christ, comme de la manne, avant d’avoir la vie, nous étant nourri de sa mort, ayant «mangé sa chair et bu son sang» (voir Jean 6:53, 54). Après que nous avons reçu la vie, il nous est dit: «Comme le Père qui est vivant m’a envoyé, et que moi, je vis à cause du Père, de même celui qui me mangera, celui-là aussi vivra à cause de moi» (v. 57).
11.5. Christ: la nourriture des siens
Nous laissons au lecteur le soin d’étudier pour lui-même ce passage significatif, et nous nous bornerons à rappeler les deux points mentionnés: premièrement, que la manne dans notre chapitre présente Christ; et secondement, que Christ, dans ce caractère, est la nourriture des siens pendant leur traversée du désert. Il y a une différence entre les enfants d’Israël et les croyants de cette dispensation. Les premiers ne pouvaient être qu’en un seul lieu à la fois, car nous avons ici un récit historique réel. Les seconds, les chrétiens, sont à deux endroits: leur place est dans les lieux célestes en Christ (voir Éphésiens 2); et, quant à leurs circonstances présentes, ils sont des pèlerins dans le désert. En tant que placés dans les lieux célestes, notre nourriture est un Christ glorifié, typifié par le vieux blé du pays (Josué 5:12); mais dans les circonstances du désert, c’est Christ tel qu’il était ici-bas, Christ comme la manne, qui répond à nos besoins.
Dans la lassitude et les fatigues de notre sentier de pèlerins, quel bonheur et quel réconfort de pouvoir nous nourrir de la grâce et de la sympathie d’un Christ humilié. Combien nous aimons à nous souvenir qu’il a passé par les mêmes circonstances; et que, de ce fait, il connaît nos besoins et trouve sa joie à y répondre, pour notre encouragement et notre bénédiction. C’est à cet effet que l’auteur de l’épître aux Hébreux dit: «Considérez celui qui a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même, afin que vous ne soyez pas las, étant découragés dans vos âmes» (Héb. 12:3). Comme un autre l’a dit, en présentant ce sujet: «Ainsi, lorsque quelque chose me rend impatient au cours de la journée, eh bien, Christ est ma patience et ainsi, il est la manne pour me garder patient. Il est la source de la grâce, non pas simplement l’exemple que j’ai à imiter»; et c’est comme source de grâce, de sympathie et de force, pour nous dans le désert, que Christ est la manne de nos âmes.
11.6. Comment recueillir la manne
Il y a quelques directives pratiques quant à la manière de recueillir la manne qui sont de la plus grande importance. Premièrement, les enfants d’Israël devaient la recueillir chacun en proportion de ce qu’il pouvait manger (v. 16-18). Ainsi celui qui avait beaucoup n’avait pas trop; et celui qui avait peu, n’en manquait pas. L’appétit déterminait la quantité à recueillir. Combien cela n’est-il pas vrai du croyant! Nous avons tous autant de Christ que nous le désirons, ni plus, ni moins. Si nos désirs sont grands, si nous ouvrons notre bouche toute grande, il la remplira. Nous ne pouvons pas désirer trop, ni être déçus dans ce désir. D’un autre côté, si nous ne sommes que faiblement conscients de nos besoins, nous n’aurons qu’un petit peu de Christ. Ainsi la mesure dans laquelle nous nous nourrissons de lui, comme notre pain dans le désert, dépend-elle entièrement des besoins spirituels que nous ressentons, de notre appétit.
Deuxièmement, la manne ne pouvait pas être accumulée pour être mangée plus tard. Personne ne devait en laisser de reste jusqu’au matin. Certains désobéirent à cette injonction, mais ils durent constater que ce qu’ils avaient ainsi laissé de reste s’était corrompu. La nourriture récoltée aujourd’hui ne pourra pas nous soutenir demain. Ce n’est que dans un exercice présent de l’âme que nous pouvons nous nourrir de Christ. L’oubli de ce principe a entraîné de grands dommages pour beaucoup de personnes. Elles avaient eu une telle abondance de manne, qu’elles avaient essayé de s’en nourrir pendant des jours; mais cela a toujours abouti à une déception et à une perte au lieu d’une bénédiction. Dieu donne chaque jour la portion d’un jour seulement, et pas plus.
Troisièmement, la manne devait être recueillie de bonne heure, car à la chaleur du soleil, elle fondait. Aucun moment, certes, n’est plus propice au croyant pour recueillir la manne que les premières heures de la journée, lorsque dans la tranquillité, il est seul avec le Seigneur; il n’est pas encore absorbé par les occupations de la journée, il ne sait pas quel sera le caractère précis de son sentier; mais il sait qu’il aura besoin de la manne pour le soutenir. Qu’il soit donc zélé dès les premières heures du jour, et que sa main ne soit pas paresseuse à recueillir, et à recueillir autant qu’il pourra en avoir besoin. Car quand bien même il en chercherait plus tard, il découvrirait qu’elle a entièrement disparu devant l’éclat et la chaleur du jour. Combien d’échecs n’ont-ils pas leur point de départ dans la négligence de ce principe! Une épreuve se présente, arrive inopinément, et l’âme succombe. Pourquoi donc? parce que la manne n’a pas été recueillie avant que le soleil soit chaud. Nous devrions tous prendre cela à cœur, et être en garde contre les artifices de Satan, qui cherche à détourner notre esprit de cette nécessité. Mettons-y toute diligence, afin que, quoi qu’il puisse survenir au cours de la journée, nous ne manquions pas de manne.
11.7. Ch. 16:22-30 — Le sabbat
En relation avec la manne, le sabbat est aussi donné dans le même chapitre.
Nous lisons, en Genèse 2, que «Dieu bénit le septième jour, et le sanctifia; car en ce jour il se reposa de toute son œuvre que Dieu créa en la faisant» (v. 3). Cela établit la signification du sabbat ou septième jour; car, remarquons bien qu’il s’agit du septième jour, et d’aucun autre jour, montrant bien que c’est le repos de Dieu. Cette signification est également soulignée d’une façon très nette dans l’épître aux Hébreux (voir chap. 4:1-11). Le sabbat est donc une figure du repos de Dieu et, en tant que donné à l’homme, il exprime le désir du cœur de Dieu que l’homme ait une part avec Lui dans son repos. Le sabbat apparaît pour la première fois ici. Nous n’en trouvons pas trace dans toute l’époque des patriarches, ni pendant le séjour des enfants d’Israël en Égypte, mais, tel que nous le trouvons dans ce chapitre, en relation avec la manne, il a une signification des plus précieuses.
Quelques remarques sont cependant encore nécessaires avant de l’exposer. Nous avons indiqué le but que Dieu avait en vue en instituant le sabbat; mais il est très clair que l’homme, en conséquence du péché, n’a jamais possédé ce repos. Bien plus encore, Dieu lui-même, pour le même motif, ne pouvait pas se reposer. Aussi, lorsque le Seigneur fut accusé de ne pas respecter le sabbat, il répondit: «Mon Père travaille jusqu’à maintenant, et moi je travaille» (Jean 5:17). Dieu ne pouvait pas se reposer en présence du péché, et du déshonneur qui lui était fait par le péché; et par conséquent, l’homme ne pouvait pas avoir part au repos avec lui. L’auteur de l’épître aux Hébreux développe ce dernier point. Il montre que les enfants d’Israël ne purent l’obtenir à cause de leur incrédulité et de leur dureté de cœur; que Josué ne le leur a pas donné; qu’au temps de David, il en était parlé comme étant encore futur, et l’apôtre conclut en disant: «Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu» (Héb. 3 et 4).
La question est alors la suivante: comment le posséder? Nous trouvons la réponse dans notre chapitre. La manne, comme nous l’avons vu, est une figure de Christ, et nous voyons par là que c’est lui seul qui peut nous faire entrer dans le repos de Dieu. Il est l’unique chemin. Ainsi l’apôtre dit: «Nous qui avons cru, nous entrons dans le repos» (Héb. 4:3); c’est-à-dire que seuls ceux qui croient en Christ entrent dans le repos, non pas, en aucune manière, que le repos soit une chose présente, comme certains l’ont enseigné. Le contexte montre clairement qu’il est présenté comme une bénédiction future. Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Que les croyants puissent jouir du repos de la conscience et du repos du cœur en Christ est parfaitement vrai; mais le repos de Dieu ne sera atteint que lorsque nous serons introduits dans cette scène éternelle où toutes choses sont faites nouvelles, lorsque l’habitation de Dieu sera «avec les hommes, et il habitera avec eux; et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu» (Apoc. 21:1-7).
11.8. Instructions concernant la manne
Deux circonstances, liées dans ce passage à l’institution du sabbat, appellent une brève remarque. La première est la double provision de manne le sixième jour, afin que le peuple puisse se reposer dans ses tentes le septième. Si la manne était recueillie dans cette proportion un autre jour, par un acte de volonté propre, elle perdait sa valeur et se corrompait; mais lorsqu’elle l’était par obéissance en vue du sabbat, elle restait saine et bonne. Nous apprenons par là que, lorsque par grâce nous aurons part au repos de Dieu, Christ restera notre nourriture durant l’éternité et notre bonheur consistera à nous réjouir avec Dieu en un Christ qui a été humilié. Rien d’autre ne satisfera le cœur de Dieu que notre pleine communion avec lui au sujet de son Fils bien-aimé. Il y a peut-être une autre pensée. C’est que tout ce que nous saisissons de Christ ici-bas devient notre possession et nos délices éternelles. Recueillons donc autant de manne que nous pouvons, deux omers au lieu d’un; si elle est conservée pour le repos qui reste, elle sera une source de force et de joie durant l’éternité.
La seconde circonstance, c’est que malgré l’injonction qu’ils avaient reçue, certains Israélites sortirent le septième jour pour recueillir de la manne, mais ils n’en trouvèrent pas (v. 27). Quelles que soient les manifestations de la grâce, le cœur de l’homme reste le même. La désobéissance est liée à sa nature corrompue et se manifeste de la même manière, que ce soit sous la loi ou sous la grâce. L’Éternel reprit, par Moïse, la conduite de son peuple, bien que dans sa patience et dans sa grâce, il les supportât. Si, comme cela a été expliqué, nous prenons le sabbat comme une image du repos de Dieu et le considérons, par conséquent, comme étant encore futur puisque le péché est intervenu, nous verrons tout de suite qu’un enseignement typique spécial se rattache au fait qu’il n’y avait pas de manne le jour du sabbat. Le temps de la manne sera alors passé à jamais. Christ ne sera plus jamais connu sous ce caractère, car les circonstances du désert auront pris fin à toujours pour les siens. Ils jouiront encore des provisions faites dans le désert; mais il n’y aura plus rien à recueillir. Nous trouvons sous un certain aspect le même enseignement dans les directives que Moïse donne, sur le commandement de l’Éternel, à la fin du chapitre.
11.9. Ch. 16:32-36
Il y a sans aucun doute une allusion à cela dans la promesse faite à celui qui vaincra, dans l’assemblée à Pergame: «À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée…» (Apoc 2:17). Christ dans son humiliation ne sera jamais oublié: les siens s’en souviendront toujours et se nourriront de lui avec reconnaissance, durant l’éternité.
Ainsi, «plein un omer» de manne fut posé devant l’Éternel, devant le témoignage, pour être gardé pour leurs générations. Pendant quarante ans, pendant toute la durée de leurs étapes dans le désert jusqu’à ce qu’ils parviennent dans un pays habité la manne fut leur nourriture quotidienne; ils la mangèrent jusqu’à leur arrivée à la frontière du pays de Canaan.
Chapitre 17, versets 1 à 7
12. Exode 17— Rephidim et Amalek
Une fois encore les enfants d’Israël se mettent en route et rencontrent d’autres difficultés. Mais «toutes ces choses leur arrivèrent comme types, et elles ont été écrites pour nous servir d’avertissement, à nous que les fins des siècles ont atteints» (1 Cor. 10:11). Un intérêt particulier se rattache donc à toutes leurs peines et expériences du désert.
12.1. Ch. 17:1-7 — Les murmures: un péché contre Dieu
Dans le cas du rocher frappé, comme dans celui de la manne, le péché du peuple fut l’occasion de ce déploiement de puissance et de grâce. À Rephidim, «il n’y avait point d’eau à boire pour le peuple». Et que fit celui-ci? N’y avait-il pas dans les expériences déjà faites de la fidélité et des tendres soins de Dieu un encouragement à se tourner vers lui, dans la confiance qu’il interviendrait? Les cailles et la manne n’étaient-elles pas un souvenir vivant dans leur esprit, comme preuve de la toute-suffisance de l’Éternel pour répondre à leurs besoins? N’avaient-ils pas appris que l’Éternel était leur berger et que, par conséquent, ils ne manqueraient de rien? Si nous ne connaissions pas le cœur humain et le caractère de la chair, c’est là ce que nous aurions attendu de la part des Israélites qui avaient vu les œuvres magnifiques de l’Éternel. Mais bien loin de là! Le peuple contesta avec Moïse, et ils dirent: «Donnez-nous de l’eau pour que nous buvions». Dans leurs murmures coupables et leur incrédulité, ils considéraient Moïse comme l’auteur de toutes leurs misères et, dans leur colère, ils étaient près de le tuer.
Avant d’examiner la ressource que va leur donner la grâce en réponse à leurs besoins, nous ferons une ou deux remarques sur le caractère du péché des Israélites. Le peuple contesta avec Moïse; mais, en réalité, comme le dit celui-ci, ils tentèrent l’Éternel (v. 2), disant: «L’Éternel est-il au milieu de nous, ou n’y est-il pas?» (v. 7). Moïse était leur conducteur reconnu, il était donc le représentant de l’Éternel pour le peuple. Contester avec lui, c’était contester avec l’Éternel; et se plaindre de privations, c’était en fait douter de la présence de l’Éternel, sinon la renier. Car s’ils avaient cru que l’Éternel était au milieu d’eux, tout murmure aurait été étouffé. Ils se seraient reposés dans l’assurance que Celui qui les avait rachetés d’Égypte, qui avait fendu pour eux les eaux de la mer Rouge, qui les avait délivrés du Pharaon et conduits dans toutes leurs étapes, de nuit par la colonne de feu, et de jour par la colonne de nuée, entendrait leur cri au moment voulu et répondrait à leurs besoins.
Cela montre la gravité du péché consistant à murmurer et à se plaindre à cause des épreuves du désert, et cela nous enseigne en même temps que tous les soupirs de cette sorte proviennent du doute quant à la présence du Seigneur avec nous. Aussi l’antidote à toutes ces tendances, notre défense contre ces pièges ordinaires de Satan, qui si souvent par leur moyen fait trébucher les enfants de Dieu et leur dérobe leur paix et leur joie — si même il ne réussit pas à les faire tomber — est le maintien ferme et inébranlable de la vérité que le Seigneur est au milieu de nous, qu’il conduit les siens comme un troupeau à toutes les étapes de la traversée du désert. Quelle perfection dans l’attitude du Seigneur en contraste avec celle d’Israël! Lorsqu’Il fut tenté par Satan dans le désert, il repoussa, dans une dépendance absolue, chacune des suggestions du diable par la seule parole de Dieu.
12.2. Le rocher frappé
Moïse cria à l’Éternel, et l’Éternel entendit sa prière; et malgré le péché du peuple, «il ouvrit le rocher, et les eaux en découlèrent; elles allèrent par les lieux secs, comme une rivière. Car il se souvint de sa parole sainte, et d’Abraham, son serviteur» (Ps. 105:41, 42). Ainsi, la grâce prévalait encore et satisfaisait aux besoins du peuple. Mais l’intérêt principal réside dans l’instruction typique de cet incident. Comme la manne, le rocher nous parle de Christ. L’apôtre Paul le dit expressément: «Ils buvaient d’un rocher spirituel qui les suivait: et le rocher était le Christ» (1 Cor. 10:4). Mais le Rocher fut frappé avant que l’eau ne coule. Moïse reçut le commandement de prendre la verge — celle avec laquelle il avait frappé le fleuve — et là, l’Éternel se tenant devant lui sur le rocher en Horeb, il devait frapper le rocher, «et il en sortira des eaux, et le peuple boira». La verge est un symbole de la puissance de Dieu. Dans le fait qu’elle frappe, elle présente l’exercice de Sa puissance judiciaire. Nous voyons donc, dans cet acte de frapper le rocher, le coup du jugement de Dieu s’abattant sur Christ à la croix. Le rocher frappé représente un Christ crucifié.
Remarquons que ce fut à cause du péché du peuple que le rocher dut être frappé, image saisissante de cette vérité qu’«Il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités». Il y a là, certes, un objet de méditation tant pour les pécheurs que pour les croyants. Les pécheurs peuvent considérer Christ sur la croix, portant le jugement du péché, et comprendre, s’ils veulent bien peser la chose, ce qu’est le péché aux yeux d’un Dieu saint. Et tout en apprenant cette leçon, qu’ils prennent aussi garde à ce que sera leur destinée s’ils persistent dans leur endurcissement et leur incrédulité! Car si Dieu n’a pas épargné son propre Fils lorsqu’il a réglé la question du péché, ce Fils qui était les délices de son cœur, qui était saint, innocent, sans souillure, et séparé des pécheurs, comment peuvent-ils espérer échapper? Quant aux croyants, ils oublient trop souvent de regarder à la croix. Combien leurs cœurs sont touchés, humiliés et émus, lorsque par grâce ils sont rendus capables de dire: «Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois» (1 Pierre 2:24). Jamais, dans toute l’éternité, ils n’oublieront que leurs péchés ont rendu cette mort nécessaire; jamais ils ne cesseront de se souvenir qu’elle a glorifié Dieu dans chacun des attributs de son caractère, et qu’elle est ainsi le fondement éternel et immuable de toutes leurs bénédictions. Que le Rocher ait absolument dû être frappé pour que le peuple puisse boire est certes une vérité aussi solennelle que précieuse! Du moment que le péché était en question — le péché qui avait déshonoré Dieu à la face de tout l’univers — tout ce que Dieu était demandait, pour sa propre gloire, que le rocher soit frappé; et du moment que le peuple aurait péri sans eau, il fallait, pour qu’il puisse vivre, que le rocher soit frappé. Mais Dieu seul pouvait y pourvoir, et à cette occasion, dans les directives données à Moïse, apparaît une nouvelle manifestation, pleine de beauté, de la grâce qui est dans son cœur.
12.3. Les eaux jaillissent
Le Rocher fut frappé, et les eaux jaillirent. Pas avant, c’était impossible; car à cause du péché, Dieu était pour ainsi dire retenu. Sa miséricorde et ses compassions, sa grâce et son amour, étaient comme renfermés au-dedans de lui. Mais aussitôt accomplie l’expiation par laquelle les exigences de sa sainteté étaient à jamais satisfaites, des fleuves de grâce et de vie purent se répandre à travers le monde. Aussi lisons-nous dans l’évangile selon Matthieu que dès que le Seigneur Jésus eut rendu l’esprit, «le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas» (Matt. 27:50, 51). Dieu était maintenant libre, en justice, de se manifester en grâce à un monde pécheur et d’offrir le salut. Et l’homme, en croyant, était libre d’entrer avec pleine assurance dans la présence immédiate de Dieu. Le chemin était révélé par lequel l’homme pouvait en justice se tenir dans la pleine lumière de la sainteté de Dieu.
L’eau qui sortait du Rocher est une figure du Saint Esprit comme puissance de vie. L’évangile selon Jean le montre clairement. Ainsi le Seigneur dit à la femme samaritaine: «Celui qui boira de l’eau que je lui donnerai, moi, n’aura plus soif à jamais; mais l’eau que je lui donnerai, sera une fontaine d’eau jaillissant en vie éternelle» (Jean 4:14). Au chapitre 7, il se sert de la même image, et Jean ajoute: «Il disait cela de l’Esprit qu’allaient recevoir ceux qui croyaient en lui; car l’Esprit n’était pas encore, parce que Jésus n avait pas encore été glorifié» (v. 39). Il apparaît clairement dans ce passage: premièrement, que «l’eau vive» est un type du Saint Esprit, et secondement, que cette «eau vive», le Saint Esprit, ne pouvait pas être reçu avant que Jésus ait été glorifié. En d’autres termes, le Rocher doit d’abord être frappé, comme nous l’avons déjà vu, avant que les eaux puissent en sortir et apaiser la soif des hommes.
Il y a encore ici un enseignement d’une importance pratique immense, à savoir que rien ne peut satisfaire les besoins insatiables de l’homme sinon le Saint Esprit comme puissance de vie éternelle; et cette bénédiction ne peut être reçue que par l’intermédiaire d’un Christ crucifié et ressuscité. Aussi le Seigneur cria-t-il aux Juifs, disant: «Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive» (Jean 7:37). Cette proclamation est encore valable aujourd’hui: «Que celui qui veut prenne gratuitement de l’eau de la vie» (Apoc. 22:17). Puisse cette vérité être imprimée par la puissance du Saint Esprit dans l’âme de tous ceux qui lisent ces lignes!
Ainsi l’Éternel répondit en grâce aux murmures du peuple et lui donna de l’eau à boire; mais les noms donnés à ce lieu, Massa et Meriba, restèrent comme monument de leur péché.
12.4. Le conflit avec Amalek
Aussitôt après que les eaux furent sorties du rocher, nous trouvons le conflit avec Amalek. La liaison de ces incidents est des plus instructives et illustre les voies et la vérité de Dieu. La manne nous parle de Christ descendu du ciel; le Rocher frappé, de Christ crucifié; l’eau vive est une image du Saint Esprit; et maintenant, l’Esprit étant reçu, vient le conflit. Il doit en être ainsi; car «la chair convoite contre l’Esprit, et l’Esprit contre la chair; et ces choses sont opposées l’une à l’autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez» (Gal. 5:17). D’où l’ordre de ces événements typiques. Qu’est-ce qui est symbolisé par Amalek, pouvons-nous alors nous demander? On entend souvent répondre que c’est la chair; mais ce n’est là qu’une partie de la vérité. Quant à Amalek, dès son origine, son vrai caractère nous est donné à connaître (voir Gen. 36:12). Mais ce qu’il nous faut discerner ici, c’est qu’Amalek est en antagonisme ouvert avec le peuple de Dieu, cherchant à l’arrêter, et même à le faire disparaître de la surface de la terre. Il s’agit donc de la puissance de Satan, agissant par la chair, qui entrave la marche des enfants d’Israël. Et la subtilité de Satan dans le choix du moment de l’attaque apparaît très clairement: c’est aussitôt après que le peuple eut péché, à un moment donc où un ennemi pouvait supposer qu’il encourait le déplaisir de Dieu. Telle est toujours la tactique de l’ennemi. Mais si Dieu est pour son peuple, il ne permettra à aucun adversaire de consommer sa destruction. Certes, si Israël avait été abandonné à lui-même, il aurait facilement été dispersé; mais Celui qui les avait conduits au travers des eaux de la mer Rouge ne permettra pas qu’ils périssent maintenant. L’Éternel était leur bannière, et ainsi leur défense était assurée. Remarquons maintenant comment s’accomplit la défaite d’Amalek.
À suivre
Chapitre 17, versets 8 à 16
12.5. Le secret de la victoire — v. 8-13
Nous voyons d’abord qu’au commandement de Moïse, Josué se place à la tête des hommes choisis pour combattre. Josué représente Christ, dans l’énergie de l’Esprit, conduisant ses rachetés au combat. Quelle consolation! Si Satan rassemble ses forces pour assaillir les enfants de Dieu, Christ, d’un autre côté, conduit ceux qu’il a choisis à la rencontre de l’adversaire. La bataille est donc à l’Éternel. Cette vérité est illustrée tout au long de l’histoire d’Israël; et quant au principe, elle est tout aussi vraie des conflits que connaissent les croyants de cette dispensation. Si cela était compris, notre esprit resterait paisible face aux pires difficultés. Cela nous aiderait à ne pas compter sur l’homme, et à nous appuyer sur le Seigneur. Cela nous rendrait capables d’estimer à leur juste valeur l’activité incessante et les desseins des hommes et à attendre la délivrance du Seigneur, seul Conducteur des siens. En un mot, nous nous souviendrions que nous ne pouvons opposer aucune défense efficace à nos adversaires, sinon dans la puissance de l’Esprit de Dieu.
Il y a encore un autre aspect important: si Josué conduit ses guerriers dans la plaine, Moïse, avec Aaron et Hur, monte au sommet de la colline; et le combat dans la plaine dépend des mains levées de Moïse sur la montagne. Moïse, considéré ainsi, est une figure de Christ en haut, dans la valeur de son intercession. Tout en conduisant les siens sur la terre dans la puissance de l’Esprit, il maintient leur cause par son intercession dans la présence de Dieu, et il leur assure miséricorde et grâce afin qu’ils aient du secours au moment opportun. Ils n’ont donc aucune force pour le combat en dehors de cette intercession sacerdotale; et l’énergie de l’Esprit est en relation avec cette intercession. L’apôtre Paul mentionne cette vérité lorsqu’il dit: «C’est Christ qui est mort, mais plutôt qui est aussi ressuscité, qui est aussi à la droite de Dieu, qui aussi intercède pour nous; qui est-ce qui nous séparera de l’amour du Christ? Tribulation, ou détresse, ou persécution, ou famine, ou nudité, ou péril, ou épée?... Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés» (Rom. 8:34-37). Le Seigneur lui-même a enseigné à ses disciples la relation entre son œuvre en haut et l’action de l’Esprit en eux sur la terre, lorsqu’il dit: «Si je ne m’en vais, le Consolateur ne viendra pas à vous» (Jean 16:7). C’est aussi la raison pour laquelle il nomme le Saint Esprit «un autre consolateur» (Jean 14:16); et l’apôtre Jean applique à notre Seigneur le même titre (c’est-à-dire Avocat, mais en fait le même mot, «paraclet»: 1 Jean 2:1).
12.6. Le parfait Intercesseur
Mais aucun homme ne pouvait être un type parfait de Christ. Les mains de Moïse étaient pesantes, de sorte qu’Aaron et Hur les soutenaient. Cela ne fait que manifester plus pleinement la vérité de l’intercession de Christ. Aaron, bien qu’il n’ait pas encore été expressément mis à part, représente la sacrificature, et Hur, si nous pouvons nous appuyer sur la signification de son nom, personnifie la lumière ou la pureté. Considérés ensemble, ils nous parlent donc de l’intercession sacerdotale de Christ, exercée dans la sainteté devant Dieu; et, par conséquent, d’une intercession qui, basée sur tout ce que Christ est et a fait, est toujours efficace et victorieuse. Cette leçon devrait être bien retenue. La bataille ici-bas ne dépendait pas de la force des hommes armés, ni même du Saint Esprit, mais de l’intercession incessante et efficace de Christ. Car «lorsque Moïse élevait sa main... Israël avait le dessus; et quand il reposait sa main, Amalek avait le dessus». D’où la nécessité de la dépendance. Sans celle-ci, nous pouvons être prêts pour le combat, notre cause peut être juste, mais notre défaite sera inévitable. Au contraire, si nous sommes dépendants, Christ en haut intercédant en notre faveur, et Christ dans l’énergie de l’Esprit étant notre Conducteur ici-bas, quand les méchants, nos adversaires et nos ennemis s’approcheront de nous, ils broncheront et tomberont (Ps. 27:2). Aucun adversaire ne peut alors tenir devant les enfants de Dieu.
12.7. L’Éternel mon enseigne
Amalek fut ainsi mis hors de combat. Mais une telle victoire pour Israël, révélation de la source de sa force et du caractère inchangé de l’ennemi, ne devait pas être oubliée. Elle devait être écrite «pour mémorial dans le livre».
Ch. 17:14-16
Deux faits étaient liés dans ce mémorial: le récit de leur délivrance d’Amalek, et la garantie de sa destruction finale. Tout déploiement de la puissance de l’Éternel en faveur des siens porte ce double caractère. Si Dieu intervient et défend ses enfants contre les assauts de leurs ennemis, il les assure par cet acte même de son incessante protection et de ses soins. Chacune de ses interventions contre leurs ennemis devait être rappelée à leurs oreilles et écrite dans leur cœur, à la fois comme mémorial du passé, et comme garantie de sa protection constante. Ainsi le psalmiste, célébrant une délivrance passée, s’écrie: «Quand une armée camperait contre moi, mon cœur ne craindrait pas; si la guerre s’élève contre moi, en ceci j’aurai confiance» (Ps. 27:3). Moïse, dans la même confiance, bâtit un autel. Il reconnaissait par là, avec gratitude, la main divine, tout en donnant à connaître que la victoire était à la louange de l’Éternel. C’est là précisément que tant de personnes manquent. Dieu leur accorde aide et délivrance, mais elles oublient de bâtir un autel. Amenées par leurs difficultés dans la présence du Seigneur, elles oublient trop souvent de le louer une fois délivrées. Tel ne fut pas le cas pour Moïse. En bâtissant l’autel, il déclarait devant tout Israël: C’est l’Éternel qui a combattu pour nous et a remporté la victoire. C’est ce qui est proclamé par le nom donné à l’autel: «l’Éternel mon enseigne» (ma bannière). C’était lui qui avait conduit nos armées, et c’est lui qui les conduira encore; car sa lutte avec Amalek ne cessera jamais. Aussi longtemps que l’Éternel aura un peuple sur la terre, Satan cherchera à le détruire. Nous devons nous en souvenir; mais avec tout ce que cela comporte, nos cœurs resteront confiants pour autant que nous saisissions avec puissance la vérité de Jéhovah-Nissi. La bataille est à l’Éternel, nous combattrons sous ses couleurs et ainsi, quel que soit l’acharnement de l’Ennemi, la victoire est certaine.
À suivre
Chapitre 18, versets 1 à 12
13. Exode 18— Bénédiction milléniale
Avec ce chapitre, nous arrivons à la fin de la dispensation de la grâce dans l’histoire d’Israël. D’Égypte à Sinaï tout était pure grâce. À Sinaï, le peuple se placera sous la loi. Cela explique le caractère spécial du chapitre 18. La manne, comme nous l’avons vu, présentait Christ dans son incarnation; le Rocher frappé nous parlait de sa mort, et les fleuves qui sortaient du Rocher, du don de l’Esprit. Maintenant, faisant suite à la dispensation de l’Esprit, nous avons en figure la bénédiction des Juifs et des Gentils, et l’établissement de l’ordre gouvernemental en Israël. En fait, l’Église, les Juifs et les Gentils sont tous présentés en figure. Nous le verrons en soulignant différents points dans le passage qui suit.
13.1. Ch. 18:1-12 — La visite de Jéthro
Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apparaît maintenant. Il avait appris tout ce que Dieu avait fait à son peuple; et alors il amène Séphora et ses deux fils à Moïse. Les noms mêmes donnés aux enfants expliquent le caractère symbolique de toute cette scène. Le premier-né est Guershom, «car il avait dit: J’ai séjourné [ou j’ai été pèlerin] dans un pays étranger». Cela nous parle donc des jours difficiles de l’absence d’Israël de son propre pays, alors que le peuple était dispersé, séjournant comme des étrangers parmi les nations (voir 1 Pierre 1:1). Le nom du second est Éliézer, «car le Dieu de mon père m’a été en aide, et m’a délivré de l’épée du Pharaon». Sans aucun doute, cela rappelait le passé, mais c’est aussi une prophétie concernant l’avenir, et cela nous parle de la délivrance finale d’Israël, préparant son introduction dans la bénédiction sous le règne du Messie. Les deux noms marquent ainsi deux périodes distinctes dans les voies de Dieu envers Israël: la première comprend tout le temps qui couvrira leur captivité à Babylone; tandis que la seconde parle de l’heure solennelle dans laquelle le Seigneur apparaîtra soudain pour délivrer son peuple, quand Il sortira pour combattre contre ces nations rassemblées contre Jérusalem pour le combat (Zach. 14). Mais dans cette scène du chapitre 18, tant les douleurs de la dispersion, que la délivrance de l’épée du Pharaon, sont vues comme passées; et en figure, le peuple est maintenant en possession de cette bénédiction si longtemps différée et tant attendue.
13.2. L’Église et les nations
L’Église est vue en Séphora. Elle était l’épouse de Moïse prise d’entre les Gentils et, comme telle, elle préfigure l’Église. Tout est ainsi en harmonie avec le caractère millénial de ce tableau; car lorsque Israël sera restauré et se réjouira sous l’heureuse domination d’Emmanuel, l’Église aura sa part dans la félicité de ce jour, comme associée aux gloires du règne de mille ans. Ce sera un jour de joie inexprimable pour Celui qui, selon la chair, est né de la descendance de David; et chaque pulsation de sa joie éveillera un écho dans le cœur de celle qui occupera la position de femme de l’Agneau. Lui donc, et elle avec lui, bien que dans une moindre mesure, auront communion dans la joie au jour des noces d’Israël.
Nous avons ensuite les Gentils, symbolisés dans la bénédiction de Jéthro et le fait qu’il confesse le nom de l’Éternel. Et remarquons ce qui produit cette confession. Moïse, le Juif, raconte à Jéthro «tout ce que l’Éternel avait fait au Pharaon et à l’Égypte à cause d’Israël, toute la fatigue qui les avait atteints en chemin, et comment l’Éternel les avait délivrés». Ce récit touche le cœur de Jéthro; il se réjouit de la délivrance d’Israël et bénit l’Éternel, confessant sa suprématie absolue. C’est ainsi que nous lisons dans les Psaumes: «Tu m’as délivré des débats du peuple; tu m’as établi chef des nations (les Gentils); un peuple que je ne connaissais pas me servira. Dès qu’ils ont entendu de leur oreille, ils m’ont obéi; les fils de l’étranger se sont soumis à moi» (Ps. 18:43, 44).
Jéthro s’unit ensuite à Aaron et aux anciens d’Israël pour adorer, avec Moïse, en la présence de Dieu. Moïse est ici le roi, et ainsi, avec Israël et les Gentils (Jéthro), il mange le pain en la présence de l’Éternel. C’est l’union d’Israël et des Gentils dans l’adoration. C’est la scène annoncée par le prophète: «Et il arrivera, à la fin des jours, que la montagne de la maison de l’Éternel sera établie sur le sommet des montagnes, et sera élevée au-dessus des collines; et toutes les nations y afflueront; et beaucoup de peuples iront, et diront: Venez, et montons à la montagne de l’Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem, la parole de l’Éternel» (És. 2:2, 3).
Dans la fin du chapitre, nous trouvons l’établissement du jugement et du gouvernement.
A suivre
Chapitre 18 v 13 à 27
Ch. 18:13-27
Deux aspects des choses doivent être soigneusement distingués: le manquement de Moïse, et ce qui est symbolisé par l’établissement de chefs sur le peuple. Pour commencer par ce dernier point, il est évident que cet arrangement pour juger le peuple est une figure de l’ordre dans le gouvernement que le Messie établira lorsqu’il entrera dans son règne. Comme le dit le psalmiste: «Il jugera ton peuple en justice, et tes affligés avec droiture. Les montagnes porteront la paix au peuple, et les coteaux, — par la justice» (Ps. 72:2, 3). C’est la raison pour laquelle cette partie se termine par ce récit. Mais s’il devait en être ainsi selon les pensées de Dieu, il ne faut pas passer sous silence la faute de Moïse en écoutant Jéthro. En fait, nous perdrions par là une instruction de grande valeur.
La première erreur de Moïse fut d’écouter Jéthro sur un tel sujet. L’Éternel avait donné cette charge à Moïse, et c’est à lui que Moïse aurait dû avoir recours pour tout ce qui concernait son peuple.
Les arguments avancés par Jéthro étaient certes spécieux et subtils. Ils étaient fondés sur son souci du bien-être de son gendre. «Tu t’épuiseras certainement, toi et ce peuple qui est avec toi, car la chose est trop lourde pour toi; tu ne peux la faire toi seul». Si seulement Moïse voulait suivre ses conseils, alors dit-il, «tu allégeras ce qui pèse sur toi»; et encore, «tu pourras subsister, et tout ce peuple aussi arrivera en paix en son lieu». Ce n’étaient donc pas les intérêts de Dieu, mais ceux de Moïse, qui animaient Jéthro. Mais les arguments qu’il fournissait étaient les plus propres à influencer l’homme naturel. Qui, même parmi les serviteurs du Seigneur, ne sent pas parfois le poids de sa responsabilité, et ne se réjouirait pas à la perspective de voir celle-ci diminuée? Dans un tel moment, aucune tentation n’est en fait plus séduisante que le besoin d’un peu d’égard pour soi-même et pour son confort. Mais malgré le danger de cette tentation, Moïse n’y aurait pas cédé s’il s’était souvenu de la source de son ministère, comme aussi de sa force. Car si sa tâche de juger le peuple était de l’Éternel, et pour l’Éternel, la grâce de l’Éternel ne pouvait qu’être suffisante pour son serviteur. L’Éternel enseigna cette leçon à Moïse, comme nous le trouvons dans le livre des Nombres, lorsque ce dernier se plaignit à l’Éternel, et cela dans les termes mêmes que Jéthro avait insinués dans son esprit: «Je ne puis, moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi» (11:14). L’Éternel entendit sa plainte et lui commanda de prendre avec lui soixante-dix hommes pour lui aider dans sa tâche, disant: «J’ôterai de l’Esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu’ils portent avec toi le fardeau du peuple, et que tu ne le portes pas toi seul» (v. 17).
Ainsi, bien que l’Éternel réponde à son désir, il n’y eut aucun apport supplémentaire de force pour le gouvernement d’Israël mais Moïse était maintenant appelé à partager avec les soixante-dix l’Esprit qu’il possédait seul auparavant. Selon l’homme, le conseil de Jéthro était sage et prudent, témoignant de beaucoup de perspicacité dans les affaires humaines; mais selon Dieu, son acceptation était caractérisée par le doute et l’incrédulité. En réalité, c’était laisser Dieu de côté et faire de la santé de Moïse l’objectif principal, en perdant tout à fait de vue le fait que ce n’était pas Moïse qui portait le fardeau du peuple, mais l’Éternel par Moïse; et par conséquent qu’il n’était pas question de la force de Moïse, mais de ses ressources en Dieu. Combien nous sommes tous enclins à oublier cette vérité importante que, dans tout service, s’il est fait pour le Seigneur, les difficultés qu’on y rencontre devraient être mesurées non par ce que nous sommes, mais par ce qu’Il est. Nous ne sommes jamais envoyés à la guerre à nos propres dépens, mais tout vrai serviteur est soutenu par la toute-suffisance de Dieu. Moïse pouvait être découragé devant une si grande charge, de même que Paul pourra être presque abattu par la présence de l’écharde dans la chair, mais à l’un comme à l’autre s’adresse la parole divine, si seulement l’oreille est attentive pour la recevoir: «Ma grâce te suffit».
13.3. Sagesse humaine
Plusieurs précieuses instructions peuvent être tirées de ce récit. Premièrement, il est toujours dangereux de prêter l’oreille à l’avis d’un parent dans les choses de Dieu. Lorsque le Seigneur, avec ses disciples, était entièrement adonné à son ministère, «en sorte qu’ils ne pouvaient pas même manger leur pain», ses amis ou proches «sortirent pour se saisir de lui; car ils disaient: Il est hors de sens».Ils ne pensaient pas aux droits de Dieu, et ne pouvaient rien comprendre de ce zèle qui le dévorait dans le service qu’il était venu accomplir. Les parents voient au travers de leurs droits, ou de leurs affections naturelles; aussi l’œil, n’étant pas simple, ne peut pas juger justement dans la présence de Dieu. Cela demandait certes beaucoup de sacrifice de soi et d’abandon de ses aises et de son confort de la part de Séphora, et de Moïse aussi, dans l’œuvre à laquelle il était appelé. Ce n’était cependant pas un petit honneur, un privilège de moindre importance, que d’être ainsi engagé; et s’il en avait été pleinement conscient, Moïse aurait résolument fermé l’oreille à la voix du tentateur en la personne de Jéthro.
Deuxièmement, nous apprenons que lorsqu’une fois une parole de doute ou une plainte a été admise dans le cœur, elle n’en est pas très facilement bannie. Comme nous l’avons vu, en Nombres 11, Moïse dans sa plainte reprendra les paroles mêmes qui lui avaient été suggérées par Jéthro. C’est précisément là que Satan a tant de succès. Il peut n’y avoir dans notre esprit qu’une pensée à peine ébauchée, une insinuation, et aussitôt l’Ennemi arrive, la concrétise et la présente à nos âmes. Par exemple, lorsque nous sommes fatigués dans le service et peut-être découragés, combien souvent Satan ne nous suggérera-t-il pas que nous en faisons beaucoup trop, que nous allons au-delà de nos forces; et si nous cédons à la tentation, cette pensée nous préoccupera, peut-être pendant des années, même si elle ne s’exprime pas par des murmures devant Dieu. Nous avons donc à veiller très soigneusement sur notre cœur, n’ignorant pas les desseins de l’Ennemi.
Enfin, il apparaît clairement que l’ordre selon l’homme ne correspond en aucune manière à la pensée de Dieu. À vues humaines, le système gouvernemental proposé par Jéthro était sage et opportun; il semblait beaucoup plus propre à assurer l’administration de la justice parmi le peuple. L’homme croit toujours pouvoir améliorer l’ordre de Dieu. C’est là le secret de la ruine de l’Église. Au lieu de s’attacher à l’Écriture qui révèle la pensée divine, l’homme a introduit des idées, des plans et des systèmes de son propre cru, d’où les innombrables divisions et sectes qui caractérisent la chrétienté dans sa forme extérieure. La sécurité des bien-aimés du Seigneur réside dans l’attachement inébranlable à la parole de Dieu et, par conséquent, dans le refus de tout conseil ou avis qui pourrait être donné par l’homme en dehors d’elle.
Jéthro avait accompli son œuvre et, avec la permission de Moïse, il s’en alla dans son pays (v. 27). Quel contraste avec Moïse et les enfants d’Israël! Ceux-ci marchaient dans le chemin de Dieu et se rendaient vers Son pays; par conséquent, ils étaient des pèlerins traversant le désert; mais Jéthro allait son chemin (pas celui de Dieu), et retournait dans son propre pays (pas non plus celui de Dieu). Au lieu donc d’être un pèlerin, il avait une maison, dans laquelle il ne gardait pas le sabbat, mais trouvait son propre repos.
A suivre
Chapitre 19, versets 1 à 15
14. Exode 19; 20 — Sinaï
14.1. Changement de dispensation
Une nouvelle dispensation s’ouvre dans ces chapitres. Jusqu’à la fin du chapitre 18, la grâce régnait et, par conséquent, caractérisait toutes les voies de Dieu envers son peuple; mais à partir de ce point, les fils d’Israël furent placés, de par leur propre consentement, sous les exigences inflexibles de la loi. Sinaï est l’expression de cette dispensation, et il lui est associé à toujours. L’apôtre met Sinaï en contraste avec Sion, siège de la grâce royale, lorsqu’il dit en écrivant aux Hébreux: «Vous n’êtes pas venus à la montagne qui peut être touchée, ni au feu brûlant, ni à l’obscurité, ni aux ténèbres, ni à la tempête, ni au son de la trompette, ni à la voix de paroles, voix telle que ceux qui l’entendaient prièrent que la parole ne leur fût plus adressée... mais vous êtes venus à la montagne de Sion» (Héb. 12:18-22). Il montre que Sinaï avait alors passé et qu’une autre dispensation lui avait succédé, dont la montagne de Sion était l’expression.
C’est de Sinaï que s’occupent nos chapitres. L’époque et le lieu sont tous deux clairement indiqués. «Au troisième mois après que les fils d’Israël furent sortis du pays d’Égypte, en ce même jour, ils vinrent au désert de Sinaï: ils partirent de Rephidim, et vinrent au désert de Sinaï, et campèrent dans le désert; et Israël campa là devant la montagne» (v. 1, 2). L’Éternel accomplissait ainsi la parole qu’il avait donnée à Moïse: «Parce que je serai avec toi; et ceci te sera le signe que c’est moi qui t’ai envoyé: lorsque tu auras fait sortir le peuple hors d’Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne» (chap. 3:12). Ils devaient célébrer une fête à l’Éternel (voir chap. 5:1; 10:9); et ils l’auraient fait s’ils s’étaient seulement connus eux-mêmes, et s’ils avaient connu le cœur de l’Éternel. Mais ils allaient être mis à l’épreuve d’une nouvelle manière. La grâce les avait déjà sondés et n’avait trouvé que désobéissance, rébellion et péché; et maintenant ils allaient être mis à l’épreuve par la loi. Voilà quel a été le but de Dieu dans toutes ses dispensations: éprouver, et par là révéler ce qu’est l’homme. Mais, béni soit son nom, s’il a mis à nu la corruption incurable de notre nature, il a révélé en même temps ce que Lui est, chacune des révélations de lui-même étant en rapport avec le caractère de la relation dans laquelle il entrait avec son peuple. Il enseignait par là que si l’homme était totalement ruiné et perdu, c’était en Lui et en Lui seul, que le secours et le salut pouvaient être trouvés. À cet égard, la loi donnée sur le mont Sinaï a une importance et un intérêt particuliers. Tout ce qui la concerne est digne de notre attention.
14.2. Mise à l’épreuve
Chapitre 19 v 3-9
Il y a deux points importants dans le message que l’Éternel charge Moïse d’apporter au peuple. Premièrement, il leur rappelle ce qu’il avait fait pour eux d’une manière qui aurait dû les rendre conscients de leur propre et totale impuissance et leur enseigner que toutes leurs ressources étaient en Dieu. «Vous avez vu, dit-il, ce que j’ai fait à l’Égypte, et comment je vous ai portés sur des ailes d’aigle, et vous ai amenés à moi». Il les avait délivrés de la main du Pharaon, l’avait détruit, lui et ses armées; il avait porté son peuple par sa puissance, l’avait amené à Lui, et lui avait donné une place et une relation d’intimité avec Lui. Il avait tout fait pour eux, et pour preuve il en appelle à leur propre souvenir. Un tel appel aurait dû remplir leur cœur de gratitude, puisqu’il plaçait devant leur esprit la source de toutes les bénédictions dont ils jouissaient maintenant.
Puis, secondement, l’Éternel fait une proposition. «Et maintenant, si vous écoutez attentivement ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m’appartiendrez en propre d’entre tous les peuples; car toute la terre est à moi...». La portée de cette proposition doit être clairement indiquée. Dieu avait racheté Israël par sa propre puissance: conformément à ses plans de grâce et d’amour; il avait fait d’eux son propre peuple, et s’était engagé à les conduire dans un pays ruisselant de lait et de miel (chap. 3:7, 8); tout cela reposait sur la grâce la plus pure, et n’était soumis à aucune condition quelconque requise du peuple. Il le leur rappelle, en les invitant à regarder en arrière à l’œuvre qu’il avait opérée pour eux. Mais maintenant, pour les mettre à l’épreuve, il dit: «Je vais faire dépendre votre position et vos bénédictions de votre obéissance. Jusqu’à présent j’ai tout fait pour vous; dorénavant je me propose de faire dépendre ma faveur de vos œuvres. Êtes-vous disposés à accepter ces conditions et à promettre une obéissance absolue à ma parole et à mon alliance?» Voilà en substance la proposition que Moïse était chargé d’apporter aux enfants d’Israël.
14.3. Le message de l’Éternel
Moïse remplit fidèlement sa mission. Il « appela les anciens du peuple, et mit devant eux toutes ces paroles que l’Éternel lui avait commandées » (v. 7). Un tel message allait certainement produire de profonds exercices. On aurait pu, pour le moins, s’attendre à ce qu’ils prennent du temps pour considérer cette proposition dans toute sa portée. Ils ne pouvaient pas avoir oublié qu’ils avaient déjà péché à maintes reprises, même durant la courte période de trois mois qui s’était écoulée depuis qu’ils avaient traversé la mer Rouge ; que chaque nouvelle difficulté n’avait fait que mettre en évidence leurs manquements et leur péché. Si donc ils s’étaient penchés sur leurs expériences passées, ils auraient vu que s’ils acceptaient ces nouvelles conditions, tout serait perdu. Ils allaient sûrement se dire l’un à l’autre: «Nous avons désobéi chaque fois, et nous craignons que la même chose ne se reproduise, et qu’alors nous ne perdions tout. Non, nous devons nous rejeter sans réserve sur cette même grâce qui nous a sauvés, nous a conduits, et nous a préservés jusqu’ici dans notre marche à travers le désert. Si la grâce ne continue pas à régner, nous sommes un peuple perdu».
Or, tout au contraire, ils acceptent instantanément la condition proposée, et déclarent: «Tout ce que l’Éternel a dit, nous le ferons». Leurs expériences passées n’avaient servi à rien. Ils manifestent ainsi l’ignorance la plus totale, tant du caractère de Dieu que de leur propre cœur. C’était en fait une erreur fatale. Au lieu de s’accrocher avec ténacité, dans la conscience de leur propre impuissance, à ce que Dieu était pour eux, autrement dit à la grâce, ils s’offrent de façon inconsidérée à faire tout dépendre de ce qu’ils pouvaient, eux, être pourDieu, ce qui est le principe de la loi. Il en est toujours ainsi. L’homme, dans sa folie et dans son aveuglement, prétend obtenir la bénédiction sur le terrain de ses propres œuvres, et rejette un salut qui lui est offert en pure grâce; car il n’est pas disposé à n’être rien, tandis que la grâce fait tout dépendre de Dieu, et ne doit rien à l’homme. Voilà pourquoi la grâce blesse l’orgueil et la propre importance du pécheur, et provoque ainsi la résistance de son cœur dépravé.
Moïse rapporte la réponse du peuple, et l’Éternel se prépare à instituer ses nouvelles relations avec son peuple sur le terrain de la loi. Tout d’abord, il établit Moïse comme médiateur. «Voici, je viendrai à toi dans l’obscurité d’une nuée, afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi, et qu’aussi ils te croient à toujours». Il lui donne une position que le peuple serait forcé de reconnaître. Ensuite viennent les directives pour le peuple, en rapport avec la promulgation de la loi par laquelle il allait être gouverné, code qui établit la mesure des exigences de Dieu. Chaque commandement portait la marque du changement de dispensation. Jusque-là, les Israélites avaient affaire à un Dieu de grâce; maintenant, ils ont affaire à un Dieu de justice. Cela impliquait de la part de Dieu la distance, car il avait affaire à des pécheurs, et de la part du peuple la séparation et la purification. La première de ces choses était représentée par «l’obscurité d’une nuée» dans laquelle l’Éternel annonce sa venue vers Moïse; et la seconde, par les diverses prescriptions données au peuple.
14.4. Sanctification
Chapitre 19 v 10-15
Le peuple devait donc être «sanctifié» pendant deux jours. Le sens à attribuer à ce terme est toujours déterminé par le contexte dans lequel il se trouve. Ici c’est la séparation du peuple, leur mise à part pour Dieu sur le terrain de l’obéissance qu’ils avaient promise. Cela impliquerait sans aucun doute leur séparation extérieure de tout ce qui ne convenait pas à la présence d’un Dieu saint. Ils devaient également laver leurs vêtements. Remarquons que tout, maintenant, doit être fait par eux. Moïse devait les sanctifier et ils devaient laver leurs vêtements; car du moment où ils s’engageaient à obéir comme condition de la bénédiction, ils acceptaient en fait la responsabilité de se rendre propres pour la présence de Dieu. Ils acquéraient sans doute ainsi une sorte de qualification cérémonielle pour rencontrer Dieu; mais la distance même à laquelle ils étaient gardés, prouvait aussitôt l’inutilité de leurs efforts. Ils pouvaient laver leurs vêtements le plus scrupuleusement possible et les rendre si propres qu’aucun œil humain n’y découvrît de la souillure, mais la question qui était adressée à leur conscience, si seulement ils avaient compris, était: Pouvaient-ils se purifier eux-mêmes suffisamment pour supporter l’inspection d’un Dieu saint? Laissons Job répondre à cette question: «Si, dit-il, je me lave avec de l’eau de neige, et que je nettoie mes mains dans la pureté, alors tu me plongeras dans un fossé, et mes vêtements m’auront en horreur» (Job 9:30, 31). Le Seigneur lui-même a répondu à cette question pour nous. S’adressant à Israël par le prophète, il dit: «Quand tu te laverais avec du nitre, et que tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité reste marquée devant moi» (Jér. 2:22). L’homme ne peut pas se purifier lui-même devant Dieu. C’est là ce qu’enseigne toute l’Écriture.
A suivre
Chapitre 19, versets 16 à 25
14.5. Pourquoi le commandement ?
Mais dira-t-on alors, pourquoi l’Éternel a-t-il donné ce commandement à Israël? Pour la même raison qu’il leur donne ensuite la loi: pour montrer ce qui était dans leur cœur, pour manifester au plein jour ce qui s’y tenait caché, pour exposer vraiment la corruption de leur nature, et leur montrer ainsi leur état de perdition et de culpabilité. Dans une mesure, ils apprenaient l’inanité de leurs propres efforts; car malgré toute leur «sanctification», tous leurs «lavages», ils ne pouvaient s’approcher de Dieu et étaient terrifiés à l’ouïe de sa voix. Il en est souvent ainsi dans l’expérience des pécheurs. Quelque peu éveillés quant à leur condition, ils commencent par essayer de s’améliorer, de purifier leur cœur, et de se rendre de cette manière propres à la faveur de Dieu. Mais ils découvrent bientôt que le seul résultat de tous leurs efforts est d’amener à la lumière leur péché et leur méchanceté. Ou, s’ils réussissent à se tisser une robe de propre justice, et à cacher ainsi pour un temps leurs infirmités morales, au moment où ils sont amenés dans la présence de Dieu, leur robe apparaît à la lumière de sa sainteté comme n’étant que des haillons souillés. L’homme, de fait, est totalement impuissant, et jusqu’à ce qu’il ait appris cela, il ne peut pas comprendre que le seul moyen de purifier ses vêtements de toute tache et de toute souillure morales, de les rendre assez blancs pour satisfaire même aux exigences de la sainteté de Dieu, est de les laver dans le sang de l’Agneau (voir Apoc. 1:5 et 7:14).
14.6. Un Dieu justement redoutable
Le peuple fut donc sanctifié, et ils lavèrent leurs vêtements et jeûnèrent afin d’être prêts pour «le troisième jour». Le troisième jour est souvent significatif; et ici, il semble parler, en figure, de la mort. Ce fut donc le matin du troisième jour que l’Éternel descendit sur montagne de Sinaï, avec tout l’appareil de sa redoutable et terrible majesté. Il y eut des tonnerres et des éclairs, expressions du pouvoir judiciaire, l’attitude nécessaire de Dieu, dans sa sainteté, lorsqu’il entre en contact avec des pécheurs. Il y eut aussi une épaisse nuée sur la montagne (voir v. 9), donnant à connaître la distance de Dieu et la difficulté de le rencontrer. Comme le dit le psalmiste: «Des nuées et l’obscurité sont autour de lui; la justice et le jugement sont la base de son trône» (Ps. 97:2). Plus encore, le son de la trompette, à la fois annonce de l’approche de Dieu et signe de ralliement pour le peuple, retentit avec puissance. Toute la solennité possible entourait cette rencontre avec Dieu, et tout le peuple qui était dans le camp tremblait malgré les préparatifs auxquels il s’était soumis. Si, auparavant, les Israélites avaient eu confiance en eux-mêmes, leur assurance devait maintenant avoir été bien ébranlée, sinon avoir disparu; car s’ils avaient été prêts à rencontrer Dieu, pourquoi auraient-ils craint?
N’était-ce pas celui qui les avait portés sur des ailes d’aigle, et qui les avait amenés jusqu’à lui, qu’ils devaient rencontrer? N’était-il pas leur Sauveur et leur Seigneur? Pourquoi alors tremblaient-ils devant les signes de sa présence? Parce que dans leur folie, ils avaient entrepris de rencontrer Dieu sur le terrain de ce qu’ils étaient en eux-mêmes, de leurs œuvres, au lieu de se rejeter sur sa miséricorde, sa grâce et son amour. Erreur fatale! et maintenant ils étaient amenés à le constater. Mais leur parole était irrévocable, et ils ne pouvaient alors être dégagés des obligations qu’elle impliquait.
Moïse fit donc «sortir le peuple hors du camp à la rencontre de Dieu, et ils se tinrent au pied de la montagne. Et toute la montagne de Sinaï fumait, parce que l’Éternel descendit en feu sur elle; et sa fumée montait comme la fumée d’une fournaise, et toute la montagne tremblait fort» (v. 17, 18). Dans les Psaumes nous lisons: «La terre trembla; les cieux aussi distillèrent des eaux devant Dieu, ce Sinaï trembla devant Dieu, le Dieu d’Israël» (Ps. 68:8). Le feu était donc ce qui caractérisait la présence de l’Éternel sur le Sinaï: feu et fumée, le feu étant le symbole de sa sainteté, mais de sa sainteté dans son aspect de jugement contre le péché. «Notre Dieu est un feu consumant». Ainsi, rencontrant Israël sur le terrain de la loi, le feu était l’expression la plus significative du fait que la justice et le jugement sont la base de son trône. C’est pourquoi Moïse parle de la «loi de feu» sortie de la droite de Dieu; de feu parce qu’étant sainte, et juste, et bonne, elle ne pouvait que juger et consumer ceux qui ne répondaient pas à ses exigences. C’est de cet effet que Moïse parle lorsqu’il dit: «Nous sommes consumés par ta colère, et nous sommes épouvantés par ta fureur» (Ps. 90:7).
14.7. La voix de Dieu
Comme le son de la trompette se prolongeait et se renforçait de plus en plus, Moïse parla à Dieu, et Dieu lui répondit par une voix. Puis Moïse fut appelé au sommet de la montagne, et quelle fut la nature du premier commandement qu’il reçut ? Déjà des bornes avaient été mises à l’entour de la montagne; car le lieu sur lequel Dieu se tenait était une terre sainte, et la peine de mort s’attachait à quiconque, homme ou bête, ne ferait que toucher la montagne. Mais même cela n’était pas suffisant. «Descends», dit l’Éternel à Moïse, «avertis solennellement le peuple, de peur qu’ils ne rompent les barrières pour monter vers Éternel pour voir, et qu’un grand nombre d’entre eux ne tombe» (v. 21). Tous, tant les sacrificateurs que le peuple, doivent être maintenus à distance, à l’exception de Moïse et d’Aaron, de peur que l’Éternel ne se jette sur eux (v. 24).
Tous ces détails sont du plus solennel intérêt en ce qu’ils montrent l’incapacité totale de l’homme à se tenir devant Dieu sur le fondement de ses propres mérites. Ils enseignent en même temps que si le pécheur se risque à entrer en contact avec Dieu sur un tel terrain, cela ne peut être que pour sa propre destruction. Plus encore, en dehors de l’expiation, Dieu ne peut pas rencontrer le pécheur sur le terrain de la justice sans le détruire. Quand donc les hommes apprendront-ils qu’il y a, et qu’il doit toujours y avoir, l’antagonisme le plus irréductible entre la sainteté et le péché; que Dieu doit être contre le pécheur à moins que les exigences de sa sainteté ne soient satisfaites; et qu’elles ne peuvent jamais l’être, sinon dans la mort du Seigneur Jésus Christ ? Considérée à cette lumière, nous avons ici une scène touchante. Dieu sur le Sinaï, dans toute la redoutable majesté de sa sainteté; le peuple, dans tout son éloignement et sa culpabilité, tremblant devant ce qu’il voyait et entendait, gardé à distance de la montagne, mais conduit hors du camp pour rencontrer Dieu et recevoir les commandements de sa juste loi, à laquelle il s’était engagé à obéir.
A suivre
Chapitre 20, versets 1 à 17
Plusieurs points en rapport avec le don de la loi demandent une attention spéciale. Le premier est la nature de la loi elle-même. Les commandements sont au nombre de dix, et sont fondés sur la relation dans laquelle Dieu était entré avec son peuple par la rédemption, ou plutôt en découlent. «Je suis l’Éternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison de servitude». Si nous considérons les commandements dans leur ensemble, nous verrons que les quatre premiers se rapportent à Dieu, et les six derniers à l’homme; c’est-à-dire qu’ils déterminent la responsabilité envers Dieu et envers l’homme. Aussi, en réponse à la question: quel est le grand commandement dans la loi? le Seigneur les résume ainsi: «Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta pensée». C’est là le grand et premier commandement. Et le second lui est semblable: «Tu aimeras ton prochain comme toi-même». De ces deux commandements dépendent la loi tout entière et les prophètes» (Matt. 22:35-40; voir Deut. 10:12 et Lév. 19:18). L’amour pour Dieu, parfait selon leur capacité, et l’amour pour leur prochain selon la mesure de l’amour pour soi-même, voilà ce qui était ordonné à Israël.
14.8. Les saintes exigences de Dieu
Mais remarquez que ce qui caractérise les commandements dans leur détail, c’est l’interdiction. «Tu ne...» est l’essence même du tout, si nous exceptons le quatrième commandement, et même là, «garder le sabbat» signifie s’abstenir de tout travail. Ce fait a une importante portée sur le second point que nous désirons considérer: l’objet de la loi. Ces dix commandements étaient la mesure de ce que Dieu exigeait d’Israël. Le peuple s’était volontairement engagé à obéir à la voix de Dieu et à garder son alliance, comme condition de la bénédiction. En réponse à cela, l’Éternel lui révélait par Moïse ce qu’il exigeait. Aussi un étalon fut-il établi, afin que, par ce moyen, le peuple pût facilement s’assurer par lui-même si oui ou non il obéissait à la parole de Dieu. Par ces commandements, Dieu venait donc éprouver les Israélites afin que sa crainte soit devant leurs yeux pour qu’ils ne pèchent pas (v. 20). Mais Dieu connaissait ce qui était dans leur cœur, même si eux l’ignoraient, et c’est pourquoi le but réel de la loi était d’amener à la lumière ce qui était dans leur cœur.
Cela explique la forme négative des commandements. Car pourquoi dire: Tu ne tueras point, tu ne commettras point adultère, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, si la tendance à toutes ces formes de péchés ne se trouvait pas en eux? L’apôtre l’explique en Romains 7. «Je n’eusse pas connu le péché, dit-il, si ce n’eût été par la loi; car je n’eusse pas eu conscience de la convoitise, si la loi n’eût dit: «Tu ne convoiteras point». Mais le péché, ayant trouvé une occasion par le commandement, a produit en moi toutes les convoitises, car sans la loi le péché est mort» (Rom. 7:7, 8). La convoitise était dans le cœur avant que la loi n’intervînt; mais, n’étant pas défendue, elle ne pouvait être connue comme convoitise. Dès le moment où le commandement dit: tu ne convoiteras point, la chose devint manifeste, et l’opposition du cœur à Dieu fut établie. La loi est donc intervenue, comme le dit l’apôtre ailleurs, afin que la faute abondât (Rom. 5:20), c’est-à-dire pour faire connaître les transgressions. Celles-ci étaient commises auparavant; mais elles n’étaient pas connues comme transgressions jusqu’à ce qu’elles furent défendues. Dès lors, leur nature ne pouvait plus être cachée, et tous pouvaient comprendre qu’elles étaient des transgressions de la loi de Dieu.
14.9. La loi pour obtenir la vie ?
Ce point est de toute importance, vu que même maintenant, où l’évangile de la grâce de Dieu est pleinement révélé et prêché, on entend affirmer qu’obéir à la loi est le chemin de la vie. Combien de milliers de personnes sont victimes de ce piège fatal. Puissent-elles peser les paroles de l’apôtre: «S’il avait été donné une loi qui eût le pouvoir de faire vivre, la justice serait en réalité sur le principe de la loi» (Gal. 3:21). Certes, il avait été dit: «Vous garderez mes statuts et mes ordonnances, par lesquels, s’il les pratique, un homme vivra» (Lév. 18:5); mais comment des hommes, pécheurs par nature et dans leur comportement, pourraient-ils garder les commandements de Dieu? Écoutons la propre argumentation du Saint Esprit, par le moyen de Paul, sur ce sujet: «Tous ceux qui sont sur le principe des œuvres de loi sont sous malédiction; car il est écrit: «Maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire». Or que par la loi personne ne soit justifié devant Dieu, cela est évident, parce que: «Le juste vivra de foi». Mais la loi n’est pas sur le principe de la foi, mais: «Celui qui aura fait ces choses vivra par elles» (Gal. 3:10-12). Cela ôte toute difficulté et établit sans aucun doute possible le vrai but de la loi, qui était, comme nous l’avons dit, de donner un étalon des exigences de Dieu, et de convaincre ainsi l’homme de péché. «La loi est intervenue afin que la faute abondât». Et on peut se servir maintenant avec beaucoup de bénédiction de la loi dans le même but. Si l’on rencontre un homme totalement confiant en sa propre justice, il peut être sondé et éprouvé par elle: on peut lui demander s’il aime Dieu de tout son cœur, et son prochain comme lui-même, et par là mettre à jour le caractère trompeur de ses propres œuvres.
14.10. La loi pour connaître le cœur de Dieu ?
Si cela est bien compris, et s’il y a soumission simple à la parole de Dieu, il n’y aura aucune difficulté à admettre que la loi n’est pas donnée comme une révélation complète de la pensée et du cœur de Dieu. La manière dont il est souvent parlé de la loi pourrait amener des âmes à supposer qu’il ne saurait y avoir de révélation plus pleine et plus complète. Mais s’il en était ainsi, où trouverions-nous la miséricorde de Dieu, ses compassions et son amour? Non, «la loi... est sainte, et le commandement est saint, et juste, et bon»; car c’est une révélation de Dieu, comme toute parole et tout acte de Dieu doivent nécessairement l’être; mais affirmer que la loi est une révélation pleine et parfaite, c’est ignorer la nécessité de l’expiation, c’est ne pas voir le vrai caractère de l’œuvre de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, c’est oublier, en un mot, la différence entre Sinaï et le Calvaire. Jusqu’à la croix, il était impossible à Dieu de se révéler parfaitement. Mais aussitôt que l’œuvre opérée à la croix a été accomplie, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas, pour montrer que Dieu était maintenant libre en justice, de se manifester en grâce au pécheur, et que le pécheur qui croyait au témoignage de Dieu quant à l’efficacité du sang de Christ était libre d’entrer dans la présence directe de Dieu. La loi dévoile le caractère de justice de Dieu et par conséquent ce qu’il exigeait d’Israël; mais Dieu lui-même demeurait encore dans l’obscurité profonde; il n’était pas révélé.
14.11. La loi comme règle de conduite ?
Un autre point demande à être examiné en passant. Tout en admettant que la loi n’est pas le moyen d’obtenir la vie, on entend parfois demander si elle n’est pas la règle de la conduite chrétienne. Considérons-la bien, et puis demandons-nous si cela est possible. Prenons par exemple les interdictions en rapport avec notre prochain. Est-ce que Dieu serait satisfait d’un chrétien qui s’en tiendrait à ne pas pratiquer les péchés spécifiés ici? Un chrétien qui se serait simplement abstenu de ces choses aurait-il la conviction d’avoir répondu à la pensée de Dieu quant à sa marche? Supposons maintenant qu’il soit même parvenu à aimer son prochain comme lui-même: est-ce que cela le placerait à la hauteur de l’exemple de Christ? Que dit l’apôtre Jean? «Par ceci nous avons connu l’amour, c’est que lui a laissé sa vie pour nous». C’est-à-dire que la vraie expression de l’amour apparaît dans la mort de Christ pour nous. Aussi l’apôtre ajoute-t-il: «Et nous, nous devons laisser nos vies pour les frères» (1 Jean 3:16). Agir ainsi serait certainement aimer nos frères mieux que nous-mêmes, aller donc bien au-delà de la portée de la loi.
La vérité, telle que nous l’a enseignée l’apôtre Paul, est que nous avons «été mis à mort à la loi par le corps du Christ, pour être à un autre, à celui qui est ressuscité d’entre les morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu» (Rom. 7:4). La loi était une règle pour Israël; mais Christ, et Christ seul, est le modèle du croyant. «Celui qui dit demeurer en lui, doit lui-même aussi marcher comme lui a marché» (1 Jean 2:6). C’est donc un modèle infiniment plus élevé que celui de la loi, et qui comporte des responsabilités beaucoup plus grandes. En fait, cette affirmation que nous sommes encore sous la loi, malgré la déclaration: «Vous n’êtes pas sous la loi, mais sous la grâce» (Rom. 6:14), provient de l’ignorance de ce qu’est la rédemption. Quand on a vu que les croyants sont sortis de leur ancienne condition par la mort et la résurrection de Christ, et qu’ils ont une place et une position tout à fait nouvelles, qu’ils ne sont pas dans la chair, mais dans l’Esprit (Rom. 8:9), on comprend facilement qu’ils appartiennent à une sphère dans laquelle la loi ne peut pas entrer; et que, comme Christ est le seul objet de leur âme, exprimer Christ dans leur marche et leur comportement est leur seule responsabilité pendant qu’ils traversent cette scène. Nous recommandons très spécialement ces points à l’attention de tout enfant de Dieu.
14.12. Effets du don de la loi
L’effet du don de la loi est maintenant développé. Le peuple est rempli de terreur, comme dans le chapitre précédent: «ils tremblèrent et se tinrent loin» (v. 18). Ils auraient pu apprendre par là que les pécheurs ne peuvent se tenir dans la présence de Dieu. Et ils «dirent à Moïse: Toi, parle avec nous, et nous écouterons; mais que Dieu ne parle point avec nous, de peur que nous ne mourions» (v. 19). Triste confession de ce qu’ils étaient, et indication révélatrice de ce qu’il adviendrait de l’obéissance à laquelle ils s’étaient engagés. Ah! si le pécheur voulait seulement apprendre cette leçon, que si Dieu parle avec lui lorsqu’il est dans ses péchés, il doit mourir! Car la sainteté et le péché ne peuvent cœxister, et s’ils étaient mis en contact, en dehors de l’expiation, il ne pouvait y avoir que ce seul résultat. Ces enfants d’Israël, tremblants, ne font donc qu’exprimer cette simple vérité. Dieu s’était approché dans sa sainteté, et les fils d’Israël épouvantés se tenaient loin de sa présence, de peur de mourir, proclamant qu’ils étaient des pécheurs dans leur culpabilité, incapables, comme tels, d’écouter sa voix. Moïse les exhorte alors à ne pas craindre, leur disant que c’est pour les éprouver que Dieu est venu, et afin que sa crainte soit devant leurs yeux, pour qu’ils ne pèchent point. Pour eux, le chemin était clairement indiqué dans les dix commandements, et bientôt on pourrait voir s’ils y marcheraient ou non. La position est nettement établie maintenant: le peuple se tient loin, de fait et moralement. Dieu était dans l’obscurité profonde, indiquant qu’il devait rester caché tant qu’il était sur le terrain de la loi. Moïse, par l’élection et la grâce de Dieu, occupe la place de médiateur. Ainsi, il peut s’approcher de l’obscurité profonde où Dieu était. Par là, il représente le seul «médiateur entre Dieu et les hommes... l’homme Christ Jésus» (1 Tim. 2:5).
14.13. Conditions pour adorer
Le chapitre se termine par des directives concernant l’adoration. Car aussitôt que la relation formelle entre Dieu et son peuple est établie, même sur le terrain de la loi, il est parlé de l’adoration. Il suffit de relever ici trois points. Premièrement que l’homme ne pouvait s’approcher de Dieu, sinon par des sacrifices. Deuxièmement, que Dieu pouvait venir et bénir en tout lieu où il mettrait la mémoire de son nom, malgré ce qu’ils étaient, en vertu de la bonne odeur de leurs offrandes1. Troisièmement, le caractère de l’autel est précisé. Cela pouvait être un autel de terre. S’il était de pierres, il ne devait pas être fait de pierres taillées, «car si tu lèves ton ciseau dessus, tu le profaneras. Et tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité n’y soit pas découverte» (v. 24-26). L’œuvre de l’homme et l’ordre de l’homme sont interdits. Ainsi, dans l’adoration, tout doit être selon Dieu; et s’il y a introduction ne fût-ce que d’une seule chose pour l’agrément ou la commodité, c’est de la profanation, et «la nudité» de l’homme est découverte. Avec quelle jalousie les chrétiens ne devraient-ils donc pas veiller à ce que rien ne soit admis dans l’adoration, qui n’ait le sceau de l’autorité de la parole de Dieu.
1 Le sacrifice pour le péché n’avait pas encore été prescrit. Ces offrandes étaient donc toutes des sacrifices de bonne odeur.
A suivre
Chapitre 21, versets 1 à 27
15. Les ordonnances
Cette partie renferme les différents «jugements» ou statuts donnés par Dieu pour diriger son peuple dans leurs diverses relations. Nous n’exposerons pas ceux-ci dans leurs détails, mais nous nous bornerons à indiquer le sens et la portée de chacune des classes de ces jugements. Ils offrent une image frappante des soins de Dieu pour tout ce qui concernait la marche et les voies de son peuple; et si un châtiment est attaché à la transgression de ces différentes lois, ce n’est qu’en accord avec la dispensation qui venait d’être établie.
15.1. Le serviteur hébreu
Ch. 21:2-6 — La première ordonnance concerne le serviteur hébreu. Nous avons en lui une image magnifique et très expressive de Christ. Le point à relever, c’est qu’après avoir servi six ans, il devait sortir «libre, gratuitement». Mais si son maître lui avait donné une femme durant le temps de sa servitude, et qu’elle lui ait enfanté des fils et des filles, sa femme et ses enfants appartiendraient à son maître, mais lui sortirait seul; et l’unique manière pour lui de garder sa femme et sa famille était de devenir serviteur pour toujours. L’application typique à Christ est très intéressante. Christ a pris la forme d’esclave (Phil. 2); il est venu pour faire la volonté de Dieu (Héb. 10); non pour faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l’a envoyé (Jean 6:38). Il a servi en perfection durant toute la période qui lui était assignée et, par conséquent, il aurait pu sortir libre. Comme il le dit à Pierre: «Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père, et il me fournira plus de douze légions d’anges? Comment donc seraient accomplies les écritures, qui disent qu’il faut qu’il en arrive ainsi?» (Matt. 26:53, 54). En ce qui le concernait Lui, il n’y avait aucune nécessité qu’il allât à la croix, sinon la contrainte de son propre cœur et son désir de glorifier Dieu et d’acquérir son épouse, cette perle de grand prix.
Pourquoi alors se laissa-t-il clouer à cette croix infâme? Pourquoi se laissa-t-il mener comme un agneau à la boucherie? Il était libre devant Dieu et devant les hommes. Personne ne pouvait le convaincre de péché. Il était absolument libre; et alors, nous le répétons, pourquoi n’est-il pas sorti «libre»? Parce qu’il aimait son Maître, sa femme et ses enfants, et ainsi il allait devenir Serviteur à toujours. Son «Maître» occupait dans son âme la place suprême, et il brûlait du saint désir de le glorifier sur la terre et d’achever l’œuvre qu’il lui avait donné à faire. Il aimait «sa femme», l’Église, et s’est livré lui-même pour elle; et il était attaché par les mêmes liens d’immuable amour à «ses enfants», les siens considérés individuellement. C’est pourquoi il ne voulait pas sortir libre, mais il s’est présenté lui-même à son Maître, afin de le servir à toujours. Ainsi, son oreille fut percée, signe de service (comparer Ps. 40:6 avec Héb. 10:5), en témoignage de la position qu’il prenait. Il ne cessera par conséquent jamais d’être Serviteur. Il sert les siens maintenant à la droite de Dieu (voir Jean 13); et il les servira dans la gloire encore. Lui-même dit: «Bienheureux sont ces esclaves, que le maître, quand il viendra, trouvera veillant. En vérité, je vous dis qu’il se ceindra et les fera mettre à table, et, s’avançant, il les servira» (Luc 12:37). L’image parle donc à la fois de l’humble service de Christ sur la terre, et du service qu’il continue d’exercer maintenant qu’il est glorifié à la droite de Dieu et qu’il accomplira pour les siens durant l’éternité. Elle révèle en même temps la grâce incomparable et l’amour insondable de son cœur, amour et grâce qui l’ont conduit à prendre cette position et à la garder. Et combien il est merveilleux que son amour associe l’Église à son «Maître». «J’aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre». Bien-aimé Seigneur, tu as ainsi uni les tiens, par la puissance de ton amour, à ton Dieu et à toi-même pour toujours!
15.2. Protection de la servante
Ch. 21:7-11 — Le paragraphe suivant contient les directives à l’égard de la fille vendue par son père pour être une servante. Bien que celle-ci n’ait point à sortir «comme sortent les serviteurs», Dieu, dans sa tendresse, protège ses droits dans la position qu’elle occupe. La tendance à traiter ceux qui sont entièrement subordonnés et dépendants suivant l’humeur et les caprices du moment ne se manifeste que trop souvent. Cela ne devrait pas être. Si son maître changeait d’avis et qu’elle en venait à déplaire à ses yeux, elle devait pouvoir être rachetée. Elle ne devait pas être dégradée dans son service, pas plus qu’il n’avait le pouvoir de la vendre à un peuple étranger. Par sa conduite trompeuse, il avait perdu les droits qu’il aurait autrement possédés. Qu’elle fût fiancée à son fils ou à lui-même, les droits de la servante étaient soigneusement maintenus; et s’ils étaient méprisés, son maître prenant une autre femme, alors elle serait absolument libre. Ainsi, dans son amour compatissant, l’Éternel protège par des lois ceux d’entre les siens qui sont faibles et sans défense, afin de leur assurer un traitement équitable et correct.
15.3. Délits punis de mort
Ch. 21:12-17 — Nous trouvons ensuite les délits auxquels la peine de mort est attachée. Le premier cas traité est celui d’un meurtre. Ce n’est pas une ordonnance nouvelle. À Noé, Dieu avait dit: «Qui aura versé le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé; car à l’image de Dieu, il a fait l’homme» (Gen. 9:6). Dieu réclamerait la vie de l’homme de la main du «frère» de tout homme. Ainsi l’homme fut fait le gardien de son frère, et Dieu protégeait celui qu’il avait fait à sa propre image par la peine la plus solennelle qu’il était en droit d’imposer; car la vie lui appartient et, par conséquent, il ne peut pas admettre qu’un autre empiète sur sa prérogative. Ainsi, lorsque Caïn tua son frère Abel, l’Éternel lui dit: «Qu’as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre à moi» (Gen. 4:10). Pour le meurtre de propos délibéré, la peine ne pouvait pas être remise, même si le meurtrier avait pu fuir pour chercher protection à l’autel de Dieu (voir 1 Rois 2:28-32). Il devait mourir. Rien dans la parole de Dieu ne justifie le mouvement philanthropique moderne pour l’abolition de la peine de mort. Celui-ci met des idées humaines à la place de la loi primitive de Dieu. En fait, il élève l’homme au-dessus de Dieu. Les directives données par notre Seigneur dans le «sermon sur la montagne» (Matt. 5:38-48) ne s’appliquent qu’aux relations des sujets de son Royaume, non pas à celles existant d’homme à homme et, par conséquent, elles n’annulent en aucune manière le précepte donné à Noé.
15.4. Villes de refuge
Une exception est faite. «S’il ne lui est pas dressé d’embûche, et que Dieu l’ait fait tomber sous ses mains, je t’établirai un lieu où il s’enfuira» (comparer Deut. 19:4, 5; lire en fait tout le chapitre). Si nous appliquons ces statuts à la conduite de la nation juive envers Christ, nous souvenant comment les Juifs «dressèrent des embûches», et comment finalement, à force de corruption et d’artifices, ils réussirent à obtenir son arrestation et sa condamnation, il pourrait sembler qu’il n’y ait aucune échappatoire possible pour ce peuple. Mais le Seigneur lui-même pria: «Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font» (Luc 23:34); de sorte que s’ils se repentent, Dieu, en grâce, sur le fondement de cette intercession, attribuera cet acte à leur ignorance, et établira pour eux une ville de refuge, pour leur délivrance et leur sécurité. Ainsi, s’adressant à eux, Pierre dit: «Je sais que vous l’avez fait par ignorance, de même que vos chefs aussi» (Actes 3:17). La grâce peut ainsi délivrer du châtiment de la loi, sur la base de l’expiation pour le péché, expiation qui a été opérée par la mort de Christ.
Frapper ou maudire son père ou sa mère (v. 15, 17) faisait aussi encourir la peine de mort. Dieu établissait ainsi, par les saintes sanctions de sa loi, l’autorité des parents et réclamait vis-à-vis de celle-ci l’attitude respectueuse des enfants. La désobéissance aux parents est mentionnée comme un signe des temps fâcheux qui surviendront dans les derniers jours (2 Tim. 3:2); cela montre clairement la valeur, aux yeux de Dieu, de la soumission des enfants à leurs parents. Car c’est en fait l’autorité de Dieu que ceux-ci représentent, d’où son caractère absolu lorsqu’il en est fait usage pour Dieu, qui exige une obéissance implicite et inconditionnelle (voir Deut. 21:18-21; Éph. 6:1; Col. 3:20). Cela explique la gravité des péchés mentionnés ici. Mais si le fait de frapper ou de maudire les parents selon la chair était puni de mort, combien plus terrible est le péché de rébellion ouverte contre Dieu!
Voler un homme, et vendre un homme, c’est-à-dire l’esclavage tel qu’il est encore pratiqué dans quelques parties du monde, avait aussi pour châtiment la peine de mort (v. 16). L’homme, même pécheur et malgré les exigences de Dieu à son égard, exigences qui doivent être satisfaites pour qu’il puisse être délivré, est d’une valeur telle aux yeux de Dieu, que sa liberté doit être tenue pour sacrée; Combien il est étonnant qu’avec un tel passage, l’esclavage dans ses pires formes: vol, vente et détention d’hommes comme s’il s’agissait de bétail, ait pu être maintenu si longtemps par ceux qui professent suivre Christ.
15.5. Dommages causés au prochain
Ch. 21:18-27 — Ce paragraphe traite des offenses contre la personne de son prochain et des peines qui s’y rattachent. Nous ne ferons que deux remarques, laissant au lecteur le soin de se pencher sur les détails. La première, c’est que tous ces préceptes révèlent la tendresse de Dieu dans ses soins pour le corps des siens, et particulièrement de ceux qui occupent une position de subordination. La seconde, c’est que nous trouvons ici le vrai caractère de la loi. La grâce en est absente. C’est œil pour œil, et dent pour dent... Le Seigneur cite expressément ces ordonnances pour montrer le contraste entre celles-ci et la grâce. Il dit: «Vous avez ouï qu’il a été dit: «œil pour œil, et dent pour dent». Mais moi, je vous dis: Ne résistez pas au mal; mais si quelqu’un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l’autre» (Matt. 5:38, 39). Sur le terrain de la loi, une équivalence exacte est requise, ni plus ni moins; mais la grâce n’insiste pas sur ses droits; car nous-mêmes ayant été les objets de la grâce, ayant eu toute notre dette remise, nous devons agir selon le même principe dans nos rapports les uns avec les autres. N’oublions cependant jamais que la grâce elle-même a son fondement inébranlable dans la justice et que, par conséquent, elle règne par la justice (Rom. 5:21), établie sur une base éternelle et immuable.
A suivre
Chapitre 21, verset 28 à chapitre 22 verset 31
Ch. 21:28-36 — Ces versets présentent la responsabilité du propriétaire pour les actes de son bétail. Nous nous bornerons à indiquer que le même principe de juste compensation prévaut ici également. La mort du maître de la bête, comme aussi celle du bœuf, étaient requises dans le cas où le maître avait été averti du penchant de l’animal, et où il n’avait pris aucune précaution pour éviter le dommage (v. 29). De quelle manière remarquable cela ne place-t-il pas devant notre esprit la vérité enseignée par le Seigneur, que les cheveux mêmes de notre tête sont tous comptés! Tout est prévu, et chaque relation, avec ses diverses violations, est réglée en harmonie avec le juste gouvernement sous lequel Israël était maintenant placé. Il y a un détail qu’il ne faut pas passer sous silence. Le serviteur, ou la servante, était évalué àtrente sicles d’argent. C’est à cela que fait allusion le prophète Zacharie: «Et je leur dis: Si cela est bon à vos yeux, donnez-moi mon salaire: sinon, laissez-le. Et ils pesèrent mon salaire, trente pièces d’argent» (Zach. 11:12). C’est Christ qui est présenté ainsi, lui qui a été livré pour trente pièces d’argent (Matt. 26:15). Telle fut la valeur à laquelle l’homme estima Dieu manifesté en chair, le Fils unique du Père!
15.6. Vol et restitution
Dans le chapitre suivant (chap. 22), nous avons la loi concernant la restitution dans les cas de vol.
Ch. 22:1-15 — Zachée fait sans doute allusion à cette ordonnance de la loi (v. 1), lorsqu’il dit au Seigneur: «Si j’ai fait tort à quelqu’un par une fausse accusation, je lui rends le quadruple» (Luc 19:8). Dans le chapitre précédent nous avons remarqué comment Dieu protégeait la vie et la personne des siens; dans ce chapitre, nous voyons comment il veille sur leurs biens, et tient tous ceux qui méprisent sa loi pour redevables envers lui. Mais la question placée devant notre âme est la suivante: si le fait de voler son prochain est puni de cette manière, que faire du péché qui consiste à frustrer Dieu? Comment ceux qui sont déjà pécheurs pourront-ils faire réparation devant Lui? C’est impossible; et si nous avions été laissés à nous-mêmes, nous serions à jamais restés sous les conséquences de nos fautes. Mais dans les Psaumes, nous entendons quelqu’un dire: «Ce que je n’avais pas ravi, je l’ai alors rendu» (Ps. 69:4). Il a été le sacrifice pour le délit, comme aussi le sacrifice pour le péché et l’holocauste. Il a par conséquent fait une restitution pleine et parfaite (c’est ce que nous pouvons dire si nous croyons) pour toutes nos fautes. Pas une seule transgression ne pourrait être mise à notre charge pour laquelle il n’ait pas, Lui, fait réparation dans sa grâce merveilleuse et sa miséricorde.
Cela place devant nous un aspect très précieux de sa mort. Dans notre chapitre, le coupable devait lui-même restituer. Nous n’aurions jamais pu le faire si un substitut ne s’était pas présenté pour nous. S’il n’y avait eu personne pour rendre à Dieu ce que Lui n’avait pas ravi — mais bien nous — nous serions restés à jamais responsables envers Lui, à jamais redevables, mais sans rien avoir pour payer. Plus donc nous nous souviendrons de cela, plus nous magnifierons la grâce de celui qui, de sa propre volonté, a répondu devant Dieu pour nous, de telle sorte qu’il peut en justice nous acquitter de toute exigence, et qu’il peut tout aussi justement nous introduire dans la lumière et la joie inaltérables de sa propre présence. Béni soit à jamais son saint nom!
Nous passons maintenant à des injonctions d’une autre nature. La première de celles-ci est en rapport avec le désir charnel (v. 16). Ici la culpabilité est principalement celle de l’homme, sans cependant enlever à la femme sa part de responsabilité. L’homme ne peut pas pécher avec légèreté, et agir comme s’il n’avait pas péché, en particulier dans le cas mentionné dans ce passage. Aussi était-il dans l’obligation de payer une dot et de prendre pour femme celle qu’il avait séduite. Le principe général est posé par l’apôtre Paul en 1 Corinthiens 6:16: «Ne savez-vous pas que celui qui est uni à une prostituée est un seul corps avec elle? «Car les deux, dit-il, seront une seule chair». Pour la même raison, le Seigneur dit que «quiconque répudiera sa femme, non pour cause de fornication, et en épousera une autre, commet adultère; et celui qui épouse une femme répudiée, commet adultère» (Matt. 19:9). Quelle appréciation sur les lois humaines qui méprisent la sagesse de Dieu et en même temps trahissent l’ignorance la plus complète des relations fondamentales entre l’homme et la femme. Si nous sommes tenus d’obéir aux puissances qui sont établies lorsque celles-ci ne sont pas en conflit avec l’autorité de Dieu, leurs lois ne peuvent pas être le guide de la conscience du croyant ou de l’Église.
15.7. Autres péchés punis de mort
«Tu ne laisseras point vivre la magicienne» (v. 18). Ce qui caractérisait essentiellement une magicienne était le commerce avec les esprits, ce que l’on retrouve dans le spiritisme des temps actuels. Aussi dans le Lévitique est-elle nommée une évocatrice d’esprits (chap. 20:27). La femme qui évoquait les esprits à En-Dor est un exemple des personnes de son espèce; car nous lisons que Saül vint chez elle et dit: «Devine pour moi, je te prie, par un esprit, et fais-moi monter celui que je te dirai» (1 Sam. 28:8). C’est précisément ce que les spirites prétendent faire: mettre leurs clients en rapport avec les esprits de ceux qui ne sont plus. Semblables à Saül qui était incapable d’obtenir des communications avec Dieu, ils cherchent à entrer en relation avec l’au-delà par l’intermédiaire d’esprits. C’est, en fait, se détourner de Dieu vers Satan. Tout ce système, tant en Israël qu’aujourd’hui, est satanique. Aussi la magicienne devait-elle être mise à mort. Cela montre l’antagonisme total de sa profession envers Dieu; le spiritisme en vogue maintenant n’est pas moins abominable, ni moins destructeur pour l’âme lorsqu’on s’y adonne.
Nous trouvons ensuite deux péchés punis de mort. Le premier est celui de la chair dans sa forme la plus horrible et la plus révoltante. Le second est l’idolâtrie. Dieu ne pouvait pas admettre que son propre peuple reconnaisse un autre dieu, en dehors de lui. Ce serait un reniement de ses propres droits et de son autorité, et le renversement des fondations mêmes de sa relation avec son peuple. De leur part, ce serait la négation du vrai caractère de Dieu et le rejet de son pouvoir absolu. L’adoration du vrai Dieu et celle de faux dieux ne pouvaient donc pas cœxister. Aussi l’apôtre dit-il: «Les choses que les nations sacrifient, elles les sacrifient à des démons et non pas à Dieu: or je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons; vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons» (1 Cor. 10:20, 21). Accepter des faux dieux, c’est rejeter le vrai Dieu. À l’opposé, lorsque les Thessaloniciens se furent convertis, il est dit d’eux qu’ils se sont «tournés des idoles vers Dieu, pour servir le Dieu vivant et vrai...» (1 Thess. 1:9).
15.8. L’étranger, la veuve, l’orphelin, le pauvre
Ch. 22:21-27 — Ces versets présentent plusieurs cas où la bonté et la compassion sont requises. L’étranger est nommé en premier: le souvenir de ce que les Israélites avaient été dans le pays d’Égypte devait diriger toute leur conduite envers lui. Ils avaient eux-mêmes connu l’amertume de l’âme par un dur esclavage, lorsqu’ils étaient sous le joug de fer du Pharaon, et ils pouvaient, par conséquent, entrer dans les sentiments de ceux qui étaient étrangers dans un pays éloigné.
Puis les faibles sont placés sur le cœur des Israélites; et, de tous les sans-appui qui font appel à notre compassion, certes la veuve et l’orphelin ont la première place. Aussi Dieu les entoure-t-il ici de la puissante protection de son bras. Ceux qui les affligeraient seraient mis à mort, leurs femmes seraient veuves, et leurs enfants orphelins. Tout au long des Écritures, ces deux classes de personnes sont mentionnées comme étant les objets particuliers des soins de Dieu, aussi devraient-elles être les objets de notre sollicitude. L’apôtre Jacques dit: «Le service religieux pur et sans tache devant Dieu le Père, est celui-ci: de visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, de se conserver pur du monde» (Jacq. 1:27).
Les deux ordonnances suivantes concernent le pauvre, la première, pour le protéger contre l’extorsion, comme pour empêcher le riche de tirer profit de sa pauvreté; et la seconde, pour le mettre à l’abri du dénuement. Bien que les enfants d’Israël fussent maintenant gouvernés depuis le Sinaï, ces lois nous permettent de découvrir le cœur de Dieu. Quelle tendresse dans l’indication qu’un vêtement pris en gage devait être rendu «avant que le soleil soit couché; car c’est sa seule couverture, son vêtement pour sa peau: dans quoi coucherait-il? Il arrivera que, quand il criera à moi, je l’écouterai; car je suis miséricordieux» (v. 26, 27). L’amour de Dieu doit être reflété par les siens, et Dieu est touché par la vue de celui qui n’a rien pour se couvrir lorsqu’il se couche pour dormir!
15.9. Diverses dispositions
Le respect pour les autorités établies est également enjoint. «Tu n’outrageras pas les juges, et tu ne maudiras pas le prince de ton peuple» (v. 28). L’apôtre Paul cite ce passage lors de sa comparution devant Ananias et le sanhédrin (Actes 23:5). Cela correspond aux exhortations que nous trouvons dans les épîtres (Rom. 13; 1 Tim. 2:2; 1 Pierre 2:13-17). La conduite des enfants de Dieu en ce qui concerne les rois, les gouverneurs et les magistrats est donc extrêmement simple. Ils doivent respect et obéissance à toute autorité, quelle que soit sa forme, tant que celle-ci ne s’oppose pas à ce qui est dû à Dieu. Ils sont mis dans cette place de soumission par le Seigneur lui-même.
Les premiers fruits aussi bien que le premier-né de leurs fils devaient être offerts à Dieu (v. 29:30; voir chap. 13:12, 13). Les Israélites devaient reconnaître par là à la fois leur dépendance et la source de leurs bénédictions, et confesser qu’eux-mêmes appartenaient à l’Éternel. C’était Dieu qui amènerait à maturité les fruits et qui donnerait «ce qui coule» du pressoir; en témoignage de cela, il demandait pour lui une offrande. Il revendiquait également le premier-né de leurs fils, mais cela — nous l’avons vu au chapitre 13 — en rappel de la destruction des premiers-nés d’Égypte la nuit de la Pâque, et de leur propre rédemption par le sang de l’agneau pascal.
En résumé, les Israélites devaient être «des hommes saints» pour l’Éternel, séparés du mal et sanctifiés pour Dieu; car celui qui avait fait d’eux son peuple était saint, et voulait qu’ils soient conformes à son caractère. À cause de cela, ils ne devaient pas se souiller par des aliments impurs, de la chair déchirée par des animaux impurs et bonne seulement à être jetée aux chiens. Un peuple saint doit marcher dans la sainteté, comme il convient devant un Dieu saint. Des sujets d’une nature différente sont introduits dans le chapitre suivant (23).
A suivre
Chapitre 23, versets 1 à 19
15.10. Médisance et faux témoignage
Chap. 23:1-8 — Il est d’abord question des péchés de la langue. Le premier est relatif aux faux bruits, rapportés ou reçus. Combien de mal a été fait par ce moyen, même dans l’Église de Dieu! Qui ne serait pas horrifié à la pensée de faire courir un faux bruit? Un tel péché serait condamné par tout esprit droit; même un homme du monde n’en atténuerait pas la gravité. Mais le texte original a une signification plus étendue: il inclut la réception d’un faux bruit. Plusieurs de ceux qui éviteraient le premier péché tombent dans le piège du second. On entend quelque chose qui semble véridique et on le répand, alors que si on avait pris la peine de le vérifier, on aurait pu en constater la fausseté. Les chrétiens plus que tous devraient être sur leur garde et refuser tout rapport jetant du discrédit sur leur prochain, à moins que le fait ne soit confirmé par un témoignage incontestable. La responsabilité repose ainsi sur celui qui entend comme sur celui qui répète des bruits. Si nous nous souvenions de cela, plus d’une calomnie serait étouffée d’emblée, plus d’un rapporteur démasqué et plus d’une rupture de communion évitée. L’antidote se trouve dans cet amour qui «n’impute pas le mal... ne se réjouit pas de l’injustice, mais se réjouit avec la vérité... supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout» (1 Cor. 13:5-7). Le faux témoignage est ensuite condamné, péché connu sous le nom moderne de parjure. Cette injonction, de même que celles du verset suivant et des versets 3 et 5, semble liée à l’administration de la justice. Rien n’échappe à l’œil d’un Dieu juste, aucun mauvais penchant ni aucune mauvaise influence, aussi Dieu donne-t-il des directives pour la conduite des siens dans chaque circonstance de leur vie. Il est difficile d’être seul contre une multitude, même si la cause est juste. Avec le Seigneur devant l’âme, cela devient simple.
D’un autre côté, le pauvre ne doit pas être favorisé dans son procès; que cela paraisse juste ou injuste, le jugement ne sera pas «fléchi» (v. 6). Certains peuvent se laisser influencer par le riche, d’autres par le pauvre, spécialement dans une époque de démocratie et de mépris de l’autorité légale. Mais le cœur doit être libre à l’égard des deux, et il le sera, s’il demeure dans un chemin d’obéissance à la parole de Dieu. Au milieu de ces commandements, nous trouvons une directive spéciale au sujet du bœuf ou de l’âne d’un ennemi. L’Israélite ne devait pas déverser sa colère sur le bétail d’un ennemi, ni lui refuser son aide à cause de son inimitié à l’égard de son propriétaire. «Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi, ou son âne, égaré, tu ne manqueras pas de le lui ramener»; «car en faisant cela tu entasseras des charbons de feu sur sa tête». De même, «si tu vois l’âne de celui qui te hait couché sous son fardeau... tu ne manqueras pas de le délier». Les compassions de Dieu se déversent sur ses créatures muettes, et les siens devraient l’imiter en toutes choses.
15.11. Vérité et justice
La vérité et la justice sont également enjointes (v. 7). Le motif donné à cet égard est très remarquable: «Car je ne justifierai pas le méchant». Dieu est juste dans toutes ses voies en gouvernement, faisant preuve d’une discrimination infaillible; et il ne permet pas à l’homme de relever quelque chose contre lui. Mais, comme le proclame le psalmiste, il sera justifié quand il parle, et trouvé pur quand il juge (Ps. 51:4). Le méchant n’échappera par conséquent jamais à son jugement. Mais en grâce, Dieu a révélé un moyen par lequel il peut justifier l’impie (Rom. 5). Sous la loi c’était impossible. «Mais maintenant, sans loi, la justice de Dieu est manifestée, témoignage lui étant rendu par la loi et par les prophètes, la justice, dis-je, de Dieu par la foi en Jésus Christ envers tous, et sur tous ceux qui croient» (Rom. 3:20, 21). Sur ce terrain il peut être juste et justifiant celui qui est de la foi de Jésus (v. 26).
Une mise en garde contre la réception de présents est ajoutée. Souvenons-nous qu’il s’agit encore d’une question de jugement entre homme et homme, ou du discernement entre la vérité et la fausseté. Recevoir un présent, dans un tel cas, aveuglerait ceux qui voient clair et pervertirait les paroles des justes. Cela pourrait éloigner Dieu de devant une âme et, par là, détourner un œil simple. Le verset 9 est une répétition de l’injonction contenue dans le chapitre 22, 21. Cela montre son importance aux yeux de Dieu, et ici, il est ajouté avec emphase: «Vous savez ce qu’est le cœur d’un étranger». Les enfants d’Israël étaient donc qualifiés de par leur propre expérience à sympathiser avec les étrangers (comparer Héb. 4:15, et aussi 2:18); et le souvenir de leurs propres afflictions passées devait les diriger dans leur conduite envers ceux qui connaissaient les mêmes circonstances.
15.12. Le sabbat — les fêtes
Viennent ensuite diverses ordonnances concernant le pays et les fêtes.
Ch. 23:10-19 — La terre devait jouir de ses sabbats, en témoignage perpétuel qu’elle appartenait à l’Éternel. Elle donc aussi, comme l’homme, devait avoir part au repos de Dieu. Ici cependant il est tenu compte de l’indigent et des bêtes des champs. On devait prendre soin de toute la création de Dieu. Il était ainsi rappelé aux enfants d’Israël qu’ils n’étaient que des gérants et qu’ils tenaient de l’Éternel leur pays, leurs vignes et leurs oliviers. Ils devaient considérer avec égards non seulement l’indigent mais même les bêtes des champs, puisqu’ils étaient les objets des soins de Dieu.
Le sabbat de l’homme vient ensuite. Nous trouvons les fêtes au complet en Lévitique 23; et dans ce chapitre comme ici, le sabbat est nommé en premier. Dans notre passage, trois fêtes seulement sont mentionnées en plus du sabbat: la fête des pains sans levain, la fête de la moisson et la fête de la récolte, c’est-à-dire, la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. Les fêtes dans leur ensemble, telles qu’elles nous sont présentées dans le Lévitique, symbolisent tout le cycle des voies de Dieu envers Israël. En conséquence, le sabbat a la première place, parce que le but et le résultat de toutes les voies de Dieu envers eux (comme aussi envers les croyants de la présente dispensation) est de les amener dans la jouissance de son repos. Le but de Dieu étant révélé, nous trouvons, développées typiquement, les méthodes par lesquelles il sera atteint, ou les voies successives de Dieu pour y parvenir.
Bien qu’il ne soit parlé que de trois fêtes dans notre chapitre, celles-ci sont très significatives. La première est la fête des pains sans levain1; la seconde celle des premiers fruits, symbolisant Christ en résurrection comme cela est développé avec plus de détails dans le Lévitique; la troisième celle de la récolte, suggérant la récolte des âmes, dont la résurrection de Christ est le gage, et dont la Pentecôte a été le commencement béni. C’est ainsi que nous lisons: «Les prémices, Christ; puis ceux qui sont du Christ, à sa venue» (1 Cor. 15:23). Ce passage s’applique premièrement à Israël, mais, dans un sens plus large, la récolte dont il est parlé ici comprendra les saints de cette dispensation comme aussi ceux de la dispensation milléniale, en un mot, l’immense multitude des rachetés de chaque période de l’histoire de l’homme. Les Israélites devaient donc, trois fois l’an, célébrer une fête à l’Éternel et, en ces occasions, tous leurs mâles devaient paraître devant la face du Seigneur, l’Éternel. C’était la pensée centrale de la fête: le rassemblement du peuple autour de lui, sur le fondement qu’il avait lui-même établi, en fait celui de la rédemption. Ils étaient donc rassemblés autour de l’Éternel comme un peuple racheté, pour prendre garde à tout ce qu’il leur avait dit; et ils ne devaient pas même mentionner le nom d’autres dieux, ni le laisser entendre de leur bouche (v. 13). Comme peuple racheté et sanctifié, ils appartenaient seulement et exclusivement à l’Éternel.
1 La signification de cette fête a été exposée en rapport avec le chapitre 13.
15.13. Ordonnance concernant le levain et la graisse
L’interdiction de manger du pain levé est une fois encore répétée ici, en rapport avec le sang du sacrifice; car, comme les sacrifices nous parlent de Christ, le levain, emblème du mal, aurait faussé leur signification symbolique. Christ ne peut pas être associé avec le mal. Aussi le levain était-il formellement interdit. De même, la graisse du sacrifice ne devait pas passer la nuit jusqu’au matin. (Comparer chap. 12:10). L’explication complète de cette prescription nous sera donnée dans les directives concernant le sacrifice de prospérités (Lev. 3). «La graisse qui couvre l’intérieur, et toute la graisse qui est sur l’intérieur, et les deux rognons, et la graisse qui est dessus, qui est sur les reins, et le réseau qui est sur le foie, qu’on ôtera jusque sur les rognons; et les fils d’Aaron feront fumer cela sur l’autel, sur l’holocauste qui est sur le bois qui est sur le feu: c’est un sacrifice par feu, une odeur agréable à l’Éternel» (v. 3-5). La graisse était donc la part de Dieu. (Voir aussi Lév. 4:8-10). À cause de cela, elle ne devait pas être laissée de côté jusqu’au matin suivant, mais elle devait être offerte aussitôt. Dieu doit avoir sa part avant que les siens aient la leur. C’est là le secret de toute bénédiction: donner à l’Éternel la place suprême, penser d’abord à ce qui lui est dû à lui, et oublier toute autre chose jusqu’à ce que cela lui ait été rendu.
15.14. Autres prescriptions
Les Israélites devaient apporter les prémices des premiers fruits de leur terre à la maison de l’Éternel, leur Dieu. En Deutéronome 26, nous trouvons une magnifique description de cette obligation et de la manière dont il fallait s’en acquitter. C’est un exposé inspiré de cette injonction. Enfin, nous avons une interdiction très remarquable (v. 19). Elle est répétée trois fois dans les Écritures (chap. 34:26; Deut. 14:21). Dieu veut que les siens soient pleins de délicatesse, et il les met en garde contre la violation de tout instinct de la nature. Le lait de la mère était la nourriture, la subsistance du chevreau, aussi ne devait-il pas servir à cuire le jeune animal pour être mangé par d’autres. Certains ont vu un enseignement spirituel dans cette prescription.
Dans la dernière partie de ce chapitre, nous voyons ce que Dieu avait prévu pour amener son peuple au lieu qu’il avait préparé, ainsi que des mises en garde quant à leur conduite, et une déclaration de la manière selon laquelle les Israélites entreraient en pleine possession du pays.
A suivre
Chapitre 23, verset 20 à chapitre 24, verset 3
15.15. Conduits et protégés par l’ange
Ch. 23:20-33 — Un ange irait devant eux pour les conduire et les garder dans le chemin. Il en est souvent parlé (chap. 14:19; 33:2; Nomb. 20:16, etc.). Le prophète Ésaïe l’appelle l’Ange de sa face (la face de l’Éternel) (És. 63:9). Qui donc était cet Ange? Il est évident, tant d’après ces versets que d’après le chapitre 14 et d’autres passages, que des caractères divins lui sont attribués. Dans notre chapitre, par exemple, il est dit: «Mon nom est en lui». Au chapitre 14, après avoir été présenté comme un ange, il est identifié à l’Éternel (comparer le v. 24 avec le v. 19). Nous trouvons la même chose en Genèse 22, en rapport avec le sacrifice d’Isaac (v. 15, 16). Il est donc clair que l’ange est un être divin; et cela justifie la déduction (faite de tout temps par les hommes pieux qui se sont penchés sur la Parole) que cet ange personnifie la deuxième Personne de la Trinité, Dieu le Fils, l’Éternel. Comme tel, dans la diversité de ses manifestations, nous pouvons voir des préfigurations de son incarnation. C’est lui qui a toujours été le Conducteur de son peuple; et c’est lui ici qui prend place à la tête des enfants d’Israël pour les garder dans le chemin et les amener au lieu que Dieu avait préparé. Comme le dit Ésaïe: «L’Ange de sa face les a sauvés; dans son amour et dans sa miséricorde il les a rachetés, et il s’est chargé d’eux, et il les a portés tous les jours d’autrefois» (És. 63:9).
D’où l’avertissement solennel adressé à Israël. Ils devaient prendre garde à eux à cause de sa présence, écouter sa voix et ne pas l’irriter. Il était saint, et du fait que son peuple s’était placé sous la loi, il ne pouvait pas pardonner leurs transgressions. «Mon nom» — l’expression de tout ce qu’était Dieu dans sa relation avec Israël — «est en lui», de ce fait il agirait en justice, sur la base de la loi qui avait été donnée comme niveau de leur conduite. D’un autre côté, l’obéissance devenait la condition de sa complète identification avec leur cause. S’ils obéissaient, leurs ennemis seraient ses ennemis, et il les exterminerait.
15.16. Conditions de la bénédiction
Il est à remarquer que toutes ces instructions concernent le pays plutôt que le désert. À cet égard, deux choses desquelles dépendraient toutes leurs bénédictions sont ajoutées: se séparer du mal et servir l’Éternel, leur Dieu (v. 24, 25). Ces conditions de bénédiction demeurent toujours les mêmes. Elles sont aussi vraies maintenant qu’elles l’étaient pour Israël. Rappelons de nouveau que les Thessaloniciens sont décrits comme s’étant tournés des idoles vers Dieu, pour servir le Dieu vivant et vrai (1 Thess. 1:9). En fait, là où Dieu se manifeste, il ne peut y avoir aucune complicité avec le mal. Dieu revendique tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, et lorsque cette exigence est reconnue, il peut nous bénir selon les désirs de son propre cœur. Ainsi, dans notre passage, les bénédictions suivent; ce sont des bénédictions terrestres, car Israël était un peuple terrestre, mais elles sont sans restrictions ni limites. Remarquons encore que Dieu n’ignore rien de ce qui touche son peuple. Il dit aux enfants d’Israël qu’il ne chassera pas leurs ennemis devant eux en une année, «de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi» (v. 29). Il les conduirait, et les bénirait dans la mesure de ce qu’ils pourraient supporter. Mais au temps propre, ils posséderaient toute l’étendue de leur territoire: «depuis la mer Rouge jusqu’à la mer des Philistins, et depuis le désert jusqu’au fleuve» (v. 31), une promesse, hélas! qui fut perdue, et qui à cause de l’incrédulité d’Israël ne se réalisa jamais, sinon pour une brève période pendant les règnes de David et Salomon (1 Chron. 18; 2 Chron. 9:26). Même pendant le règne de Salomon, elle ne fut accomplie en fait que partiellement; car il restait encore des Héthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens qui n’avaient pas été chassés (2 Chron. 8:7, 8). Elle attend donc son accomplissement dans toute son étendue et sa bénédiction sous le règne de Celui duquel David et Salomon n’étaient que des ombres et des types. Ce qu’Israël placé sous la responsabilité a perdu sera alors accompli en grâce et en puissance.
Enfin une séparation absolue est une fois encore enjointe. Il ne devait point y avoir d’alliance avec le peuple du pays ou ses dieux; et les Israélites ne devaient pas les laisser habiter dans le pays. Car, s’ils le faisaient, ils seraient certainement amenés à pécher contre l’Éternel. Il ne peut y avoir aucune alliance entre le peuple de Dieu et les ennemis de Dieu. «L’amitié du monde est inimitié contre Dieu» (Jacq. 4:4). Puisse cette vérité dans toute sa puissance être gravée sur le cœur et la mémoire de tous ceux qui se réclament du nom de Christ!
16. Exode 24— La ratification de l’alliance
16.1. Vous vous prosternerez de loin
L’alliance, base de la relation future de l’Éternel avec Israël, ayant été développée et expliquée, sa ratification solennelle nous est rapportée dans ce chapitre. Préalablement, Moïse, Aaron, Nadab et Abihu, et soixante-dix des anciens d’Israël furent appelés à monter vers l’Éternel (v. 1). Mais tous ne pouvaient pas s’approcher. «Vous vous prosternerez de loin; et Moïse s’approchera seul de l’Éternel; mais eux ne s’approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui» (v. 2). La position de médiateur est clairement marquée, une position haute et privilégiée, conférée à Moïse par l’Éternel dans sa grâce. Moïse ne méritait pas plus que ses compagnons de s’approcher de Dieu. C’était la grâce seule qui lui donnait cette place spéciale.
Tout cela répond au caractère de la dispensation, en contraste absolu avec la position des croyants depuis la mort de Christ. Il n’est plus dit maintenant: «vous vous prosternerez de loin», mais: «approchons-nous» (Héb. 10:22). Le sang de Christ a une efficacité telle qu’il purifie le croyant de tout péché, de sorte que celui-ci n’a plus aucune conscience de péchés; il est rendu parfait à perpétuité par la seule offrande de Christ et, le voile étant déchiré (témoignage que Dieu a été glorifié dans la mort de Christ), il a une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints. Là il peut adorer Dieu en esprit et en vérité; là il peut se glorifier en Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, par lequel nous avons reçu la réconciliation (Rom. 5:11); car il est sans tache devant l’œil scrutateur d’un Dieu saint, et peut paraître dans une sainte assurance devant le trône même de sa sainteté. Qu’il est grand, le contraste entre la loi et la grâce! La loi, il est vrai, «ayant l’ombre des biens à venir, non l’image même des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices que l’on offre continuellement chaque année, rendre parfaits ceux qui s’approchent» (Héb. 10:11). Mais en grâce, par la seule offrande de Christ, Dieu ne se souviendra plus jamais de nos péchés ni de nos iniquités (Héb. 10:17). Par Christ nous avons accès auprès du Père par un seul Esprit (Éph. 2:18). Dans la place qu’il occupait, Moïse était donc dans une certaine mesure un type du croyant. Soulignons cependant cette immense différence: il s’approchait de l’Éternel, alors que nous nous avons accès auprès du Père, nous adorons Dieu, Dieu dans sa pleine révélation comme notre Dieu et Père, parce qu’il est le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ.
16.2. Nadab et Abihu
La mention des noms de Nadab et d’Abihu ne peut manquer d’arrêter notre attention. Ils étaient tous deux des fils d’Aaron, et avaient été choisis avec leur père pour ce privilège particulier. Mais ni la lumière ni les privilèges ne peuvent assurer le salut ni, pour des croyants, garantir une marche sainte dans l’obéissance. Tous deux connurent par la suite une fin terrible. Ils «présentèrent devant l’Éternel un feu étranger, ce qu’il ne leur avait pas commandé. Et le feu sortit de devant l’Éternel, et les dévora, et ils moururent devant l’Éternel» (Lév. 10:1, 2). Après la scène de notre chapitre, ils furent consacrés pour exercer la sacrificature, et ce fut dans l’accomplissement de leur devoir dans cette fonction, ou plutôt à cause de leur manquement dans cet office, qu’ils tombèrent sous le jugement de Dieu. Puisse notre cœur être profondément pénétré par cet avertissement que ni une fonction ni des privilèges spéciaux ne peuvent garder; et aussi par cette leçon que Dieu ne peut rien admettre dans notre adoration qui ne lui soit rendu dans l’obéissance. L’offrande doit venir de lui, et le cœur doit être soumis à sa volonté.
16.3. Confirmation de l’alliance
Ensuite Moïse «vint, et raconta au peuple toutes les paroles de l’Éternel, et toutes les ordonnances. Et tout le peuple répondit d’une seule voix, et dit: Toutes les paroles que l’Éternel a dites, nous les ferons» (v. 3). Malgré la terreur qui s’était emparée de leur cœur devant les signes de la présence et de la majesté de l’Éternel sur le Sinaï, ils restaient totalement ignorants de leur propre impuissance à satisfaire à ses saintes exigences. Peuple insensé! On aurait pu s’attendre à ce que leurs yeux aient été ouverts avant cela; mais, nous le répétons, la vérité est qu’ils ne connaissaient ni eux-mêmes ni Dieu. Aussi une fois encore ils se déclarent prêts à obéir, comme condition de la bénédiction. Dieu avait parlé, ils avaient approuvé, et maintenant l’accord devait être confirmé et ratifié.
A suivre
Chapitre 24 versets 4 à 8
Ch. 24:4-8 — Il n’y a qu’un seul autel, même s’il y a douze stèles — un autel parce qu’il était pour Dieu, douze stèles parce que chacune des douze tribus devait être représentée dans les sacrifices qui seraient offerts. La sacrificature n’étant pas encore établie, ce sont des «jeunes hommes» qui exercent l’office sacerdotal en ce jour. C’était probablement les premiers-nés que l’Éternel avait spécialement réclamés pour lui, comme nous l’avons vu au chapitre 13. Plus tard, il est vrai, la tribu de Lévi prit leur place et fut mise à part pour le service de l’Éternel. Ainsi il est dit: «Et tu feras approcher les Lévites devant l’Éternel, et les fils d’Israël poseront leurs mains sur les Lévites; et Aaron offrira les Lévites en offrande tournoyée devant l’Éternel de la part des fils d’Israël, et ils seront employés au service de l’Éternel» (Nomb. 8:10, 11; aussi chap. 3:40, 41). Jusqu’au moment de la substitution des Lévites aux premiers-nés, les «jeunes hommes» occupèrent la place du service en rapport avec l’autel.
Remarquons qu’il n’y avait que des holocaustes et des sacrifices de prospérités, parce que, comme cela a déjà été dit, les sacrifices pour le péché n’avaient pas leur raison d’être avant que la question du péché eût été formellement soulevée par la loi. Les sacrifices étaient pour Dieu (toutefois ceux qui les offraient et le sacrificateur avaient leur part des sacrifices de prospérités, en communion avec Dieu, Lév. 3); mais la signification particulière des rites de cette journée doit être cherchée dans l’aspersion du sang. Il était fait aspersion de la moitiésur l’autel. Puis le livre de l’alliance ayant été lu aux oreilles du peuple, ils répètent: «Tout ce que l’Éternel a dit, nous le ferons, et nous écouterons».
16.4. L’aspersion du sang
«Et Moïse prit le sang, et en fit aspersion sur le peuple, et dit: Voici le sang de l’alliance que l’Éternel a faite avec vous selon toutes ces paroles» (v. 7, 8). Avant d’expliquer la signification de cet acte solennel, citons pour avoir plus de détails le passage de l’épître aux Hébreux qui s’y rapporte. «Car chaque commandement, pour ce qui concerne la loi, ayant été proclamé par Moïse à tout le peuple, il prit le sang des veaux et des boucs, avec de l’eau et de la laine écarlate et de l’hysope, et en fit aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant: «C’est ici le sang de l’alliance que Dieu vous a ordonnée» (chap. 9:19, 20). Nous trouvons ici un point intéressant non mentionné dans l’Exode: c’est qu’il était fait aspersion du sang sur le livre, comme aussi sur le peuple. Il y avait ainsi trois aspersions: sur l’autel, sur le livre et sur le peuple.
Ce qui doit nous occuper tout d’abord, c’est la signification du sang. Cela ne peut pas être l’expiation, puisqu’il est fait aspersion sur le peuple et sur le livre comme sur l’autel; ni la purification, pour la même raison. La vie est dans le sang (Lév. 17:11) et, par conséquent, le sang, le sang versé, représente la mort, et la mort liée à un sacrifice, comme châtiment du péché. Ici donc, l’aspersion du sang parle de la mort comme sanction pénale de la loi. Le peuple promit l’obéissance, et alors il fut fait aspersion tant sur lui que sur le livre en témoignage que la mort serait le jugement de la transgression. Voilà la position solennelle dans laquelle ils avaient été introduits, en vertu de leur propre consentement. Ils s’engageaient à obéir sous peine de mort. L’apôtre pouvait donc bien dire: «Tous ceux qui sont sur le principe des œuvres de loi sont sous malédiction» (Gal. 3:10). Il en est de même maintenant, quant au principe, de tous ceux qui prennent le terrain de la loi comme chemin de la vie, de tous ceux qui se confient dans leurs propres œuvres comme condition de bénédiction. Par là, en fait sans le savoir, ils lient sur leurs épaules la malédiction de la loi, comme les Israélites dans cette scène, et acceptent la mort comme sanction de la désobéissance.
16.5. Mis à part pour Dieu
Le peuple s’étant engagé à obéir, il fut fait aspersion du sang sur lui. Il peut nous être utile de considérer les expressions que nous trouvons dans l’épître de Pierre et qui, sans aucun doute, se rapportent en partie à cette transaction. S’adressant «à ceux de la dispersion, du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l’Asie et de la Bithynie», c’est-à-dire aux chrétiens d’entre les Juifs dispersés dans ces contrées, Pierre dit d’eux qu’ils sont «élus selon la préconnaissance de Dieu le Père, en sainteté de l’Esprit, pour l’obéissance et l’aspersion du sang de Jésus Christ» (1 Pierre 1:2). Cet ordre est très significatif, bien qu’il ait soulevé des difficultés, du fait que l’allusion à la nation juive n’a pas toujours été discernée. Comme nation, les Juifs avaient été élus par l’appel souverain de Dieu, sanctifiés par des rites charnels, séparés du reste des nations (voir Éph. 2:14), et mis à part pour Dieu (chap. 19:10). Plus que cela, élus pour l’obéissance (c’était là l’objet proposé au peuple et, comme nous l’avons vu, accepté par lui); et alors il fut fait aspersion du sang sur eux, l’alliance que Dieu faisait avec eux étant ainsi scellée par la solennelle sanction de la mort.
16.6. Contraste avec le peuple céleste
Les termes correspondent donc parfaitement; mais combien leur signification est différente! Les croyants sont élus selon la préconnaissance de Dieu le Père, qui nous a «prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté» (Éph. 1:5). Ils ne sont par conséquent pas simplement les objets d’une élection terrestre, et pour une bénédiction terrestre, comme Israël, mais les objets d’un choix éternel, pour être introduits dans la jouissance de la relation intime d’enfants, dans une place de proximité parfaite, rendus agréables dans le Bien-aimé. Ils ont été sanctifiés, non par des rites et des ordonnances extérieurs et charnels, mais par l’opération de l’Esprit de Dieu dans la nouvelle naissance, en vertu de laquelle ils sont mis entièrement à part pour Dieu, n’étant plus du monde, de même que Christ n’est pas du monde; et ils ont été élus pour l’obéissance de Jésus Christ1, c’est-à-dire pour obéir comme Christ a obéi, sa marche étant la règle normale, le modèle pour chaque croyant (1 Jean 2:6). Plus encore, ils ont été sanctifiés non pas pour l’aspersion du sang qui sanctionnait par la mort toute transgression, mais pour ce qui parle d’une expiation accomplie et de la purification parfaite de toute âme qui se place sous son efficace. L’apôtre Pierre établit ainsi un contraste total, et ce contraste est celui qui existe entre la loi et la grâce. «La loi a été donnée par Moïse; la grâce et la vérité vinrent par Jésus Christ» (Jean 1:17).
1 Les termes «obéissance» et «aspersion» se lient tous deux sans aucun doute à Jésus Christ; c’est l’obéissance de Jésus Christ, comme aussi le sang de Jésus Christ.
A suivre
Chapitre 24 verset 9 à 25 verset 9
16.7. Sur la montagne
L’alliance ratifiée, «Moïse et Aaron, Nadab et Abihu, et soixante-dix des anciens d’Israël montèrent; et ils virent le Dieu d’Israël, — et sous ses pieds comme un ouvrage de saphir transparent, et comme le ciel même en pureté. Et il ne porta point sa main sur les nobles d’entre les fils d’Israël: ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent» (v. 9-11). Avant que l’alliance fût établie, Moïse seul avait pu s’approcher, mais maintenant cette grâce particulière était accordée aux représentants du peuple; et ils s’approchèrent en toute sécurité. Dans cette scène, deux choses sont soulignées. Ils virent le Dieu d’Israël. Dieu se manifesta devant leurs yeux dans la majesté de sa sainteté. L’ouvrage de saphir (voir Ezéch. 1:26; 10:1), et la description supplémentaire qui en est donnée: «comme le ciel même en pureté», parlent de la splendeur et de la pureté célestes. Dieu se révélait donc à ces témoins choisis, selon le caractère de l’économie qui venait d’être établie. Plus encore, ils mangèrent et burent. C’était en vertu du sang qu’ils furent admis à ce privilège particulier, car c’était un privilège de voir le Dieu d’Israël et d’entrer en relation avec lui, quoique le caractère de la révélation accordée parlât de distance plutôt que de proximité. Pourtant, comme hommes dans la chair, ils mangèrent et burent dans la présence de Dieu, et comme l’a remarqué un autre: ils «continuent leur vie terrestre et humaine»1. Ils virent Dieu et ne moururent pas. Car l’alliance venait seulement d’être inaugurée, et aucun manquement n’étant encore intervenu, Dieu pouvait sur cette base leur permettre de s’approcher de lui comme du Dieu d’Israël.
1 Études sur la Parole de Dieu, par J.N. Darby.
16.8. Les tables de pierre
Une fois encore Moïse est mis à part d’Aaron, de Nadab et d’Abihu, et des anciens d’Israël. Il reprend sa place de médiateur, pour recevoir les tables de pierre, écrites du doigt de Dieu, les oracles vivants, comme Etienne les nomme (Actes 7:38). C’est dans ce but que Moïse est appelé à monter vers l’Éternel sur la montagne (v. 12). Ayant laissé les anciens et désigné Aaron et Hur pour toute affaire, Moïse monta sur la montagne, et il fut quarante jours et quarante nuits seul avec Dieu. Pendant ce temps, la gloire de l’Éternel était manifestée, et elle «demeura sur la montagne de Sinaï... Et l’apparence de la gloire de l’Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des fils d’Israël» (v. 15-18). Ce n’était pas la gloire de sa grâce, mais la gloire de sa sainteté, comme l’indique le symbole du feu dévorant, la gloire de l’Éternel dans sa relation avec Israël sur la base de la loi (comparer 2 Cor. 3). C’était par conséquent une gloire de laquelle aucun pécheur n’osait s’approcher, car la sainteté et le péché ne peuvent pas être conciliés. Maintenant, par la grâce de Dieu, sur le fondement de l’expiation accomplie, les croyants peuvent non seulement s’approcher, et demeurer dans la gloire, mais, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, ils sont transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en Esprit (2 Cor. 3:18). Nous nous approchons avec hardiesse et contemplons avec délices la gloire, parce que chacun de ses rayons dans la face de Christ glorifié est une preuve du fait que nos péchés sont ôtés et que la rédemption est accomplie.
17. Exode 25:1-9 — Le tabernacle
Avec ce chapitre, nous abordons un nouveau sujet qui s’étend jusqu’à la fin du chapitre 30, celui du tabernacle. Cette portion se trouve de nouveau divisée en trois parties. D’abord, dans les directives concernant la construction du tabernacle et de ses ustensiles, les objets qui manifestent Dieu sont décrits. Cette partie va jusqu’au chapitre 27:19. Puis les vêtements et la consécration des sacrificateurs nous sont présentés dans les chapitres 28 et 29. Enfin les ustensiles nécessaires pour pouvoir s’approcher de Dieu sont détaillés dans le chapitre 30. Il est à remarquer que certains des ustensiles qui évoquent tel ou tel aspect de la gloire de Dieu servent aussi à s’approcher. Mais si nous nous souvenons de l’intention première de chacun d’eux, il n’y aura pas de confusion, et leur disposition sera facilement comprise. Nous aurons l’occasion, en passant en revue les différentes parties du tabernacle, d’indiquer la signification de chacune d’elles avec plus de précision. Pour l’instant, la division proposée aidera le lecteur à pénétrer avec plus d’intelligence dans l’étude de cette section de l’Exode.
17.1. Le tabernacle: une habitation pour Dieu
Ch. 25:1-9 — Il y a trois côtés à relever dans ces directives. Le premier, c’est leur but: faire un sanctuaire. «Ils feront pour moi un sanctuaire, et j’habiterai au milieu d’eux». La pensée primitive qui se rattache au tabernacle est donc qu’il était l’habitation de Dieu. Comme cela a été relevé au chapitre 15:2, Dieu n’avait jamais habité sur la terre avec les siens avant la traversée de la mer Rouge, avant qu’en figure, la rédemption ait été accomplie. Dieu visitait Adam dans le jardin; il apparaissait aux patriarches et communiquait avec eux; mais la construction d’un sanctuaire dans lequel il habiterait ne se trouve pas mentionnée avant qu’il eût racheté son peuple hors d’Égypte. Le tabernacle était donc une preuve de la rédemption, et le signe que Dieu avait amené un peuple racheté en relation avec lui-même, lui étant le centre autour duquel ils étaient rassemblés. Telle est la pensée de Dieu dans la rédemption. Il ne veut pas seulement sauver les siens selon ses propres intentions, mais il désire aussi, selon les vœux de son amour immense, les avoir dans une place de proximité, rassemblés autour de lui — lui leur Dieu, et eux son peuple. Nous savons combien imparfaitement les désirs de son cœur ont été satisfaits à cause des manquements du peuple placé sous la responsabilité.
Cependant Dieu avait son sanctuaire au milieu d’eux, tant dans le désert que sous la royauté. Dans la dispensation chrétienne, les siens eux-mêmes constituent sa maison; dans le millénium, il aura un autre sanctuaire matériel à Jérusalem; et enfin, dans l’état éternel, la sainte cité, nouvelle Jérusalem, descendra du ciel d’auprès de Dieu et formera sur la nouvelle terre l’habitation de Dieu avec les hommes (Apoc. 21:2, 3). Alors l’admirable propos de Dieu sera manifesté dans toute sa perfection. Et comme les choses vieilles avec toutes les afflictions qui y sont liées à cause du péché de l’homme seront passées, rien ne viendra ternir la jouissance pleine, parfaite et bénie de l’amour de Dieu pour les siens, amour auquel répondra celui des rachetés pour leur Dieu. Leur adoration et leur service en constitueront l’éternelle et parfaite manifestation. Mais tout cela se trouve en type dans ce sanctuaire qu’Israël fut appelé à faire afin que Dieu puisse habiter au milieu d’eux.
17.2. Le tabernacle: manifestation de la gloire de Dieu
Le tabernacle peut cependant être considéré à un autre point de vue. La maison dans laquelle Dieu habitait devait nécessairement être la scène de la révélation de sa gloire. Aussi, comme nous le verrons en considérant les détails de ce sanctuaire, chacune des parties qui la composent présente une manifestation de Dieu lui-même. Comme un autre l’a écrit: «Le tabernacle nous présente les gloires variées de Christ comme médiateur; pourtant nous n’avons pas l’unité de l’Église envisagée comme son corps. Mais il nous présente toutes les manières dont les voies et les perfections de Dieu ont leur manifestation par Christ, soit dans la création tout entière, soit dans la gloire des siens, soit dans sa propre personne. En un mot, nous y voyons la scène de la manifestation de la gloire de Dieu, sa maison, son domaine, dans lesquels il déploie son Être (pour autant que son Être peut être vu), les richesses de sa grâce et de sa gloire; enfin nous y trouvons sa relation en Christ avec nous, pauvres et faibles créatures qui nous approchons de Lui; mais il y a encore un voile qui cache sa présence, et il est vu comme Dieu, non pas comme Père»1. C’est la raison pour laquelle l’homme spirituel se plaît à rechercher l’enseignement typique de tous les éléments de ce sanctuaire, y découvrant les diverses mesures et manières selon lesquelles Dieu s’est révélé, et apprenant qu’elles ne peuvent être comprises que lorsque la clé de leur secret est trouvée dans la personne de Christ. Si nous nous souvenons de cela, nous serons d’une part préservés de tout écart de l’imagination, et d’autre part, nos méditations seront marquées par un intérêt tout nouveau, Christ lui-même étant toujours devant l’âme.
1 Études sur la Parole de Dieu, par J.N. Darby.
17.3. Le tabernacle: image du ciel
Le tabernacle présente encore un troisième aspect. Il est une image du ciel. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le sacrificateur traversait ainsi en figure le premier et le deuxième ciel avant d’entrer dans le troisième, scène de la présence particulière de Dieu. L’apôtre Paul révèle qu’il a été «ravi jusqu’au troisième ciel». Dans l’épître aux Hébreux, il y a une allusion à cette signification donnée au tabernacle: «Ayant donc un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu» (Héb. 4:14). Dans ce passage Christ est vu comme ayant traversé, tel le souverain sacrificateur au grand jour des expiations, le parvis et le lieu saint pour entrer dans le lieu très saint (tous trois étant des symboles du ciel), dans la présence de Dieu.
À cet égard, on peut mentionner, et c’est là le deuxième point, que le tabernacle fut fait d’après le modèle montré à Moïse sur la montagne (v. 9, 40, etc.), et que, par conséquent, il était le type de choses célestes. Cet enseignement est développé dans l’épître aux Hébreux. Là il nous est parlé de Christ comme «ministre des lieux saints et du vrai tabernacle que le Seigneur a dressé, non pas l’homme» (8:2); et plus loin, il est dit: «Il était donc nécessaire que les images des choses qui sont dans les cieux fussent purifiées par de telles choses (le sang des sacrifices d’animaux), mais que les choses célestes elles-mêmes le fussent par de meilleurs sacrifices que ceux-là. Car le Christ n’est pas entré dans des lieux saints faits de main, copies des vrais, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu» (9:23, 24).
17.4. Le tabernacle: lieu de rencontre entre Dieu et les siens
Il est donc clair que le tabernacle était la scène du ministère sacerdotal; car puisqu’il était le lieu de l’habitation de Dieu, c’était aussi la place où le pécheur s’approchait de Dieu (plutôt où un peuple amené en relation avec lui s’approchait de Dieu), dans la personne du sacrificateur. En réalité, le souverain sacrificateur n’entrait qu’une seule fois l’an dans le lieu très saint (voir Lév. 16); mais c’était la conséquence de la chute de la sacrificature, et l’intention originale ne s’en trouvait aucunement affectée. Tout cela, y compris le voile et le fait que tous, sauf les sacrificateurs, étaient exclus du lieu saint, ne contribue qu’à nous enseigner, même par voie de contraste, les privilèges plus grands et plus bénis dont jouissent les croyants de la dispensation présente. Le voile étant déchiré, ils ont une pleine liberté pour entrer en tout temps dans le lieu très saint, parce qu’ils ont été rendus parfaits à perpétuité, n’ayant plus aucune conscience de péchés, par la seule offrande de Christ (Héb. 10); et ils s’approchent non pas de l’Éternel, mais de leur Dieu et Père, dans le Christ Jésus.
17.5. Les offrandes
Le dernier point mentionné est l’invitation adressée au peuple d’apporter en offrandes les matériaux dont serait composé le tabernacle. C’est une magnifique manifestation de grâce de la part de Dieu que d’associer ainsi les siens à lui-même dans son désir d’avoir un sanctuaire pour habiter au milieu d’eux. Ainsi les offrandes ne devaient venir que de ceux qui avaient un esprit libéral. C’est de toute beauté! Dieu produit d’abord le vouloir, et ensuite il attribue aux Israélites l’offrande qu’ils apportaient. Il comptait sur la communion du peuple, cherchant une réponse au désir formel de son cœur. Comme nous le verrons plus loin dans ce livre, les Israélites répondirent, et de manière si abondante qu’il fallut proclamer de ne plus apporter d’offrandes. Nous avons aussi un bel exemple de cela en David, quant au temple: «Il a juré à l’Éternel, et fait un vœu au Puissant de Jacob: Si j’entre dans la demeure de ma maison, si je monte sur le lit où je couche, si je permets à mes yeux de dormir, à mes paupières de sommeiller, jusqu’à ce que j’aie un lieu pour l’Éternel, des demeures pour le Puissant de Jacob!» (Ps. 132:2-5). Même si ce fut dans une mesure moindre que plus tard au temps du roi d’Israël, les offrandes nécessaires furent apportées en abondance par des cœurs bien disposés. Inclinés par la grâce de Dieu, ils eurent ainsi le privilège d’offrir des matériaux qui, assemblés selon les directives reçues, constitueraient l’habitation de l’Éternel. Et ces matériaux, considérés séparément, serviraient de symbole et de manifestation de quelque rayon de sa gloire.
La signification symbolique de toutes ces offrandes sera indiquée en rapport avec la place qu’ils occupent dans le tabernacle. Pour l’instant, il suffira de dire qu’ils parlent tous de Christ.
A suivre
Chapitre 25 verset 10 à 22
18. Exode 25:10-22 — L’arche et le propitiatoire
L’arche et le propitiatoire sont soigneusement distingués l’un de l’autre, bien que, d’un autre côté, ils forment un tout. Ils sont décrits séparément et il est ainsi préférable de suivre l’ordre dans lequel l’Écriture nous les présente.
18.1. Une figure de Christ
Ch. 25:10-22 — Plusieurs aspects sont à considérer en rapport avec l’enseignement symbolique de l’arche. Elle était d’une part une manifestation de Dieu en Christ et, d’autre part, le siège de son trône et de son gouvernement en Israël.
L’arche peut donc être vue premièrement comme une figure de la personne de Christ. Cela apparaît dans les matériaux qui la composaient. Elle était faite de bois de sittim et recouverte d’or pur. Le sittim est une variété d’acacia, un bois que l’on dit imputrescible, qui correspond à ce qui est humain en Christ. Le fait qu’il est incorruptible nous fournit une image d’autant plus belle de l’humanité de notre Seigneur. L’or est toujours le symbole de ce qui est divin. Nous avons donc dans la structure de l’arche la figure de l’union des deux natures dans la personne de Christ à la fois parfaitement Dieu et parfaitement homme. «Au commencement était la Parole; et la Parole était auprès de Dieu; et la Parole était Dieu». Il est ajouté: «Et la Parole devint chair, et habita au milieu de nous (et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d’un Fils unique de la part du père) pleine de grâce et de vérité» (Jean 1:1-14). Ainsi il était Dieu et homme, Dieu manifesté en chair.
Le contenu de l’arche est aussi très significatif sous ce rapport: «Et tu mettras dans l’arche le témoignage que je te donnerai» (v. 16). Les deux tables de pierre qui portaient gravés les dix commandements étaient donc déposées dans l’arche; raison pour laquelle celle-ci est souvent appelée l’arche de l’alliance (Nomb. 10:33; Deut. 31:26; etc.), parce qu’elle contenait la loi sur laquelle l’alliance était fondée. Mais ce fait nous parle d’une manière évidente de Christ. S’exprimant par l’Esprit dans les Psaumes, il dit: «Voici, je viens; il est écrit de moi dans le rouleau du livre. C’est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir, et ta loi est au-dedans de mes entrailles» (Ps. 40:7, 8).
Le témoignage dans l’arche est ainsi l’expression de la loi de Dieu magnifiée en Christ, montrant premièrement que, né dans ce monde, de la semence de David selon la chair, il est «né sous la loi» (Gal. 4:4); et secondement, qu’il a parfaitement accompli celle-ci. «Ta loi au-dedans de mes entrailles» atteste la perfection de son obéissance. Dieu a trouvé en lui et en lui seul la vérité dans l’homme intérieur, une réponse pleine et entière à tout ce que réclamait sa sainteté. Il pouvait dès lors se reposer en lui avec une satisfaction parfaite et, parce qu’il le voyait faisant toujours les choses qui lui étaient agréables, exprimer les délices de son cœur par ces paroles: «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai trouvé mon plaisir» (Matt. 3:17).
18.2. Les anneaux et les barres
Les anneaux et les barres (v. 12-15) ont aussi un enseignement pour nous. Ils servaient à «porter l’arche» (v. 14), indication que le peuple de Dieu, pèlerin dans le désert, était en route pour le lieu que Dieu avait préparé pour lui. Mais le temps viendra où il entrera en possession de l’héritage, et où le temple qui sera élevé sera digne de la magnificence de la gloire du roi d’Israël. Les barres, qui dans le désert ne devaient pas être retirée des anneaux de l’arche (v. 15), seront alors enlevées (2 Chron. 5:9 [selon la traduction de la version du Roi Jacques, et non pas selon la traduction JND]) parce que, le pèlerinage étant fini, l’arche ainsi que le peuple seront entrés «dans son repos» (Ps. 132:8). Les barres dans les anneaux nous parlent par conséquent de Christ accompagnant son peuple, étant lui-même avec eux dans les circonstances du désert. C’est Christ dans ce monde, Christ dans toute sa perfection comme homme, Christ, en un mot, dans tout ce qu’il était comme Celui qui nous a révélé Dieu; car en vérité, il était la parfaite présentation de Dieu à l’homme. «Personne ne connaît le Fils, si ce n’est le Père; ni personne ne connaît le Père, si ce n’est le Fils, et celui à qui le Fils voudra le révéler» (Matt. 11:27).
18.3. Le trône de Dieu
En second lieu l’arche, avec le propitiatoire et les chérubins, constituait le trône de Dieu sur la terre au milieu d’Israël. Quelqu’un d’autre a dit: «L’arche de l’alliance représentait le trône où Dieu se manifestait si quelqu’un pouvait entrer devant Lui en justice (justice qui n’était pas séparée de sa sainteté, et qui ne prenait pas le simple devoir comme mesure de l’acceptation...); Dieu se présentait là comme le souverain envers lequel tout homme vivant est responsable, le Dieu de toute la terre... La loi, témoignage de ce qu’il exigeait des hommes, devait être placée dans l’arche. Au-dessus était le propitiatoire, qui cachait la loi et formait le trône même, ou plutôt la base du trône; et les chérubins, qui étaient tirés du propitiatoire, en étaient les supports, les côtés»1. Dieu nous est ainsi présenté dans les Écritures comme demeurant entre les chérubins. Ceux-ci personnifient les attributs de Dieu et nous voyons alors le trône de Dieu maintenu par tout ce que lui est. C’est la raison pour laquelle ils sont liés, tout au long de l’Ancien Testament, à l’exercice du pouvoir judiciaire: Dieu ayant affaire avec des pécheurs, son trône avait toujours un aspect judiciaire. Nous voyons ainsi Dieu assis sur son trône de justice entre les chérubins.
1 Études sur la Parole de Dieu, par J.N. Darby.
On pourrait se demander pourquoi Israël qui a constamment violé la loi n’a pas été immédiatement détruit; nous avons la réponse (quoique nous anticipions la vérité du propitiatoire) dans l’attitude des chérubins. Comme exécuteurs du pouvoir judiciaire de Dieu, ils devaient exiger l’exécution du châtiment dû au transgresseur. Mais «les faces des chérubins seront tournées vers le propitiatoire» (v. 20). Ils voyaient ainsi le sang dont il avait été fait aspersion sur le propitiatoire, le sang qui était placé là chaque année au grand jour des expiations (Lév. 16), et par lequel les droits du trône étaient pleinement satisfaits, Dieu lui-même étant rendu favorable au coupable. S’il en avait été autrement, Dieu, gouvernant avec justice, aurait dû détruire son peuple.
18.4. Dieu parlant à Moïse
C’était aussi de dessus le propitiatoire, d’entre les deux chérubins, que Dieu parlait avec Moïse (v. 22). Le lieu où l’Éternel rencontrait son peuple était à l’entrée de la tente d’assignation (chap. 29:42, 43). Moïse seul (à part le souverain sacrificateur exceptionnellement au grand jour des expiations) jouissait du privilège de rencontrer Dieu et de recevoir les communications qu’il lui donnait de dessus le propitiatoire. En grâce il était reconnu comme le médiateur. Tous les croyants de l’économie actuelle jouissent de ce privilège, en vertu de l’efficacité de l’œuvre de la rédemption. Mais de tout Israël, Moïse seul avait la liberté d’entrer en tout temps dans la présence de Dieu. C’était là que Dieu parlait avec lui (voir Nomb. 7:89) et lui confiait ses commandements pour diriger les enfants d’Israël. C’est là seulement que la voix de Dieu peut être entendue et ses pensées connues; et quiconque veut faire des progrès dans la connaissance de sa volonté doit connaître lui aussi l’intimité du sanctuaire.
18.5. Le transport de l’arche
Si nous considérons le livre des Nombres, nous trouverons les directives pour le transport de l’arche à travers le désert. «Lorsque le camp partira, Aaron et ses fils entreront, et ils démonteront le voile qui sert de rideau, et en couvriront l’arche du témoignage; et ils mettront dessus une couverture de peaux de taissons, et étendront par-dessus un drap tout de bleu; et ils y placeront les barres» (chap. 4:5, 6). Le voile, comme nous le verrons plus loin, est un emblème de l’humanité de Christ, «sa chair» (Héb. 10:20). Nous avons donc premièrement l’arche; c’est-à-dire Christ caché sous le voile de son humanité. Par-dessus on plaçait les peaux de taissons, expression de la sainte vigilance par laquelle il se préservait du mal d’une façon absolue, comme on le voit par exemple dans ce verset du Psaume 17: «Par la parole de tes lèvres je me suis gardé des voies de l’homme violent» (v. 4). Enfin venait le drap tout de bleu — symbole de ce qui est céleste. «Dans ce cas les peaux de taissons étaient à l’intérieur, parce que, Christ gardant sa perfection séparée de tout mal, on ne voyait se manifester en lui que ce qui était céleste». Nous avons par conséquent Christ dans le désert; et il l’a traversé toujours caractérisé par ce qui est céleste. Comme tel, ne l’oublions pas, il est notre modèle. «Celui qui dit demeurer en lui, doit lui-même aussi marcher comme lui a marché».
18.6. Le propitiatoire
Le propitiatoire, quoique formant le couvercle de l’arche et complétant ainsi sa structure, est dans un certain sens complet en lui-même; et à cause de l’importance qu’il revêt, il mérite d’être considéré séparément. Placé «sur l’arche, par-dessus» (v. 21), il se trouvait par conséquent dans le lieu très saint, la scène de la manifestation spéciale de Dieu, constituant comme nous l’avons déjà dit, la base de son trône. Dieu habite là entre les chérubins. Le propitiatoire différait de l’arche en ce que le bois de sittim n’entrait pas dans sa composition. Il était fait d’or pur, comme l’étaient aussi les deux chérubins, tirés de la même pièce à ses deux bouts. L’or est l’emblème de ce qui est divin, de la justice divine.
Si pour un moment nous le considérons en rapport avec le témoignage qui est dans l’arche, nous avons l’union de la justice humaine et de la justice divine, le témoignage parlant de la loi — la justice humaine — qui faisait les délices de Christ (Ps. 40) et l’or, de la justice divine qui est aussi manifestée en lui. Le propitiatoire est par conséquent d’une manière bien particulière un type de Christ. L’apôtre Paul d’ailleurs applique directement cette expression à Christ lorsqu’il dit: «Étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire, par la foi en son sang» (Rom. 3:24, 25).
18.7. L’aspersion du sang
Nous comprendrons facilement cette allusion si nous nous reportons à l’activité du sacrificateur au grand jour des expiations. Après avoir mis l’encens sur le feu devant l’Éternel, il est dit: «Et il prendra du sang du taureau, et il en fera aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l’orient; et il fera aspersion du sang avec son doigt, sept fois, devant le propitiatoire» (Lév. 16:14). Il agissait de même avec le sang du bouc du sacrifice pour le péché pour le peuple. Deux questions nous donneront la signification de cet acte. Premièrement, Pourquoi était-il fait aspersion du sang sur et devant le propitiatoire? Pour faire propitiation pour les péchés du peuple. Étant pécheurs, les Israélites ne pouvaient paraître dans la présence d’un Dieu saint. Le sang par conséquent était porté devant lui selon l’enseignement divin, et il en était fait aspersion, de la manière décrite, sur le propitiatoire Pour faire propitiation pour les péchés du peuple.
De même devant le propitiatoire mais là sept fois, pour que le sacrificateur lorsqu’il s’approchait trouve un témoignage parfait de l’efficacité de l’œuvre. Une seule fois, comme on l’a souvent dit, était suffisante pour Dieu, mais dans sa grâce il condescendait à ce qu’il en soit fait aspersion sept fois pour la pleine assurance du cœur de l’homme.
En second lieu, quel était l’effet de cette aspersion du sang? Elle accomplissait l’expiation: toutes les saintes exigences de Dieu à l’égard du peuple étaient satisfaites. Quelle valeur a le sang de Christ! Il glorifie pleinement Dieu dans tout ce qu’il est; il le glorifie pour toujours en ce qui concerne la question du péché, de sorte que Celui qui était contre nous à cause de notre culpabilité est maintenant pour nous à cause du sang. Le propitiatoire parle donc avant tout de Christ; car, comme le dit l’apôtre Jean, «Lui est la propitiation pour nos péchés, et non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier» (1 Jean 2:2). Les péchés des croyants sont ôtés, et ôtés pour toujours; et la valeur de la propitiation est telle que Dieu peut maintenant en justice et dans sa grâce faire proclamer l’évangile dans le monde entier afin que des pécheurs soient réconciliés avec lui (2 Cor. 5:20). Christ, nous le répétons, est figuré par le propitiatoire; et ainsi nous apprenons que c’est par lui seul que l’on peut s’approcher de Dieu de même que, dans le désert, on ne pouvait s’approcher de Dieu que par le propitiatoire. Mais, béni soit son nom, quiconque s’approche maintenant de Dieu par Christ trouve le parfait témoignage rendu à la valeur de son œuvre expiatoire dans la présence de Dieu.
18.8. Un chemin ouvert
Mais, considérons-le bien, c’est par le sang seul que nous avons accès auprès de lui. Christ est «présenté pour propitiatoire, par la foi en son sang». En conséquence tous ceux qui s’approchent, croyant dans la valeur de son sang selon le témoignage de Dieu, peuvent le faire avec une pleine liberté, ne doutant nullement, dans l’entière confiance que le chemin est ouvert pour le plus coupable, le plus vil, jusque dans la présence même de Dieu. Car «Christ étant venu, souverain sacrificateur des biens à venir, par le tabernacle plus grand et plus parfait qui n’est pas fait de main, c’est-à-dire qui n’est pas de cette création, et non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle» (Héb. 9:11, 12).
Les chérubins faisaient partie du propitiatoire. Comme nous l’avons dit, ils sont les symboles des attributs divins et, comme tels du pouvoir judiciaire. Mais Dieu ayant été glorifié par le sang placé sur le propitiatoire, tous ses attributs sont en harmonie et tous s’exercent en faveur des croyants. À la croix, la grâce et la vérité se sont rencontrées, la justice et la paix se sont embrassées; et ainsi, la justice est satisfaite, toutes ses exigences ont été satisfaites, et les chérubins eux-mêmes sont favorables à ce que miséricorde soit faite à tous ceux qui s’approchent en se confiant dans la valeur du sang. Vérité bénie! Tout ce que Dieu est, est opposé au péché et maintenant tout ce que Dieu est, est pour le croyant. Le sang mis sur le propitiatoire a opéré ce merveilleux changement.
A suivre
Chapitre 25 verset 23 à 30
19. Exode 25:23-30 —La table des pains de proposition
19.1. La table dans le lieu saint
L’arche seule, avec le propitiatoire et les chérubins, se trouvait dans le lieu très saint. Il n’y avait rien d’autre dans le lieu de la présence immédiate de Dieu. Mais si, arrivant de dehors, on passait derrière le rideau (supposant pour un moment que le tabernacle est dressé), on entrait dans le lieu saint, l’endroit où les sacrificateurs exerçaient leur service habituel. Il y avait là trois objets: la table des pains de proposition, le chandelier d’or pur, et l’autel de l’encens, quoique nous n’ayons pas encore ici la description de ce dernier. C’est du premier objet nommé, la table des pains de proposition, que nous nous proposons de nous occuper maintenant.
Ch. 25:23-30 — La composition de la table est identique à celle de l’arche. Elle était faite de bois de sittim, et plaquée d’or pur (v. 23-25). La signification est par conséquent la même: le bois de sittim étant un type de ce qui est humain, et l’or de ce qui est divin. Nous avons donc ici une figure de Christ, présentant dans sa personne l’union de sa nature humaine et de sa nature divine. C’est là en fait que réside la beauté de tout ce qui est lié au tabernacle. Christ est partout, Christ en lui-même ou dans quelqu’une de ses perfections et gloires variées.
19.2. Les pains sur la table
C’est dans le livre du Lévitique que nous trouvons les détails concernant les pains. «Et tu prendras de la fleur de farine, et tu en cuiras douze gâteaux: chaque gâteau sera de deux dixièmes; et tu les placeras en deux rangées, six par rangée, sur la table pure, devant l’Éternel, et tu mettras de l’encens pur sur chaque rangée; et ce sera un pain de mémorial, un sacrifice par feu à l’Éternel. Chaque jour de sabbat on les arrangera devant l’Éternel, continuellement, de la part des fils d’Israël: c’est une alliance perpétuelle. Et cela appartiendra à Aaron et à ses fils, et ils le mangeront dans un lieu saint; car ce lui sera une chose très sainte d’entre les sacrifices de l’Éternel faits par feu: c’est un statut perpétuel» (chap. 24:5-9).
1) Les pains ou gâteaux étaient de fleur de farine. Cela évoque d’emblée l’offrande de gâteau qui, elle aussi, était de fleur de farine, additionnée d’huile et d’encens (voir Lév. 2). Il n’est pas fait mention de levain, tandis que pour les deux pains tournoyés (Lév. 23:17) le levain est expressément spécifié, pour la raison évidente que dans ce cas les pains sont une image de l’Église, et alors le levain, emblème du mal, s’y trouve. Mais la fleur de farine est une image de l’humanité de Christ, et c’est pourquoi les pains de proposition sont sans levain, de même que lui est saint, innocent, sans souillure, absolument sans péché.
2) Les pains étaient cuits. Ils présentent donc Christ comme ayant été exposé à l’action du feu, figure du jugement de la sainteté de Dieu. Sondé et éprouvé sur la croix, il a été trouvé répondant, et répondant parfaitement, à toutes les exigences de cette sainteté.
3) Ils étaient au nombre de douze, six par rangée. Nous avons vu que le souverain sacrificateur portait sur ses épaules les noms des douze tribus, six sur chaque épaule. Les pains parlent eux aussi des douze tribus d’Israël. Le nombre douze signifie la perfection administrative du gouvernement dans l’homme; c’est pourquoi on trouve douze tribus, douze apôtres, douze portes et douze fondements dans la sainte cité, nouvelle Jérusalem. (Voir pour une illustration de cette signification du nombre 12 Matthieu 19:28). On peut voir ainsi dans les douze pains, Israël en ses douze tribus; et cela suggère, en rapport avec le sens du nombre douze, l’association de Christ avec Israël pour gouverner d’une manière parfaite (car Christ était de la semence de David, et héritier de son trône: Luc 1:32). Cela sera manifesté dans le millénium selon les prédictions des prophètes (Ps. 72 par exemple). Mais les pains étaient sur la table et ainsi, d’un autre côté, Israël est vu en association avec Christ devant Dieu.
4) Notons encore un point. «Et tu mettras de l’encens pur sur chaque rangée; et ce sera un pain de mémorial, un sacrifice par feu à l’Éternel» (Lév. 24:7). L’encens évoque la bonne odeur de Christ pour Dieu. Nous pouvons donc remarquer qu’Israël, dans ses douze tribus, est toujours présenté devant Dieu enveloppé de tout le parfum de Christ; il est donc maintenu là à travers toute la nuit de son incrédulité en vertu de ce que Christ est et de ce qu’il a fait, sûre garantie de leur restauration et de leur bénédiction futures.
19.3. Le rebord de la table
Aussi les pains devaient-ils être arrangés «devant l’Éternel, continuellement, de la part des fils d’Israël: c’est une alliance perpétuelle» (Lév. 24:8). Les fils d’Israël peuvent être infidèles; ils l’ont été, mais Dieu ne peut se renier lui-même. Il demeure fidèle et, en conséquence, bien qu’ils aient été dispersés dans tout le monde à cause de leur incrédulité, il accomplira ses conseils de grâce et de vérité. Il les rassemblera des quatre coins de la terre et les rétablira dans leur pays dans une plénitude de bénédiction introduite et assurée par celui que symbolise la table des pains de proposition.
C’est ce qu’on peut voir dans le rebord de la table: «Et tu y feras un rebord d’une paume tout autour, et tu feras un couronnement d’or à son rebord, tout autour» (v. 25). Il est bien clair que ce rebord avait pour raison d’être de maintenir en place les pains; et si le couronnement d’or qui l’ornait est pris comme symbolisant la gloire divine de Christ, le tout nous enseigne que la position d’Israël est assurée en Christ devant Dieu par tout ce qu’il est dans sa divinité. Bien plus, sa gloire divine se doit de maintenir le peuple dans sa propre sphère, comme aussi de le conserver pour toute la bénédiction que lui-même a assurée et dans laquelle il sera sûrement introduit un jour. Mais le symbole va au-delà de la position d’Israël. Quant au principe, il embrasse celle de tout croyant. Là, dans le lieu saint, toujours devant les yeux de Dieu, enveloppé du suave parfum de l’encens, il est vu en Christ. C’est bien la parfaite présentation du croyant à Dieu. En d’autres termes, c’est le fait que nous sommes rendus agréables dans le Bien-aimé.
19.4. La nourriture des sacrificateurs
Considérons maintenant les pains comme nourriture pour les sacrificateurs: «Et cela appartiendra à Aaron et à ses fils, et ils le mangeront dans un lieu saint; car ce lui sera une chose très sainte d’entre les sacrifices de l’Éternel faits par feu: c’est un statut perpétuel» (Lév. 24:9). Se nourrir implique l’identification et la communion avec ce dont on se nourrit. L’apôtre Paul le fait expressément ressortir dans son enseignement concernant la table du Seigneur: «Le pain que nous rompons, n’est-il pas la communion du corps du Christ? Car nous qui sommes plusieurs, sommes un seul pain, un seul corps, car nous participons tous à un seul et même pain» (1 Cor. 10:16, 17). Il en était de même pour les sacrificateurs. Par exemple, dans certains cas ils mangeaient aussi du sacrifice pour le péché, s’identifiant par là avec lui (Lév. 6:19). Se nourrir des pains de proposition symbolise donc le fait que Christ, comme sacrificateur, s’identifie toujours avec Israël devant Dieu. Le pain, remarquons-le, ne devait être mangé que dans le lieu saint: Christ donc, en communion de pensées avec Dieu, s’identifie lui-même avec les douze tribus dans l’exercice de sa sacrificature. Cela place devant nous un aspect très précieux de la vérité. Que Christ soit le souverain sacrificateur de la dispensation actuelle, tout le monde l’admet; mais on ne s’arrête pas suffisamment sur ce fait que, malgré l’incrédulité d’Israël, il s’identifie avec lui devant Dieu dans son office sacerdotal et qu’il sortira du lieu très saint dans lequel il est entré, comme Melchisédec pour être sacrificateur sur son trône au-dessus d’un peuple de franche volonté. «L’Éternel enverra de Sion la verge de ta force: Domine au milieu de tes ennemis! Ton peuple sera un peuple de franche volonté, au jour de ta puissance, en sainte magnificence. Du sein de l’aurore te viendra la rosée de ta jeunesse. L’Éternel a juré, et il ne se repentira point: Tu es sacrificateur pour toujours, selon l’ordre de Melchisédec» (Ps. 110:2-4).
19.5. Dispositions pour le transport de la table
«Et tu lui feras quatre anneaux d’or, et tu mettras les anneaux aux quatre coins qui seront à ses quatre pieds. Les anneaux seront près du rebord, pour recevoir les barres, pour porter la table. Et tu feras les barres de bois de sittim, et tu les plaqueras d’or; et avec elles on portera la table» (v. 26-28). Les enfants d’Israël étaient pèlerins dans le désert, et le tabernacle et tous ses accessoires répondaient à ce caractère les accompagnant dans toutes leurs traites. Christ est toujours avec son peuple; les anneaux et les barres faits, comme la table elle-même, d’or et de bois de sittim, nous parlent de lui comme du Dieu-Homme. Mais c’est le livre des Nombres qui nous donne les détails sur le transport de la table pendant la marche. «Et ils étendront un drap de bleu sur la table des pains de proposition, et mettront sur elle les plats et les coupes, et les vases, et les gobelets de libation; et le pain continuel sera sur elle. Et ils étendront sur ces choses un drap d’écarlate, et ils le couvriront d’une couverture de peaux de taissons, et ils y placeront les barres» (Nomb. 4:7, 8). La couverture intérieure, on le remarquera, est un drap de bleu, symbole de ce qui est céleste; ensuite vient un drap d’écarlate, emblème de la gloire humaine ou de la royauté juive; enfin à l’extérieur, une couverture de peaux de taissons, type de la sauvegarde à l’égard du mal, résultant d’une sainte vigilance. La signification de cet arrangement apparaît si l’on considère l’ensemble (la table et les pains de proposition) comme Christ associé à Israël, devant être plus tard manifesté dans la perfection du gouvernement administratif. Le drap de bleu recouvrait immédiatement l’or: le caractère céleste de Christ était en relation intime avec sa divinité. Ensuite venait le drap d’écarlate figurant la royauté ou la gloire humaine, parce que celle-ci n’était pas manifestée tant que durait le temps du désert; elle le sera en rapport avec le royaume, à Son apparition. Par conséquent, les peaux de taissons se trouvent à l’extérieur, cachant sa gloire humaine ou royale et exprimant cette sainte vigilance qui de tous côtés le gardait du mal, tandis qu’il rencontrait les circonstances du désert.
Tous les ustensiles se rapportant à la table étaient d’or (v. 29): tout est divin quant aux choses qui concernent le service de Celui qui était réellement Dieu manifesté en chair, et qui sera reconnu, au jour futur de la bénédiction d’Israël, comme son Seigneur et son Dieu. On voit ainsi que chaque détail, aussi bien que l’ensemble de la table des pains de proposition, parle de Christ. Puissent nos yeux être ouverts pour discerner chacun des aspects de sa personne et de son œuvre, tels que l’Esprit de Dieu nous les présente.
A suivre
Chapitre 25 versets 31 à 40
20. Exode 25:31-40 — Le chandelier d’or pur
Après la table des pains de proposition vient le chandelier. L’autel de l’encens se trouvait aussi dans le lieu saint, mais il est omis ici, parce qu’il avait trait à l’«approche» plus qu’à la «manifestation». Or, comme cela a déjà été remarqué, tout ce qui se rapportait à la manifestation de Dieu est donné avant que soit décrit ce qui était nécessaire pour venir en sa présence. Tant que cette distinction n’est pas faite, tout semble confusion où tout est au contraire ordre et méthode.
20.1. Forme et composition du chandelier
Ch. 25:31-40 — Tout d’abord, la forme du chandelier doit nous arrêter. Si on lit soigneusement sa description, on voit qu’il avait sept branches: une tige centrale avec trois branches s’en détachant de chaque côté (voir v. 31, 32, et aussi chap. 37:17, 18). Il y avait donc sept lampes sur le chandelier unique. Le nombre sept joue aussi un rôle important dans son ornementation. Il y avait «trois calices en forme de fleur d’amandier» sur chaque branche (v. 33) et «quatre calices en forme de fleur d’amandier» au chandelier (v. 34), c’est-à-dire sur la tige centrale de laquelle sortaient les branches. Le nombre sept constitue donc une caractéristique marquée.
Il y a lieu de considérer ensuite la matière dont il était fait, et le caractère de sa lumière. Comme le propitiatoire, le chandelier ne comporte que de l’or pur (v. 31). On n’y trouve pas de bois de sittim — rien d’humain. Tout est divin. Le chapitre 27 nous apprend que la lumière était alimentée par de «l’huile d’olive pure, broyée, pour le luminaire, pour faire luire les lampes continuellement» (v. 20). L’huile, dans l’Écriture, est toujours un symbole du Saint Esprit. C’est ainsi que l’apôtre dit aux croyants: «Vous avez l’onction de la part du Saint» (1 Jean 2:20); et Paul parle du fait que nous avons été «oints» (2 Cor. 1:21). En réunissant ces trois éléments — le nombre sept, l’or et l’huile — dans leur sens typique, on voit ce que le chandelier signifie: la lumière divine dans sa perfection, dans la puissance de l’Esprit. C’est Dieu donnant la lumière du Saint Esprit; et cela est manifesté dans sa septuple perfection. De même le Seigneur s’adresse à l’Église de Sardes comme ayant «les sept Esprits de Dieu», c’est-à-dire le Saint Esprit dans sa perfection (nombre sept) et son énergie (Apoc. 3:1). Et il est aussi parlé de «sept lampes de feu, brûlant devant le trône, qui sont les sept Esprits de Dieu» (Apoc. 4:5).
20.2. À quoi servait le chandelier
On peut maintenant rechercher quel était le but du chandelier. Il semble avoir été double.
Premièrement, il était placé dans le lieu saint «vis-à-vis de la table» (chap. 26:35; 40:24). Il était donc en face de la table des pains de proposition et projetait sa lumière sur elle. C’est dans ce but, sans doute, qu’il devait être placé de la sorte. Or, comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, la table des pains de proposition symbolise la manifestation de Dieu dans l’homme (Christ), pour un gouvernement administratif parfait. En outre les douze pains sur la table représentent Israël, et même les croyants de la dispensation actuelle, associés à Christ devant Dieu. La lumière du chandelier éclairant la table, c’est donc le Saint Esprit rendant témoignage au futur déploiement de la perfection administrative en Christ, quand il aura pris son pouvoir et qu’il régnera depuis le fleuve jusqu’aux bouts de la terre; rendant témoignage aussi à la véritable place d’Israël (et du croyant) en Christ devant Dieu. Ces vérités peuvent être obscurcies ou oubliées sur la terre, mais là, dans le lieu saint, devant les yeux de Dieu, elles sont pleinement déployées et mises en évidence par la parfaite lumière de l’Esprit.
Mais, en second lieu, la lumière devait aussi illuminer le chandelier lui-même. «Et l’Éternel parla à Moïse, disant: Parle à Aaron et dis-lui: Quand tu allumeras les lampes, les sept lampes éclaireront sur le devant, vis-à-vis du chandelier. Et Aaron fit ainsi; il alluma les lampes pour éclairer sur le devant, vis-à-vis du chandelier, comme l’Éternel l’avait commandé à Moïse» (Nomb. 8:1-3). L’émission de la lumière du Saint Esprit révèle les beautés de l’objet qui sert à la répandre. Une illustration parfaite de ce fait nous est donnée dans la transfiguration du Seigneur, lorsque «son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière» (Matt. 17:2). Il en était toujours ainsi tout au long de sa carrière bénie pour ceux qui avaient les yeux ouverts (voir Jean 1:4; 2:11); mais sur la montagne, sa beauté fut déployée de façon manifeste. Il en fut de même pour Étienne. Nous lisons qu’il était un «homme plein de foi et de l’Esprit Saint», et que «tous ceux qui étaient assis dans le sanhédrin, ayant leurs yeux arrêtés sur lui, virent son visage comme le visage d’un ange» (Actes 6:5, 15). Il en est ainsi de chaque croyant dans la mesure où la lumière du Saint Esprit — Christ lui-même — brille dans sa marche et dans sa conduite.
Mais on peut demander encore: Qu’est-ce qui, sur la terre, répond à la lumière parfaite de l’Esprit, symbolisée par le chandelier aux sept branches du lieu saint? Christ, lorsqu’il était ici-bas, y a parfaitement répondu. Il était la lumière des hommes, la lumière du monde, etc. (Jean 1:4; 8:12). Pas un seul moment la lumière de l’Esprit ne fut obscurcie en lui; elle brillait, pure, sans une vacillation, illuminant les ténèbres à travers lesquelles il passait, dans le rayonnement vivifiant et béni que répandit sa vie entière. Il fut un vase parfait. Après son départ de cette scène et son ascension, l’Église fut constituée la lampe (Apoc. 1:20). C’est là son caractère, si tristement qu’elle y ait manqué, et bien que cette chute doive entraîner finalement son entier rejet comme porteur du témoignage sur la terre (voir Apoc. 3:16). Le croyant, individuellement, y répond aussi dans la mesure où il présente Christ dans sa marche et dans ses voies. Paul écrit ainsi aux Philippiens: «Faites toutes choses sans murmures et sans raisonnements, afin que vous soyez sans reproche et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d’une génération tortue et perverse, parmi laquelle vous reluisez comme des luminaires dans le monde» (Phil. 2:14, 15).
20.3. Entretien et durée de la lumière
Il est intéressant aussi d’observer comment la lumière était entretenue. «Et l’Éternel parla à Moïse, disant: Commande aux fils d’Israël qu’ils t’apportent de l’huile d’olive pure, broyée, pour le luminaire, afin de faire brûler la lampe continuellement. Aaron l’arrangera devant l’Éternel, continuellement, du soir au matin, en dehors du voile du témoignage, dans la tente d’assignation: c’est un statut perpétuel en vos générations; il arrangera les lampes sur le chandelier pur, devant l’Éternel, continuellement» (Lév. 24:1-4; voir aussi Ex. 27:20, 21). D’abord, les fils d’Israël devaient apporter de l’huile d’olive pure. Cela a trait à la responsabilité du peuple de Dieu sur la terre, le vase dans lequel cela devait être manifesté, Israël alors, l’Église maintenant.
Aaron devait arranger les lampes. Nous apprenons par là que la lumière de l’Esprit, dans son déploiement, ne peut être entretenue que par le service sacerdotal et l’intercession de Christ. Lui seul pouvait employer «ses mouchettes et ses vases à cendre», car ils étaient les uns et les autres d’or pur (v. 38). Tout rayon de lumière qui brille au-dessous, que ce soit par l’Église ou par le croyant individuellement n’est que la réponse à son office de sacrificateur. Remarquons, en rapport avec cela, que l’huile d’olive devait être «broyée» pour le luminaire (chap. 27:20), et que le chandelier lui-même devait être fait d’or «battu». Ne pouvons-nous pas voir là le fait que l’intercession de Christ est fondée sur l’efficacité de son œuvre à la croix, les termes «broyée» et «battu» annonçant d’avance les souffrances de Celui par les meurtrissures duquel nous sommes guéris?
Notons enfin la durée de la lumière. Elle devait brûler «du soir au matin». La lampe est pour la nuit; et tout au long de la nuit de l’incrédulité d’Israël, jusqu’à ce que l’aube se lève et que les ombres fuient, le chandelier d’or doit être arrangé devant l’Éternel. Le témoignage rendu à la véritable position du peuple est maintenu à travers les pénibles et ténébreuses années de son incrédulité par l’intercession de Celui qu’il a rejeté et crucifié. Mais à la fin il sera lui-même pour eux «comme la lumière du matin, quand le soleil se lève, un matin sans nuages: par sa clarté l’herbe tendre germe de la terre après la pluie» (2 Sam. 23:4). L’espérance du chrétien est plus immédiate; car «la nuit est fort avancée, et le jour s’est approché» (Rom. 13:12). Mais, tant que dure l’attente, puissent nos lampes — alimentées par la véritable huile et arrangées continuellement devant le Seigneur — resplendir, toujours plus brillantes, jusqu’à son retour !
A suivre
Chapitre 26 versets 1 à 14
21. Exode 26:1-14 — Les tapis du tabernacle
Le chapitre précédent se termine par une injonction à l’obéissance. Aucune place ne doit être laissée aux pensées et aux intentions humaines dans la maison de Dieu. Là, son autorité doit être maintenue et reconnue comme étant suprême. C’est un principe de toute importance, aussi est-il répété à maintes reprises au cours de ces communications. Après avoir rappelé à Moïse de toujours garder devant les yeux le modèle qui lui avait été montré sur la montagne, l’Éternel se met à lui donner les instructions relatives à la composition, aux dimensions, etc. des tapis qui devaient former le tabernacle, la tente et leurs couvertures.
21.1. Tabernacle — tente — couvertures
Ch. 26:1-14 — Il y a, comme nous le verrons, quatre séries de tapis. La première est nommée le tabernacle (v. 1-6); la deuxième, la série des tapis de poil de chèvre, est appelée la tente (v. 11, 12); et les deux dernières portent simplement le nom de «couvertures». Trois termes (et il en est de même dans l’original) sont appliqués aux quatre séries de tapis: «le tabernacle» pour la partie le plus à l’intérieur; «la tente» pour la deuxième et «les couvertures» pour les deux parties extérieures, celles de peaux de béliers teintes en rouge et celles de peaux de taissons.
21.2. Le tabernacle et les tapis
1) Pour suivre l’ordre des Écritures, nous considérerons d’abord la série la plus cachée: le tabernacle. Les tapis qui le constituent sont composés de quatre matériaux: le fin coton retors, le bleu, la pourpre et l’écarlate. De plus, des chérubins d’ouvrage d’art étaient brodés dessus. L’enseignement typique de ces tapis réside dans ces matériaux. Le fin coton retors est un symbole de la pureté immaculée. Ainsi, les sacrificateurs en étaient vêtus (Ex. 28:39-43); et au grand jour des expiations, Aaron était revêtu de lin, afin qu’il pût représenter la pureté absolue de la nature de Celui dont il n’était que l’ombre (Lév. 16:4). Dans le Nouveau Testament, il est dit du fin lin que «ce sont les justices des saints» (Apoc. 19:8). Le bleu est toujours un symbole de ce qui est céleste; la couleur elle-même l’indique clairement. La pourpre est l’emblème de la dignité impériale des Gentils. L’évangile selon Jean, par exemple, nous rapporte que les soldats, se moquant avec une grossière méchanceté de Jésus qui disait être Roi, le vêtirent d’un vêtement de pourpre (Jean 19:2). L’écarlate parle de la gloire humaine et, en même temps, de la royauté juive. Ainsi, David dit de Saül qu’il avait revêtu les filles d’Israël d’écarlate, magnifiquement» (2 Sam. 1:24), faisant allusion à la dignité qu’il leur avait conférée. Dans l’évangile selon Matthieu, où Christ est présenté plus spécialement comme le Messie, nous lisons que les soldats lui mirent un manteau d’écarlate et «fléchissant les genoux devant lui, ils se moquaient de lui, disant: Salut, roi des Juifs!» (Matt. 27:28, 29).
21.3. Application à Christ
Si nous appliquons tout cela à Christ, la signification est très frappante. Nous voyons Christ dans la pureté absolue de sa nature, Christ dans son caractère céleste, Christ comme le Roi d’Israël (et, à ce titre, revêtu de toute gloire humaine), et enfin, Christ comme celui qui règne aussi sur les Gentils. Les deux derniers traits se rejoignent, car lorsqu’il s’assiéra sur le trône de David son père, ce sera le temps de sa domination universelle: alors tous les rois se prosterneront devant lui, et toutes les nations le serviront (Ps. 72:11). C’est par conséquent Christ tel qu’il était comme homme dans ce monde et tel qu’il sera dans le déploiement futur de sa gloire dans ce monde, comme Fils de David et comme Fils de l’homme. De plus des chérubins étaient brodés sur ces tapis. On a dit que les chérubins parlaient de l’autorité judiciaire. Cela ajoute un trait important à la présentation de Christ: il a autorité de juger aussi, parce qu’il est Fils de l’homme (Jean 5:27). Nous avons donc là une pleine manifestation de ce que Christ était essentiellement comme homme, ainsi que de ses gloires et de ses dignités en rapport avec la terre. Bienheureux ceux qui, dans l’exercice de leur fonction sacerdotale, étaient admis dans l’enceinte du lieu saint et avaient le privilège de contempler ces différentes manifestations des gloires du Christ de Dieu!
Les dimensions des tapis ont aussi une signification. «La longueur d’un tapis sera de vingt-huit coudées et la largeur d’un tapis de quatre coudées: une même mesure pour tous les tapis» (v. 2). Or, 28 = 7 x 4; la longueur est donc de sept fois quatre; la largeur, étant également de quatre coudées, divise la longueur en sept; c’est-à-dire: 28: 4 = 7. Sept et quatre sont ainsi caractéristiques. Sept est le chiffre parfait, étant absolument indivisible si ce n’est par lui-même; et c’est le plus élevé des nombres premiers. Quatre est le chiffre de ce qui est complet sur la terre, comme cela paraît par exemple dans les quatre coins de la terre, les quatre vents, le carré, les quatre évangiles, etc. Les dimensions des tapis font ainsi allusion à la perfection déployée dans son entier sur la terre; et une telle signification ne pouvait être appliquée qu’à la vie du Seigneur Jésus. Les tapis du tabernacle parlent donc de la pleine manifestation de ses perfections comme homme, alors qu’il parcourait cette terre.
Nous avons ensuite leur disposition et leur nombre. Cinq tapis étaient «joints l’un à l’autre», de sorte qu’il y avait deux séries de cinq tapis, puisqu’il y en avait dix au total. Dix est le nombre de la responsabilité envers Dieu, comme nous le voyons par exemple dans les dix commandements (voir aussi Ex. 30:13, etc.); et cinq est celui de la responsabilité envers l’homme (voir Gen. 47:24; Nomb. 5:7, etc.). Nous apprenons par là que Christ, comme homme, a pleinement répondu à sa responsabilité tant envers Dieu qu’envers l’homme; il a aimé Dieu de tout son cœur et son prochain comme lui-même, allant même en cela, nous le savons bien, infiniment plus loin que les exigences de la loi. Il a été le seul à s’être acquitté pleinement et parfaitement de ces responsabilités.
En outre leur assemblage présente également un enseignement. Il comprenait cinquante ganses de bleu et cinquante agrafes d’or, par lesquelles les tapis étaient joints. Si nous nous souvenons que le bleu est la couleur céleste, que l’or est l’aspect divin, et que les deux nombres, dix et cinq, qui viennent d’être expliqués, entrent dans la composition de cinquante, nous apprenons que le caractère céleste et divin du Seigneur Jésus assurait l’ajustement parfait de la double responsabilité qu’il avait comme Homme, d’une part envers Dieu, d’autre part envers l’homme; autrement dit, qu’elles étaient parfaitement unies par son énergie divine et céleste. Le lecteur comprendra que ces significations ne sont que des suggestions dignes d’être considérées avec sérieux à la lumière des Écritures et qui, si elles sont examinées dans la présence de Dieu, ne sont pas sans intérêt ni profit.
21.4. Les tapis de poil de chèvre
2) Les tapis de poil de chèvre recouvraient immédiatement ceux qui constituaient le tabernacle; ils formaient la tente. Cet assemblage parle lui aussi de Christ — représentant, a écrit quelqu’un, «sa pureté positive, ou plutôt, cette séparation rigoureuse du mal, qui lui donnait le caractère de prophète; il n’y avait pas de sévérité dans ses voies envers les pauvres pécheurs; mais il maintenait, dans sa séparation d’avec les pécheurs, une sévérité à l’égard de lui-même, qui le tenait à l’écart et lui donnait son autorité morale, ce vêtement moral qui distinguait le prophète»1. En confirmation de cette interprétation, nous lisons en Zacharie: «Et il arrivera, en ce jour-là, que les prophètes auront honte, chacun de sa vision, quand il prophétisera, et ils ne se vêtiront plus d’un manteau de poil pour mentir...» (chap. 13:4; comp. Matt. 3:4). Les dimensions de ces tapis différaient de celles des tapis du tabernacle: ils étaient de la même largeur, mais avaient deux coudées de plus dans la longueur, trente coudées au lieu de vingt-huit, et il y avait un tapis de plus. Si nous ne pouvons suggérer aucune valeur typique quant aux nombres, la raison des dimensions plus grandes de ces tapis n’en est pas moins évidente. Ils devaient être posés sur les tapis du tabernacle, de tous les côtés, de façon à les protéger entièrement. «Et ce qui pend, le surplus des tapis de la tente [c’est-à-dire, les tapis de poil de chèvre], la moitié du tapis, savoir le surplus, pendra sur le derrière du tabernacle; et la coudée deçà, et la coudée delà, qui est de surplus dans la longueur des tapis de la tente, pendront sur les côtés du tabernacle, deçà et delà, pour le couvrir» (v. 12, 13). Cela signifie que Christ — dans tout ce qu’il était comme représenté par les tapis de l’intérieur — était gardé par cette séparation parfaite du mal qui découlait de sa pureté positive et absolue. Il pouvait par conséquent défier ses adversaires par les paroles: «Qui d’entre vous me convainc de péché?» (Jean 8:46). Oui, il pouvait déclarer aux siens: «Le chef du monde vient, et il n’a rien en moi» (Jean 14:30). Sa séparation morale de tout mal était si totale qu’il pouvait même toucher un lépreux sans contracter la souillure.
1 Études sur la Parole de Dieu, par J.N. Darby.
Les agrafes des tapis étaient en airain au lieu d’être en or. La couleur des ganses n’est pas mentionnée. L’airain, dans ce contexte, semblerait parler de justice divine, non pas, comme dans l’or, selon ce que Dieu est en lui-même, mais comme éprouvant l’homme, en responsabilité. Cette interprétation apparaîtra plus clairement lorsque nous considérerons l’autel d’airain, mais sa relation avec les tapis de poil de chèvre est facile à comprendre. Christ est ainsi placé devant nous comme étant moralement séparé des pécheurs, mais mis à l’épreuve par la justice divine, dans son sentier, tout au long de son passage sur la terre. Et il est à peine nécessaire de l’ajouter, le seul résultat de cette mise à l’épreuve a été de manifester qu’il répondait parfaitement à chacune des exigences de la justice divine.
21.5. Les couvertures
3) Par-dessus la tente, composée des tapis de poil de chèvre, étaient posées deux couvertures: la première, de peaux de béliers teintes en rouge; et la seconde, de peaux de taissons. Le bélier était l’animal désigné comme offrande de consécration en rapport avec la mise à part des sacrificateurs pour leur fonction. Il est appelé le «bélier de consécration» (chap. 29:27). L’expression «teintes en rouge» parle très clairement de mort. Le sens est donc: une entière consécration, un dévouement jusqu’à la mort; et où cela a-t-il jamais été vu d’une manière parfaite, si ce n’est dans Celui qui s’est abaissé Lui-même et est devenu obéissant jusqu’à la mort, et à la mort de la croix? Les peaux de taissons sont un emblème de cette sainte vigilance manifestée dans sa marche et dans ses voies, vigilance qui le préservait de tout mal. Il est dit de Jérusalem qu’elle a été chaussée de peau de taisson (Éz. 16:10): ressource fournie par l’Éternel pour la mettre à l’abri du mal dans sa marche. La vigilance, ainsi symbolisée, est souvent exprimée dans les Psaumes: «Par la parole de tes lèvres, je me suis gardé des voies de l’homme violent»; et encore: «J’ai caché ta parole dans mon cœur, afin que je ne pèche pas contre toi». Les couvertures proclament donc aussi la perfection de Celui dont elles sont un type. En même temps, il ne faut pas oublier que les traits qu’elles représentent devraient être vus dans chaque croyant. Car Christ est notre exemple dans tout ce qui a caractérisé sa marche ici-bas. Par conséquent, si nous admirons les perfections morales qui ont été manifestées en lui, nous devrions nous souvenir qu’il est placé devant nous comme la mesure de notre responsabilité.
Représentons-nous pour un moment le tabernacle complet: à l’extérieur le regard ne rencontrait que les couvertures de peaux de taissons. En revanche, le sacrificateur qui avait le privilège d’entrer dans le lieu saint pouvait admirer en levant les yeux toute la beauté du fin coton retors, du bleu, de la pourpre et de l’écarlate, et des chérubins d’ouvrage d’art. C’était Christ tant à l’extérieur qu’a l’intérieur; mais à l’extérieur, c’était Christ tel que l’œil naturel le voit, ne discernant aucune beauté en lui pour le faire désirer à l’homme; et à l’intérieur, c’était Christ tel que le voit l’œil ouvert par l’Esprit de Dieu, Christ comme un porte-bannière entre dix mille et comme celui dont toute la personne est désirable.
A suivre
Chapitre 26, versets 15 à 30
22. Exode 26:15-30 — La structure du tabernacle
Cette section renferme plusieurs sujets distincts. Nous avons d’abord la description de la structure du tabernacle et de ses fondements.
Ch. 26:15-30 — Si nous considérons avec soin les détails qui sont donnés, nous verrons que le nombre des ais (ou planches) formant le tabernacle était de quarante-huit. Il y en avait vingt pour le côté du midi (v. 18); vingt pour le côté du nord (v. 20); six pour le fond du tabernacle, vers l’occident au fond (v. 22); et deux pour les angles du tabernacle (v. 23) — ce qui fait un total de quarante huit. Puis remarquons que chacun de ces ais avait deux tenons (v. 17); et chaque tenon avait pour soubassement ou fondement une base d’argent (v. 19, 25). Il s’y ajoutait quatre bases d’argent sous les piliers supportant le voile magnifique (v. 32); de sorte qu’au total cent bases d’argent soutenaient la structure du tabernacle.
22.1. Cent bases d’argent
1) Commençons par le fondement et considérons d’abord l’enseignement typique des bases d’argent. Nous en réserverons toutefois l’explication détaillée pour le moment où nous arriverons à ce sujet, au chapitre 30, et nous nous contenterons d’en indiquer ici les grandes lignes. Nous voyons que, du dénombrement du peuple, chaque homme devait donner un demi-sicle d’argent comme rançon de son âme à l’Éternel; le riche ne devait pas augmenter, et le pauvre ne devait pas diminuer ce montant; cet «argent de la propitiation» était destiné au service du tabernacle (chap. 30:11-16). Dans un autre passage, il est rapporté que la somme ainsi recueillie s’était élevée à cent talents et mille sept cent soixante-quinze sicles. Les cent talents furent utilisés pour les bases des ais et le reste essentiellement pour les crochets des piliers (chap. 38:28). Il est ainsi évident que les bases d’argent, étant faites avec l’argent de la rançon, sont une figure de la propitiation, du sang de Christ versé en rançon pour plusieurs (Matt. 20:28). C’est à cela et à Nombres 31:49-54 que Pierre fait allusion lorsqu’il écrit aux croyants d’entre les Juifs: «Vous avez été rachetés... non par des choses corruptibles, de l’argent ou de l’or» (1 Pierre 1:18). Nous trouvons donc ici la vérité précieuse que l’habitation de Dieu est fondée sur la rédemption telle qu’elle a été accomplie par le sang de Christ. L’habitation de Dieu est maintenant composée de croyants de sorte que l’Église comme telle et chaque croyant individuellement en tant que faisant partie de l’Église (car tout Israélite ayant l’âge requis était représenté dans l’argent de la propitiation) sont placés devant Dieu sur le fondement sûr et efficace de la propitiation accomplie. Le sang précieux de Christ est le fondement de la position de tout croyant qui ainsi paraît devant Dieu dans toute la valeur inexprimable et infinie de ce sang.
Comme cela a été mentionné, ces bases étaient au nombre de cent, c’est-à-dire dix fois dix. Dix est le chiffre de la responsabilité envers Dieu. Ainsi, le sang de Christ tel qu’il est présenté par l’argent a répondu à l’expression la plus élevée de notre responsabilité envers Dieu, a accompli une expiation absolument parfaite, satisfaisant à toutes les exigences de Dieu, et nous purifiant entièrement et pour toujours. Dans la conscience de la perfection de cette œuvre, l’âme a bien des motifs de chanter de joie.
22.2. Quarante-huit ais
2) Les ais; et d’abord leur matière, leur forme et leur longueur. Ils étaient faits avec les mêmes matériaux que l’arche et la table des pains de proposition: du bois de sittim plaqué d’or (v. 15:29). Ils parlent donc en tout premier lieu de Christ, mais aussi, comme nous allons le voir, du croyant. Chaque ais avait deux tenons qui entraient dans leurs bases d’argent respectives. Deux, dans l’Écriture, est le nombre requis pour un témoignage valable; ainsi par exemple: «Par la bouche de deux ou de trois témoins toute affaire sera établie» (2 Cor. 13:1; Deut. 19:15). Chaque ais contient en lui-même un témoignage suffisant à la valeur et à la perfection de la propitiation sur laquelle il repose (comp. 1 Jean 5:6). La longueur de chacun des ais était de dix coudées (v. 16). Cela nous parle de nouveau de la responsabilité envers Dieu, applicable, dans ce cas, aux croyants. Étant devant Dieu sur le terrain de la rédemption, nous ne devons jamais oublier notre responsabilité. Notre position en est effectivement la mesure; et, par conséquent, chacun des ais avait dix coudées de longueur.
Comme nous l’avons vu, il y avait en tout quarante-huit ais, c’est-à-dire douze fois quatre. Douze parle de la perfection administrative, et quatre, de ce qui est complet sur la terre. Le nombre quarante-huit signifie donc la perfection administrative déployée dans toute son étendue, soit en Christ, soit, si nous considérons les ais en rapport avec l’habitation de Dieu, par la maison de Dieu. Le premier aspect sera réalisé durant le millénium; et le second aussi, dans un certain sens, car Christ ne régnera pas sans l’Église. Les deux nombres, douze et quatre, sont ainsi caractéristiques de la sainte cité, la nouvelle Jérusalem. Il se peut que, le jour de la Pentecôte à Jérusalem, l’Église telle qu’elle fut organisée sous les douze apôtres, ait été une ombre fugitive de cette perfection administrative.
22.3. Traverses et anneaux
Un détail est encore à remarquer: la ressource donnée pour assurer la sécurité des ais une fois qu’ils étaient fixés sur leurs bases d’argent. Il y avait cinq traverses de bois de sittim de chaque côté, retenues par des anneaux d’or (v. 26-29); et les ais étaient en outre joints aux angles par des anneaux (v. 24). L’anneau est un symbole de la sécurité, car il n’a pas de fin; par conséquent, les traverses étant là pour renforcer et assurer la charpente, les anneaux et les traverses ensemble peuvent bien parler de la sécurité éternelle dont jouissent tant l’Église que le croyant individuellement. En rapport avec l’Église, le Seigneur lui-même a dit: «Sur ce roc je bâtirai mon assemblée, et les portes du hadès ne prévaudront pas contre elle» (Matt. 16:18). Ailleurs il déclare, en rapport avec le croyant: «Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent, et moi, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais; et personne ne les ravira de ma main» (Jean 10:27, 28).
Une fois les ais préparés, il fallait les mettre à leur place. Et remarquons qu’une fois encore, il est enjoint à Moïse de faire tout selon le modèle qui lui avait été montré sur la montagne. Cela devait être véritablement «la figure et l’ombre des choses célestes» et, par conséquent, aucune place ne devait être laissée aux pensées ou à l’imagination humaines. Il appartenait à Moïse d’obéir et d’être fidèle dans l’exécution du plan céleste. De même maintenant la fidélité à la parole de Dieu, l’obéissance à chacun de ses enseignements, est ce que Dieu requiert des croyants en rapport avec son Église. Si des règlements humains ou une autorité humaine sont admis, l’Église cesse d’être, comme telle, un vrai témoin pour Dieu. Que cette injonction soit donnée pour la troisième fois montre l’importance de l’obéissance aux yeux de Dieu (chap. 25:9, 40; 26:30).
A suivre
Chapitre 26, versets 31 à 37
23. Exode 26:31-37 — Le voile magnifique
La structure du tabernacle, telle que nous l’avons considérée dans le chapitre précédent, comprenait le tabernacle proprement dit, c’est-à-dire le lieu saint et le lieu très saint. En dehors, nous le verrons en temps voulu, se trouvait le parvis du tabernacle, qui venait compléter cette division en trois parties. Mais l’intérieur du tabernacle n’en comptait que deux: le lieu saint et le lieu très saint. Jusqu’ici cette division n’a pas été montrée; mais elle ressort maintenant des directives concernant le voile, données dans le passage suivant.
23.1. Description du voile
Ch 26: 31-37
1) Plusieurs points différents sont à considérer dans la description du voile. Quant aux matériaux dont il est fait, ils correspondent dans chaque détail à ceux des tapis formant le tabernacle (chap. 26:1). Dans les tapis comme dans le voile, ils présentent Christ: Christ dans ce qu’il est quant à sa nature et à son caractère, Christ dans ce qu’il sera en tant que Fils de l’homme et Fils de David dans les gloires à venir de son règne millénaire, et Christ encore comme Fils de l’homme, revêtu du pouvoir judiciaire suprême. Une différence doit être pourtant relevée. Dans les tapis du tabernacle, le fin coton retors vient en premier; ici, le bleu est nommé d’abord et le fin coton retors en dernier. La raison en est que les tapis présentent Christ en relation avec la terre; ainsi la pureté absolue de sa nature est le premier fait mentionné; tandis que le voile montre Christ plutôt en relation avec le ciel et, par conséquent, le bleu, son caractère céleste, est nommé en tête. La signification du voile nous est donnée dans l’épître aux Hébreux: «Ayant donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant qu’il nous a consacré à travers le voile, c’est-à-dire sa chair» (Héb. 10:19, 20). Nous pouvons en tirer deux déductions: d’abord, de même que le voile dans le tabernacle cachait la scène de la présence et de la manifestation immédiates de Dieu, ainsi la chair de Christ, Christ dans son incarnation, masquait la présence de Dieu à l’œil naturel. Il était Dieu manifesté en chair; mais sa chair était également là pour cacher aux yeux des hommes ce fait surprenant. Et seconde déduction, de même que le voile était la seule voie pour entrer dans le lieu très saint, Christ est le seul chemin pour aller à Dieu. Ainsi, le Seigneur dit à Thomas: «Moi, je suis le chemin, et la vérité, et la vie; nul ne vient au Père que par moi» (Jean 14:6).
23.2. Piliers, crochets et bases
Les supports du voile étaient au nombre de trois. Dabord les piliers, puis les crochets et enfin les bases d’argent (v. 32). Les piliers étaient de bois de sittim plaqués d’or comme les ais. Cela symbolise, nous l’avons signalé plus d’une fois, la personne de Christ dans ses deux natures, humaine et divine, comme le Dieu-Homme. Le voile était supporté par ces piliers, nous pouvons en tirer la leçon que tout dans la rédemption dépend de la personne de Christ. S’il n’avait pas été homme, il n’aurait pas pu mourir pour nos péchés; et s’il avait été seulement homme, son sacrifice n’aurait pas pu suffire pour tous les siens. Mais, étant Dieu et homme, il pouvait être la propitiation pour le monde entier (1 Jean 2:2). Toute la valeur aussi de son œuvre découle de sa personne; d’où l’importance de rester fermement attaché au vrai enseignement scripturaire sur ce point et de garder jalousement cette doctrine bénie. Si la vérité quant à la personne de Christ pouvait être ébranlée, tout le système et toute la structure de la rédemption seraient compromis. Aussi l’Esprit de Dieu prend-il soin, on peut même dire prend plaisir à lui rendre témoignage tant par de nombreuses images, formes, figures et types, que par des déclarations catégoriques. Les crochets étaient d’or qui, nous l’avons dit, représente la justice divine. Si donc tout dans la rédemption repose sur la personne de Christ, il est également vrai, comme nous l’indique le fait que le voile était suspendu à ces crochets d’or, que tout dépend aussi de la manifestation de la justice de Dieu en Christ. On peut affirmer d’une manière plus directe encore que Christ tient la place du chemin conduisant vers Dieu en justice divine. Car, puisqu’il a glorifié Dieu sur la terre et a achevé l’œuvre que Dieu lui a donnée à faire, la justice de Dieu s’est manifestée en le ressuscitant d’entre les morts et en le faisant asseoir à sa propre droite. À cause de ce qu’il est, Dieu se doit de le placer et de l’établir dans la position qu’il occupe ainsi.
Les bases étaient d’argent, figure du sang, prix de l’expiation. Cela nous ramène au fondement de tout, l’œuvre que Christ a accomplie sur la croix. Ces deux éléments, le sang et le voile, sont unis dans le passage de l’épître aux Hébreux cité plus haut. Jamais ne doit être oublié le fait que la croix est le fondement de tout, de la bénédiction de l’Église et de celle d’Israël, comme aussi de la réconciliation de toutes choses. Dieu trouve ses délices dans ce qu’est son Fils et dans ce qu’il a fait; cela apparaît clairement dans la description de son sanctuaire où le moindre détail dirige nos regards sur un des multiples aspects de l’œuvre et de la personne de Christ.
23.3. La fonction du voile
La place du voile est très importante: «Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et tu mettras là, au-dedans du voile, l’arche du témoignage; et le voile fera séparation pour vous entre le lieu saint et le lieu très saint» (v. 33). Il isolait, comme cela a été expliqué, le lieu très saint dans lequel était placée l’arche du témoignage, le trône de Dieu sur la terre, afin que personne n’y entre, si ce n’est Aaron une fois l’an au grand jour des expiations (Lév. 16). Nous pouvons bien nous demander quelle en était la signification. La réponse doit être donnée dans les termes de l’Écriture: «L’Esprit Saint indiquant ceci: le chemin des lieux saints n’a pas encore été manifesté, tandis que le premier tabernacle a encore sa place» (Héb. 9:8). Si d’une part, le voile comme figure de Christ enseigne la vérité bénie que c’est par Lui seul que nous pouvons avoir accès à Dieu, le voile en lui-même parle d’autre part de séparation, de ce qui est caché. Dieu ne pouvait en fait pas se révéler lui-même pleinement, il ne pouvait aller avec justice au-devant du pécheur ou amener le pécheur à lui avant que la question du péché ne fût abordée et définitivement réglée. C’est ce que Christ a fait et, en conséquence, aussitôt qu’il rendit l’esprit, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu’en bas (Matt. 27). Ainsi le voile, dans le tabernacle, indiquait que le chemin des lieux saints n’avait pas encore été manifesté; il prouvait par là, non seulement que la question du péché n’était pas encore réglée, mais aussi que le peuple était pécheur et, comme tel, impropre à la présence de Dieu. Des dons et des sacrifices étaient offerts pour lui, mais ils ne pouvaient pas rendre parfaits quant à la conscience ceux qui rendaient culte, sinon ils auraient eu un droit inaliénable d’entrer dans les lieux saints. Non, il n’était pas possible que le sang de taureaux et de boucs ôte les péchés. Coupables comme ils l’étaient, comment les enfants d’Israël auraient-ils pu entrer dans la présence d’un Dieu saint? Et lui, comment serait-il sorti au-devant d’eux, car Dieu dans sa sainteté est un feu consumant?
23.4. Un voile déchiré
L’existence du voile révèle donc le contraste entre la position d’Israël et celle des croyants du temps actuel. Israël était tenu à l’extérieur; il n’avait jamais accès dans le lieu très saint. Moïse, reconnu en grâce comme médiateur, et Aaron, une fois l’an en tant que souverain sacrificateur, étaient seuls autorisés à entrer. Maintenant, tout croyant jouit de ce précieux privilège (voir Héb. 10:19-22). Le voile est déchiré, car «Christ étant venu, souverain sacrificateur des biens à venir, par le tabernacle plus grand et plus parfait qui n’est pas fait de main, c’est-à-dire qui n’est pas de cette création, et non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle» (Héb. 9:11, 12). Le seul lieu où nous pouvons adorer se trouve donc à l’intérieur du voile déchiré, et nous avons une pleine liberté pour entrer, car par une seule offrande Christ a rendu parfaits à perpétuité ceux qui sont sanctifiés.
Un autre contraste ne doit pas être oublié: même lorsque Aaron entrait dans le lieu très saint, il ne se trouvait pas dans la présence de Dieu comme l’est maintenant le croyant. Dieu n’était alors révélé que comme l’Éternel; les croyants le connaissent maintenant comme leur Dieu et Père. Aussi l’apôtre dit-il: «Par lui [Christ] nous avons, les uns et les autres, accès auprès du Père par un seul Esprit» (Éph. 2:18; voir aussi Jean 20:17). Nous sommes remplis d’admiration devant la sagesse de Dieu révélée dans les gloires et les préfigurations de Christ que nous donne le tabernacle. Et nous nous sentons poussés à nous incliner devant Dieu avec adoration et louange lorsque nous découvrons, par contraste avec Israël, la grâce qui nous a introduits dans la pleine jouissance de tout ce qui est représenté ici et de bénédictions plus étendues encore que celles-ci.
23.5. Place des saints ustensiles
2) Nous avons ensuite la disposition des saints ustensiles (v. 33-35). Il sera utile de rappeler une nouvelle fois que l’autel de l’encens n’a pas encore été décrit parce qu’il est un symbole d’approche et qu’il appartient par conséquent à la dernière division de cette section. Les ustensiles présentés sont tous des symboles de manifestation. C’est pourquoi nous n’en ferons pas pour le moment un exposé détaillé, mais nous bornerons à quelques brèves remarques sur la disposition des ustensiles dans ce passage. Tout d’abord, l’arche devait être placée dans le lieu très saint, et le propitiatoire sur l’arche du témoignage, avec les «chérubins de gloire ombrageant le propitiatoire». Il n’y avait rien d’autre dans le lieu très saint, parce que, comme cela a déjà été expliqué, c’était la scène de la présence et de la manifestation de Dieu. C’était là que, le grand jour des propitiations, on s’approchait de Dieu demeurant entre les chérubins, avec l’encens pris sur l’autel d’or et avec le sang des sacrifices. C’était là aussi que se tenait Moïse pour recevoir les communications destinées au peuple. Le voile magnifique isolait ce lieu du lieu saint. Le lieu très saint était donc la partie la plus cachée du tabernacle.
En dehors du voile, dans le lieu saint, se trouvait la table des pains de proposition et le chandelier; ce dernier, sur le côté du nord et la table, vers le sud. Pour emprunter le langage d’un autre: «En dehors du voile était la table avec ses douze pains et le chandelier d’or à sept branches. Douze est le nombre de la perfection de l’administration de Dieu dans l’homme; sept, celui de la perfection spirituelle, soit en bien, soit en mal. Ces deux perfections se rencontrent en dehors du voile, tandis que au-dedans était la manifestation la plus immédiate du Dieu suprême; mais il se cachait encore, pour ainsi dire, dans l’obscurité. La table et le chandelier représentaient la nourriture et la lumière: Dieu en puissance lié avec l’humanité, et Dieu donnant la lumière du Saint Esprit. De même il y a douze apôtres attachés au Seigneur dans la chair, et sept églises pour Celui qui a les sept Esprits de Dieu. Les douze tribus étaient pour le moment ce qui répondait extérieurement à cette manifestation. Cela se retrouve dans la nouvelle Jérusalem. Le fond de la pensée était la manifestation de Dieu dans l’homme et par l’Esprit»1. Ces deux vérités sont liées, et la preuve du lien qui les unit est donnée par les positions respectives de la table et du chandelier; la lumière du chandelier rendant en fait toujours témoignage à la vérité incarnée dans la table des pains de proposition.
1 Études sur la Parole de Dieu, par J.N. Darby.
23.6. Le rideau
3) La dernière chose en rapport avec cette partie du sujet est le «rideau» pour l’entrée de la tente. Ce «rideau» séparait le parvis du tabernacle du lieu saint et en constituait l’entrée. Il occupait par rapport au lieu saint la même position que le voile magnifique par rapport au lieu très saint. Ainsi, lorsque les sacrificateurs arrivaient du parvis (non encore décrit), ils passaient par ce «rideau» pour entrer dans le lieu saint où ils accomplissaient leur service. Les matériaux dont il était fait correspondent à ceux du voile magnifique. Remarquons toutefois une différence importante: il n’y avait pas de chérubins brodés sur le «rideau». À part cela, il était identique au voile, aussi l’enseignement typique de l’un s’applique-t-il à l’autre.
Que signifie alors l’omission des chérubins? Ils représentent, rappelons-le, le Fils de l’homme dans son caractère judiciaire. Le «rideau», comme le voile, est donc une figure de Christ, mais son caractère judiciaire est soigneusement exclu. La raison en est évidente. Dans le «rideau», Christ est présenté en grâce à ceux qui étaient dehors comme le chemin d’accès à la position et aux privilèges de sacrificateurs, comme le chemin d’accès dans la présence de Dieu sous ce caractère de grâce. Les piliers sont faits de la même matière que ceux du tabernacle, les crochets également; ils parlent aussi de la personne de Christ et de la justice divine, telle qu’elle est accomplie et manifestée en lui, à la droite de Dieu. Mais pourquoi cinq piliers au lieu de quatre? Cela peut venir du fait que le «rideau», c’est Christ dans sa présentation au monde en grâce, et cela introduit la pensée de responsabilité envers l’homme. Les bases étaient d’airain au lieu d’argent. L’airain, comme toujours, correspond à la justice divine éprouvant l’homme en responsabilité. Ce point sera plus amplement développé dans le chapitre suivant; mais il est facile de comprendre que Christ manifesté en grâce, c’est Christ présenté à l’homme responsable et, par conséquent, pierre de touche pour cet homme responsable. Dès le moment cependant où la question de ses péchés est réglée, non seulement devant Dieu mais aussi pour sa propre conscience, l’homme trouve en Christ le chemin d’accès dans la présence de Dieu. Ensuite, tout est fondé sur l’argent, car il se trouve maintenant sur le terrain de l’expiation accomplie; en Christ, il a la rédemption par son sang.
Tout parle de Christ. Il est sans doute difficile de donner une interprétation à certains des plus petits détails; toutefois, si Christ est devant l’âme, quelque rayon de sa gloire ne tardera pas à être discerné. Ayons seulement de la patience et une vraie dépendance, jointes à la vigilance contre l’activité de nos propres pensées, et l’Esprit de Dieu se plaira à nous dévoiler ces ombres.
A suivre
Chapitre 27, versets 1 à 8
24. Exode 27:1-8 — L’autel d’airain
En sortant du lieu saint, la cuve était le premier objet que l’on rencontrait, lorsque le tabernacle et toutes ses parties étaient à leur place. Elle est cependant omise ici, pour la même raison que l’autel de l’encens n’était pas décrit dans le chapitre précédent. Elle était un symbole d’approche et non pas de manifestation; c’est pourquoi l’autel d’airain vient ensuite. Il avait, comme nous allons le voir, un caractère particulier. Il était une manifestation de Dieu et, en même temps, le lieu de rencontre entre Dieu et le pécheur. Sous cet aspect, il est la limite de la manifestation de Dieu: c’est-à-dire que Dieu ne se manifeste pas au-delà de cet endroit. En effet, c’est là qu’il rencontre le pécheur, et désormais celui-ci (ou plutôt le sacrificateur agissant pour lui) a la liberté, tout étant préparé, d’entrer en partant de là. Dès lors, ce sont des symboles d’approche dont il a besoin.
24.1. Signification de l’autel
Ch. 27:1-8 — Avant de considérer l’usage de l’autel, il convient d’expliquer sa signification symbolique. Nous trouvons ici aussi, comme pour l’arche, la table, les ais, le bois de sittim, mais il est plaqué d’airain et non pas d’or. L’airain représente la justice divine, non pas telle qu’elle est symbolisée par l’or: selon ce que Dieu est en lui-même, c’est-à-dire adaptée à sa nature divine, mais comme éprouvant l’homme en responsabilité. De ce fait, il s’y rattache toujours un certain aspect judiciaire, car cette justice juge nécessairement l’homme qu’elle rencontre en responsabilité, parce qu’il est pécheur. L’autel, comme un tout, parle donc de Dieu manifesté en justice; il était le lieu de rencontre entre Dieu et le pécheur, car aussi longtemps que le pécheur est dans ses péchés, Dieu ne peut le rencontrer que sur le terrain de sa responsabilité. L’autel était par conséquent le premier objet que rencontrait le regard du pécheur lorsque, sortant du monde, il pénétrait dans le parvis du tabernacle. Ce qu’il voyait donc, c’était un autel, symbole de la croix de Christ. Ainsi, lorsque le pécheur venait à l’autel, croyant à l’efficacité du sacrifice, bien que l’autel mît en évidence sa responsabilité, il découvrait que tous ses péchés étaient ôtés et qu’il pouvait se tenir devant Dieu dans toute la bonne odeur du sacrifice qui avait été consumé là. La position même de l’autel manifeste ce caractère. Il était juste en dehors du monde et juste à l’intérieur du parvis. De même lorsque Christ fut rejeté, il fut chassé du monde, élevé au-dessus de celui-ci en étant cloué sur le bois de la croix. Mais là, comme le sacrifice sur l’autel, il a rencontré et a porté dans son entier la responsabilité de l’homme. Il a subi tout le saint jugement de Dieu contre le péché et a répondu d’une manière si complète à chacune des exigences de sa gloire, que ce sacrifice, entièrement brûlé sur l’autel pouvait monter devant Dieu comme un parfum d’agréable odeur. C’était l’holocauste et non pas le sacrifice pour le péché qui était placé sur l’autel d’airain. Le sacrifice pour le péché était brûlé hors du camp. L’autel d’airain montre davantage ce que Dieu a trouvé — sa part — dans la mort de Christ; et ce n’est que lorsque nous avons appris cette vérité que nous pouvons venir dans sa présence avec une sainte liberté1.
1 Il ne faut jamais oublier que si l’holocauste présente la part de Dieu dans la mort de Christ, il était cependant agréé pour celui qui l’offrait, pour faire propitiation pour lui (Lév. 1:4).
24.2. Usage de l’autel
Si nous considérons maintenant l’usage de l’autel, nous recueillerons d’autres instructions sur ce point. Il était avant tout, comme cela vient d’être dit, l’autel de l’holocauste (Lév. 1). A part l’holocauste, certaines parties de l’offrande de gâteau, du sacrifice de prospérités et même du sacrifice pour le péché, étaient également brûlées sur «l’autel de l’holocauste» (comparer Lév. 2:2; 3:5; 4:10). Sans entrer ici dans les caractères particuliers de ces divers sacrifices, il suffira de dire qu’ils sont des figures des différents aspects de la mort de Christ; et c’est par conséquent dans la combinaison de tous que nous apprenons la valeur infinie et le prix inestimable de ce seul sacrifice qu’ils présentent en type. L’autel d’airain parle donc de Christ, de ce seul sacrifice de Christ, lorsque, par l’Esprit éternel, il s’est offert lui-même à Dieu sans tache. Tout Israélite qui apportait un sacrifice reconnaissait par cet acte qu’il ne pouvait par lui-même répondre aux justes exigences de Dieu, qu’il était un pécheur et que, comme tel, il avait perdu sa vie; c’est pourquoi il apportait une autre vie, afin qu’elle soit sacrifiée à sa place. En venant ainsi, il s’identifiait avec le sacrifice, comme cela ressort du fait qu’il posait la main sur la tête de la victime (Lév. 1:4, etc.).
S’il apportait un sacrifice pour le péché, dont seule la graisse qui est sur l’intérieur était brûlée sur cet autel (voir Lév. 4), au moment où il posait sa main sur la tête de l’animal, sa culpabilité était transférée (en figure) sur le sacrifice qui, par conséquent, était brûlé hors du camp comme une chose impure, étant chargé des péchés de celui qui l’offrait. S’il s’agissait d’un holocauste, par le même acte consistant à poser sa main sur la tête de la victime, celui qui apportait le sacrifice était pour ainsi dire revêtu de toute l’acceptation du sacrifice; il était identifié avec lui. Ainsi deux choses étaient effectuées. D’un côté, ses péchés étaient ôtés de la vue de Dieu; de l’autre, il était amené devant Dieu dans toute l’acceptation de Christ. Si donc l’autel éprouvait l’homme en justice, il révélait en même temps la grâce qui avait pourvu à un sacrifice parfait en sa faveur; de sorte que Dieu pouvait le rencontrer en grâce et en amour aussi bien qu’en justice, et lui donner le droit de se tenir, pleinement agréé, dans sa sainte présence. Les dimensions de l’autel illustrent cette vérité. C’était un carré de cinq coudées de côté: la responsabilité du côté de l’homme entièrement manifestée et satisfaite dans la croix de Christ.
24.3. Réponse aux exigences de Dieu
Quel précieux encouragement Dieu donne au pécheur! Les exigences de son trône, de son gouvernement ont été satisfaites par l’autel; car il a été fait aspersion du sang sur lui, et le sacrifice a été consumé. Dieu peut alors recevoir en grâce et en justice quiconque s’approche avec foi de l’autel; et c’est pour proclamer cette bonne nouvelle que l’Évangile est annoncé dans tout le monde. La croix de Christ est maintenant le lieu de rencontre entre Dieu et le pécheur. C’est sur la base de ce qui a été accompli là que Dieu peut être juste et justifier celui qui est de la foi de Jésus. Il n’existe aucun autre terrain sur lequel il puisse amener le pécheur dans sa présence. Si l’Israélite rejetait l’autel d’airain, il se privait à toujours de la miséricorde de Dieu; et pareillement quiconque rejette la croix de Christ se prive à jamais de l’espérance du salut.
24.4. Les cornes de l’autel
Les cornes de l’autel peuvent aussi retenir notre attention. Il en comptait quatre, une à chaque coin (v. 2). Dans certains cas, on devait faire aspersion du sang du sacrifice sur ces cornes, comme par exemple dans le sacrifice pour le péché pour un chef ou pour quelqu’un du peuple (Lév. 4:25, 30, etc.). La corne est un symbole de la force. Lors donc qu’il était fait aspersion du sang sur les cornes, toute la force de l’autel (et elle était déployée d’une manière complète) qui avait été contre le pécheur, était alors exercée en sa faveur. Les cornes de l’autel devenaient ainsi un lieu de refuge, un sanctuaire inviolable, pour tous ceux qui étaient à bon droit sous leur protection, sur le terrain de l’aspersion du sang. Joab a recherché cette protection lorsqu’il s’enfuyait de devant Salomon (1 Rois 2:28); mais comme il n’y avait aucun droit, étant un meurtrier, il fut mis à mort. Il en est de même du pécheur qui, arrivé à sa fin, voudrait bien se mettre au bénéfice de la mort de Christ pour échapper au jugement, quoique dans son cœur, il soit encore loin de Christ. En revanche, là où se trouve la confiance dans la valeur du sacrifice qui a été offert à Dieu sur l’autel, il n’existe aucune puissance sur la terre ou en enfer qui puisse porter atteinte à l’âme qui repose à son abri et sous sa protection.
24.5. Ressources pour le voyage
Il est intéressant de s’arrêter un instant sur les ressources pour le voyage telles qu’elles sont détaillées en Nombres 4: «Et ils ôteront les cendres de l’autel, et ils étendront sur lui un drap de pourpre. Et ils mettront dessus tous ses ustensiles dont on fait usage pour son service: les brasiers, les fourchettes, et les pelles, et les bassins, tous les ustensiles de l’autel; et ils étendront dessus une couverture de peaux de taissons, et y placeront les barres» (v. 13, 14). Le drap de pourpre était placé directement sur l’autel. La pourpre correspond à la royauté, et cela rend la signification évidente. Ce sont les souffrances de Christ, telles qu’elles sont vues à l’autel, et les gloires qui suivraient, comme l’indique la pourpre. La croix d’abord et ensuite la couronne. Mais l’autel était dans le désert, aussi les peaux de taissons étaient-elles à l’extérieur, recouvrant la pourpre. Le moment de la revendication de la gloire royale de Christ n’était pas encore venu. Entre-temps seules apparaissaient les peaux de taissons, emblème de cette sainte vigilance qui le mettait à l’abri du mal tandis que, rejeté, il traversait le désert, en attendant l’avènement de son royaume.
Tous les ustensiles de l’autel étaient d’airain, en harmonie avec son trait caractéristique. Les barres avec lesquelles l’autel devait être porté étaient de bois de sittim et d’airain, comme l’autel lui-même. Enfin il est une fois encore rappelé à Moïse que ce qui lui avait été montré sur la montagne devait être son modèle. La sagesse de Dieu seule pouvait concevoir l’autel qui devait incarner tant de vérités bénies. Un roi Achaz, impressionné par la beauté de l’autel syrien, pouvait rejeter l’autel de Dieu (2 Rois 16), mais ce fut sa ruine et celle de tout Israël (2 Chron. 28:23). De même, l’homme peut aujourd’hui refuser la prédication de la croix de Christ, trouvant en elle soit une occasion de chute, soit une folie; et il peut se choisir un autel et offrir un culte qui répondent à ses propres goûts esthétiques et qui ne choqueront par conséquent pas les préjugés naturels. Mais, comme dans le cas d’Achaz, cela ne peut que l’amener à sa ruine éternelle. Dieu seul peut prescrire le chemin approprié et le moyen de s’approcher de lui.
A suivre
Chapitre 27, versets 9 à 19
25. Exode 27:9-19 — Le parvis du tabernacle
Après les prescriptions concernant l’autel d’airain, nous avons le parvis du tabernacle. C’était, rappelons-le, la cour entourant le tabernacle et délimitée par des tentures de fin coton retors, comme cela nous est rapporté dans ce passage. Le parvis constituait la troisième division, si nous le considérons comme faisant partie du tabernacle proprement dit ou plutôt comme étant en relation avec lui. Celui-ci comprenait, ainsi que cela a été montré auparavant, le lieu très saint, endroit le plus à l’intérieur; puis, en se dirigeant vers l’extérieur, le lieu saint; et enfin, le parvis qui est décrit ici. Il est, lui aussi, une manifestation de Dieu, indiquant que Christ est toujours dans la pensée de l’Esprit, dans chaque partie du sanctuaire; et que, par conséquent, Christ est la seule clé permettant de pénétrer dans ces mystères.
25.1. Dimensions du parvis
Ch. 27:9-19 — Le parvis du tabernacle avait cent coudées de long et cinquante de large (v. 9-13). Il était composé d’abord de vingt piliers de chacun des deux côtés, au nord et au sud (v. 10, 11), puis de dix piliers à chacune des deux extrémités, à l’occident et à l’orient. Les piliers du côté de l’orient, où se trouvait l’entrée, étaient répartis à raison de trois de chaque côté de l’entrée, tandis que quatre soutenaient le rideau de la porte du parvis (v. 12-16). Il y avait donc au total soixante piliers. Ces piliers — ou plus exactement cinquante-six d’entre eux si nous excluons les quatre destinés au rideau de la porte — supportaient les tentures de fin coton retors qui formaient le parvis. Les tentures s’étendaient sur cent coudées de chaque côté; cinquante coudées du côté de l’occident et trente du côté de l’orient (v. 9-15), deux cent quatre-vingts coudées au total. La porte, à l’orient, était composée de bleu, de pourpre, d’écarlate, et de fin coton retors, en ouvrage de brodeur; il était à tous égards semblable au rideau qui était à l’entrée du lieu saint, et avait vingt coudées de long. Les bases des piliers étaient toutes d’airain; les crochets et les baguettes d’attache pour le rideau étaient d’argent (v. 17). Nous verrons que l’enseignement typique de ces choses ressort de leur double présentation symbolique de Christ et du croyant.
25.2. Les tentures du parvis
Le fin coton retors, emblème de la pureté immaculée de Christ comme cela a été indiqué à maintes reprises, peut être considéré encore d’une autre manière. Les dimensions de ces tentures de fin coton retors étaient de deux cent quatre-vingts coudées. Les tapis du tabernacle (chap. 26:1, 2) avaient aussi deux cent quatre-vingts coudées, soit dix tapis, chacun ayant vingt-huit coudées de long. Les dimensions des tentures et des tapis étaient donc égales. Les tapis du tabernacle présentent Christ, Christ dans sa nature et dans son caractère, et Christ dans ses gloires et dans son autorité judiciaire futures; mais il n’était présenté ainsi que pour le regard de Dieu et pour celui du sacrificateur. Il ne pouvait être vu de l’extérieur comme tel, mais seulement de l’intérieur. Quant aux tentures de fin coton retors, elles présentent aussi Christ, toutefois non pas tant à ceux qui étaient à l’intérieur qu’à ceux qui étaient à l’extérieur. Chacun dans le camp pouvait les voir. C’était donc la présentation de Christ au monde, Christ dans la pureté de sa nature. Il pouvait ainsi défier ses adversaires de le convaincre de péché. Pilate dut confesser à maintes reprises qu’il n’y avait point de faute en lui; et les autorités juives qui, dans leur malice, l’épiaient avec des yeux d’aigle, ne purent jamais établir ni même produire une seule preuve de manquement. Pas la moindre tache ne put être discernée sur le fin coton retors de sa sainte vie, vie de justice pratique qui avait sa source dans la pureté de son être.
Autre fait remarquable: ces tentures avaient cinq coudées de haut (v. 18); leur longueur des deux côtés était de cent coudées et, aux deux extrémités, de cinquante et trente coudées. Ces derniers nombres sont tous divisibles par dix et par cinq. Si nous considérons que ces chiffres nous parlent de la responsabilité envers Dieu et de la responsabilité envers l’homme, il s’ensuit que la pureté immaculée de la vie de Christ découlait de ce qu’il répondait en perfection à ces deux responsabilités. Il a aimé Dieu de tout son cœur et son prochain comme lui-même, en fait, plus que lui-même. Ces tentures proclamaient donc à ceux dont les yeux étaient ouverts la venue de Celui qui répondrait parfaitement dans sa vie et dans sa marche à toutes les exigences de Dieu.
25.3. Les piliers, leurs bases, leurs baguettes d’attache
La matière des piliers n’est pas précisée. À première vue, d’après le verset 10, ils sembleraient avoir été d’airain; mais une comparaison avec le chapitre 38:10 fait apparaître que l’airain, très vraisemblablement, ne concerne que les bases. On pourrait penser, par analogie, qu’ils étaient de bois de sittim plaqué d’airain; mais lorsque l’Écriture garde le silence, les suppositions humaines, même si elles sont permises, sont incertaines. Deux précisions cependant: ils avaient des bases d’airain et des chapiteaux d’argent (chap. 38:17). L’airain correspond à la justice divine éprouvant l’homme en responsabilité. L’airain est par conséquent l’élément distinctif de l’extérieur du tabernacle, comme l’or est celui de l’intérieur. La responsabilité de l’homme doit être éprouvée et il doit y être répondu avant qu’il puisse être introduit dans la présence de Dieu.
Christ, en se présentant au monde, tel qu’il est symbolisé par les tentures de fin coton retors, est vu comme ayant répondu à toutes les exigences de la justice divine. C’est là la base de son caractère de Sauveur. L’argent parle de rédemption. Les piliers en étaient couronnés, et les tentures y étaient suspendues. Christ déploie ainsi l’efficacité de son œuvre. C’est sa couronne de gloire, même à la droite de Dieu. Si donc, par les bases d’airain, il sonde le pécheur, il lui déclare en même temps la valeur du sang telle qu’elle est montrée par l’argent. L’airain, éprouvant l’homme, met à découvert ses besoins et aussitôt que le besoin est connu, l’argent est là pour y répondre. Il y avait 56 piliers — sans compter ceux de la porte — auxquels étaient suspendues les tentures. 56 c’est 7 x 8. Sept est le nombre parfait, et huit, le nombre de la résurrection. La justice pratique de Christ, parfaitement déployée dans sa vie terrestre, est scellée pour ainsi dire par sa résurrection. Il a été «déterminé Fils de Dieu, en puissance, selon l’Esprit de sainteté, par la résurrection des morts» (Rom. 1:4).
25.4. Le rideau pour la porte du parvis
Ce rideau est identique à celui de l’entrée dans le lieu saint. Comme celui-ci, il parle de Christ dans tout ce qu’il est en relation avec la terre, de son caractère céleste, de ses gloires royales comme Fils de l’homme et comme Fils de David, et de sa pureté immaculée. Une fois encore, on n’y trouve pas de chérubin, et cela parce que Christ, ici, est la Porte, le Chemin, en tant que présenté au monde. Il nous est dit que Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu’il jugeât le monde (ce n’était alors pas sa mission), mais afin que le monde fût sauvé par lui (Jean 3:17). Il n’y a maintenant plus de chérubins avec la lame de l’épée qui tourne çà et là pour garder le chemin de l’arbre de vie, car cette lame de l’épée a transpercé la sainte victime qui a été offerte à Dieu sur le Calvaire: Christ a ainsi satisfait, et à jamais, aux exigences de la sainteté de Dieu, de sorte qu’il peut maintenant se présenter au monde dans tous les attraits de sa Personne et de sa grâce, comme étant le chemin, la vérité et la vie.
Ainsi ce rideau de la porte était déployé devant les yeux de tous; et tandis que chacune des couleurs parlait de Christ, toutes ensemble proclamaient dans leur harmonie et leur beauté: «Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé». Il est également à remarquer que Christ est le chemin pour entrer dans le lieu saint et dans le lieu très saint, aussi bien que dans le parvis. «Il est la seule porte, a remarqué quelqu’un, donnant accès aux champs variés de gloire qui doivent encore être manifestés, soit sur la terre, soit dans le ciel, soit dans les cieux des cieux».
25.5. Les tentures et leurs dimensions
Il reste à considérer un autre aspect du parvis du tabernacle. Si d’une part il présente Christ, il donne d’autre part, et parce que c’est Christ, le niveau de la responsabilité du croyant. Aucune mesure inférieure ne peut être invoquée ou acceptée; car il nous a laissé un modèle, afin que nous suivions ses traces. Les dimensions, considérées elles aussi sous cet angle, sont significatives. Les tapis du tabernacle avaient, comme cela a été dit, deux cent quatre-vingts coudées. Ils manifestaient Christ devant le regard de Dieu. Mais, «comme il est, lui, nous sommes, nous aussi, dans ce monde» (1 Jean 4:17). Ce sont donc, pour ainsi dire, les «tapis des privilèges», révélant notre parfaite acceptation devant Dieu. Les tentures de fin coton retors avaient également deux cent quatre-vingts coudées; en tant qu’elles parlent de la justice pratique de la vie de Christ, de sa marche irréprochable, de sa pureté immaculée, elles sont les «tapis de la responsabilité». Dans l’Apocalypse, il est dit que «le fin lin, ce sont les justices des saints» (chap. 19:8). La responsabilité du saint est mesurée par son privilège, par ce qu’il est devant Dieu. On peut y voir une autre pensée. Marcher comme Christ a marché (1 Jean 2:6) constitue notre responsabilité envers Dieu. Mais ces tapis avaient cinq coudées de haut. Cinq, rappelons-le, est le nombre de la responsabilité envers l’homme; et par là, il nous est enseigné que nous sommes responsables envers l’homme aussi bien qu’envers Dieu, responsables de présenter Christ dans notre marche et dans notre conduite.
25.6. Les piliers
Les piliers peuvent aussi parler du croyant. Être dans l’airain, fondés sur la justice divine dont les exigences ont été satisfaites, et avoir sur nos têtes la valeur de la rédemption, représentée par l’argent, sont des faits qui doivent nécessairement précéder une telle manifestation de Christ. Des pieux et des cordages (chap. 27:19; 35:18) étaient là pour assurer la stabilité, et maintenir à leur place les piliers avec les tentures de fin coton retors. L’application de ces images au croyant nous enseigne que la source de sa force n’est pas en lui-même, qu’il a besoin d’une puissance venant de l’extérieur pour pouvoir manifester la justice pratique devant le monde. Et, en fait, une vérité plus étendue nous est présentée; c’est que le croyant, bien que placé sur le terrain de la justice divine et mis au bénéfice de la rédemption, ne pourrait se maintenir dans cette position un seul instant s’il était abandonné à ses propres ressources. Les pieux et les cordages rappellent donc que le croyant est gardé «par la puissance de Dieu par la foi, pour un salut qui est prêt à être révélé au dernier temps» (1 Pierre 1:5). Tout est de Dieu; tout ce que le croyant est, tout ce qu’il a et tout ce dont il jouit, est le don de Sa grâce. Sa position comme aussi sa responsabilité ne peuvent être maintenues que dans la dépendance du Seigneur. Tous ces pieux, de même que les ustensiles du tabernacle pour tout le service, et tous les pieux du parvis, étaient d’airain (v.19). Ainsi, tout en dehors du lieu saint et du lieu très saint était caractérisé par la justice divine, mais la justice divine éprouvant l’homme en responsabilité, parce que c’était le lieu de rencontre entre Dieu et le peuple (voir chap. 29:42). Toutefois, puisque l’homme ne peut, par lui-même, répondre à ces exigences, la justice de Dieu est par la foi en Jésus Christ envers tous, et sur tous ceux qui croient. C’est pourquoi, sauvé par la grâce, il se tient sur le fondement inébranlable de la justice divine devant Dieu. Car la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus Christ notre Seigneur (Rom. 5:21).
A suivre
Chapitre 28
26. Exode 28 — La sacrificature
Avant d’aborder ce sujet, il est utile de récapituler ce que nous avons vu. À l’exception de l’autel de l’encens et de la cuve, le tabernacle et ses saints ustensiles sont maintenant au complet. Après l’arche de l’alliance ont été décrits la table des pains de proposition et le chandelier. Le tabernacle (les splendides tapis), la tente (les tapis de poil de chèvre), et les couvertures respectivement de peaux de béliers teintes en rouge et de peaux de taissons ont suivi. Nous avons vu ensuite les ais du tabernacle et leur érection, la séparation entre le lieu très saint et le lieu saint par le voile, et le «rideau» pour la porte de la tente, permettant l’entrée dans le lieu saint depuis l’extérieur. Puis la disposition des saints ustensiles nous a été donnée: l’arche avec le propitiatoire et ses «chérubins de gloire» avait place dans le lieu très saint; la table et le chandelier occupaient le lieu saint. Les prescriptions touchant l’autel d’airain ont suivi et enfin le parvis du tabernacle. Tous ces objets nous ont présenté tour à tour — sous des aspects symboliques — autant de manifestations de ce que Dieu est en Christ. Nous y voyons, pour ainsi dire, Dieu allant au-devant de son peuple.
26.1. S’approcher de Dieu
À partir de ce chapitre, l’ordre est inverse. Il ne sera plus question de Dieu se présentant à l’homme, mais de l’homme entrant vers Dieu. Tout ce qui suit est donc en rapport avec l’accès dans sa présence et, par conséquent, tous les ustensiles qui ont été laissés de côté sont des symboles d’approche, image de ce qui est nécessaire pour s’approcher de Dieu.
Mais avant que ces ustensiles ne soient considérés, l’établissement et la consécration de la sacrificature sont présentés. La raison en est qu’il devait y avoir des personnes désignées pour s’approcher avant que les ustensiles puissent être utilisés. On reconnaît donc un ordre divin dans cette apparente confusion. Dieu s’est présenté à son peuple par des types et des figures; puis il indique ceux qui doivent être mis à part pour son service dans le sanctuaire, ceux qui jouiront du privilège particulier d’entrer vers lui; finalement nous trouvons les ustensiles, dont ils auront besoin pour exercer leurs saintes fonctions dans la maison de Dieu. Cet ordre nous aidera aussi à comprendre pourquoi le commandement concernant l’huile pour le luminaire est introduit à la fin du chapitre 27. Comme cela a déjà été compris, l’huile est une figure du Saint Esprit. Moïse enjoint aux fils d’Israël d’apporter l’huile; ils sont alors formellement unis (en figure) à la lumière du chandelier et ainsi, représentés par cette lumière des lampes qui devaient être arrangées par Aaron et ses fils devant l’Éternel, depuis le soir jusqu’au matin. En d’autres termes, le peuple apprend pour qui les sacrificateurs auraient à agir, avant que ceux-ci ne soient établis. Cette vérité sera toutefois développée d’une manière plus précise lorsque nous considérerons l’argent de la propitiation. Nous verrons ainsi que chaque détail, la place de chaque verset ainsi que l’ordre des sujets, portent le sceau de la sagesse de Dieu et de l’enseignement qu’il veut donner. Tout étant maintenant disposé, les sacrificateurs doivent être mis à part pour leur saint office.
26.2. Nécessité d’une sacrificature
Ch. 28:1 — Deux ou trois remarques préliminaires nous aideront à comprendre ce sujet. S’il était nécessaire que des sacrificateurs soient établis, c’est parce que les fils d’Israël étaient des pécheurs et que, comme tels, du fait qu’il n’y avait encore aucune ressource pour les purifier de la culpabilité du péché, ils n’avaient aucun titre pour entrer dans la présence de Dieu. L’homme, dans sa nature, ne peut pas, n’ose pas venir devant Dieu. L’objet du service sacerdotal était donc d’exercer la sacrificature devant Dieu (v. 1), mais d’exercer ce serviceen faveur du peuple (Héb. 5:1, 2). Dans la dispensation actuelle, il n’existe pas une classe d’enfants de Dieu agissant comme sacrificateurs pour les autres dans ce sens particulier. Tous les croyants sont maintenant des sacrificateurs (voir 1 Pierre 2:5, 9); tous jouissent pareillement de la liberté d’entrer dans le lieu très saint (Héb. 10).
Aaron donc, quand il est seul, est un type de Christ; lorsqu’il est associé à ses fils, ils constituent, lui et eux ensemble, un type de l’Église comme famille sacerdotale, mais en même temps, de l’Église associée à Christ. Cette distinction apparaîtra plus clairement dans le chapitre suivant. Il est de toute importance d’être au clair sur ce sujet, car par ignorance ou indifférence quant à la vérité, des milliers de croyants professants sont retournés sur le terrain juif et des milliers d’autres y retournent encore, acceptant l’existence d’une classe spéciale d’hommes qui prétendent posséder, comme Aaron et ses fils, le privilège particulier d’aller à Dieu pour représenter leurs semblables. Revendiquer un tel droit, c’est attaquer le fondement même du christianisme, car c’est renier la valeur éternelle de la seule offrande de Christ. Aaron donc, souvenons-nous-en, est un type de Christ; mais lorsqu’il est considéré avec ses fils, les privilèges de l’Église — unie à Christ comme famille sacerdotale — sont placés devant nous. Le choix d’Aaron et de ses fils était pure grâce. La qualification essentielle pour cet office était l’appel divin (Héb. 5:4); mais Aaron n’a pas été choisi en vertu de quelque mérite personnel; il était en fait simplement l’objet de la faveur divine et souveraine. Il n’avait aucune prétention quelconque à faire valoir envers Dieu pour obtenir un tel honneur; mais Dieu le lui a conféré dans l’exercice de ses prérogatives souveraines.
Le chapitre renferme deux sujets: les vêtements sacerdotaux et l’office sacerdotal. Les deux sont entremêlés; les vêtements sont toutefois présentés d’abord.
26.3. Les vêtements du sacrificateur — l’éphod
Ch. 28:2-8 — En tout six vêtements saints «pour gloire et pour ornement» (v. 4) ou sept si nous ajoutons la lame d’or pur sur la tiare (v. 36), constituaient le costume du souverain sacrificateur. L’éphod vient en premier, car il était le vêtement sacerdotal par excellence. Sans lui, le sacrificateur ne pouvait pas exercer d’une manière complète son office. L’éphod était fait de quatre matériaux: le bleu, la pourpre, l’écarlate et le fin coton retors, déjà considérés à plusieurs reprises, avec en plus de l’or (v. 5). Celui-ci est mentionné d’abord; il parle de ce qui est divin. Si nous prenons plus précisément l’or comme un emblème de la justice divine, il apparaît que c’est là le fondement sur lequel Christ exerce son office de sacrificateur; que son intercession est selon cette justice devant Dieu et que, par conséquent, elle l’emporte nécessairement. Dans les quatre autres matériaux, nous avons: le caractère céleste de Christ (le bleu); ses gloires comme Fils de l’homme et comme Fils de David (la pourpre et l’écarlate) et sa pureté immaculée (le fin coton retors) , en tant que saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs.
Il s’ensuit un double enseignement. D’abord que Christ agit pour nous comme sacrificateur, selon tout ce qu’il est dans sa divinité et dans son humanité, comme Dieu-Homme. Toute la valeur de sa personne entre dans l’exercice de son office, l’or parlant de ce qu’il est comme Dieu, et les différentes couleurs, de ses perfections et de ses dignités comme homme. L’apôtre lie ces deux côtés dans l’épître aux Hébreux: «Ayant donc un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu...» (Héb. 4:14). Il est Jésus et il est le Fils de Dieu: vérité si précieuse, exposée en type dans les matériaux de l’éphod. Combien s’élargit notre conception de la valeur de son œuvre pour nous comme sacrificateur lorsque nous nous souvenons de ce qu’il est en lui-même, et que nous sommes portés dans son intercession par tout ce qu’il est en tant que l’homme Christ Jésus et en tant que Fils de Dieu!
Secondement, ces matériaux révèlent le caractère de sa sacrificature. Des gloires royales sont décrites, ainsi que sa nature et son caractère essentiels. Il sera véritablement «sacrificateur sur son trône» (Zach. 6:13). Il exerce maintenant son office en faveur des croyants, selon l’ordre aaronique, au grand jour des expiations, à l’intérieur du voile; mais la pleine expression de son service sacerdotal pour Israël sera vu dans son caractère de Melchisédec (Ps. 110; Héb. 7). L’éphod d’Aaron parlait de ces gloires à venir qui seront manifestées lorsque Christ sera à la fois Roi de justice et Roi de paix. Ainsi, à strictement parler, le vêtement est un symbole de Christ comme sacrificateur pour Israël, bien qu’Aaron ne soit jamais entré dans le lieu très saint dans le caractère dont parlait l’éphod. Car, par Nadab et Abihu, le manquement est intervenu et, en conséquence, il fut interdit à Aaron d’entrer dans la présence de Dieu, si ce n’est une fois l’an et non plus alors dans les vêtements pour gloire et pour ornement (Lév. 10; 16). Mais Christ revêtira tout ce que ces vêtements représentent et alors, pour la première fois, la pensée de Dieu quant à la sacrificature pour son peuple sera vue pleinement réalisée.
26.4. Le ceinture de l’éphod
La ceinture était faite des mêmes matériaux que l’éphod. C’est donc sur sa signification que notre attention est dirigée. Dans l’Écriture, une ceinture parle toujours du service. Ainsi dans l’évangile selon Luc, quand le Seigneur dit: «Bienheureux sont ces esclaves, que le maître, quand il viendra, trouvera veillant. En vérité, je vous dis qu’il se ceindra et les fera mettre à table, et, s’avançant, il les servira» (Luc 12:37). La ceinture de l’éphod évoque donc le service de Christ comme sacrificateur, le service qu’il accomplit pour nous devant Dieu en cette qualité. Lui, le parfait serviteur, trouvait toutes ses délices à faire la volonté de son Père alors qu’il traversait ce monde, et dans son amour il reste, bien que glorifié, encore serviteur. Il est entré dans le ciel afin de paraître pour nous devant la face de Dieu (Héb. 9:24). C’est dans ce caractère qu’il exerce en notre faveur une intercession permanente, par laquelle il nous dispense continuellement la miséricorde et la grâce: la miséricorde pour notre faiblesse, et la grâce pour nous secourir lorsque nous sommes tentés. Il est très réconfortant pour nous d’élever les yeux et de considérer Christ revêtu de sa ceinture sacerdotale, car par là nous avons l’assurance qu’il nous sauvera tout le long du chemin, qu’il nous conduira en toute sécurité en traversant la terre et qu’il nous introduira dans le repos de Dieu, parce qu’il est toujours vivant pour intercéder pour nous. Quelle preuve d’amour de sa part! Moïse s’est plaint à l’Éternel de ce que la charge d’Israël, consistant à conduire le peuple dans ses étapes, était trop pesante pour lui. Mais le Seigneur Jésus, notre grand souverain sacrificateur, n’est jamais lassé, malgré les innombrables manquements des siens, leurs infidélités et leurs «retours de cœur en Égypte». Il n’est jamais fatigué et il ne se repose jamais, car son amour est inépuisable. Que son nom soit béni!
26.5. Les pierres d’onyx
V. 9-30 — Nous avons ensuite les pierres d’onyx et le pectoral. Sur les deux pierres d’onyx étaient gravés les noms des fils d’Israël: six tribus sur chacune d’elles. Elles étaient enchâssées dans des chatons d’or et mises sur les épaulières de l’éphod. «Et Aaron portera leurs noms devant l’Éternel, sur ses deux épaules, en mémorial». Cette description a donc trait, en figure, à l’exercice de l’office sacerdotal. Les pierres d’onyx étaient des pierres précieuses, préfigurant les beautés morales de Christ; et si nous lions cette pensée au fait qu’elles étaient enchâssées dans de l’or, deux conclusions se dégagent: d’abord, que les noms de ceux qui constituent le peuple de Dieu apparaissent sur les épaules du sacrificateur selon toute sa beauté et son excellence, et secondement, qu’ils sont établis selon la justice divine, comme le symbolise l’or. L’épaule est l’emblème de la force (voir Ésaïe 9:6; 22:22, etc.). Christ donc, tel qu’il est dépeint ici, porte dans sa toute-puissance les siens dans la présence de Dieu; et il est en droit de le faire, car ils sont placés sur ses épaules, selon la justice divine, revêtus de tout l’éclat de sa propre beauté. Quel réconfort pour nous, conscients de notre grande faiblesse! Celui qui soutient toutes choses par la parole de sa puissance nous présente constamment devant Dieu; et parce que c’est lui qui nous porte dans sa présence, Dieu nous considère comme ayant un droit indéniable à être sur ses épaules et nous voit à juste titre revêtus de toute l’excellence du souverain sacrificateur. Nous sommes ainsi continuellement rappelés devant lui, car Christ ne peut pas être dans la présence de Dieu sans que nos noms soient vus sur ses épaules. Remarquez aussi que les chatons dans lesquels les pierres d’onyx étaient enchâssées étaient attachés par deux chaînettes d’or en torsade qui les liaient sur ses épaules selon la justice divine.
26.6. Le pectoral
Puis nous avons le pectoral. Les matériaux dont il est fait correspondaient à ceux de l’éphod (v. 15). Il était de forme carrée et garni de quatre rangées de pierres précieuses; et sur ces pierres également étaient gravés les noms des fils d’Israël selon leurs douze tribus. L’enseignement typique aura par conséquent le même caractère, tout en soulignant la différence existant entre les épaules et le cœur.
1) Aaron portait donc les noms des fils d’Israël sur son cœur aussi bien que sur ses épaules. Le cœur est le symbole des affections. Cela nous montre que si d’une part Christ présente les siens devant Dieu par sa puissance éternelle, d’autre part il les porte aussi sur son cœur dans son amour éternel. La force éternelle et l’amour éternel s’unissent dans la présentation des croyants devant Dieu par le Sacrificateur. Sur le cœur de Christ! Qui peut en sonder les profondeurs? Si nous pensons à la puissance, nous entendons les paroles du Seigneur: «Personne ne les ravira de ma main.» Si c’est l’amour qui retient nos pensées, nous nous rappelons le défi de l’apôtre: «Qui est-ce qui nous séparera de l’amour du Christ?» Ainsi, la puissance et l’amour, tous deux réunis en Christ, s’emploient à nous présenter devant Dieu. Il nous a comme chargés sur ses épaules, nous supportant, par sa puissance souveraine, et il nous a liés sur son cœur par son amour impérissable. Cela nous aidera à comprendre quelque chose de la valeur de son intercession pour nous, basée sur l’efficacité de son sacrifice.
26.7. Les noms gravés
2) Les noms des enfants d’Israël étaient gravés sur les pierres précieuses. L’exercice de la sacrificature selon la pensée de Dieu se déployait — et c’est effectivement le cas pour Christ sinon pour Aaron — dans la présence immédiate de Dieu, devant la pleine lumière de la sainteté de son trône. Or l’effet de la lumière sur les pierres précieuses est de manifester leurs beautés variées et multiples. Ainsi, comme cela a été remarqué en rapport avec les pierres d’onyx, les noms des enfants de Dieu, portés sur le cœur du sacrificateur, resplendissent de toute la splendeur des pierres sur lesquelles ils sont gravés. Cela symbolise le fait que les croyants sont devant Dieu dans toute l’acceptation de Christ. Lorsque Dieu regarde le grand Souverain Sacrificateur, il voit sur son cœur et sur ses épaules les siens parés de toute la beauté de Celui sur lequel son regard repose toujours avec une parfaite satisfaction. Ou, sous un autre aspect, on pourrait dire que Christ présente les siens à Dieu, dans l’exercice de sa sacrificature, selon ce qu’il est lui-même. Il revendique ainsi devant Dieu, dans son intercession, ses propres droits à leur égard! Car ils sont ceux pour lesquels il est mort, ceux qu’il a lavés par son précieux sang, ceux dont il a fait les objets de son propre amour et qu’il amènera bientôt pour être avec lui pour toujours. Il intercède pour eux devant Dieu selon toute la force de ces liens, selon tous les droits qu’il a lui-même à l’amour de Dieu en vertu de son œuvre à la croix.
3) Le pectoral était fixé à l’éphod par des chaînettes d’or en ouvrage de torsade et par «un cordon de bleu» et des anneaux d’or. Nous en déduisons que le pectoral ne peut pas être séparé de l’éphod. Il est indissolublement lié à l’office sacerdotal de Christ; il est attaché à l’éphod, le vêtement sacerdotal, par des chaînettes d’or, c’est-à-dire par tout ce que Christ est dans sa divinité, selon la justice divine, une justice qui répond à la nature de Dieu. C’est également une relation éternelle, ce qui est représenté par les anneaux. L’anneau, qui n’a ni commencement ni fin, est un emblème de l’éternité. En tant que sacrificateur, Christ ne peut jamais nous faire défaut. S’il a pris une fois en main notre cause, il ne l’abandonnera jamais.
26.8. L’intercession de Christ
Cette vérité sera certes bien propre à fortifier nos cœurs dans des temps d’épreuve ou de faiblesse. Il se peut que nous soyons découragés, mais si nous levons les yeux, nous pouvons nous réjouir à la pensée que nous ne perdrons jamais notre place sur le cœur et sur les épaules de Christ. De nombreux croyants ont, à certains moments, l’impression qu’ils ne peuvent entrer dans la présence de Dieu ni se faire entendre de lui, que ce soit à cause d’une faute, de la froideur de cœur ou encore de leur faiblesse spirituelle. Ne nous cherchons pas d’excuses mais souvenons-nous que, si nous-mêmes ne pouvons pas prier, Christ lui ne manque jamais de nous porter dans son intercession constante, et que nous sommes indissolublement liés sur son cœur et sur ses épaules: ce sera un antidote aux tentations de Satan en de tels moments. Cette assurance dissiperait vite notre tristesse et notre tiédeur, car elle nous amènerait à détourner les yeux de nous-mêmes et à attendre tout de Lui et de son ministère incessant pour nous dans la présence de Dieu. Comme l’a dit un autre. «Il nous présente à Lui comme ceux qu’il a sur son cœur. Il ne peut pas être devant Lui sans le faire; et quel que soit le droit des vœux et des demandes de Christ à attirer la faveur de Dieu, ce droit attire cette faveur sur nous. La lumière et la faveur du sanctuaire — Dieu y demeure, — ne peut luire sur Christ sans luire aussi sur nous, comme sur un objet présenté à Dieu pour avoir part à ce privilège»1.
1 Études sur la Parole de Dieu, par J.N. Darby.
26.9. Lumières et perfections
4) Aaron portait le jugement du peuple en rapport avec les urim et les thummim. Ceux-ci étaient mis sur le pectoral de jugement (v. 29, 30). Urim et thummim signifient: «lumières» et «perfections». Nous en avons besoin pour que nous soyons bénis. «Si nous étions devant Dieu tels que nous sommes, nous attirerions sur nous-mêmes le jugement, ou bien nous devrions nous éloigner de la lumière et de la perfection de Dieu, et nous tenir dehors. Mais, puisque Christ porte notre jugement selon cette lumière et cette perfection, notre présentation à Dieu est conforme à la perfection de Dieu lui-même, — notre jugement est porté; mais aussi notre position, notre lumière, la direction que nous avons à suivre dans nos voies, notre intelligence spirituelle, sont conformes à cette même lumière divine, à cette même perfection; en effet le souverain sacrificateur demandait à Dieu et recevait des réponses de lui par les urim et les thummim. C’est un précieux privilège». Toutes ces images sont là pour nous montrer avec quelle perfection Christ, comme sacrificateur, intervient pour les siens et prend soin d’eux.
26.10. La robe de l’éphod
Ch. 28:31-35 — La robe de l’éphod est décrite ensuite. Elle était entièrement de bleu — couleur du ciel, rappelant le caractère céleste du sacrificateur et la scène où s’exerçaient ses fonctions ou plutôt la parfaite harmonie entre son caractère et cette place. C’est ainsi que dans l’épître aux Hébreux il est dit de lui non seulement qu’il était saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs, mais aussi qu’il a été élevé plus haut que les cieux (Héb. 7:26). Il fallait prendre soin que la robe ne se déchire pas (v. 32), car ce qui porte le caractère céleste doit nécessairement être inaltérable dans sa perfection. Sur les bords de la robe, il devait y avoir des grenades de bleu, et de pourpre, et d’écarlate, alternant avec des clochettes d’or. Il est spécifié que «Aaron en sera revêtu quand il fera le service; et on en entendra le son quand il entrera dans le lieu saint, devant l’Éternel, et quand il en sortira, afin qu’il ne meure pas» (v. 35). La signification symbolique des grenades et des clochettes est claire: ce sont respectivement les fruits et le témoignage de l’Esprit. En outre, «entrer» et «sortir» indiquent deux périodes distinctes. Si nous considérons Christ, dont Aaron n’était qu’un type, il entra lorsqu’il monta aux cieux, et le son se fit entendre, le jour de la Pentecôte, dans le témoignage que l’Esprit de Dieu rendit par la bouche des apôtres. Il y eut ainsi des fruits liés à ce témoignage, fruits de l’Esprit dans la marche et dans la vie de ceux qui furent convertis par son moyen (voir Actes 2). La même chose se produira lorsque Christ sortira, et dans les deux cas tout découle de Christ dans son caractère céleste. L’apôtre Pierre joint les deux périodes. Il s’adresse à la multitude qui s’était assemblée, confondue par le témoignage de l’Esprit, et leur déclare: «C’est ici ce qui a été dit par le prophète Joël: «Et il arrivera aux derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon Esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes hommes verront des visions, et vos vieillards songeront en songes», etc. (Actes 2:16, 17). Ce qui se passait devant leurs yeux étonnés n’était qu’un échantillon, quoique d’un caractère différent, de ce qui aurait lieu lorsque le Sacrificateur sortirait avec la bénédiction pour Israël. C’est sous ce dernier aspect qu’il nous faut considérer la signification des couleurs des grenades. Les fruits de l’Esprit sont de caractère céleste et, par conséquent, le «bleu» est la première couleur mentionnée. Mais les grenades étaient aussi «de pourpre» et «d’écarlate», car elles seront alors également associées aux gloires royales de Christ, aux gloires dont il héritera en tant que Fils de l’homme et Fils de David. Les deux périodes — son entrée et sa sortie peuvent ainsi correspondre aux pluies de la première et de la dernière saison, du moins en rapport avec Israël (voir Osée 6:1-3).
26.11. La lame d’or
Ch. 28:36-38 — Puis est mentionnée la lame d’or. C’est la ressource miséricordieuse que Dieu a fournie pour les imperfections et les souillures de notre service et de notre adoration. Il ne peut accepter que ce qui répond à sa propre nature. Tout ce qui lui est offert doit, par conséquent, porter le sceau de la sainteté. De ce fait, si nous sommes laissés à nous-mêmes, bien qu’étant purifiés et amenés en relation avec lui et ayant le droit de nous approcher, nos offrandes ne pourraient jamais être acceptées. Mais il est répondu à notre besoin. Christ, comme sacrificateur, porte l’iniquité de nos saintes offrandes; et il est «sainteté à l’Éternel», de sorte que notre adoration est acceptable à Dieu, comme étant présentée par lui. Consolation bénie, car sans cette ressource, nous serions exclus de la présence de Dieu! Aussi l’apôtre ne parle-t-il pas seulement du sang et du voile déchiré, mais également du grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu (Héb. 10).
26.12. La tunique
Ch. 28:39 — Nous trouvons enfin les directives concernant la tunique de fin coton retors. Comme partout ailleurs, le fin coton retors est un type de la pureté personnelle et, appliqué à Christ, de la pureté personnelle absolue. Le fait que la tunique était brodée nous enseigne qu’Il est paré de toute grâce. Tous les vêtements nous parlent donc de Christ quoique, rappelons-le, ils n’aient été que l’ombre des biens à venir et non pas l’image même des choses. Il est toujours nécessaire d’y penser lorsque nous considérons les figures placées sous nos yeux. Soulignons aussi une fois encore que ces vêtements pour gloire et pour ornement ne furent jamais portés à l’intérieur du voile. Ils sont par là d’autant plus applicables à notre position; car si Aaron, revêtu de ces vêtements, avait eu accès dans le lieu très saint, cela aurait été le signe que le peuple qu’il représentait était pleinement accepté. Nous sommes rendus agréables dans le Bien-aimé; et Christ, glorifié, exerce son ministère dans le vrai sanctuaire comme souverain Sacrificateur de son peuple; il nous introduit, par conséquent, dans la jouissance de toutes les bénédictions préfigurées ici. C’est ce qui ressort de l’épître aux Hébreux, et cela explique la raison pour laquelle Christ y est présenté en complet contraste avec tout ce qui, dans l’ancienne dispensation, avait préfiguré sa personne, son office ou son œuvre.
Les vêtements pour les fils d’Aaron et pour Aaron lui-même (v. 40-43) se rattachent davantage au sujet du chapitre suivant: la consécration des sacrificateurs.
A suivre
Chapitre 27, versets 9 à 19
25. Exode 27:9-19 — Le parvis du tabernacle
Après les prescriptions concernant l’autel d’airain, nous avons le parvis du tabernacle. C’était, rappelons-le, la cour entourant le tabernacle et délimitée par des tentures de fin coton retors, comme cela nous est rapporté dans ce passage. Le parvis constituait la troisième division, si nous le considérons comme faisant partie du tabernacle proprement dit ou plutôt comme étant en relation avec lui. Celui-ci comprenait, ainsi que cela a été montré auparavant, le lieu très saint, endroit le plus à l’intérieur; puis, en se dirigeant vers l’extérieur, le lieu saint; et enfin, le parvis qui est décrit ici. Il est, lui aussi, une manifestation de Dieu, indiquant que Christ est toujours dans la pensée de l’Esprit, dans chaque partie du sanctuaire; et que, par conséquent, Christ est la seule clé permettant de pénétrer dans ces mystères.
25.1. Dimensions du parvis
Ch. 27:9-19 — Le parvis du tabernacle avait cent coudées de long et cinquante de large (v. 9-13). Il était composé d’abord de vingt piliers de chacun des deux côtés, au nord et au sud (v. 10, 11), puis de dix piliers à chacune des deux extrémités, à l’occident et à l’orient. Les piliers du côté de l’orient, où se trouvait l’entrée, étaient répartis à raison de trois de chaque côté de l’entrée, tandis que quatre soutenaient le rideau de la porte du parvis (v. 12-16). Il y avait donc au total soixante piliers. Ces piliers — ou plus exactement cinquante-six d’entre eux si nous excluons les quatre destinés au rideau de la porte — supportaient les tentures de fin coton retors qui formaient le parvis. Les tentures s’étendaient sur cent coudées de chaque côté; cinquante coudées du côté de l’occident et trente du côté de l’orient (v. 9-15), deux cent quatre-vingts coudées au total. La porte, à l’orient, était composée de bleu, de pourpre, d’écarlate, et de fin coton retors, en ouvrage de brodeur; il était à tous égards semblable au rideau qui était à l’entrée du lieu saint, et avait vingt coudées de long. Les bases des piliers étaient toutes d’airain; les crochets et les baguettes d’attache pour le rideau étaient d’argent (v. 17). Nous verrons que l’enseignement typique de ces choses ressort de leur double présentation symbolique de Christ et du croyant.
25.2. Les tentures du parvis
Le fin coton retors, emblème de la pureté immaculée de Christ comme cela a été indiqué à maintes reprises, peut être considéré encore d’une autre manière. Les dimensions de ces tentures de fin coton retors étaient de deux cent quatre-vingts coudées. Les tapis du tabernacle (chap. 26:1, 2) avaient aussi deux cent quatre-vingts coudées, soit dix tapis, chacun ayant vingt-huit coudées de long. Les dimensions des tentures et des tapis étaient donc égales. Les tapis du tabernacle présentent Christ, Christ dans sa nature et dans son caractère, et Christ dans ses gloires et dans son autorité judiciaire futures; mais il n’était présenté ainsi que pour le regard de Dieu et pour celui du sacrificateur. Il ne pouvait être vu de l’extérieur comme tel, mais seulement de l’intérieur. Quant aux tentures de fin coton retors, elles présentent aussi Christ, toutefois non pas tant à ceux qui étaient à l’intérieur qu’à ceux qui étaient à l’extérieur. Chacun dans le camp pouvait les voir. C’était donc la présentation de Christ au monde, Christ dans la pureté de sa nature. Il pouvait ainsi défier ses adversaires de le convaincre de péché. Pilate dut confesser à maintes reprises qu’il n’y avait point de faute en lui; et les autorités juives qui, dans leur malice, l’épiaient avec des yeux d’aigle, ne purent jamais établir ni même produire une seule preuve de manquement. Pas la moindre tache ne put être discernée sur le fin coton retors de sa sainte vie, vie de justice pratique qui avait sa source dans la pureté de son être.
Autre fait remarquable: ces tentures avaient cinq coudées de haut (v. 18); leur longueur des deux côtés était de cent coudées et, aux deux extrémités, de cinquante et trente coudées. Ces derniers nombres sont tous divisibles par dix et par cinq. Si nous considérons que ces chiffres nous parlent de la responsabilité envers Dieu et de la responsabilité envers l’homme, il s’ensuit que la pureté immaculée de la vie de Christ découlait de ce qu’il répondait en perfection à ces deux responsabilités. Il a aimé Dieu de tout son cœur et son prochain comme lui-même, en fait, plus que lui-même. Ces tentures proclamaient donc à ceux dont les yeux étaient ouverts la venue de Celui qui répondrait parfaitement dans sa vie et dans sa marche à toutes les exigences de Dieu.
25.3. Les piliers, leurs bases, leurs baguettes d’attache
La matière des piliers n’est pas précisée. À première vue, d’après le verset 10, ils sembleraient avoir été d’airain; mais une comparaison avec le chapitre 38:10 fait apparaître que l’airain, très vraisemblablement, ne concerne que les bases. On pourrait penser, par analogie, qu’ils étaient de bois de sittim plaqué d’airain; mais lorsque l’Écriture garde le silence, les suppositions humaines, même si elles sont permises, sont incertaines. Deux précisions cependant: ils avaient des bases d’airain et des chapiteaux d’argent (chap. 38:17). L’airain correspond à la justice divine éprouvant l’homme en responsabilité. L’airain est par conséquent l’élément distinctif de l’extérieur du tabernacle, comme l’or est celui de l’intérieur. La responsabilité de l’homme doit être éprouvée et il doit y être répondu avant qu’il puisse être introduit dans la présence de Dieu.
Christ, en se présentant au monde, tel qu’il est symbolisé par les tentures de fin coton retors, est vu comme ayant répondu à toutes les exigences de la justice divine. C’est là la base de son caractère de Sauveur. L’argent parle de rédemption. Les piliers en étaient couronnés, et les tentures y étaient suspendues. Christ déploie ainsi l’efficacité de son œuvre. C’est sa couronne de gloire, même à la droite de Dieu. Si donc, par les bases d’airain, il sonde le pécheur, il lui déclare en même temps la valeur du sang telle qu’elle est montrée par l’argent. L’airain, éprouvant l’homme, met à découvert ses besoins et aussitôt que le besoin est connu, l’argent est là pour y répondre. Il y avait 56 piliers — sans compter ceux de la porte — auxquels étaient suspendues les tentures. 56 c’est 7 x 8. Sept est le nombre parfait, et huit, le nombre de la résurrection. La justice pratique de Christ, parfaitement déployée dans sa vie terrestre, est scellée pour ainsi dire par sa résurrection. Il a été «déterminé Fils de Dieu, en puissance, selon l’Esprit de sainteté, par la résurrection des morts» (Rom. 1:4).
25.4. Le rideau pour la porte du parvis
Ce rideau est identique à celui de l’entrée dans le lieu saint. Comme celui-ci, il parle de Christ dans tout ce qu’il est en relation avec la terre, de son caractère céleste, de ses gloires royales comme Fils de l’homme et comme Fils de David, et de sa pureté immaculée. Une fois encore, on n’y trouve pas de chérubin, et cela parce que Christ, ici, est la Porte, le Chemin, en tant que présenté au monde. Il nous est dit que Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu’il jugeât le monde (ce n’était alors pas sa mission), mais afin que le monde fût sauvé par lui (Jean 3:17). Il n’y a maintenant plus de chérubins avec la lame de l’épée qui tourne çà et là pour garder le chemin de l’arbre de vie, car cette lame de l’épée a transpercé la sainte victime qui a été offerte à Dieu sur le Calvaire: Christ a ainsi satisfait, et à jamais, aux exigences de la sainteté de Dieu, de sorte qu’il peut maintenant se présenter au monde dans tous les attraits de sa Personne et de sa grâce, comme étant le chemin, la vérité et la vie.
Ainsi ce rideau de la porte était déployé devant les yeux de tous; et tandis que chacune des couleurs parlait de Christ, toutes ensemble proclamaient dans leur harmonie et leur beauté: «Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé». Il est également à remarquer que Christ est le chemin pour entrer dans le lieu saint et dans le lieu très saint, aussi bien que dans le parvis. «Il est la seule porte, a remarqué quelqu’un, donnant accès aux champs variés de gloire qui doivent encore être manifestés, soit sur la terre, soit dans le ciel, soit dans les cieux des cieux».
25.5. Les tentures et leurs dimensions
Il reste à considérer un autre aspect du parvis du tabernacle. Si d’une part il présente Christ, il donne d’autre part, et parce que c’est Christ, le niveau de la responsabilité du croyant. Aucune mesure inférieure ne peut être invoquée ou acceptée; car il nous a laissé un modèle, afin que nous suivions ses traces. Les dimensions, considérées elles aussi sous cet angle, sont significatives. Les tapis du tabernacle avaient, comme cela a été dit, deux cent quatre-vingts coudées. Ils manifestaient Christ devant le regard de Dieu. Mais, «comme il est, lui, nous sommes, nous aussi, dans ce monde» (1 Jean 4:17). Ce sont donc, pour ainsi dire, les «tapis des privilèges», révélant notre parfaite acceptation devant Dieu. Les tentures de fin coton retors avaient également deux cent quatre-vingts coudées; en tant qu’elles parlent de la justice pratique de la vie de Christ, de sa marche irréprochable, de sa pureté immaculée, elles sont les «tapis de la responsabilité». Dans l’Apocalypse, il est dit que «le fin lin, ce sont les justices des saints» (chap. 19:8). La responsabilité du saint est mesurée par son privilège, par ce qu’il est devant Dieu. On peut y voir une autre pensée. Marcher comme Christ a marché (1 Jean 2:6) constitue notre responsabilité envers Dieu. Mais ces tapis avaient cinq coudées de haut. Cinq, rappelons-le, est le nombre de la responsabilité envers l’homme; et par là, il nous est enseigné que nous sommes responsables envers l’homme aussi bien qu’envers Dieu, responsables de présenter Christ dans notre marche et dans notre conduite.
25.6. Les piliers
Les piliers peuvent aussi parler du croyant. Être dans l’airain, fondés sur la justice divine dont les exigences ont été satisfaites, et avoir sur nos têtes la valeur de la rédemption, représentée par l’argent, sont des faits qui doivent nécessairement précéder une telle manifestation de Christ. Des pieux et des cordages (chap. 27:19; 35:18) étaient là pour assurer la stabilité, et maintenir à leur place les piliers avec les tentures de fin coton retors. L’application de ces images au croyant nous enseigne que la source de sa force n’est pas en lui-même, qu’il a besoin d’une puissance venant de l’extérieur pour pouvoir manifester la justice pratique devant le monde. Et, en fait, une vérité plus étendue nous est présentée; c’est que le croyant, bien que placé sur le terrain de la justice divine et mis au bénéfice de la rédemption, ne pourrait se maintenir dans cette position un seul instant s’il était abandonné à ses propres ressources. Les pieux et les cordages rappellent donc que le croyant est gardé «par la puissance de Dieu par la foi, pour un salut qui est prêt à être révélé au dernier temps» (1 Pierre 1:5). Tout est de Dieu; tout ce que le croyant est, tout ce qu’il a et tout ce dont il jouit, est le don de Sa grâce. Sa position comme aussi sa responsabilité ne peuvent être maintenues que dans la dépendance du Seigneur. Tous ces pieux, de même que les ustensiles du tabernacle pour tout le service, et tous les pieux du parvis, étaient d’airain (v.19). Ainsi, tout en dehors du lieu saint et du lieu très saint était caractérisé par la justice divine, mais la justice divine éprouvant l’homme en responsabilité, parce que c’était le lieu de rencontre entre Dieu et le peuple (voir chap. 29:42). Toutefois, puisque l’homme ne peut, par lui-même, répondre à ces exigences, la justice de Dieu est par la foi en Jésus Christ envers tous, et sur tous ceux qui croient. C’est pourquoi, sauvé par la grâce, il se tient sur le fondement inébranlable de la justice divine devant Dieu. Car la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus Christ notre Seigneur (Rom. 5:21).
A suivre
Chapitre 29, versets 1 à 35
27. Exode 29:1-35 — La consécration des sacrificateurs
Après avoir décrit les vêtements sacerdotaux, l’Éternel instruit Moïse quant aux cérémonies à observer pour la consécration des sacrificateurs. Nous laisserons pour le moment de côté les trois premiers versets qui donnent les directives générales sur les sacrifices qui devaient être offerts à cette occasion. Nous y reviendrons plus loin.
27.1. Le lavage d’eau
V. 4-9 — La première partie du cérémonial était le lavage d’eau, à l’entrée de la tente d’assignation (v. 4). Cet acte est des plus significatifs, l’eau étant un symbole de la parole de Dieu, comme par exemple en Jean 3:5; Éph. 5:26, etc. Cela nous parle symboliquement de la nouvelle naissance ou de la sanctification par la Parole: ils étaient par là mis à part pour le service de Dieu. Le Seigneur priait en ces termes: «Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu’eux aussi soient sanctifiés par la vérité» (Jean 17:19). Aaron était lavé avec de l’eau afin que, si nous le considérons tout seul, il personnifie la pureté absolue de Christ. Christ était personnellement sans tache; Aaron est rendu tel, en figure, par l’application de la Parole, en sainteté de l’Esprit, comme cela est exprimé par l’apôtre Pierre (1 Pierre 1:2). Si Aaron est considéré associé avec ses fils, le lavage proclame en type la vérité que seuls ceux qui sont nés de nouveau, séparés pour Dieu par l’application de la Parole à leur âme, peuvent occuper la place de sacrificateurs et jouir du privilège de «servir» dans les lieux saints. Les sacrificateurs ne peuvent être nommés par l’homme; et prétendre le faire, c’est ne tenir aucun compte de l’enseignement le plus clair et le plus fondamental des Écritures. Les sacrificateurs ne peuvent être établis que par Dieu et tous ceux qui sont nés de nouveau, lavés dans le sang précieux de Christ et scellés par le Saint Esprit, sont sacrificateurs. S’arroger le droit d’ordonner des sacrificateurs, et le faire indépendamment même de la question de leur condition devant Dieu, c’est donc s’ingérer dans un domaine qui frise la profanation; c’est renier les droits et les privilèges de tous les enfants de Dieu.
Aaron est ensuite séparé de ses fils pour l’acte suivant: il est revêtu et oint seul. Il est d’abord revêtu des vêtements sacerdotaux décrits dans le chapitre précédent, les vêtements pour gloire et pour ornement. Puis il est oint avec l’huile qui est versée sur sa tête. Il a déjà été expliqué, et il faut le rappeler ici pour comprendre cette action, que lorsque Aaron est présenté seul, il est devant nous comme l’image de Christ; mais lorsqu’il est en compagnie de ses fils, c’est l’Église qui est représentée en tant que famille sacerdotale. Ainsi s’explique le fait qu’Aaron soit oint avec de l’huile immédiatement après avoir été revêtu des vêtements sacerdotaux, tandis que, comme nous le verrons plus loin, lui et ses fils seront aspergés de sang avant d’être oints d’huile. C’est comme «type» de Christ qu’Aaron est oint sans du sang. Car le grand «Antitype» d’Aaron, étant absolument saint, n’avait pas besoin du sang; aussi lisons-nous que Jésus, lors de son baptême au début de son ministère pour Israël fut oint du Saint Esprit (Matt. 3; Actes 10:38). Il reçut le Saint Esprit, il fut oint, en vertu de sa sainteté absolue, alors que les siens (comme nous allons le voir) sont scellés et oints en vertu de leur purification parfaite par son sang précieux. Aaron oint seul sans du sang est un type de Christ dans son caractère complet de sacrificateur, sacrificateur pour l’éternité selon l’ordre de Melchisédec.
Aaron et ses fils représentent l’Église comme la famille sacerdotale, mais en tant qu’associée à Christ. Comme Aaron il faut qu’ils soient revêtus. Leurs vêtements ne sont pas les mêmes que ceux qui sont décrits en détail dans le chapitre précédent, mais bien ceux qui sont brièvement indiqués à la fin. Ce sont des tuniques, des ceintures et des bonnets; ils étaient de fin coton retors et étaient brodés; d’eux aussi il est dit qu’ils étaient «pour gloire et pour ornement» (chap. 28:39, 40; 29:9). Le fin coton retors brodé représente la pureté de la nature de Christ parée de toute grâce. L’acte de revêtir les fils d’Aaron correspond en réalité à «revêtir Christ»; et en fait, cela les associe à lui, car l’Église ne possède rien en dehors de Christ. Si, par exemple, des croyants sont amenés dans la position de sacrificateurs et dans la jouissance des privilèges sacerdotaux, c’est en vertu de leur relation avec lui. Il est le sacrificateur et c’est lui qui fait d’eux des sacrificateurs (voir Apoc. 1:5, 6). Tout découle de lui. Ainsi lorsque Aaron est présenté en compagnie de ses fils, cela ne signifie pas qu’il se trouve confondu à eux dans la famille sacerdotale, mais plutôt que toutes les bénédictions et tous les privilèges de la famille sacerdotale découlent de Christ. Pour cela il faut qu’ils soient d’abord revêtus de robes pour gloire et pour ornement, de robes qui les parent de la gloire et de la beauté de Christ.
27.2. Le sacrifice pour le péché
L’étape suivante était le sacrifice pour le péché. Aaron et ses fils étaient enveloppés d’infirmité: ils étaient des hommes pécheurs et devaient offrir pour les péchés, pour eux-mêmes aussi bien que pour le peuple. Ils devaient par conséquent être placés sous la valeur symbolique du sang avant de pouvoir accomplir leur saint office et exercer le ministère dans le sanctuaire. D’où les directives qui suivent.
Ch. 29:10-14 — Le sacrifice pour le péché est un type de Christ portant les péchés des siens. Remarquons d’abord qu’Aaron et ses fils posaient leurs mains sur la tête du taureau. Cet acte marquait l’identification de ceux qui offraient avec la victime qui allait être sacrifiée (comparer Lév. 4:4, etc.). Après qu’ils avaient posé leurs mains sur sa tête, le taureau qui allait être égorgé se tenait devant Dieu comme le représentant d’Aaron et de ses fils dans leurs péchés. Leur culpabilité était symboliquement transférée, imputée à la victime qui est maintenant considérée comme portant leurs péchés. Ainsi, par cet acte, ils reconnaissaient leur culpabilité, le fait qu’ils méritaient la mort et qu’ils avaient besoin d’un substitut. Ensuite, le taureau devait être égorgé devant l’Éternel. Le coup de la justice s’abattait sur la victime choisie, qui était comme chargée des péchés d’Aaron et de ses fils, proclamant par là que la mort était le châtiment du péché. S’ils entraient quelque peu dans la signification de ce qui se déroulait, combien cela devait paraître solennel à leurs yeux! Ils pouvaient avoir une idée du vrai caractère du péché devant Dieu, lorsque le taureau était amené et que, après qu’ils avaient posé en silence leurs mains sur sa tête, celui-ci devait mourir. C’est une ombre, faible certes, de la croix, de la mort du Seigneur Jésus en tant que sacrifice pour le péché. Et lorsque nous nous tenons là en esprit et que nous entendons son cri: «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?» il nous est donné de comprendre la nature affreuse du péché, ce qu’il a d’odieux devant Dieu, puisqu’il a rendu nécessaire la mort de son Fils unique. En regardant rétrospectivement cette scène solennelle, les croyants s’écrient: «Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois»; et, en même temps, ils peuvent comprendre quelque peu le jugement dont, par la grâce de Dieu, ils ont été délivrés. Certes, c’était la grâce, et la grâce seule, qui avait pourvu au sacrifice; et c’était l’amour inaltérable de la part de Celui qui a consenti à être conduit comme un agneau à la tuerie, afin de nous racheter pour Dieu.
27.3. Le sang et la graisse
Une fois la victime égorgée, il était fait aspersion du sang. Celui-ci était mis sur les cornes de l’autel, et le reste était versé au pied de l’autel (v. 12). Le sang était ainsi entièrement pour Dieu. La vie est dans le sang (Lév. 17:11), et son aspersion signifiait par conséquent que la vie de la victime était offerte à Dieu à la place de celle d’Aaron et de ses fils. Cela avait lieu sur le principe de la substitution, Dieu acceptant en grâce la mort du sacrifice pour le péché à la place de la mort de ceux pour lesquels il était offert. Puis il fallait faire fumer sur l’autel la graisse qui couvre l’intérieur, et les diverses parties cachées du sacrifice. La graisse, de même que le sang, était interdite aux enfants d’Israël. C’est un emblème de l’énergie intérieure, de la force de volonté. Elle était brûlée sur l’autel, parce que le sacrifice pour le péché était un type de Christ, et elle montrait que alors même qu’il était chargé des péchés des siens, Dieu trouvait en lui, comme dans le cas de l’holocauste, ce qui répondait parfaitement à sa propre pensée, la vérité dans l’homme intérieur. Sa valeur infinie pour Dieu ne fut jamais manifestée plus pleinement que lorsqu’il courba la tête sous les péchés des siens. En grâce il a pris notre place, mais en acceptant le coup du jugement qui nous était dû, chaque pensée de son cœur, chaque mouvement de sa volonté, toute l’énergie de son âme, étaient parfaits devant Dieu. Ce fut en fait dans sa mort sur la croix qu’il prouva le plus complètement son obéissance. Il montra là que la gloire de Dieu était à ce point l’unique motif de son don de lui-même, que même les vagues et les flots du jugement ne purent l’en détourner. Enfin, la chair du taureau, et sa peau, et sa fiente, étaient brûlées hors du camp. C’était un sacrifice pour le péché et comme tel, il devait être jeté dehors et consumé, car il était considéré comme portant par imputation la culpabilité d’Aaron et de ses fils. Nous y voyons Christ souffrant hors de la porte, rejeté des hommes, abandonné de Dieu, parce que, dans sa grâce et dans son amour, il a souffert pour les péchés, le Juste pour les injustes, afin qu’il nous amenât à Dieu. Ce cérémonial accompli, Aaron et ses fils étaient alors sous toute l’efficacité et sous toute la valeur du sacrifice pour le péché.
27.4. L’holocauste
Ch. 29:15-18 — L’holocauste fait suite au sacrifice pour le péché. Comme dans le cas de ce dernier, Aaron et ses fils posaient leurs mains sur la tête de l’holocauste; mais au lieu du transfert ou de l’imputation de leur culpabilité, c’est, pour ainsi dire, eux qui sont transférés, de manière à être identifiés avec le bélier sur le point d’être égorgé. En d’autres termes, si l’acte est semblable, les effets sont en contraste. Après l’imposition des mains, la victime, dans le sacrifice pour le péché, est considérée comme chargée de la culpabilité de ceux pour lesquels elle allait être offerte en sacrifice; tandis que, dans l’holocauste, par ce même acte, Aaron et ses fils sont vus comme revêtus de toute l’acceptation du sacrifice. Leurs péchés étaient transférés dans le premier cas et dans le second, leur position était changée en vertu de la valeur de l’offrande.
Le bélier était ensuite égorgé et il était fait aspersion du sang sur l’autel, tout autour; la vie était présentée à Dieu. Ce n’était pas tout; le bélier était coupé en morceaux et son intérieur était lavé, afin qu’il devînt un type plus exact de la pureté de Christ; puis tout le bélier était brûlé sur l’autel. «C’est un holocauste à l’Éternel, une odeur agréable; c’est un sacrifice par feu à l’Éternel». Dans le sacrifice pour le péché, la chair du taureau était brûlée au feu, hors du camp; mais tout le bélier de l’holocauste était consumé sur l’autel, car il était tout entier agréable à Dieu. L’holocauste est un type du parfait dévouement de Christ jusqu’à la mort; et, sous cet aspect, il n’est pas considéré comme portant les péchés, mais comme entièrement consacré à la volonté et à la gloire de Dieu. Comme tel, par conséquent, Christ sur la croix, sous l’action du feu saint — c’est-à-dire éprouvé par le jugement pénétrant de la sainteté de Dieu — était tout entier une odeur agréable à Dieu.
Lorsque Christ portait nos péchés, Dieu a détourné sa face de lui, mais lorsque, obéissant jusqu’à la mort de la croix, par l’Esprit éternel, il s’est offert lui-même à Dieu sans tache, il a fourni un nouveau motif d’amour au cœur du Père: «À cause de ceci le Père m’aime, c’est que moi je laisse ma vie, afin que je la reprenne» (Jean 10:17). Sous cet aspect, «il était à la place du péché et Dieu était glorifié comme aucune création, aucun état d’innocence ne pouvait le faire. Tout était d’agréable odeur dans ce lieu et correspondait à ce que Dieu était en justice et en amour». La différence entre les deux sacrifices ressort des termes employés. Le mot «brûler» dans l’holocauste n’est pas le même que celui qui est utilisé en rapport avec le sacrifice pour le péché; c’est celui qui est employé pour brûler l’encens. Ce terme même indique le parfum et l’acceptation infinis de Christ comme holocauste. Mais dans notre passage, il est à remarquer qu’il était offert pour Aaron et ses fils; et, par conséquent, aussitôt qu’il était consumé sur l’autel, ils étaient placés sous toute son efficacité. Leurs péchés étaient ôtés par le sacrifice pour le péché, mais maintenant ils se tiennent devant Dieu dans toute l’acceptation et la bonne odeur positives de l’holocauste; ces deux résultats sont acquis au croyant par la mort de Christ, car ces sacrifices sont destinés à présenter les aspects variés de son seul sacrifice.
27.5. Le bélier de consécration
Ces sacrifices étaient dans une certaine mesure préparatoires, se rapportant davantage à l’état personnel des sacrificateurs. S’y ajoute maintenant le bélier de consécration. D’une manière générale, ce sacrifice a le caractère d’un sacrifice de prospérités (voir Lév. 3) et il présente un autre aspect de la mort de Christ: sa valeur pour nous, les obligations qui en résultent pour nous et la communion dans laquelle nous sommes introduits avec Dieu, avec le Sacrificateur et avec toute l’Église. Mais ici, comme nous allons le voir, il est en relation spéciale avec l’office d’Aaron et de ses fils.
Ch. 29:19-35 — Ici aussi, comme dans les deux offrandes précédentes, les mains d’Aaron et de ses fils sont posées sur la tête du bélier de consécration et par là, ils sont identifiés avec sa valeur devant Dieu. Puis deux actions distinctes à l’égard du sang sont prescrites. D’abord, une fois le bélier égorgé, le sang était mis sur le lobe de l’oreille droite d’Aaron et de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit; et simultanément, il en était fait aspersion sur l’autel, tout autour. Ils étaient ainsi placés sous la valeur du sang expiatoire; car le sang qui était offert à Dieu pour eux les mettait également sous Son autorité, de sorte que désormais ils n’étaient plus à eux-mêmes, mais étaient achetés à prix. Le sang mis sur ces différentes parties de leur corps signifiait que, dès lors, ils devaient n’écouter que le Seigneur, n’agir que pour lui, ne marcher que pour lui, en tant que rachetés par le sang précieux. Il en est de même pour les croyants de cette dispensation. Étant rachetés, ils appartiennent au Rédempteur et, délivrés de l’esclavage et de la puissance de Satan, ils jouissent de l’immense privilège de vivre pour Celui qui pour eux est mort et a été ressuscité. Leurs oreilles, leurs mains et leurs pieds doivent tous être employés pour lui, à son service.
27.6. Aspersion du sang et de l’huile
Après cela, une seconde chose était prescrite. Il devait être fait aspersion du sang qui était sur l’autel et de l’huile de l’onction tant sur eux que sur leurs vêtements (v. 21). Les croyants sont ainsi mis à part par le sang et par l’onction du Saint Esprit. «Il est important de remarquer ici que le sceau du Saint Esprit vient après l’aspersion du sang, non après le lavage d’eau. En effet, il faut que nous soyons régénérés, mais ce n’est pas cette purification-là qui nous place dans un état que Dieu puisse sceller de son sceau: le sang de Christ en est seul capable. Par ce sang, nous sommes parfaitement nettoyés, rendus blancs comme la neige, et le Saint Esprit vient rendre témoignage au prix que Dieu attache à cette effusion de sang. C’est pourquoi aussi, tout était aspergé en même temps qu’Aaron. Le sang de Christ et l’Esprit Saint nous ont associés à Christ, là où il est, et là où sont la présence, la liberté et la puissance de l’Esprit Saint; et ce lien est la conséquence de son sacrifice parfait, représenté par le bélier des consécrations»1. La croix et la Pentecôte sont en fait liées: l’efficacité du sang et le don du Saint Esprit, et tous deux sont ici appréciés, du moins en figure2. Ces trois étapes conduisent à la position chrétienne. Le lavage d’eau vient en premier, puis la purification avec le sang, et enfin l’onction du Saint Esprit: «Vous n’êtes pas dans la chair, mais dans l’Esprit, si du moins l’Esprit de Dieu habite en vous; mais si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, celui-là n’est pas de lui» (Rom. 8:9).
1 Études sur la Parole de Dieu, par J.N. Darby.
2 Comparer la loi pour la purification du lépreux en Lévitique 14, en se souvenant que là il est question de la purification des péchés et non pas, comme ici, de la consécration de la sacrificature.
27.7. Des mains remplies
Ensuite, certaines parties du bélier de consécration (v. 22), un pain, un gâteau de pain à l’huile, et une galette... étaient mis sur les mains d’Aaron et de ses fils pour être tournoyés comme offrande tournoyée devant l’Éternel. Le pain, le «gâteau de pain à l’huile» (v. 2, comparé avec Lévitique 2) était un sacrifice de prospérités, représentant Christ dans la perfection de son humanité ou plutôt, la sainteté de sa vie en dévouement pour Dieu, l’entière consécration de chaque faculté de son âme à la volonté et à la gloire de Dieu. Si nous mettons cette offrande en relation avec les parties du bélier, les mains d’Aaron et de ses fils étaient donc en fait remplies de Christ dans tout ce qu’il était pour Dieu dans sa vie et dans sa mort. Le mot traduit dans notre chapitre par «consacrer» signifie, comme l’indique la note, «remplir les mains». Cela nous aide à comprendre ce qu’est aux yeux de Dieu la «consécration». Beaucoup pensent qu’elle consiste à céder quelque chose à Dieu et, par conséquent, à chercher en soi la force de se dévouer, pour mettre toutes ses énergies au service de Dieu: et on essaie souvent d’y parvenir par un acte solennel d’abandon de soi-même. L’Écriture nous révèle une meilleure voie. Elle consiste, comme nous le montre ce chapitre, à être occupé de Christ. C’est Christ possédant, absorbant et contrôlant notre âme. Cela ne demande, par conséquent, aucun effort de notre part, bien que cela requière le maintien d’un jugement de soi constant, le refus permanent de satisfaire la chair sous quelque forme que ce soit. Car Christ veut nous posséder tout entier, et si l’Esprit n’est pas attristé, il habitera dans nos cœurs par la foi; devenant alors le seul objet de notre vie, lui seul aussi sera manifesté dans notre marche et dans notre conduite. Voilà la consécration selon Dieu, telle qu’elle est préfigurée par le fait de remplir les mains d’Aaron et de ses fils.
27.8. Une odeur agréable
Après avoir tournoyé le contenu de leurs mains devant l’Éternel, Moïse le prenait et le faisait fumer sur l’autel, sur l’holocauste, en odeur agréable devant l’Éternel: c’est un sacrifice par feu à l’Éternel. Cela nous enseigne à la fois ce qui est agréable à Dieu dans l’adoration et ce qu’est, par conséquent, le vrai service sacerdotal. C’est la présentation de Christ — Christ qui a passé au travers du saint feu du jugement, étant fait péché pour nous sur la croix — qui monte en odeur agréable devant Dieu. C’est là véritablement avoir communion avec Dieu au sujet de la mort de son Fils: notre âme entrant, par l’Esprit, dans ce qu’il est, dans le caractère de sa mort, et le présentant lui et son œuvre devant le regard de Dieu. Nous trouvons nos délices à présenter et il trouve ses délices à recevoir. Il commence par remplir nos mains, et lui seul peut le faire, de ce qu’il se plaira à accepter. Voilà donc notre service comme sacrificateurs, nos privilèges comme adorateurs: présenter toujours Christ devant Dieu. Il est alors facile de comprendre que la chair ne peut avoir aucune place dans un tel service; en réalité, l’adoration ne peut être rendue que par et dans la puissance du Saint Esprit.
27.9. Une part commune
Suivent enfin des instructions concernant les différentes parties du bélier de consécration qui pouvaient être mangées. Moïse devait avoir sa part, la poitrine, après qu’elle avait été présentée comme offrande tournoyée devant l’Éternel (v. 26). Aaron et ses fils avaient leur part (v. 27, 28, 31, 32). Ainsi Dieu, et Christ comme sacrificateur, avec toute l’Église, symbolisée par Aaron et ses fils, se nourrissent du même sacrifice offert. C’était la communion de Dieu, de Christ et des siens, chacun ayant sa part, dans l’expiation accomplie. Nous apprenons aussi que Christ seul est la nourriture des siens. Amenés sous la pleine valeur de son sacrifice par lequel ils sont consacrés et sanctifiés, c’est lui qui devient leur nourriture et leur force (v. 33). Deux interdictions sont ajoutées. D’abord, nul étranger ne devait manger de cette nourriture sacerdotale. Elle était réservée à ceux qui sont mis à part pour l’office de sacrificateurs. Secondement, la chair des consécrations devait être mangée le jour même (v. 34). La nourriture sacerdotale doit être mangée en rapport avec l’autel. De même, vous ne pouvez pas vous nourrir de Christ si vous le dissociez de la croix. C’est en tant qu’offert à Dieu et glorifié par lui à cause de son œuvre que Christ est notre nourriture et que nous pouvons nous nourrir de lui en communion avec Dieu.
Pendant sept jours ces cérémonies devaient être répétées, et pendant sept jours l’autel devait être sanctifié (v. 36, 37). La consécration des sacrificateurs devait être parfaite et l’autel où ils servaient devait être parfaitement sanctifié. La consécration et la sanctification doivent toutes deux être selon la perfection des exigences d’un Dieu saint.
A suivre
Chapitre 29, versets 38 à 46
28. Exode 29:38-46 — L’holocauste continuel
Faisant suite à la consécration des sacrificateurs, nous avons des directives pour l’holocauste continuel. Continuel, car il devait être offert matin après matin et soir après soir, dans toutes les générations des enfants d’Israël. C’était en fait un sacrifice journalier perpétuel.
Ch. 29:38-46 — Distinguons trois parties dans notre sujet: l’holocauste et ce qui l’accompagnait, le lieu de rencontre entre Dieu et son peuple, et l’Éternel demeurant au milieu d’eux et étant leur Dieu.
28.1. L’holocauste du matin et du soir
L’holocauste se composait de deux agneaux d’un an, dont l’un devait être offert le matin et l’autre le soir. Il ne devait jamais cesser d’être offert (voir Nomb. 28:3, 6, 10, etc.; Esdras 3:5). Comme cela a été expliqué au chapitre précédent, l’holocauste continuel, en tant que figure du sacrifice de Christ dans ce caractère, parle de son dévouement jusqu’à la mort, dans laquelle, pour le péché et pour la gloire de Dieu, il prouva son obéissance jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’à être fait péché pour les siens. Tout était par conséquent consumé sur l’autel et montait comme un parfum agréable devant l’Éternel (voir Lév. 1). Cette odeur agréable évoque celle que Dieu trouvait dans la mort de Christ en obéissance à sa volonté. L’offrande placée devant nous étant continuelle, Dieu posait ainsi un fondement sur lequel Israël pourrait se tenir et être accepté, selon tout son parfum et sa saveur. Ce sacrifice devient aussi une image de la position du croyant, révélant la base de son acceptation dans le Bien-aimé; car de même que l’odeur agréable de l’holocauste continuel montait toujours devant Dieu en faveur d’Israël, Christ, selon toute son excellence, est toujours devant ses yeux, en faveur de ses enfants. Nous pouvons par conséquent dire: «Comme il est, lui, nous sommes, nous aussi, dans ce monde»; car nous sommes dans la présence divine selon toute la saveur de son sacrifice et dans toute l’acceptation de sa Personne.
Deux choses accompagnaient l’holocauste; d’abord, «un dixième de fleur de farine, pétrie avec un quart de hin d’huile broyée»; et secondement: «une libation d’un quart de hin de vin». La première était un sacrifice de prospérités et la seconde, une libation. Comme cela a été indiqué en rapport avec la consécration des sacrificateurs, le sacrifice de prospérités est un emblème du dévouement de Christ dans sa vie, de son entière consécration à la volonté et à la gloire de Dieu. La fine fleur de farine était pétrie avec de l’huile (voir aussi Lév. 2), pour préfigurer la mystérieuse vérité que Christ, quant à son humanité, a été conçu par le Saint Esprit. Elle représentait donc la perfection de sa vie ici-bas, sa vie d’obéissance parfaite, toute l’énergie de son âme s’écoulant par ce canal, trouvant ses délices à faire la volonté de son Père et à achever son œuvre. Israël était par conséquent devant Dieu dans toute la valeur et l’acceptation de sa vie et de sa mort, de tout ce qu’il était pour Dieu, soit dans la parfaite consécration de sa vie, soit dans l’expression la plus élevée de la perfection de son obéissance telle qu’elle a été manifestée lorsqu’il a été fait péché sur la croix. La libation était composée de vin. Le vin est un symbole de la joie: il «réjouit Dieu et les hommes»; présenté ici à Dieu, il parle de la joie de Dieu, sa joie dans le sacrifice offert. Mais il était offert par son peuple, par le sacrificateur en faveur des enfants d’Israël. Il exprimait aussi à cet égard leur communion avec la joie de Dieu dans la perfection de la vie et dans le dévouement jusqu’à la mort de son Fils unique. Tel est le cœur de Dieu. Il veut nous amener dans la communion avec lui, il veut que nous goûtions ses propres délices, que la joie de son propre cœur, s’écoulant et remplissant aussi nos cœurs, déborde en louange et en adoration. C’est ainsi que l’apôtre Jean dit: «Or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ» (1 Jean 1:3).
28.2. Un point de rencontre
Considérons maintenant le lieu de rencontre de Dieu avec son peuple. Moïse avait été autorisé, par grâce, à rencontrer l’Éternel devant le propitiatoire (Ex. 25:22; Nomb. 12:8); mais le peuple ne pouvait franchir la porte de la tente d’assignation. C’était là que l’holocauste était présenté sur l’autel d’airain; aussi était-ce le lieu de rencontre entre Dieu et Israël, sur le fondement du sacrifice. Il ne pouvait y avoir aucun autre lieu; de même que maintenant Christ est l’unique lieu de rencontre entre Dieu et le pécheur. Il est de toute importance, particulièrement pour ceux qui ne sont pas sauvés, de discerner cette vérité: en dehors de Christ, on ne peut s’approcher de Dieu. «Je suis le chemin, et la vérité, et la vie; nul ne vient au Père que par moi» (Jean 14:6). De plus, remarquez bien qu’on ne peut s’approcher de Dieu que sur le terrain du sacrifice de Christ. Voilà la vérité préfigurée en relation avec l’holocauste. Si la croix, si Christ crucifié, sont laissés de côté, il ne peut y avoir aucune relation avec Dieu sinon celle existant entre un pécheur coupable et un juge saint. Mais du moment que le pécheur est amené à se placer devant Dieu sur le fondement de «l’odeur agréable» du sacrifice, en vertu de l’efficacité de ce que Christ a accompli par sa mort, Dieu peut le rencontrer en grâce et en amour.
28.3. La gloire de Dieu
Autre aspect à considérer: Quelle était la conséquence du fait que Dieu venait rencontrer son peuple et habitait au milieu de lui? Dieu sanctifiait le tabernacle par sa gloire; il sanctifiait la tente d’assignation et l’autel; et il sanctifiait aussi Aaron et ses fils, afin qu’ils exercent la sacrificature devant lui (v. 43, 44). En vertu du sacrifice, Dieu revendiquait ses droits et mettait tout à part pour lui-même. Le tabernacle, l’autel et les sacrificateurs, tout était sanctifié, revendiqué comme appartenant à l’Éternel et destiné à son service. L’expression «par ma gloire», appliquée au tabernacle, est remarquable. Le lieu très saint était le seul lieu de la terre où sa gloire était manifestée, dans cette nuée lumineuse, appelée la shekina, qui était le symbole de sa présence. Ainsi déployée, elle séparait la tente de tout autre lieu de la terre, en faisait un lieu saint, la sanctifiait. Mais davantage encore, sa gloire étant là, elle devenait la mesure de tout ce qui était présenté. Pour tous ceux qui s’approchaient et pour tout ce qui était offert, la question, considérée sous son aspect le plus élevé, était par conséquent de savoir ce qui convenait à la gloire de Dieu. Ainsi nous lisons dans l’épître aux Romains que «tous ont péché et n’atteignent pas à la gloire de Dieu»; preuve que si nous ne répondons pas à ses exigences, si nous ne pouvons pas nous tenir devant le déploiement direct de sa gloire, nous sommes des pécheurs coupables. Cela va plus loin encore. Le tabernacle lui-même était sur la terre, au milieu du peuple terrestre de Dieu. En tant que sanctifié par sa gloire, il annonçait aussi prophétiquement le jour où toute la terre serait remplie de sa gloire. C’était donc une brillante promesse de bénédiction milléniale.
28.4. Dieu habitant au milieu de son peuple
Cela nous conduit au troisième point — Dieu habitant au milieu de son peuple. C’était le but exprès de la construction d’un sanctuaire (chap. 25:8). Dieu voulait habiter au milieu d’eux pour qu’ils puissent être amenés en relation avec lui, pour qu’ils puissent le connaître comme le Dieu rédempteur, comme celui qui les avait conduits hors du pays d’Égypte. En réalité le fondement de son habitation au milieu d’eux était la rédemption accomplie. Aussi, Dieu n’a-t-il jamais habité avec Adam, Noé, Abraham ni aucun des patriarches, quelle qu’ait été par ailleurs l’intimité des relations dont ils ont pu jouir avec lui. Il n’a pas non plus habité — et il ne le pouvait pas — avec Israël tant que le peuple était dans le pays d’Égypte; mais après qu’il les eut amenés hors de la maison de leur servitude et à travers la mer Rouge, il désira avoir son sanctuaire au milieu d’eux. La bonne odeur du sacrifice, emblème de l’acceptation du sacrifice de Christ à Dieu, lui permit de s’entourer de ceux qu’il avait rachetés. Mais il ne s’agissait pas seulement de son habitation au milieu du peuple. Dieu voulait établir avec lui une relation. «Je leur serai Dieu». Ce n’est pas, remarquons-le, ce qu’eux seront pour lui, bien que, par sa grâce, ils fussent son peuple, mais ce que lui sera pour eux: leur Dieu — paroles pleines de bénédictions. Car lorsque Dieu s’engage à devenir le Dieu des siens, lorsqu’il consent à entrer en relation avec eux, il leur assure tout ce dont ils ont besoin, que ce soit pour la direction, la nourriture, la protection, le secours, tout leur est assuré par ce qu’il est pour eux en tant que leur Dieu. «Bienheureux le peuple qui a l’Éternel pour son Dieu», s’écriait le psalmiste, conscient de tout ce que comportait une si merveilleuse relation (Ps. 144:15). Toutefois, comme nous l’avons vu, si Dieu habitait au milieu d’eux, c’était pour qu’ils puissent le connaître, et le connaître par la rédemption. C’était là son désir, et c’était à cet effet qu’il les avait visités en Égypte, qu’il avait frappé le Pharaon, son pays et son peuple par des jugements, qu’il avait fait sortir les fils d’Israël à main forte et à bras étendu, qu’il les avait amenés à lui et qu’il leur donnait maintenant des directives pour la construction de son tabernacle. Il voulait avoir sa joie dans le bonheur de ses rachetés, en s’entourant d’un peuple heureux et joyeux. C’était là sa pensée, même si eux n’y entraient que bien peu; une pensée qui aurait un jour son accomplissement plein et parfait, bien qu’elle dût encore être différée.
En fait on peut considérer le tabernacle dans le désert, entouré par les tribus d’Israël, comme une image de l’état éternel. Le but, exprimé ici par Dieu, fut répété (Lév. 26:12) et réaffirmé en relation avec le millénium (Ézéch. 37:27, 28). Mais ce n’était là que des ombres de la pleine bénédiction que Dieu destinait à son peuple, et ne pouvait aller plus loin compte-tenu de ce qu’ils étaient; aussi cela ne sera pas réalisé en perfection avant l’état éternel. Même maintenant s’il est vrai dans un sens que Dieu habite sur la terre (car l’Église est son habitation par l’Esprit; et tout croyant qui a reçu l’Esprit d’adoption est un temple du Saint Esprit) c’est seulement lorsque tous les conseils de Dieu en Christ seront accomplis, que les rachetés de cette dispensation formeront, sous la figure de la nouvelle Jérusalem, le tabernacle éternel et le lieu d’habitation de Dieu (Apoc. 21).
A suivre
Chapitre 30, versets 1 à 10
29. Exode 30:1-10 — L’autel de l’encens
La place qu’occupe l’autel de l’encens dans les directives reçues par Moïse est des plus instructives. Jusqu’à la fin du chapitre 27, toutes choses sont arrangées en vue de la manifestation de Dieu; ce sont les symboles de la manifestation, comme on les appelle quelquefois. Puis il va être question de s’approcher de Dieu; aussi trouve-t-on immédiatement la désignation et la consécration des sacrificateurs qui seuls ont le privilège d’entrer dans le sanctuaire. Mais, avant d’aller plus loin, l’holocauste continuel est présenté, comme nous l’avons considéré au chapitre précédent. En effet, tant que le peuple n’est pas devant Dieu dans toute l’acceptation de son odeur agréable, et que Dieu lui-même n’habite pas parmi les siens, sanctifiant le tabernacle par sa gloire et mettant tout à part pour lui-même, il ne peut y avoir ni approche, ni accès en sa présence. En d’autres termes, il ne peut y avoir d’adoration sans l’odeur du sacrifice, ni en dehors de la présence de l’Éternel. Tout étant ainsi préparé, les symboles de l’approche suivent, c’est-à-dire les saints ustensiles qui étaient employés pour venir en la présence de Dieu. Le premier est l’autel d’or, ou l’autel de l’encens.
29.1. Matériaux de l’autel
Ch. 30:1-10 — L’autel était fait des deux matériaux caractéristiques de l’arche et de la table des pains de proposition: le bois de sittim et l’or (v. 1-5).
Ainsi, l’autel lui-même (en dehors de son emploi) était une figure de la personne de Christ, Christ à la fois Dieu et homme, Dieu manifesté en chair. Que cela soit rattaché à l’autel est significatif: cela nous enseigne qu’il n’y a aucun accès à Dieu sinon par Christ, que lui-même est le fondement à la fois de notre approche et du culte. Le sacrificateur (l’adorateur) ne voyait dans l’autel que l’or, et Dieu lui aussi ne voyait que l’or: ce qui lui convenait, ce qui convenait à sa propre nature. Le souvenir de ce fait donne pleine hardiesse, quand on se prosterne en sa présence. Quelle grâce merveilleuse que Christ soit lui-même devant les yeux de Dieu et devant ceux de l’adorateur, le lieu de rencontre entre Dieu et son peuple, aussi bien que le fondement de l’acceptation de son peuple!
29.2. Position de l’autel
La position de cet autel est donnée au verset 6. Il devait être placé «vis-à-vis du voile qui est devant l’arche du témoignage». L’autel d’airain, comme nous l’avons vu, était au-dehors, dans le parvis du tabernacle; c’était le premier objet que rencontrait l’œil de celui qui, venant du camp, entrait dans le parvis. Nous apprenons par là que la question du péché doit être réglée pour qu’on puisse être admis dans la présence de Dieu. L’autel de l’encens, lui, était à l’intérieur, dans le lieu saint, et les sacrificateurs seuls y avaient accès. En fait, entre les deux autels se trouvait la cuve; mais elle n’est mentionnée que plus tard, parce que la valeur du sacrifice offert sur l’autel d’airain amène directement (en figure) à l’autel d’or. L’autel d’airain éprouvait l’homme dans sa responsabilité; et, les exigences de la justice de Dieu ayant été satisfaites par le sacrifice, il pouvait introduire le croyant dans sa présence immédiate, lui accorder les privilèges sacerdotaux et, par conséquent, l’accès, dans la personne du sacrificateur, à l’autel de l’encens. Les exigences de l’autel d’airain satisfaites, rien ne pouvait exclure l’adorateur de l’autel d’or. Son titre était parfait. C’est ce que l’on voit dans l’épître aux Hébreux. Le sang versé sur la croix donne liberté d’accès dans les lieux saints (Héb. 10). Un rapport étroit lie donc les deux autels.
29.3. L’encens pur
Nous pouvons considérer maintenant à quoi servait l’autel. Aaron devait y faire fumer l’encens pur (l’encens des drogues odoriférantes), matin et soir, quand il arrangeait les lampes (v. 7, 8). La composition de l’encens nous est donnée au verset 34. Remarquez qu’il était brûlé sur l’autel; c’est sous l’action du feu qu’il exhalait son parfum agréable; et le feu était pris de dessus l’autel d’airain (voir Lév. 16:12, 13). Ainsi, le feu qui consumait le sacrifice était le même que celui qui faisait s’exhaler le parfum de l’encens. Cela explique sa signification. Le feu est un type du jugement scrutateur de Dieu, de sa sainteté s’exerçant en jugement, et c’est à travers ce jugement que notre Sauveur a dû passer lorsqu’il était sur la croix. Or le seul effet de l’action du feu divin sur lui a été de répandre une «nuée» de parfum de bonne odeur. C’est ce que l’encens représente: la bonne odeur de Christ pour Dieu; et, le fait que ce devait être un encens continuel (v. 8), nous dit que ce parfum monte toujours devant le trône. Si l’efficacité de son œuvre est représentée par l’odeur du sacrifice, l’acceptation de saPersonne l’est par l’encens. Les deux choses sont distinguées au jour des expiations. Aaron entrait avec de l’encens dans le saint des saints avant de faire aspersion avec du sang sur et devant le propitiatoire. Ainsi, Christ lui-même est entré avec son propre sang; mais, si l’on ose parler ainsi de choses aussi indissolublement liées, lui-même prend le pas sur son propre sang. C’est ce qu’il est en lui-même qui donne au sang son ineffable prix.
29.4. Le service d’Aaron
Mais, peut-on demander, quel est le sens de cet acte quant à Aaron? D’abord, Aaron est un type de Christ, et de Christ devant l’autel dans le lieu saint. En faisant fumer l’encens, il est l’image de Christ dans son intercession souveraine. Aaron, on s’en souvient, entre dans le lieu saint selon toute la vertu du sacrifice consumé sur l’autel d’airain. En outre, l’encens qu’il brûle par le feu saint est toujours acceptable pour Dieu. Cela nous enseigne ainsi que l’intercession de Christ monte vers Dieu de façon acceptable, en raison de l’efficacité de ce qu’il est et de ce qu’il a fait. Par conséquent elle ne saurait manquer. Et de même que cet encens était continuel, de même lui est toujours vivant pour intercéder pour nous; et à cet égard il est capable de sauver entièrement son peuple, à travers tout, jusqu’au bout du voyage à travers le désert. Quelle consolation cette assurance donne à son peuple environné d’infirmités, de difficultés et d’épreuves dans le chemin!
En second lieu Aaron, devant l’autel de l’encens, est une figure du croyant, puisque tous les croyants aujourd’hui sont sacrificateurs. Ce côté est excessivement instructif, car il nous fait considérer l’acte de faire fumer l’encens comme un type du culte. Premièrement il faut observer de nouveau qu’Aaron (et le croyant qu’il représente) se tient devant l’autel d’or dans toute la bonne odeur de l’holocauste, car c’est la vertu de ce sacrifice qui lui donne accès au lieu saint. Cela est très important: il ne peut exister de véritable culte tant que nous ne connaissons pas ce que c’est que d’être amené dans la présence de Dieu selon toute l’acceptation de Christ, non seulement en sachant que nos péchés sont effacés, mais en saisissant aussi que nous sommes devant Dieu selon tout le mérite de Christ lui-même, dans tout son inexprimable parfum.
29.5. Substance du culte
Deuxièmement, c’est Christ dans tout ce qu’il est pour Dieu qui est présenté à Dieu dans le culte; non pas nos propres sentiments, ni nos propres pensées, mais ce qui réjouit le cœur de Dieu, et c’est Christ lui-même, Christ comme celui qui l’a glorifié sur la terre et qui a achevé l’œuvre qu’il lui avait donnée à faire.
Troisièmement, nous trouvons que l’essence de tout culte est dans la communion avec Dieu quant à tout ce que Christ est et a fait; car, lorsque nous adorons par le Saint Esprit, nous présentons à Dieu ce qui fait ses délices, et nous trouvons nos propres délices dans ce que nous présentons. Ainsi nos pensées, nos sentiments, nos affections sont à l’unisson de ceux de Dieu lui-même. Il en résulte le culte — l’adoration dans son caractère le plus élevé. Tel est notre service comme sacrificateurs devant l’autel: la présentation continuelle des mérites de Christ. Et si nous intercédons là, notre intercession aussi est selon la valeur de Christ; c’est pourquoi il pouvait dire: «En vérité, en vérité, je vous dis, que toutes les choses que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donnera» (Jean 16:23).
Il existe un rapport, on le remarquera, entre l’encens et les lampes. Aaron devait faire fumer l’encens quand il arrangeait les lampes, matin et soir. Les lampes, comme on l’a vu à propos du chandelier, sont la manifestation de Dieu dans la puissance de l’Esprit. C’est ce qui a été vu en perfection dans celui qui était la lumière du monde,et c’est ce qui devrait être vu à la fois dans 1’Église et dans chaque croyant. Mais il faut noter ici particulièrement que la lumière était entretenue par les soins du sacrificateur. Aaron arrangeait les lampes. Il en est ainsi maintenant. La manifestation de Dieu dans la puissance de l’Esprit dépend toujours de l’action sacerdotale de Christ; et «faire fumer l’encens» — qu’il s’agisse de l’intercession ou du culte — sera toujours en proportion de la manifestation de la puissance de l’Esprit. Ces trois choses sont en fait inséparables: le service sacerdotal de Christ, la manifestation de Dieu dans la puissance de l’Esprit, et le culte de son peuple. En d’autres termes, si les croyants ne brillent pas comme des luminaires dans ce monde, ils ne peuvent «faire fumer l’encens sur l’autel d’or», ils sont impuissants pour adorer. La marche et le culte sont liés: si le croyant ne marche pas durant la semaine dans la présence de Dieu, il ne saura pas ce que c’est que de se trouver à l’intérieur du voile déchiré, quand les saints sont rassemblés autour du Seigneur à sa table pour annoncer sa mort. Ou encore, pour faire ressortir un autre aspect, le culte ne peut pas avoir lieu s’il n’est pas le résultat de la manifestation de Dieu dans la puissance de l’Esprit. C’est pourquoi les lampes doivent être arrangées quand l’encens est offert.
29.6. Usage de l’autel
Suivent des avertissements quant à l’usage de l’autel qu’il y a lieu de rapprocher de Lévitique 10:1. Trois éléments ne devaient en aucun cas être offerts sur cet autel. D’abord, il ne devait pas y avoir d’encens étranger. L’encens offert devait être composé selon les instructions divines, et nul autre ne pouvait être accepté. Si, pour un instant, nous prenons cela au sens littéral, quelle présomption cela fait apparaître dans beaucoup d’«églises» de la chrétienté aujourd’hui! Ceux qui se proclament sacrificateurs emploient, dans des services religieux publics, pour le culte de Dieu, d’indignes imitations de ce saint composé — ce qui, selon la loi était puni de mort (voir v. 38). Un Juif même regarderait cela comme une abomination, et pourtant des chrétiens professants peuvent en supporter l’usage! Cela témoigne avec évidence et de la ruine de la chrétienté et de la puissance de Satan. Si, d’autre part, nous regardons cela comme un symbole, il nous enseigne que seule la bonne odeur de Christ est acceptable pour Dieu dans le culte. Tout ce qui est offert en dehors de Christ est «étranger» et ne peut être accepté.
Deuxièmement, ni holocauste, ni offrande de gâteau, ni libation, ne devaient être offerts sur cet autel. Cela aurait été confondre l’autel d’or avec l’autel d’airain et, par conséquent, oublier notre véritable position comme sacrificateurs. La même erreur se répéterait maintenant si, quand nous sommes rassemblés pour le culte, nous prenions notre place à la croix, et non à l’intérieur du voile déchiré. Beaucoup d’âmes y tombent involontairement, se privant de la joie d’être amenées à Dieu en vertu de l’œuvre de Christ et ainsi, comment pourraient-elles occuper leur vraie position sacerdotale?
Enfin, un passage du Lévitique interdit l’emploi d’un feu étranger. Ce devait être le feu de Dieu, le feu allumé du ciel, de devant l’Éternel, et nul autre (Lév. 9:24). L’application de cela aux croyants nous enseigne qu’ils ne peuvent adorer que par l’Esprit de Dieu. La ferveur naturelle, les émotions naturelles, quelles qu’elles soient seraient dans ce sens un feu étranger. C’est pour cette raison que les sacrificateurs ne devaient boire ni vin, ni boisson forte quand ils entraient dans le tabernacle. Les effets du vin simulent ceux qui sont produits par l’Esprit de Dieu (voir Actes 2:13-15). Le feu, comme l’encens, doit être divin pour être acceptable sur l’autel d’or; — leçon que les chrétiens de nos jours feraient sûrement bien de prendre à cœur, quand de tous côtés on tente d’agir sur l’homme naturel, soit par la vue, soit par l’ouïe pour l’aider à adorer Dieu. Puissent-ils apprendre que toutes ces choses sont en réalité abominables aux yeux de Dieu!
29.7. Application du sang
Une fois par an, propitiation devait être faite sur les cornes de l’autel avec le sang du sacrifice de péché des propitiations (v. 10). C’est ce que nous trouvons en Lévitique 16. La raison en était l’imperfection de la sacrificature. La vraie place du sacrificateur était devant l’autel d’or; mais, étant ce qu’il était, il souillait la place même où il s’approchait de Dieu (comparer Lév. 4:7). De là le besoin de la perpétuelle application du sang de l’expiation. Le contraste avec l’antitype est instructif. Maintenant un seul sacrifice subsiste pour toujours. Christ, par une seule offrande, celle de lui-même, a rendu parfaits à perpétuité ceux qui sont sanctifiés; et par conséquent ils jouissent sans interruption d’un libre accès même dans le lieu très saint.
29.8. Transport
Enfin on peut faire une remarque quant aux directives pour le transport de l’autel à travers le désert. Les barres et les anneaux décrits ici ne demandent pas d’observation, du fait qu’ils sont du même matériau que l’autel. Mais en Nombres 4:11, sont mentionnées deux couvertures: premièrement un drap de bleu; secondement, à l’extérieur, les peaux de taissons. Le bleu, rappel du caractère céleste, lié à l’intercession et à la position sacerdotale, était caché. Il était pour l’œil de Dieu seul. Ensuite viennent les peaux de taissons, évoquant cette sainte vigilance par laquelle Christ se gardait de tout mal; elles sont à l’extérieur, parce qu’il s’agit de traverser le désert de ce monde, où le mal abonde. Et cela nous enseigne, par conséquent, que, si le caractère céleste doit être maintenu, il faut une vigilance infatigable, une diligence incessante pour nous garder, grâce à l’emploi de la Parole, des souillures et des profanations qui nous menacent de toutes parts.
A suivre
Chapitre 30, verset 11 à 16
30. Chapitre 30 — L’argent de la propitiation — Exode 30:11-16
Nous avons déjà fait allusion à l’argent de la propitiation lorsque nous avons considéré les bases d’argent sous les ais du tabernacle. À première vue, l’introduction de ce sujet à cette place semble étrange; mais en réalité, c’est une marque de plus de la perfection du dessein de l’Esprit de Dieu. Les sacrificateurs ont été désignés et consacrés; l’autel d’or a été décrit, ainsi que le service qui s’y rapporte; mais avant qu’Aaron puisse s’approcher pour brûler l’encens, il fallait qu’il y ait un peuple racheté en faveur duquel il devait remplir son office. Car le principe même de la sacrificature, c’est qu’elle représentait le peuple devant Dieu. Aussi, dès que l’autel d’or a été donné, le peuple est identifié avec le tabernacle, comme cela est représenté par l’argent de la propitiation. Chaque détail dans l’ordre des sujets est donc divinement disposé.
30.1. L’argent du dénombrement
Ch. 30:11-16 — Deux notions se dégagent du premier verset de cette instruction: l’occasion et le but de l’argent de la propitiation. L’occasion, c’était: «Quand tu en feras le dénombrement». Lorsque les fils d’Israël étaient dénombrés, chaque homme était pour ainsi dire amené individuellement devant Dieu; et c’était le moment précis choisi pour leur rappeler leur condition et le besoin de la rédemption qui en résultait pour eux. Tant que la question du péché n’est pas réglée, si Dieu est mis en contact avec l’homme comme tel, il doit, de par la sainteté de sa nature, prendre connaissance de sa culpabilité. D’où cette provision miséricordieuse! Sa signification symbolique est tout simplement la vérité qui revient presque à chaque page de l’Écriture: à savoir que tous les hommes ont besoin d’une rançon pour leur âme.
Quant au but pour lequel cet argent était versé, c’était «afin qu’il n’y ait pas de plaie». Car, comme cela a été relevé, si Dieu voit le pécheur dans ses péchés, c’est nécessairement pour le jugement, à moins qu’il ne soit sous la protection de la propitiation. Nous en avons une illustration frappante dans le règne de David. Le roi, fier de la force de ses armées, fut tenté de faire dénombrer son peuple. «Va», dit-il à Joab, «et qu’on dénombre le peuple, afin que je sache le nombre du peuple». Mais il négligea l’ordonnance stipulant que chaque homme donne une rançon pour son âme, de sorte que «l’Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu’au temps assigné; et il mourut du peuple, depuis Dan jusqu’à Beër-Shéba, soixante-dix mille hommes» (2 Sam. 24). C’était d’autant plus étonnant que David avait confessé son péché immédiatement après que le peuple eut été dénombré. Mais bien que l’Éternel agît envers lui avec une grâce et une compassion pleines de tendresse, et qu’il lui donnât le choix de la nature du châtiment, le jugement ne pouvait pas, en justice, être évité. Les droits de l’Éternel devaient être reconnus. Tous ceux d’entre le peuple qui étaient dénombrés étaient soumis à son juste jugement et cela devait être reconnu par l’argent de la propitiation.
30.2. Le montant de la rançon
La somme à donner était d’un demi-sicle d’argent (voir chap. 38:25-28), selon le sicle du sanctuaire, qui comprenait dix guéras. Dix est le nombre de la responsabilité envers Dieu; et nous en concluons qu’il doit être pourvu à la responsabilité de l’homme, comme pécheur, envers Dieu. Or l’argent est une figure du rachat par le sang de Christ. L’apôtre Pierre y fait allusion lorsqu’il dit: «Vous avez été rachetés... non par des choses corruptibles de l’argent ou de l’or, mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache» (1 Pierre 1:18, 19). On remarquera qu’il parle de l’or aussi bien que de l’argent. Il y a une raison spéciale à cela. Dans une certaine occasion, le peuple avait été remarquablement préservé des périls de la guerre, de sorte que lors de son dénombrement il ne manquait pas un des fils d’Israël. Ce jour-là de l’or fut offert au lieu de l’argent, comme montant de propitiation (Nomb. 31:49-54). Aussi l’apôtre joint-il les deux en contraste avec le sang de Christ ou comme type de ce sang.
Le Seigneur lui-même parle de donner sa vie en rançon pour plusieurs (et la vie est dans le sang). Le demi-sicle d’argent était donc une image claire du sang de Christ et nous apprenons que c’est ce précieux sang qui seul peut répondre à notre responsabilité envers Dieu, en tant que pécheurs, et faire propitiation pour notre âme. En Christ nous avons la rédemption — par son sang, et de nulle autre manière. C’est là une vérité familière, si connue qu’elle est devenue, pour ainsi dire une déclaration banale. Mais n’y a-t-il pas le danger que, par sa familiarité même, elle perde sa signification? C’est d’ailleurs contre cette vérité si bénie que tout l’artifice, toutes les subtilités et les malices de Satan sont dirigés. Et ainsi il est arrivé que plusieurs, même parmi les docteurs en vue dans le christianisme, ont rejeté cette vérité ou se sont mis à insinuer des doutes à son égard. Il est donc nécessaire de la proclamer avec une insistance et un sérieux toujours plus grand. Elle ne sera cependant jamais reçue si l’on n’a pas d’abord compris que l’homme, tant par sa nature que par ses actions, a besoin de la rédemption, qu’il est un pécheur perdu et coupable et qu’il ne peut se racheter lui-même. Comme le psalmiste le dit: «Un homme ne pourra en aucune manière racheter son frère, ni donner à Dieu sa rançon» (Ps. 49:7). Une fois ceci accepté, on est préparé à comprendre qu’il n’y a de propitiation pour l’âme que par le sang précieux de Christ; que sans effusion de sang il n’y a pas de rémission, et que c’est seulement par le sang de Jésus Christ, le Fils de Dieu, que tout péché peut être ôté.
30.3. Pas de différence
Un autre point demande à être spécialement relevé. Tout homme, qu’il fût riche ou pauvre, avait exactement la même valeur devant Dieu. «Le riche n’augmentera pas, et le pauvre ne diminuera pas» (v. 15). Lorsque la question du péché est soulevée, il n’y a pas de différence aux yeux de Dieu entre un homme et un autre. «Tous ont péché et n’atteignent pas à la gloire de Dieu». Certains sont peut-être allés plus loin que les autres dans l’iniquité ouverte, dans des crimes manifestes; mais quant à l’état devant Dieu, tous, ceux qui extérieurement sont moraux comme les immoraux, le riche aussi bien que le pauvre, sont des pécheurs sous la condamnation. La condition sociale, les connaissances ou même le caractère moral ne sont d’aucune valeur devant Dieu. Tous ont péché, car il n’y a personne qui pratique la justice, pas un seul, et tous pareillement ont besoin de la rédemption qui ne peut être obtenue que par le sang de Christ. Le cœur de l’homme résiste à cette vérité, mais la question est de savoir si elle est ou non de Dieu (voir Rom. 1 à 3).
Il résulte de cette vérité que chaque homme devait donner pour lui-même. Chaque homme donnera une rançon pour son âme. En cette affaire, le riche ne pouvait pas donner pour le pauvre, mais chacun pour soi-même devait être amené dans une relation distincte et personnelle avec Dieu, pour sa rançon ou rédemption. L’argent de tout dénombré devait être représenté dans les bases d’argent, sinon il ne pouvait être considéré comme racheté. Il en est de même aujourd’hui. Chacun doit avoir un intérêt personnel dans le sang de Christ pour pouvoir être sauvé. Les prières d’autrui ne suffiront pas en elles-mêmes à sauver qui que ce soit, à moins que par leur moyen il ne soit amené, par la grâce de Dieu, à connaître personnellement Christ comme le Rédempteur. Ce sont ma propre culpabilité, mes propres péchés, qui ont besoin d’être ôtés et ainsi, tant que je ne suis pas pour moi-même sous la valeur du sang de Christ, je demeure exposé au juste jugement d’un Dieu saint. Que le lecteur pèse bien cela avec sérieux dans la présence de Dieu jusqu’à ce qu’il ait l’assurance d’avoir un droit, par la foi, à l’efficacité du sang précieux de Christ. Ce doit être une préoccupation personnelle, une affaire personnelle avec Dieu, un intérêt personnel dans le sang. Alors seulement la rédemption par le sang de Christ peut être connue et goûtée.
30.4. Usage de l’argent
La dernière instruction rapportée concerne l’usage fait de l’argent de la propitiation (v. 16). Il était destiné au service du tabernacle. En fait, comme nous l’avons déjà vu, il devait servir à faire les bases d’argent qui formaient le fondement du sanctuaire. La maison de Dieu était fondée sur la rédemption et le peuple racheté était ainsi identifié à celle-ci, chacun des fils d’Israël étant représenté par l’argent qui avait été donné, et représenté, par conséquent, dans toute la valeur de ce dont l’argent était un type. Le but était: «Il sera pour les fils d’Israël un mémorial devant l’Éternel, afin de faire propitiation pour vos âmes». Ainsi l’argent sur lequel reposait le tabernacle témoignait, en faveur des enfants d’Israël, que propitiation avait été faite pour leurs âmes. Quant à eux-mêmes ils n’entraient peut-être que faiblement dans ce fait béni; mais le mémorial était toujours devant l’Éternel; et la question, alors comme maintenant, est plutôt: nous considère-t-il comme rachetés? A-t-il accepté le prix de notre rédemption? Car si lui est satisfait, nous pouvons certes aussi nous reposer en paix.
Ainsi Dieu, en grâce, liait les fils d’Israël au tabernacle dans lequel il voulait lui-même demeurer et dans lequel les sacrificateurs devaient entrer à leur place. Ils n’y avaient pas eux-mêmes accès, mais ils étaient tous représentés dans l’argent de la propitiation et avaient par conséquent leur mémorial toujours devant l’Éternel.
Chapitre 30, versets 17 à 21
31. Chapitre 31 — La cuve — Exode 30:17-21
La cuve est le dernier des saints ustensiles décrits. Avec elle, le tabernacle et ses arrangements sont complets. Elle était placée à l’extérieur du sanctuaire proprement dit, dans le parvis du tabernacle, entre la tente et l’autel, c’est-à-dire entre l’autel d’airain qui était juste àl’intérieur du parvis et la porte du lieu saint. Aussi, après avoir dépassé l’autel de l’holocauste, les sacrificateurs qui entraient dans le tabernacle trouvaient-ils sur leur chemin la cuve. Nous en donnerons la raison un peu plus loin.
Ch. 30:17-21 — Il est à remarquer qu’il n’est rien dit de la forme de la cuve. Toutes les illustrations qui en sont données dans les ouvrages sur le tabernacle sont sans autorité; elles sont en fait purement imaginaires. Dieu a certainement ses raisons pour n’avoir donné ni sa forme ni ses dimensions. À n’en pas douter l’Esprit de Dieu veut diriger nos pensées moins sur l’ustensile lui-même que sur ce qu’il représente. Les silences de l’Écriture sont aussi instructifs que les révélations qu’elle donne, et l’heureux privilège du croyant est de s’incliner devant les uns comme devant les autres. «Les choses cachées sont à l’Éternel, notre Dieu; et les choses révélées sont à nous et à nos fils, à toujours, afin que nous pratiquions toutes les paroles de cette loi» (Deut. 29:29).
31.1. Structure de la cuve
Tant la cuve que son soubassement étaient entièrement faits d’airain. La signification de ce métal a déjà été expliquée, mais il est peut-être bon de la rappeler. Elle évoque la justice divine mettant l’homme à l’épreuve à la place où il est. Pour cette raison, l’airain se trouve toujours en dehors du tabernacle, tandis que l’or, qui est la justice divine comme répondant à la nature de Dieu, est à l’intérieur, dans le lieu saint aussi bien que dans le lieu très saint. Mais, éprouvant l’homme, cette justice de Dieu le condamne nécessairement, parce qu’il est pécheur; nous verrons ainsi qu’un certain aspect judiciaire y est associé. Un autre élément doit être relevé. La cuve était faite d’un airain de caractère particulier: il provenait des miroirs des femmes qui s’attroupaient à l’entrée de la tente d’assignation (chap. 38:8), des objets mêmes qui révélaient en figure leur condition naturelle, et montraient leur besoin de purification1. Si donc l’airain manifestait et jugeait la condition de ceux qu’il éprouvait, l’eau était là pour laver et purifier. Car l’eau est un symbole de la Parole. C’est ce que nous avons en Jean 3:5 comparé avec Jacques 1:18 et 1 Pierre 1:23-25. Nous le trouvons aussi en Éphésiens 5:26, dans le sens spécial de l’eau de la cuve.
1 Voir Jacques 1:24, 25, où nous avons une illustration instructive de cette vérité.
Nous le verrons toutefois plus clairement lorsque nous considérerons l’usage de la cuve. Elle était pour Aaron et ses fils, afin qu’ils y lavent leurs mains et leurs pieds. «Quand ils entreront dans la tente d’assignation, ils se laveront avec de l’eau, afin qu’ils ne meurent pas», etc. C’était une obligation impérative aussi bien que perpétuelle pour les sacrificateurs que de laver leurs mains et leurs pieds à des occasions spécifiées. Mais avant d’expliquer le caractère de ce lavage, quelques remarques préliminaires éclaireront le lecteur et lui seront profitables.
31.2. Lavés une fois pour toutes
Relevons d’abord que le lavage du corps des sacrificateurs, tel qu’il a eu lieu à leur consécration, n’est jamais répété. Seuls les mains et les pieds doivent être lavés toujours à nouveau dans la cuve. La raison en est évidente. Le lavage du corps tout entier est une figure de la nouvelle naissance et celle-ci ne peut pas être répétée. Le Seigneur a enseigné cela en Jean 13 dans sa réponse à Pierre: «Celui qui a tout le corps lavé (littéralement: baigné, c’est-à-dire lavé entièrement) n’a besoin que de se laver (un autre mot) les pieds; mais il est tout net». Les pieds ou, comme dans le cas des sacrificateurs, les mains et les pieds peuvent être souillés et ont besoin d’être lavés toujours à nouveau, mais le corps jamais, car il a été lavé une fois pour toutes dans l’eau à la nouvelle naissance.
Remarquons en second lieu que la cuve contient de l’eau et non du sang. On a souvent cherché à déduire de cette ordonnance pour les sacrificateurs que le croyant a besoin de l’application répétée du sang de Christ. Une telle pensée est non seulement étrangère à tout l’enseignement de l’Écriture, mais elle tend à diminuer l’efficacité du seul sacrifice de Christ. Elle met en doute la perfection de l’expiation et, par conséquent, le droit de Christ à siéger éternellement à la droite de Dieu. Le sang de Christ est en relation avec la culpabilité, et dès le moment où le pécheur se présente sous son efficacité devant Dieu, il est purifié pour toujours; «car, par une seule offrande, il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui sont sanctifiés». L’Esprit de Dieu, en Hébreux 9 et 10, met l’accent sur cette précieuse et importante vérité. Qu’elle ait été perdue de vue dans la chrétienté en général n’est que trop vrai; toutefois, ce qui doit guider le croyant, ce ne sont pas les enseignements communément reçus chez les hommes, mais l’immuable parole de Dieu. Ainsi quiconque prendra la peine de lire les deux chapitres indiqués — et de les sonder avec le désir sincère de comprendre leur enseignement — verra qu’il n’y est jamais question de l’imputation de la culpabilité au croyant; au contraire celui-ci, une fois qu’il a été lavé par le sang précieux de Christ, est en droit de se réjouir, n’ayant plus aucune conscience de péchés.
31.3. Lavage des mains et des pieds
De quelle nature était le lavage qui avait lieu à la cuve? Comme cela a été dit, il se limitait aux mains et aux pieds. Une comparaison avec Jean 13 fera ressortir une différence. Dans le cas des disciples, seuls les pieds étaient lavés; pour Aaron et ses fils, c’étaient les mains et les pieds. La différence vient du caractère des dispensations. Pour les sacrificateurs, les mains sont indiquées aussi bien que les pieds, parce que leur travail était en question: ils étaient sous la loi. Mais pour les disciples, seuls les pieds sont lavés, car, bien qu’effectué avant que le Seigneur ne les eût quittés, c’était un acte typique de la position présente des croyants, pour qui il ne s’agit pas d’œuvres de loi, mais de marche. Répétons donc que pour les sacrificateurs, le lavage ou l’aspersion avec du sang n’étaient jamais répétés. Ils sont considérés comme nés de nouveau, en figure, et comme étant constamment sous la valeur du sang. Mais ensuite intervient la question des souillures dans leur service et dans leur marche. Et s’il n’y avait pas eu de provision à cet égard, ils auraient été exclus de leurs fonctions sacerdotales dans le sanctuaire; car comment auraient-ils pu se présenter devant Dieu avec des mains et des pieds souillés, entrer dans la présence de Celui dont il est dit: «La sainteté sied à ta maison»? D’où cette miséricordieuse ressource de l’eau, symbole de la Parole, afin que, avant d’entrer dans le lieu saint, ils puissent se nettoyer les mains et les pieds des souillures qu’ils avaient contractées.
31.4. Jésus et ses disciples
Ainsi, compte tenu de la différence de dispensation (telle qu’elle apparaît dans le fait que les mains doivent être lavées), l’enseignement de la cuve correspond tout à fait à celui de Jean 13 où il s’agit de la purification des souillures morales du croyant. Nous y trouvons le Seigneur assis avec ses disciples, et il est dit que «Jésus... ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’à la fin» (v. 1). Ce verset est significatif à deux égards. Il montre premièrement que c’était une affaire qui concernait ceux qui lui appartenaient; et secondement, il révèle le mobile du ministère qu’il allait accomplir: il découlait réellement de son amour inaltérable. «Pendant qu’ils étaient à souper» (non pas «après le souper»), «le diable ayant déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, de le livrer, — Jésus, sachant que le Père lui avait mis toutes choses entre les mains, et qu’il était venu de Dieu, et s’en allait à Dieu, se lève du souper et met de côté ses vêtements; et ayant pris un linge, il s’en ceignit» (v. 2-4). La signification de cet acte était celle-ci: ne pouvant plus rester avec eux, puisqu’il s’en allait à Dieu, il voulait leur montrer comment ils pourraient avoir une part avec lui dans le lieu où il se rendait. Ils avaient été lavés (v. 10); mais au cours de leur passage dans le monde, leurs pieds seraient souillés et ainsi, à moins que comme dans le cas des sacrificateurs il n’y ait une ressource pour leur purification, ils seraient incapables d’avoir une part avec lui (v. 8), en d’autres termes de jouir de la communion avec le Père ou avec son Fils Jésus Christ. Il leur révèle par cet acte symbolique du lavage des pieds comment, par son ministère en leur faveur, il ôterait les souillures qu’ils pourraient contracter. Trois points doivent être relevés dans cet acte. D’abord, le Seigneur ayant mis de côté ses vêtements, figure de son départ de ce monde, prit un linge et s’en ceignit, acte qui exprime son service en faveur des siens. Puis, il versa de l’eau dans un bassin. L’eau est ici aussi un symbole de la Parole. Enfin, il se mit à laver les pieds de ses disciples, c’est-à-dire à appliquer cette Parole à leur conscience afin d’opérer leur purification. Nous comprenons dès lors facilement ce qui répond au lavage des pieds dans le ministère actuel de Christ pour les siens, en fait la vérité présentée par la cuve.
31.5. Un avocat auprès du Père
L’apôtre Jean nous dit que «si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus Christ, le juste» (1 Jean 2:1). Le contexte montre que cela concerne ceux qui ont la vie éternelle, et sont amenés en communion avec le Père et son Fils Jésus Christ. Il est également clair qu’il n’y a aucune nécessité que de tels pèchent: «Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas»; après quoi il ajoute: «Si quelqu’un a péché». L’office d’avocat de Christ auprès du Père est donc au profit des croyants; c’est une provision pour le péché après la conversion, le moyen de Dieu d’enlever les souillures ainsi contractées. Si donc un croyant pèche, il n’est jamais question de l’imputation de la culpabilité, mais sa communion est interrompue; et celle-ci ne peut plus être goûtée jusqu’à ce que le péché soit ôté, pardonné. S’il arrive au croyant de pécher, Christ, comme Avocat, soutient sa cause, intercède pour lui. Nous trouvons dans l’évangile selon Luc une belle illustration de cette intercession: «Et le Seigneur dit: Simon, Simon, voici, Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé; mais moi, j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas» (chap. 22:31, 32). Il en est de même maintenant: aussitôt que le péché est commis — non pas avant — Christ intercède; et la réponse à son intercession, tôt ou tard, est l’application de la Parole par le Saint Esprit à la conscience. Une illustration de ce fait peut être trouvée dans le même évangile. Après que Pierre eut renié son Seigneur malgré l’avertissement de celui-ci, il ne sentit pas son péché, pas même lorsqu’il entendit le coq chanter, jusqu’au moment où le Seigneur le regarda (Luc 22:61). C’est là ce qui atteignit sa conscience et, pour ainsi dire, brisa son cœur, si bien qu’il sortit et pleura amèrement. De même, lorsque le croyant tombe dans le péché, si ce n’était à cause de l’intercession de l’Avocat il ne se repentirait jamais; et en fait, il ne se repent pas avant qu’en réponse à la prière de l’Avocat, la Parole employée par le Saint Esprit, et faisant l’effet du regard du Seigneur sur Pierre, atteigne sa conscience et découvre le caractère de son péché devant Dieu. Il est alors aussitôt amené à se juger lui-même dans l’humiliation et à confesser son péché. Cela conduit à l’étape suivante qui est la dernière. Une fois le péché confessé, il découvre que Dieu «est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité» (1 Jean 1:9); et, restauré dans son âme, il peut de nouveau entrer dans le tabernacle ou, en d’autres termes, jouir à nouveau de la communion avec le Père et avec son Fils Jésus Christ.
31.6. Restauration du croyant
Cette vérité — celle qui concerne la cuve — est de toute importance pour le croyant. Il est essentiel en premier lieu de savoir que nous sommes purifiés une fois pour toutes quant à la culpabilité. Mais ceci étant appris, il est également essentiel de comprendre que si, après la conversion, des péchés ne sont pas confessés ni jugés, nous sommes privés de la communion avec Dieu, disqualifiés pour le service sacerdotal et le culte; et non seulement cela, mais si nous restons dans cet état, tôt ou tard Dieu s’occupera de nous, en réponse à l’intercession de Christ, pour nous rappeler nos péchés.
L’office d’avocat de Christ vient donc au-devant des besoins du croyant; il est, pour ainsi dire, la ressource miséricordieuse de Dieu pour nos péchés, pour ôter nos souillures, afin que nous puissions entrer avec une pleine liberté, sans entrave, dans la présence immédiate de Dieu pour l’adoration et la louange. Remarquons bien qu’Aaron et ses fils devaient se laver à la cuve chaque fois qu’ils entraient dans le tabernacle. Cela nous enseigne que nous avons à nous juger nous-même continuellement. Combien souvent la négligence à cet égard nous est en obstacle dans la prière, l’adoration et le service. Si nous avons commis une faute et que nous ne l’avons pas rappelée ni portée dans la présence de Dieu pour la confesser et nous en humilier, nous sommes, à notre insu peut-être, entrés dans le tabernacle avec des pieds souillés et nous avons été amenés à réaliser notre froideur et notre gêne, notre incapacité à occuper notre position sacerdotale. Puissions-nous donc ne jamais oublier l’usage de la cuve, c’est-à-dire notre besoin constant d’avoir les pieds lavés par le ministère d’amour de notre Avocat auprès du Père!
Chapitre 30, versets 22 à 38
32. Exode 30:22-38 — L’huile de l’onction sainte et l’encens composé
Le tabernacle et ses symboles sacrés ont maintenant tous été examinés. Il ne manque plus que deux éléments: l’huile de l’onction sainte et les drogues odoriférantes.
32.1. L’huile sainte
Ch. 30:22-38 — L’huile de l’onction sainte vient en premier lieu. Elle était composée, selon les instructions divines, de myrrhe, de cinnamome, de roseau aromatique et de casse, dans leurs proportions, mélangés avec un hin d’huile d’olive (v. 23, 24). Le psalmiste, parlant du Messie, écrit: «Tous tes vêtements sont myrrhe, aloès, et casse», et dans le verset précédent: «Dieu, ton Dieu, t’a oint d’une huile de joie au-dessus de tes compagnons» (Ps. 45:7, 8). Ce passage nous aide à comprendre la signification typique de l’huile de l’onction sainte.
Les drogues, ensuite, parlent des grâces de Christ. Ses vêtements mêmes exhalent ces doux parfums. Mais elles étaient mélangées avec de l’huile, image du Saint Esprit. En joignant ces deux éléments, nous apprenons que les grâces de Christ, le parfum moral de ses perfections, s’exprimaient dans la puissance du Saint Esprit.
L’huile de l’onction sainte était employée pour oindre le tabernacle, l’arche, les saints ustensiles, les sacrificateurs, etc. (v. 26-30). D’abord, le tabernacle était oint. C’est d’une grande importance. Car si nous considérons le tabernacle comme étant la maison de Dieu, la scène de Sa manifestation et le lieu du service sacerdotal et de l’adoration, le fait que tout était oint d’huile sainte enseigne que tout ce qui est lié à la maison de Dieu, à son ordonnance et à son service, tout l’office sacerdotal qui y était effectué doit être accompli dans la puissance du Saint Esprit (voir 1 Pierre 2:5). S’il en est ainsi, le parfum d’agréable odeur de Christ montera vers Dieu. Car certes c’est dans la puissance de l’Esprit que Dieu se révèle et c’est dans la puissance de l’Esprit seulement que l’adoration peut être rendue et le service accompli. Si donc tout ce qui était en rapport avec la maison de Dieu était arrangé selon sa propre Parole, mais que l’huile de l’onction sainte — la puissance du Saint Esprit — manquait, cela ne pouvait lui être agréable. Remarquez aussi l’effet: tout est sanctifié, tout devient «très saint» par l’onction, de sorte que tout ce qui touche un objet sur lequel l’huile a été mise devait également être considéré comme saint (v. 29). C’est là l’effet de l’action de l’Esprit de Dieu. Tout ce sur quoi sa puissance repose est mis à part pour Dieu et tout ce qui vient sous son action est aussi revendiqué comme saint. Toute la sphère de son action est sanctifiée (voir 1 Cor. 7:14).
32.2. Usage de l’huile
Aaron et ses fils étaient également oints. La signification de cet acte a été donnée en rapport avec la consécration des sacrificateurs. Mais il existe une raison particulière pour qu’il en soit parlé en relation avec le tabernacle. C’est pour indiquer et insister sur le fait que la qualification essentielle pour le service sacerdotal est l’onction et la puissance du Saint Esprit. Toutes les autres qualifications peuvent être réunies: le fait d’être nés de nouveau, d’être revêtus et placés sous la valeur du sang; mais s’il n’y a pas l’onction du Saint Esprit, la position sacerdotale ne peut être véritablement occupée. Du Seigneur lui-même il est dit qu’il a été oint de l’Esprit Saint et de puissance (Actes 10:38), et tous ceux qui lui appartiennent doivent l’être également pour pouvoir jouir des privilèges dans lesquels ils ont été introduits. La leçon est nécessaire dans des jours d’activité incessante et de service légal généralisé. Souvenons-nous toujours que, bien qu’enfants de Dieu, nous ne pouvons ni adorer ni servir, si ce n’est par la puissance et l’action présentes du Saint Esprit (voir Jean 4:24; Phil. 3:3).
Suivent deux mises en garde. D’abord: «On n’en versera pas sur la chair de l’homme» (v. 32). En d’autres termes l’Esprit de Dieu ne peut ni reposer ni demeurer dans l’homme naturel. Il va de soi que le don du Saint Esprit ne peut en aucun cas être reçu avant la nouvelle naissance et l’assurance du pardon des péchés. Lorsque nous sommes justifiés par la foi et que nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, nous sommes à la fois oints et scellés (voir Rom. 5:1-5; 2 Cor. 1:21, 22).
En second lieu, aucune imitation de cette huile de l’onction ne devait être faite, sous peine de mort (v. 33). Ainsi, c’est un péché terrible que d’imiter l’action de l’Esprit. Ananias et Sapphira le firent lorsqu’ils professèrent consacrer tout le prix de la terre qu’ils avaient vendue au service du Seigneur (Actes 5). Le même châtiment, remarquons-le, était attaché au fait de mettre de cette huile sur un étranger, sur ceux qui n’y avaient aucun droit. Dieu est saint; il veille jalousement sur ses droits souverains et il ne peut que visiter par le châtiment toute atteinte à ceux-ci. Si maintenant il paraît passer sur de tels péchés sans y prendre garde, cela tient au caractère de la dispensation actuelle, une dispensation de grâce; mais les péchés eux-mêmes n’en sont pas moins devant ses yeux.
32.3. L’encens composé
Les drogues odoriférantes étaient aussi mélangées en un parfum, par une directive divine et elles parlent, comme dans le cas précédent, des grâces de Christ, ce parfum moral montant à Dieu. Il ressort du chapitre 25:6 comparé avec le chapitre 35:8, que ces drogues composaient l’encens qui était brûlé sur l’autel d’or. La précision qu’il devait être mis «sur le devant du témoignage dans la tente d’assignation, où je me rencontrerai avec toi» (v. 36) l’indique aussi. Remarquons enfin que, de même que le parfum de l’encens était activé par le feu de l’autel, l’exposition de Christ au jugement de la sainteté de Dieu (le feu) sur la croix, alors qu’il était fait péché, a seulement fait ressortir tout ce qu’il y avait de plus précieux à Ses yeux. Jamais ses perfections n’ont été plus pleinement manifestées que lorsqu’il prouva son obéissance extrême, à la place même du péché. Aussi pouvait-il dire: «À cause de ceci le Père m’aime, c’est que moi je laisse ma vie, afin que je la reprenne». C’était pour la gloire de Dieu qu’il passa à travers le feu du jugement et en le faisant, toutes les «drogues odoriférantes» de ses grâces morales et la perfection de son entier dévouement furent manifestées et montèrent comme un parfum agréable devant Dieu. Pour cette raison — à cause du prix de sa signification typique — l’encens devait être pilé très fin (car plus il était pilé, plus son parfum s’exhalait) et être mis sur le devant du témoignage dans la tente d’assignation, où l’Éternel se rencontrait avec Moïse. Moïse, en tant que médiateur, serait ainsi devant Dieu dans toute l’acceptation de ce saint parfum; Dieu pourrait alors le rencontrer en grâce et lui communiquer ses pensées et sa volonté pour son peuple.
Remarquons également en rapport avec l’encens, un avertissement et un châtiment. Il ne devait point en être fait de semblable. Cet encens était «saint», «consacré à l’Éternel». Par conséquent, quiconque en ferait de semblable pour le flairer serait retranché de ses peuples (v. 38). La contrefaçon humaine des grâces de Christ ainsi que le fait d’y trouver de la satisfaction sont deux choses inacceptables devant Dieu. De même que le Seigneur, nous l’avons vu, proscrit toute imitation de l’action ou de la puissance du Saint Esprit, il met ici en garde contre toute imitation charnelle des vertus morales de Christ. L’homme ne peut faire ni l’un ni l’autre, quelles que soient ses prétentions. La subtilité de nos cœurs est toutefois telle que souvent nous nous trompons nous-mêmes et nous trompons les autres en prenant par exemple les douceurs de la nature, sa grâce et son amabilité pour l’œuvre du Saint Esprit. Il ne peut y avoir aucune ressemblance à Christ si ce n’est comme résultat de l’œuvre du Saint Esprit; et le Saint Esprit, nous l’avons vu, est le don de Dieu. Ce serait donc de l’hypocrisie de la pire espèce de vouloir faire passer quelques qualités naturelles, quelques grâces humaines, résultats de l’éducation ou de la culture, comme ce qui a été produit par le Saint Esprit. Rien ne peut plaire à Dieu et rien ne devrait nous plaire sinon ce qui a été opéré par son Esprit, pour la gloire de Christ.
A suivre
Chapitre 31, versets 1 à 17
33. Exode 31 — Qualifications pour le service
Maintenant que tous les détails concernant le tabernacle ont été donnés, il ne manque plus qu’une chose: les dispositions nécessaires à l’exécution des différents commandements que Moïse a reçus. Tout procède de l’Éternel, car tout doit découler de la grâce.
33.1. Betsaleël et Oholiab
Ch. 31:1-11
Nous pouvons retirer deux enseignements de ces versets. Premièrement, que Dieu seul peut désigner ses serviteurs pour leur travail; et secondement, que lui seul peut les qualifier pour le service auquel ils sont appelés. Ces deux points méritent une attention spéciale. On remarquera que l’Éternel appelle «par nom» tant Betsaleël qu’Oholiab. Ils ont été distingués par nom et appelés. Ce principe se retrouve à travers toutes les dispensations. L’apôtre s’y réfère lorsqu’il parle de la sacrificature de Christ. Il dit: «De même le Christ aussi ne s’est pas glorifié lui-même pour être fait souverain sacrificateur, mais celui-là l’a glorifié qui lui a dit: «Tu es mon Fils; moi je t’ai aujourd’hui engendré»; comme il dit aussi dans un autre passage: «Tu es sacrificateur pour l’éternité selon l’ordre de Melchisédec» (Héb. 5:5, 6). Et quand il parle de lui-même, il se nomme: «apôtre... par la volonté de Dieu» (1 Cor. 1:1; 2 Cor. 1:1). C’est un point très important; car s’introduire dans le service de Dieu sans être appelé ni envoyé serait la pire des présomptions. Il est vrai que, dans la dispensation actuelle, Dieu n’appelle pas ses serviteurs par nom, du moins depuis les jours de l’apôtre Paul; mais tout serviteur devrait s’assurer qu’il est vrai-ment appelé par Dieu pour son service, avoir la certitude absolue qu’il accomplit la volonté de Dieu, quelle que soit l’activité dans laquelle il est engagé. Une telle conviction est la source à la fois de la confiance et du courage. L’Éternel s’adresse à Josué en ces termes: «Ne t’ai-je pas commandé: Fortifie-toi et sois ferme? Ne te laisse point terrifier, et ne sois point effrayé; car l’Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras» (Josué 1:9). Le secret de tout service est en fait dans l’obéissance; car si je ne fais pas la volonté de Dieu, ce n’est pas là le servir. Le Seigneur lui-même qualifiait d’obéissance toute sa vie de service. Il pouvait dire: «Je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé» (Jean 6:38). Par conséquent, notre premier souci devrait être de nous assurer que nous avons été envoyé par le Seigneur, que nous avons été appelé à travailler et à servir, comme Betsaleël et Oholiab; si nous prenons le temps de nous asseoir aux pieds du Seigneur, sa pensée à cet égard nous sera révélée.
33.2. Remplis de l’esprit de Dieu
Mais le second enseignement, c’est qu’ayant été appelés par nom, ils furent remplis de l’Esprit de Dieu, et rendus dépendants de l’Éternel pour la sagesse et l’intelligence nécessaires à l’exécution du travail confié à leurs soins. La sagesse de l’homme n’a aucune valeur dans le service pour Dieu. «La folie de Dieu est plus sage que les hommes, et... la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes» (1 Cor. 1:25). L’apôtre Paul dira: «Si quelqu’un parmi vous a l’air d’être sage dans ce siècle, qu’il devienne fou, afin de devenir sage». Voilà pourquoi certains intellectuels, des hommes qui s’appuient sur leur propre intelligence, ne manifestent souvent rien d’autre que de la folie lorsqu’ils s’occupent des choses divines. Toutefois ce sont les serviteurs de Dieu qui ont le plus besoin de se souvenir de cette vérité. Ne sont-ils pas bien souvent tentés de ne faire appel qu’à leur seule intelligence pour expliquer les Écritures ou pour régler les difficultés dans l’Église de Dieu, et cela à leur propre confusion? S’ils gardaient en mémoire qu’il ne peut y avoir ni connaissance ni sagesse en dehors de Dieu, aucune intelligence à moins qu’elle ne soit reçue de lui, ils seraient gardés dans une dépendance constante, seule condition pour en être pourvu. Il en résulterait sans doute davantage de patience dans l’attente de la volonté de Dieu, et moins d’activité, celle-ci n’intervenant que lorsque le commandement d’agir a été donné. Oui, attente jusqu’à ce que la sagesse nécessaire à l’exécution du service soit accordée. On peut encore ajouter que la preuve de la sagesse divine dans le service est que la chose accomplie est selon la parole de Dieu.
«Ils feront selon tout ce que je t’ai commandé». La Parole est à la fois le guide du serviteur et le test de son service. Il devra s’assurer que ce qu’il fait et la manière dont il le fait sont conformes à la pensée de Dieu. Rien n’était laissé à la discrétion de Betsaleël ou d’Oholiab. Les objets à créer et les matériaux qui devaient être travaillés n’étaient pas répartis en deux classes: ceux qui étaient essentiels et ceux qui étaient secondaires. Rien, pas le moindre détail n’était laissé à leurs propres pensées ou à leur imagination. D’un autre côté, rien non plus ne dépendait de leur propre sagesse. Tout devait être fait selon les commandements donnés à Moïse. Betsaleël n’était pas libre de travailler selon un modèle et Oholiab selon un autre; ils étaient tous les deux liés jusque dans les plus petits détails par les directives de l’Éternel. Ce fait mérite une attention particulière aujourd’hui où même des chrétiens revendiquent la liberté pour chacun de faire selon ce qui est juste à ses propres yeux. La multiplicité des sectes et des dénominations chrétiennes suffit à montrer qu’elles ont été formées non par des Betsaleël ou des Oholiab, mais par des hommes qui n’ont reçu aucune mission divine, et n’ont pas été remplis de l’esprit de sagesse et d’intelligence. Ils ne passeront pas le test de la parole de Dieu, et doivent par conséquent être disqualifiés aux yeux de tous ceux pour qui «écouter est meilleur que sacrifice, prêter l’oreille, meilleur que la graisse des béliers» (1 Sam. 15:22). C’est donc dans cette direction qu’un retour doit commencer, là où tout est en ruine, où tout porte la marque du déclin et du non-respect de la parole de Dieu. Nous devons d’abord refuser tout ce qui ne soutiendra pas le test divin, et ensuite, malgré notre faiblesse, chercher à agir en toutes choses selon la pensée et la volonté de Dieu.
33.3. De nouveau le sabbat
Ch 31: 12-17
Une fois de plus le sabbat est ordonné. Quelqu’un a dit: «Le sabbat est mentionné chaque fois qu’un principe quelconque de relation entre le peuple et Dieu est établi: le but proposé dans toute relation entre Dieu et son peuple, c’est qu’ils entrent dans son repos». Nous avons déjà expliqué la signification du sabbat, mais il convient de relever comment le cœur de Dieu est révélé par le rejet continuel de son injonction. Il connaissait son peuple et savait que, placé sous la responsabilité, il faillirait toujours; dans ce sens, le résultat ne l’a jamais pris de court. D’un autre côté, l’adjonction du sabbat chaque fois qu’il est question de relation entre lui-même et le peuple montre son désir ardent (si cette expression nous est permise) que son peuple entre dans la réalisation de ses propos à leur égard et jouisse d’une communion bénie avec lui, dans son repos. Le sabbat est l’expression du repos de Dieu, et c’était là le but que Dieu plaçait devant son peuple. Nous savons qu’ils n’y entrèrent jamais; le chapitre 4 de l’épître aux Hébreux l’établit clairement. Mais les plans de Dieu se réalisent infailliblement; par conséquent ce qui est perdu sous la responsabilité sera établi finalement selon ses propres conseils de grâce. Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu; et tous ceux qui croient entreront dans ce repos, l’objet et le résultat de tous les conseils et de toutes les voies de Dieu à l’égard de son peuple. Ainsi nous sommes, nous les croyants de la dispensation actuelle, comme les enfants d’Israël, des pèlerins dans le désert, en marche vers le repos dont Dieu a parlé; mais sous la conduite du Chef de notre salut nous y entrerons certainement.
33.4. Don des deux tables
Ce chapitre et cette section du livre se termine par le récit du don des deux tables du témoignage. «Et lorsqu’il eut achevé de parler avec Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu» (v. 18). Souvenons-nous que toutes les instructions à partir du chapitre 24 et jusqu’ici ont été données sur la montagne. Moïse avait été seul avec Dieu. L’Éternel avait parlé avec lui, lui révélant sa pensée pour le peuple. Lorsqu’il eut terminé, il lui donna les deux tables de pierre, avec les termes de l’alliance qu’il avait faite avec son peuple. Moïse le mentionne ailleurs. Il dit: «L’Éternel me donna les deux tables de pierre, écrites du doigt de Dieu; et sur elles étaient écrites toutes les paroles que l’Éternel vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de la congrégation; et il arriva, au bout de quarante jours et de quarante nuits, que l’Éternel me donna les deux tables de pierre, les tables de l’alliance» (Deut. 9:10, 11).
Les deux tables contenaient donc les dix «paroles» ou commandements rapportés au chapitre 20, mais écrits maintenant du doigt de Dieu, les commandements qu’Israël s’engagea à garder comme condition de sa bénédiction. Ils abandonnèrent le terrain de la grâce sur lequel ils avaient été placés après la traversée de la mer Rouge et d’eux-mêmes, pour leur compte, sur la proposition de Dieu, se mirent sous la responsabilité de l’obéissance. Moïse avait été quarante jours et quarante nuits sur la montagne, sans manger et sans boire (voir Deut. 9:9), dans un état pour ainsi dire surnaturel, afin de pouvoir devenir le canal des communications de Dieu pour son peuple. La chair ne doit pas avoir de place; elle doit être mise de côté, comme aussi en quelque sorte la nature, si nous voulons écouter la voix de Dieu. Le cas d’Élie (1 Rois 19:8), et celui du Seigneur également, qui tous les deux, comme Moïse, jeûnèrent quarante jours et quarante nuits, nous viennent tout de suite à la mémoire. Mais comme un autre l’a remarqué, le Seigneur Jésus «doit avoir la prééminence en toutes choses. Moïse, par nature éloigné de Dieu, sort de l’état naturel pour s’approcher de Lui. Christ, qui était naturellement près de Dieu et bien plus que près passe quarante jours dans un état hors de nature pour avoir affaire à l’adversaire, dans l’intérêt de l’homme»1. Ce contraste est très significatif; il montre clairement que le serviteur de Dieu le plus dévoué ne peut être davantage qu’une ombre (un type, même par contraste) de la perfection de Christ. (Comparer également le cas de l’apôtre Jean en Apocalypse 1:10).
1 Études sur la Parole de Dieu, par J.N. Darby.
A suivre
Chapitre 32, versets 1 à 10
34. Exode 32 à 34 — Apostasie, médiation et restauration
Occupé de la bénédiction de son peuple, l’Éternel donnait des instructions pour la construction de son sanctuaire, afin de pouvoir demeurer au milieu de lui. Moïse était sur la montagne pour recevoir ces communications de Sa grâce. L’Éternel «parlait» avec son serviteur de ce qui matérialisait pour ainsi dire la relation dans laquelle il était entré avec Israël. Mais alors même qu’Il était occupé à cela, le péché et même l’apostasie avaient envahi le camp au pied du Sinaï. En haut, tout est lumière et bénédiction; en bas, tout est ténèbres et mal.
34.1. Au pied de la montagne
Ch. 32:1-6 — On peut remarquer une certaine ressemblance entre cette scène et celle qui se déroulera au pied de la montagne de la transfiguration. Dans les deux, Satan exerce ses pleins pouvoirs. Dans le passage qui nous occupe, c’est la nation qui est tombée sous sa puissance, dans l’autre, c’est un enfant dont il a pris possession; mais là encore, l’enfant est un type de la nation juive d’un jour à venir. L’absence ici-bas de Christ (présentée en figure également par Moïse sur le Sinaï) est l’occasion dont se sert Satan, avec la permission de Dieu, pour déployer sa puissance de méchanceté, et l’homme (Israël) dans la perversité de son cœur devient son misérable esclave. Mais remarquons que Satan, malgré toute son activité, ne prend jamais Dieu au dépourvu. Il peut chercher à s’opposer aux desseins de Dieu, et il peut sembler y parvenir en en retardant l’accomplissement, mais jamais il ne peut annuler Ses conseils. Ainsi, dans la scène placée devant nous, l’Éternel avait achevé de parler avec Moïse (chap. 31:18), et lui avait pleinement révélé sa volonté, avant que le peuple tombe dans le péché. Ce principe se retrouve tout au long des Écritures. Ne connaissant rien à l’avance, Satan est toujours en retard d’un jour; de sorte que s’il paraît remporter une victoire momentanée, ce n’est que pour s’exposer finalement à une défaite plus écrasante. Quel encouragement pour le cœur des croyants qui attendent le moment tout proche où le Dieu de paix brisera Satan sous leurs pieds! (Rom. 16:20).
34.2. Le veau d’or
La conduite du peuple n’est rien d’autre que de l’apostasie ouverte. Nous en relèverons brièvement les divers caractères. Premièrement, les enfants d’Israël oublient et abandonnent l’Éternel. Deuxièmement, ils attribuent à Moïse leur délivrance hors d’Égypte; ils le décrivent comme «cet homme qui nous a fait monter du pays d’Égypte». Enfin, ils tombent dans l’idolâtrie. Ils voulaient des dieux visibles, prouvant par là qu’ils n’avaient pas la foi. Aaron tomba avec eux, apparemment sans résistance. Celui qui avait été désigné pour remplir l’office sacerdotal celui qui devait avoir le privilège d’entrer dans le lieu très saint pour servir devant l’Éternel, devint l’instrument, sinon le chef, de leur terrible rébellion. Le sacrificateur et le peuple acceptent ensemble la triste inspiration de Satan et adorent les dieux qu’ils ont faits de leurs propres mains. Ils disent en leur rendant culte: «C’est ici ton dieu, ô Israël! qui t’a fait monter du pays d’Égypte». On remarquera encore qu’Aaron cherche à dissimuler la honte de leur idolâtrie en y liant le nom de l’Éternel. Il bâtit un autel, et crie et dit: «Demain, une fête à l’Éternel!» C’est exactement ce qu’a fait une chrétienté apostate. Elle a dressé ses idoles, et elle prétend adorer l’Éternel; les âmes sont ainsi trompées et entraînées à accepter ce qui en fait est une abomination devant Dieu. Qu’était ce veau d’or? Simplement un symbole de l’Éternel, aurait dit Aaron. C’est ce qu’affirme une grande partie de la chrétienté, légitimant ainsi son idolâtrie en la parant du nom de Christ et de christianisme. Cette scène, image d’une part du dernier état des Juifs qui sera pire que le premier, est donc, d’autre part, tout aussi instructive pour le jour actuel. En fait Israël rejetait l’Éternel et son serviteur Moïse. Le peuple devenait apostat, et «apostasie» est l’unique mot qui exprime la vraie condition de la chrétienté moderne, cette chrétienté qui, tout en se réclamant du nom de Christ, rejette l’autorité de Celui qui est assis à la droite de Dieu.
Il n’est pas étonnant que la colère de l’Éternel se soit embrasée contre son peuple.
34.3. La colère de l’Éternel
Ch. 32:7-10 — Les Israélites s’étaient exposés au juste jugement de Dieu. Ils s’étaient volontairement engagés à obéir à la loi de Dieu comme condition de la bénédiction; et l’alliance avait été scellée par l’aspersion du sang, emblème de la mort comme châtiment en cas de transgression. Ils encouraient maintenant ce châtiment. Par conséquent Dieu ne les traite plus comme son peuple. Ils l’avaient rejeté et avaient parlé de Moïse comme cet homme qui les avait fait monter d’Égypte; et l’Éternel les prend sur leur propre terrain. Aussi dit-il à Moïse: «Ton peuple, que tu as fait monter du pays d’Égypte, s’est corrompu...» (v. 7). Puis après avoir décrit leur péché, il annonce son jugement solennel: «J’ai vu ce peuple, et voici, c’est un peuple de cou roide. Et maintenant laisse-moi faire, afin que ma colère s’embrase contre eux, et que je les consume; et je ferai de toi une grande nation» (v. 9, 10). Si donc les Israélites étaient traités selon les justes exigences de la loi qu’ils avaient acceptée et à laquelle ils s’étaient engagés à obéir comme condition de la bénédiction, ils étaient perdus, sans espoir de retour, et devaient périr à cause de leur péché et de leur apostasie délibérés.
La déclaration de l’Éternel fait monter du cœur de Moïse une intercession d’une beauté et d’une force sans précédent. L’Éternel avait dit: «Je ferai de toi une grande nation»; mais dans son amour merveilleux pour son peuple, s’oubliant lui-même et ignorant complètement ce qu’on pourrait appeler ses propres intérêts, il ne pense qu’à la gloire de l’Éternel et à la misère d’Israël. Par grâce il lui est accordé de prendre la vraie place de médiateur; et il épanche son âme dans sa fervente intercession. Le caractère de sa supplication est très remarquable. Il ne cherche pas un seul instant à atténuer le péché du peuple: il ne pouvait pas le faire; il ne fait pas non plus appel à la grâce, car il n’y avait pas place pour la grâce dans l’alliance de Sinaï.
34.4. Un argument irrésistible
Il se rejette alors sur Dieu, et sur ce que sa gloire réclamait en relation avec le peuple qu’il avait racheté. D’abord il évoque le déshonneur qui serait porté à Son nom parmi les Égyptiens, si Israël devait être détruit. Il rappelle à l’Éternel le lien établi avec son peuple par la rédemption. Dieu avait dit à Moïse: «ton» peuple; mais Moïse lui répond qu’ils sont «Son» peuple. Il ne veut pas accepter la rupture du lien, mais il s’écrie: «Pourquoi, ô Éternel, ta colère s’embraserait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Égypte, avec grande puissance et à main forte? Pourquoi les Égyptiens parleraient-ils, disant: C’est pour leur mal qu’il les a fait sortir?...» (v. 11, 12). Malgré leur triste apostasie, Moïse soutient qu’ils demeurent le peuple de Dieu et que Sa gloire est engagée dans leur maintien, sinon l’ennemi se vanterait de les avoir détruits et se glorifierait à l’encontre de l’Éternel lui-même. C’était en soi un argument d’une puissance irrésistible. Josué en utilise un de caractère assez semblable lorsque les Israélites furent battus devant Aï. Il dit: «Le Cananéen et tous les habitants du pays l’entendront, et nous envelopperont, et ils retrancheront notre nom de dessus la terre; et que feras-tu pour ton grand nom?» (Josué 7:9).
34.5. Référence aux promesses
Dans les deux cas, c’était la foi s’accrochant à Dieu, s’identifiant à Sa propre gloire, et réclamant sur cette base l’exaucement de ses désirs: c’est une supplication que Dieu ne rejettera jamais. Mais Moïse va plus loin. Dans l’ardeur de son intercession, fruit certain de l’action de l’Esprit de Dieu, il remonte aux promesses absolues et inconditionnelles faites à Abraham, à Isaac et à Jacob, rappelant à l’Éternel les deux choses immuables, dans lesquelles il était impossible qu’il mentît (Héb. 6:18). On ne saurait trouver dans les Écritures un plus bel exemple d’intercession. En fait, dans la situation critique du moment, tout dépendait du médiateur; et dans sa grâce, Dieu avait permis qu’il s’en trouve un qui puisse se tenir à la brèche et soutenir la cause de son peuple. Moïse intercède non pas sur le fondement de ce qu’ils étaient, car par leur péché ils s’étaient exposés à la juste indignation d’un Dieu saint, mais en vertu de ce que Dieu était et sur le terrain de ses conseils révélés et confirmés aux patriarches, tant par serment que par promesse. L’Éternel écouta et «se repentit du mal qu’il avait dit qu’il ferait à son peuple». Quel encouragement pour la foi! S’il y a jamais eu une occasion où il paraissait impossible que la prière puisse être exaucée, c’était bien celle-ci; mais par la foi, Moïse s’éleva au-dessus de toutes les difficultés; saisissant la main de l’Éternel, il réclama son secours; et parce que Dieu ne pouvait pas se renier lui-même, la prière de Moïse fut exaucée. Oui, «la fervente supplication du juste peut beaucoup» (Jacq. 5:16).
A suivre
Chapitre 32, versets 15 à 29
34.6. Les tables sont brisées
Ch. 32:15-24 — L’alliance de Sinaï avait été irrémédiablement rompue. Moïse prend pourtant avec lui les deux tables de pierre lorsqu’il quitte la présence de l’Éternel pour redescendre dans le camp; et l’Esprit de Dieu se sert de cette circonstance pour attirer l’attention sur leur caractère divin et parfait. «Les tables étaient l’ouvrage de Dieu, et l’écriture était l’écriture de Dieu, gravée sur les tables» (v. 16). Tout était divin, divin dans son origine et divin dans son exécution. Mais ces divines tables de la loi ne parvinrent jamais dans le camp. C’était impossible. Le peuple avait provoqué une rupture totale entre lui-même et Dieu; et il ne pouvait plus dès lors être question d’obéissance sur le terrain de la loi pure. Ils pourraient être les objets de la grâce en réponse à l’intercession, mais en transgresseurs manifestes, ils avaient rompu l’alliance qu’ils avaient conclue avec tant d’empressement et étaient maintenant devenus des idolâtres.
Josué attribue à la guerre le bruit qu’il a entendu au camp; mais Moïse qui s’est tenu si longuement dans la présence de l’Éternel, discerne plus rapidement le véritable caractère des cris qui atteignent leurs oreilles. «Et il arriva que, lorsque Moïse s’approcha du camp, il vit le veau et les danses; et la colère de Moïse s’embrasa, et il jeta de ses mains les tables, et les brisa au pied de la montagne». Remarquons la pleine communion de Moïse avec la pensée de l’Éternel à l’égard de son peuple. La colère de l’Éternel s’était embrasée contre eux et bien que Moïse, comme médiateur, ait intercédé en leur faveur, sa propre colère s’embrasa lorsqu’il descendit et vit le veau d’or. En brisant les tables de la loi, il ne faisait donc que donner expression à ce qui s’imposait à cause de ce que le peuple avait fait de la loi et, en même temps, cet acte était en parfait accord avec la pensée de Dieu.
Pour reprendre le langage d’un autre: «Son oreille exercée, et prompte à discerner les dispositions morales du peuple, perçoit sa joie profane et légère. Peu après, il voit le veau d’or, qui avait été élevé dans le camp avant même le tabernacle de Dieu, et, mû d’une sainte indignation, il brise les tables au pied de la montagne... Naguère, il avait été zélé pour le peuple auprès de Dieu, par dévouement à sa gloire... le même sentiment le porte maintenant à être zélé pour Dieu auprès du peuple. Car la foi voit au-delà du fait que Dieu est glorieux, chose que chacun reconnaît. La foi voit le peuple de Dieu lié à la gloire de Dieu lui-même; dès lors, elle compte toujours sur Dieu pour la bénédiction de son peuple, car cette bénédiction est dans l’intérêt de sa propre gloire; et elle insiste sur sa sainteté, coûte que coûte, conformément à cette gloire, afin que celle-ci ne soit pas foulée aux pieds parmi ceux qui sont identifiés avec elle»1. Paroles vraies et solennelles, qui devraient s’ancrer profondément dans le cœur du peuple de Dieu dans un jour comme celui dans lequel nous vivons — où le «camp» de la chrétienté professante offre un aspect semblable à celui que Moïse découvrit lorsqu’il descendit de la montagne; paroles qui devraient être méditées par ceux d’entre les serviteurs du Seigneur qui sont appelés à agir pour Lui dans les difficultés, et en fait par tous ceux qui s’identifient d’un cœur vrai aux intérêts de Christ dans l’église. Car si nous ne sommes pas d’abord zélés devant Dieu en faveur de son peuple, nous ne pouvons pas être zélés pour sa gloire lorsque nous nous occupons de son peuple en bas.
1 Études sur la Parole de Dieu, par J.N. Darby.
34.7. Culpabilité d’Aaron
Moïse se tourne ensuite vers Aaron et l’accuse d’avoir fait venir un si grand péché sur le peuple. Un détail supplémentaire, mentionné dans le Deutéronome, nous sera en aide à cet égard. Moïse dit: «Et l’Éternel fut fort irrité contre Aaron, pour le détruire; et j’intercédai aussi pour Aaron, en ce temps-là» (Deut. 9:20). Aaron était bien évidemment considéré comme le chef responsable du peuple pendant l’absence de Moïse, d’où la culpabilité spéciale dont il est chargé; et le récit montre clairement qu’il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour accéder aux désirs du peuple. Tant Israël qu’Aaron sont épargnés des conséquences gouvernementales de leur péché par l’intercession de Moïse, mais la culpabilité de leur péché à l’égard de Dieu demeurait. Cette distinction doit être bien comprise, sinon le jugement exécuté par la suite pourrait paraître en contradiction avec la déclaration que «l’Éternel se repentit du mal qu’il avait dit qu’il ferait à son peuple».
Sans l’intercession de Moïse, le peuple aurait été détruit, comme résultat du gouvernement de Dieu sur la base de la loi du Sinaï. Si le peuple était délivré de cette conséquence, Dieu demeurait libre de s’occuper d’eux; nous lisons, à la fin du chapitre, que «l’Éternel frappa le peuple, parce qu’ils avaient fait le veau qu’Aaron avait fait». Aaron est distingué d’eux dans ces paroles; car vu la position qu’il occupait, il est considéré comme particulièrement coupable. Sa réponse à Moïse découvre le cœur d’un pécheur coupable. De même qu’Adam avait rejeté le blâme sur Ève, et Ève sur le serpent, Aaron se réfugie derrière le peuple. Il était exact que celui-ci était «plongé dans le mal»; mais son péché à lui était de les avoir aidés à parvenir à leurs fins. Il aurait dû préférer mourir plutôt que de céder à leurs désirs. Sa faiblesse, souvent montrée, malgré la faveur et la grâce de l’Éternel, a été sa honte et sa faute.
34.8. Quiconque est pour l’Éternel !
Voyant que «le peuple était dans le désordre; car Aaron l’avait livré au désordre, pour leur honte parmi leurs adversaires», Moïse rejette les excuses de son frère et, animé d’un saint zèle pour l’Éternel, se tient à la porte du camp et crie: «À moi, quiconque est pour l’Éternel!» Ce n’était pas le moment de cacher le mal ou de faire des compromis. En présence de l’apostasie ouverte, il ne peut y avoir de neutralité. Lorsque le débat est entre Dieu et Satan, la neutralité est elle-même de l’apostasie. Celui qui n’est pas avec l’Éternel dans un tel moment, est contre lui. Et remarquons en outre, que ce cri est lancé au milieu de ceux qui professaient être le peuple de l’Éternel. Ils étaient tous des Israélites. Mais maintenant il devait y avoir une séparation, et le défi de Moïse: «Quiconque est pour l’Éternel!» clarifie tout. Il fait de l’Éternel le centre; aussi se rassembler autour de Lui, c’était être pour l’Éternel; refuser de répondre, c’était être contre Lui.
Quel fut l’effet de cet appel? Eh bien! que, de toutes les tribus d’Israël, Lévi seul fut trouvé fidèle. «Tous les fils de Lévi se rassemblèrent vers lui». Ils eurent l’insigne honneur, par la grâce de Dieu, d’être du côté de l’Éternel alors que tout le camp était en pleine rébellion. Combien la fidélité de Lévi a dû être précieuse aux yeux de l’Éternel! Il semblerait en fait, si nous nous référons au livre du Deutéronome, que c’est en relation avec leur conduite dans ce moment que l’Éternel les choisit pour le service particulier du tabernacle. Moïse dit: «En ce temps-là, l’Éternel sépara la tribu de Lévi pour porter l’arche de l’alliance de l’Éternel, pour se tenir devant l’Éternel, pour faire son service, et pour bénir en son nom, jusqu’à ce jour. C’est pourquoi Lévi n’a point de part ni d’héritage avec ses frères; l’Éternel est son héritage, comme l’Éternel, ton Dieu, le lui a dit» (Deut. 10:8, 9).
34.9. Fidélité de Lévi
Cette fidélité n’était pas ordinaire; car à peine eurent-ils répondu à l’appel de Moïse, qu’il leur fut dit: «Ainsi dit l’Éternel, le Dieu d’Israël: Que chacun mette son épée sur sa cuisse; passez et revenez d’une porte à l’autre dans le camp, et que chacun de vous tue son frère, et chacun son compagnon, et chacun son intime ami. Et les fils de Lévi firent selon la parole de Moïse; et il tomba d’entre le peuple, ce jour-là, environ trois mille hommes. Et Moïse dit: Consacrez-vous aujourd’hui à l’Éternel, chacun dans son fils et dans son frère, afin de faire venir aujourd’hui sur vous une bénédiction» (v. 27-29).
Ainsi seuls les Lévites répondirent à l’appel divin; ils se séparèrent de leurs frères idolâtres et prirent sans hésiter le parti de Dieu contre l’iniquité de son peuple. C’était une épreuve sévère, une épreuve qui réclamait d’eux la mise de côté de toutes les revendications de la chair, qui demandait d’eux, selon les termes de Moïse, qu’ils disent «de son père et de sa mère: Je ne l’ai point vu; et qui n’a pas reconnu ses frères, et n’a pas connu ses fils. Car ils ont gardé tes paroles et observé ton alliance» (Deut. 33:9). C’était obéir à l’appel divin à tout prix et, par conséquent, se séparer complètement du mal dans lequel Israël était tombé. Souvent Dieu éprouve les siens de cette manière; et lorsque la confusion et le déclin s’installent, la seule voie à suivre pour celui qui veut être fidèle est celle qui a caractérisé les Lévites: la voie de l’obéissance inconditionnelle et d’un cœur non partagé. Ce chemin sera nécessairement douloureux, car il implique pour ceux qui l’empruntent l’abandon de quelques-unes des associations les plus intimes de leur vie et la rupture de beaucoup de liens naturels, d’avec des parents ou des amis; mais c’est le seul chemin de la bénédiction. Sondons chacun notre cœur et recherchons si, dans ces jours mauvais, nous sommes réellement séparés, dans la soumission à sa Parole, de tout ce qui déshonore le nom du Seigneur.
Le lendemain, Moïse remonte vers l’Éternel sur la montagne.
A suivre
Chapitre 32 verset 30 à Chapitre 33 verset 11
34.10. De nouveau sur la montagne
Ch. 32:30-34 — D’abord, Moïse place le peuple devant son péché, puis dans son amour pour lui, il propose de monter pour lui dans la présence de l’Éternel, en disant: «Peut-être ferai-je propitiation pour votre péché». Le contraste entre Moïse et le Seigneur Jésus à cet égard a été décrit d’une très belle manière par un autre: «Quelle différence entre l’œuvre de Moïse et celle de notre précieux Sauveur! Le Christ descend du lieu de sa demeure dans le sein du Père pour faire Sa volonté; et tout en gardant la loi (au lieu de détruire les tables, signes de cette alliance aux exigences de laquelle l’homme était incapable de satisfaire), c’est lui qui porte la peine de son infraction. Puis, ayant accompli l’expiation avant de retourner en haut, au lieu de monter avec sur les lèvres un triste peut-être que la sainteté de Dieu fait évanouir immédiatement, il monte au ciel avec son précieux sang, signe que l’expiation est accomplie et que l’alliance nouvelle est confirmée; et la valeur de ce sang ne pouvait être douteuse aux yeux du Dieu devant qui il allait le présenter»1. Moïse était un médiateur, il est vrai, mais comme tel, c’est plutôt par contraste qu’il est un type de Christ dans ce caractère.
1 Études sur la Parole de Dieu, par J.N. Darby.
Mais il retourne, il confesse le péché de son peuple et, dans l’intensité de son affection, il intercède pour leur pardon. Qui plus est — et il ne pouvait pas aller plus loin — il ajoute: «Sinon, efface-moi, je te prie, de ton livre que tu as écrit». Il s’était par l’Esprit si complètement identifié avec le peuple — attitude qui est la source de toute puissance dans l’intercession — que si celui-ci n’était pas pardonné, il désirait périr avec lui. C’était l’épanchement de son immense amour pour Israël coupable, comme dans le cas assez semblable de l’apôtre Paul, qui dit: «J’ai souhaité d’être par anathème séparé du Christ, pour mes frères, mes parents selon la chair» (Rom. 9:3). Dieu n’accéda pas à la requête de son serviteur, car il n’avait pas d’expiation accomplie sur laquelle s’appuyer; il n’avait pas non plus de quoi faire propitiation, et la propitiation est la seule base sur laquelle un Dieu saint pouvait pardonner avec justice à son peuple.
34.11. Résultat de l’intercession
Son intercession eut pour résultat de mettre le peuple à l’abri des conséquences gouvernementales de leur péché, à savoir de la destruction comme châtiment de leur transgression. Mais si, dans sa patience, l’Éternel les épargne, il les place individuellement sous la responsabilité par ces paroles: «Celui qui aura péché contre moi, je l’effacerai de mon livre» (v. 33). Là-dessus il commande à Moïse d’aller et de conduire le peuple au lieu qu’il avait promis, disant: «Voici, mon Ange ira devant toi; et le jour où je visiterai, je visiterai sur eux leur péché. Et l’Éternel frappa le peuple, parce qu’ils avaient fait le veau qu’Aaron avait fait». Ce n’est plus maintenant l’Éternel qui demeure au milieu d’eux, mais un ange qui ira devant eux, le peuple étant maintenu sous un juste jugement à cause de leur péché. Ce changement, qui entraîne une nouvelle intervention et intercession de Moïse, est développé, quant à ses conséquences, dans le chapitre suivant.
34.12. Chap. 33:1-6
Plusieurs points de cette déclaration demandent à être relevés, vu qu’ils indiquent la position que le peuple occupe désormais. D’abord, l’Éternel ne rétablit pas encore le peuple dans la relation avec lui perdue à cause de leur transgression. Ils L’avaient rejeté, et il les maintient, pour ainsi dire, sur ce pied. Aussi dit-il encore à Moïse: «Toi et le peuple que tu as fait monter du pays d’Égypte». Deuxièmement il leur promet malgré tout le pays; cela leur avait été acquis par la première intercession de Moïse, lorsqu’il avait fait appel aux promesses inconditionnelles faites aux patriarches (chap. 32:13). Mais, troisièmement, il annonce qu’il ne montera pas au milieu d’eux, «car, dit-il, tu es un peuple de cou roide; de peur que je ne te consume en chemin». Pour employer le langage des hommes, un Dieu saint se demandait comment il pourrait maintenant demeurer au milieu d’une nation de transgresseurs. Enfin, il les menace de jugement et commande au peuple d’ôter ses ornements, afin qu’il sache comment agir envers eux. Dieu examine, pour ainsi dire, la condition de son pauvre peuple, et attend avant de frapper, parce qu’il les voit mener deuil, humiliés par leur péché, à l’ouïe de ces paroles. Quelle scène remarquable et solennelle: le peuple dépouillé de ses ornements, attendant dans l’amertume et le brisement de cœur le jugement prononcé; et l’Éternel attendant avant de frapper!
Mais Celui qui a prononcé le jugement sur le peuple à cause de leurs péchés, leur offre une échappatoire par une nouvelle intervention de Moïse. En premier lieu, celui-ci dresse la tente hors du camp.
34.13. La tente dressée hors du camp
Ch. 33:7-11 — Nous ne voyons pas que Moïse, en dressant la tente1 hors du camp, ait agi sur un commandement direct de l’Éternel. C’était plutôt du discernement spirituel, discernement à la fois du caractère de Dieu et de l’état du peuple. Enseigné de Dieu, il sent que l’Éternel ne pouvait plus demeurer au milieu d’un camp qui avait été souillé par la présence du veau d’or. Aussi prépare-t-il hors du camp, loin du camp, une place qu’il appelle la tente d’assignation. C’était bien différent de ce que l’Éternel avait dit à Moïse: «Ils feront pour moi un sanctuaire, et j’habiterai au milieu d’eux» (chap. 25:8). Ils ne devaient plus être le peuple de l’Éternel, groupé autour de Lui, leur centre; mais Il serait dehors, et «tous ceux qui cherchaient l’Éternel sortirent vers la tente d’assignation qui était hors du camp». Cela devenait donc un exercice individuel; et les «vrais adorateurs» se plaçaient sur le terrain de la séparation d’avec le camp qui avait reconnu un faux dieu.
1 Le lecteur comprendra qu’il ne s’agit pas ici du tabernacle dont le plan et les détails avaient été communiqués à Moïse sur la montagne, mais d’une tente qui allait servir maintenant de tabernacle, de lieu de rencontre entre Dieu et ceux qui le recherchaient, une tente dressée pour répondre au besoin du moment hors du camp, à cause du péché du peuple.
Nous avons là un principe d’une valeur et d’une importance inestimables. Car il faut se souvenir qu’Israël était par profession le peuple de l’Éternel; mais ils étaient tombés dans une condition telle que celui-ci ne pouvait plus demeurer au milieu d’eux. L’épître aux Hébreux nous apprend qu’il en fut de même plus tard, d’où l’exhortation que nous y trouvons: «Sortons vers lui hors du camp, portant son opprobre» (Héb. 13:13). Lorsque le nom de l’Éternel est déshonoré, que son autorité est rejetée et qu’une autre lui est substituée, l’unique ressource de celui qui veut être fidèle est de sortir de tout ce qui correspond au camp, pour pouvoir adorer Dieu en esprit et en vérité. Et remarquons bien que, comme dans le cas de Moïse, la nécessité de se séparer est une question de discernement spirituel. Il y a des temps et des époques — et ceux qui ont un œil simple ne manqueront pas de les discerner — ou c’est un saint privilège de se mettre du côté de l’Éternel contre son peuple en prenant position contre leur manière d’agir. Comme les fils de Lévi à la fin du chapitre précédent, et comme Moïse ici, ceux qui recherchent la seule présence du Seigneur sauront prendre place en dehors de tout ce qui caractérise son peuple: le déclin, le rejet de l’autorité de l’Éternel et les pratiques idolâtres. Mais un tel pas doit être franchi dans la soumission à l’autorité de la parole de Dieu, la seule lumière à nos pieds dans les ténèbres environnantes, et notre unique ressource dans les jours mauvais. Toutefois l’application de la Parole à un état de choses donné doit être une question de sagesse et de discernement donnés par l’Esprit de Dieu.
34.14. La présence de Dieu
Une fois la tente dressée, Moïse, à la vue de tout le peuple, sortit vers elle et y entra; et, comme il entrait, l’Éternel mit immédiatement le sceau de son approbation sur son acte de foi; en effet, «la colonne de nuée descendit, et se tint à l’entrée de la tente, et l’Éternel parla avec Moïse» (v. 9). Parce qu’il s’était séparé du camp, l’Éternel se révéla comme il ne l’avait pas fait auparavant, et cela d’une manière si frappante que «tout le peuple se leva, et ils se prosternèrent, chacun à l’entrée de sa tente. Et l’Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami».
C’était quelque chose de tout à fait nouveau, de totalement différent des sublimes communications du Sinaï. Jamais auparavant Moïse n’avait connu une telle intimité et une telle communion. L’Éternel lui-même en parle comme du privilège particulier de son serviteur, lorsqu’il le défend contre les calomnies d’Aaron et de Marie (Nomb. 12:5-8). Ce fait est très encourageant: il nous enseigne que, même si celui qui professe être le peuple de Dieu est caractérisé par la ruine et par l’apostasie, il reste un chemin d’accès dans la présence de Dieu pour ceux qui, discernant par grâce sa pensée, sont conduits à prendre place en dehors de la corruption qui les entoure. En réponse à leur foi et à leur fidélité le Seigneur se révélera à eux d’une manière toute particulière et pleine de grâce. Il est clair que si nous sommes identifiés à la corruption d’un peuple apostat, nous avons nécessairement part à sa condition et même à son jugement; mais si nous nous séparons selon la pensée du Seigneur, ce qui faisait obstacle à sa présence se trouve ôté. Nous sommes sur un terrain différent, celui de la foi personnelle et de l’état spirituel individuel. Mais alors souvenons-nous que ceux qui agissent ainsi se retrouveront tous assemblés autour d’un centre nouveau. Ce que Moïse a fait est en quelque sorte une anticipation de cette parole: «Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d’eux» (Matt. 18:20). Cette assurance est la ressource du fidèle dans un jour de confusion et de corruption, comme la tente d’assignation dressée hors du camp a été la ressource de ceux qui recherchaient l’Éternel au milieu de l’idolâtrie d’Israël. Et ceux qui y ont recours avec simplicité et foi recevront, comme Moïse, des manifestations spéciales de la faveur et de la présence de l’Éternel.
Son acte ayant été approuvé, Moïse retourne dans le camp; il est reconnu maintenant comme médiateur. En revanche Josué, type de Christ en Esprit, comme conducteur de son peuple, reste dans la tente. Moïse, le médiateur, commence alors son intercession. Il accepte la position dans laquelle l’Éternel l’avait placé, comme celui qui devait faire monter le peuple dans l’héritage promis (v. 1). C’est là-dessus qu’il fonde son intercession.
A suivre
Chapitre 33 versets 12 à 23
34.15. Connaître le chemin de Dieu
Ch. 33:12, 13 — Il prie en premier lieu pour lui-même. Il veut d’abord savoir qui l’Éternel enverra avec lui. Dieu avait dit qu’il enverrait un ange (v. 2). Mais Moïse aimerait en savoir davantage; et pour cela il se réclame de ce que l’Éternel lui avait dit: «Je te connais par nom, et tu as aussi trouvé grâce à mes yeux». En outre, il voudrait connaître le chemin de Dieu, pour le connaître Lui, afin de trouver grâce à ses yeux. Puis il place le peuple devant Dieu. Comme tout dépend maintenant de Moïse en tant que médiateur, il présente d’abord sapropre cause, et ensuite il introduit le peuple. Il emploie des termes touchants: «Considère que cette nation est ton peuple». Tout ceci est d’une très grande beauté, et plein d’intérêt et d’enseignement. Moïse ne se contentait pas d’avoir été choisi par Dieu pour conduire le peuple, ni d’avoir reçu la promesse qu’un ange irait devant lui dans le chemin; il désirait savoir non pas simplement son chemin mais celui de Dieu dans le désert, afin de le connaître Lui aussi. Il ne serait satisfait qu’en connaissant Dieu et le chemin de Dieu pour son peuple. C’est ce dont tout croyant a besoin, et rien de plus, pour sa marche dans le désert de ce monde.
Dans sa grâce, l’Éternel accepte la prière de son serviteur. Il dit: «Ma face ira, et je te donnerai du repos». Il répond ainsi pleinement à la supplication du médiateur, lui accordant tout ce dont il avait besoin pour lui-même et pour le peuple pendant leur pèlerinage dans le désert. Réconforté et enhardi, Moïse dit: «Si ta face ne vient pas, ne nous fais pas monter d’ici» (v. 15). Il s’identifie maintenant avec le peuple. N’avons-nous pas une belle image du cœur de Christ dans cet amour intense de Moïse pour Israël, cet amour, qui les lie à lui dans sa position privilégiée devant Dieu? Et non seulement cela; s’élevant plus haut, il les lie de nouveau à Dieu.
34.16. Restauration du peuple
Nous avons remarqué que Dieu avait pris Israël sur son propre terrain: puisqu’ils L’avaient rejeté, il le désigne à Moïse comme «ton» peuple. Mais maintenant — maintenant que Moïse, agissant en médiateur, a gagné l’oreille de Dieu, il dit de nouveau «Ton» peuple. «Car»,. poursuit-il, «à quoi connaîtra-t-on que j’ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas en ce que tu marcheras avec nous? Ainsi, moi et ton peuple, nous serons séparés de tout peuple qui est sur la face de la terre» (v. 16). Il réclame, pour ainsi dire, une preuve de la faveur divine, de la restauration de cette faveur: la présence même de Dieu avec son peuple. Elle ne pouvait pas être connue autrement; et Sa présence les séparerait de tous les autres peuples. Il en est de même quant au principe dans la dispensation actuelle. La présence du Saint Esprit sur la terre, constituant les Siens en une habitation pour Dieu, sépare de tous les autres, et cela si complètement, qu’il n’y a que deux sphères: celle de la présence et de l’opération du Saint Esprit, et celle de l’action et du pouvoir de Satan.
«Et l’Éternel dit à Moïse: Je ferai cela aussi dont tu as parlé; car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par nom» (v. 17). Le succès de la médiation de Moïse est donc complet quant à la restauration du peuple. Les Israélites sont de nouveau le peuple de l’Éternel, un peuple qui va être placé sous une nouvelle alliance, comme nous le verrons dans le chapitre suivant, une alliance de la loi certes, mais de la loi mêlée à la grâce selon le caractère de Dieu qui vient d’être révélé. L’effet de la faveur divine sur Moïse est remarquable. Chaque nouvelle manifestation de grâce suscite des désirs plus grands; aussi Moïse demande-t-il maintenant à voir la gloire de l’Éternel.
«Et Moïse dit: Fais-moi voir, je te prie, ta gloire» (v. 18). Voilà ce que la grâce opère toujours dans l’âme. Plus Dieu se révèle, plus nous désirons le connaître. Mais la demande même de Moïse offre un contraste avec la place du croyant aujourd’hui. Nous contemplons maintenant à face découverte la gloire du Seigneur; ici Moïse demande à la voir. Toutefois, ce saint désir traduit l’effet de son intimité avec Dieu et l’action puissante du Saint Esprit qui en résulte sur l’âme.
34.17. Dans la fente du rocher
Ch. 33:19-23 — L’Éternel écoute et exauce la prière de Moïse, dans la mesure qui était possible pour celui-ci. Il ferait passer toute sa bonté devant lui et crierait le nom de l’Éternel. Il pose ensuite le principe de sa souveraineté, principe selon lequel il devait agir afin d’épargner Israël; car s’il avait agi envers eux sur la base de la juste loi, la nation entière aurait dû périr. L’apôtre Paul cite précisément ce passage pour présenter la même vérité, à savoir que, dans l’exercice des droits souverains de Dieu, Israël a été épargné d’une part et le Pharaon détruit d’autre part. Son but est de concilier le don de la grâce aux Gentils avec les promesses spéciales faites à Israël, et pour cela il les fait remonter à leur péché en relation avec le veau d’or. Il leur rappelle qu’à cette époque ils dépendaient autant de la grâce souveraine de Dieu que les Gentils actuellement, qu’ils étaient par conséquent les uns comme les autres les objets de la miséricorde et de la grâce souveraines. Cette vérité tire pour ainsi dire son origine de cette parole de l’Éternel à Moïse, bien que Dieu ait agi selon ce principe tout au long de l’histoire d’Israël (voir Rom. 9:7-13). Elle est affirmée maintenant comme étant la base sur laquelle, en réponse à l’intercession de Moïse, il pouvait épargner le peuple. Mais malgré cette faveur qui lui est accordée, malgré ce privilège de voir la bonté de l’Éternel et de porter son nom, Moïse ne pouvait voir sa face et vivre. L’Éternel le mettrait «dans la fente du rocher» quand il passerait. «Puis, dit-il, je retirerai ma main, et tu me verras par derrière; mais ma face ne se verra pas». Dieu n’était pas encore pleinement révélé; l’œuvre qui permettrait à Dieu d’introduire le pécheur dans sa présence immédiate et sans une ombre qui les séparât n’était pas encore accomplie. Par conséquent, aussi élevée que soit la place que Moïse occupait, elle n’atteint pas la proximité de Dieu dans laquelle est amené le croyant le plus humble de la dispensation actuelle. Le chrétien peut contempler toute la gloire de Dieu dans la face de Jésus Christ; mais Moïse dut être caché dans «la fente du rocher», type, peut-on dire, du croyant en Christ, pendant que la gloire passait. Comme un autre l’a dit: «Dieu prendra soin de se cacher pendant son passage, et Moïse le verra par derrière. On ne peut pas rencontrer Dieu dans Son chemin, comme si l’on était indépendant de lui...: une fois qu’il est passé, on voit toute la beauté» de ce qu’il a fait. Cela nous est présenté dans le chapitre suivant dans le rétablissement de l’alliance avec Israël.
A suivre
Chapitre 34 versets 1 à 28
34.18. La loi de nouveau donnée — ch. 34
Chap. 34:1-7 — Conformément à l’ordre divin qu’il a reçu, Moïse monte avec les deux tables de pierre pour recevoir une nouvelle fois la loi sous laquelle Israël allait être placé. Sinaï est par conséquent de nouveau la scène de sa rencontre avec l’Éternel. Fidèle à sa promesse, l’Éternel descend dans la nuée et se tient là avec lui, et crie le nom de l’Éternel. Le nom dans l’Écriture, en relation avec Dieu du moins, exprime la nature; et ici il parle de ce que Dieu était comme l’Éternel. Il est très important de se souvenir que c’est l’Éternel dans sa relation avec Israël qui est révélé ainsi, et non pas le Père. Ce n’est donc pas une révélation complète de Dieu laquelle n’était pas possible avant la croix. C’est le nom de l’Éternel qui est proclamé, expression de ce que Dieu était dans ce caractère. «Ce nom n’est pas l’expression de ses relations avec le pécheur pour sa justification; mais il est l’expression de ses relations avec Israël pour son gouvernement. Miséricorde, sainteté et patience caractérisent ses voies envers lui, mais il ne tient pas le coupable pour innocent»1. Nous invitons le lecteur à étudier pour lui-même cette révélation de ce que Dieu était pour Israël, chaque mot employé étant, sous cet aspect, la déclaration de son caractère immuable.
1 Études sur la Parole de Dieu, par J.N. Darby.
Nous voyons la grâce et la vérité associées, bien que ce ne soit qu’à la croix qu’elles se sont rencontrées et harmonisées dans leurs activités, en même temps que la justice et la paix s’embrassaient. La bonté et la grâce sont bien là, accompagnées de patience, mais la sainteté est présente aussi et, par conséquent si l’Éternel gardait la bonté envers des milliers de générations, s’il pardonnait l’iniquité, la transgression et le péché, il ne tenait en aucun cas le coupable pour innocent. Son cœur était certes débordant d’amour pour son peuple, mais cet amour était, si l’on peut s’exprimer ainsi, retenu dans son cœur tant que l’expiation n’était pas accomplie; alors seulement Dieu pourrait en justice justifier l’impie. Ceux qui prendront la peine de considérer les voies de Dieu envers Israël à partir de ce moment jusqu’à ce qu’ils furent chassés du pays, et en fait jusqu’à la croix, constateront l’exercice continuel de chacun de ces attributs. Tout ce que Dieu est, tel que nous le trouvons ici, est manifesté dans sa manière d’agir à l’égard de son ancien peuple. La proclamation de son nom est, en réalité, le résumé de son gouvernement depuis le Sinaï jusqu’à la mort de Christ. Mais, tout en reconnaissant pleinement le précieux caractère de la révélation faite ainsi à Moïse, relevons une fois encore que ce n’est pas ce dont les chrétiens jouissent aujourd’hui. L’ampleur de la différence ne peut pas nous échapper si nous comparons ce que nous avons ici avec ces paroles du Seigneur: «Et je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et moi en eux» (Jean 17:26). C’est la différence entre ce que Dieu était en tant que l’Éternel pour Israël et ce que Dieu est comme Père pour ses enfants.
34.19. Dieu tire le bien du mal
Une autre remarque peut être faite. Satan était intervenu et, sur le moment, il semblait être parvenu à faire échouer les plans de Dieu à l’égard de son peuple. Mais Satan ne connaît jamais de défaites plus complètes que lorsqu’il remporte des victoires apparentes. La croix en est l’illustration la plus claire; mais cela se voit déjà en relation avec le veau d’or. Ce dernier était l’œuvre de Satan; mais le manquement d’Israël devient pour Dieu l’occasion — par la médiation de Moïse qui était la ressource de Dieu dans sa grâce — de se révéler de façon plus complète et d’introduire la grâce dans la loi. L’activité de Satan travaille à son insu à l’accomplissement des conseils de Dieu, et sa colère tourne à la louange de Celui contre qui toute sa méchanceté et son inimitié sont dirigées.
Considérons maintenant l’effet de la proclamation du nom de l’Éternel sur Moïse. «Et Moïse se hâta, et s’inclina jusqu’à terre, et se prosterna, et dit: Si j’ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, que le Seigneur marche, je te prie, au milieu de nous; car c’est un peuple de cou roide; et pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour héritage» (v. 8, 9).
Le premier effet est personnel. Moïse est amené à se prosterner et à adorer l’Éternel. Toute révélation de Dieu au cœur des siens produit ce résultat. Les patriarches nous en offrent une illustration remarquable. Que de fois ne trouvons-nous pas de déclaration semblable à celle-ci: «Et l’Éternel apparut à Abram... Et Abram bâtit là un autel à l’Éternel, qui lui était apparu» (Gen. 12:7). Moïse en fit aussi l’expérience. Confondu par la révélation faite en grâce à son âme, il est conduit à adorer. Mais immédiatement il reprend sa position de médiateur. Rendu conscient de sa propre acceptation par la faveur dans laquelle il avait été introduit et se sachant aussi agréé en tant que médiateur pour Israël, il commence son intercession. Il demande que l’Éternel marche au milieu d’eux, et cela pour la raison même qui avait conduit l’Éternel à dire qu’il n’habiterait pas au milieu d’eux (comparer chap. 33:3).
De plus, il supplie que leur péché soit pardonné, et qu’il les prenne pour héritage. Il est très beau de relever comment Moïse, maintenant qu’il a été pleinement reconnu et accepté dans sa position de médiateur, s’identifie complètement avec ceux dont il défend la cause. Il dit: «au milieu de nous»; «nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour héritage». C’est un principe extrêmement important. Il a été illustré d’une manière parfaite par Celui dont Moïse n’était qu’une figure. Et il s’applique à l’intercession pour le peuple de Dieu sous quelque forme que ce soit. En fait, chaque fois qu’un serviteur de l’Éternel a rempli cette fonction d’intercesseur, ce principe a été clairement manifesté (voir Dan. 9; Néh. 1, etc.). Maintenant il en est de même. Nous n’aurons de puissance devant Dieu en faveur des autres, que si, par grâce, il nous est accordé d’entrer dans la condition de ceux que nous avons à cœur de porter devant le Seigneur, et de nous identifier avec eux. Moïse a pu le faire; sa prière fut acceptée et, en réponse, l’Éternel établit une alliance nouvelle avec le peuple.
34.20. L’alliance nouvellement donnée
Ch. 34:10-28 — Les termes de cette alliance ne sont pas nouveaux, même s’ils sont nouvellement donnés. Presque chacun d’entre eux a déjà été considéré dans les chapitres 13 ou 23. Nous nous bornerons donc à relever brièvement leur caractère. Le fondement de tout réside dans ce que Dieu ferait pour son peuple (v. 10). Il ordonne alors la séparation complète d’avec les nations environnantes, une fois qu’Israël aurait été mis en possession du pays — séparation d’avec les nations elles-mêmes, d’avec leur manière d’agir et d’avec leurs cultes. Ils devaient adorer l’Éternel seul, «car l’Éternel dont le nom est Jaloux, est un Dieu jaloux» (v. 11-16). Mais si d’une part il doit y avoir séparation du mal, il doit d’autre part y avoir séparation pour Dieu. Aussi la fête des pains sans levain devait-elle être gardée1. Pendant sept jours, une période de temps complète, image de leur vie entière, ils devaient manger des pains sans levain — les pains sans levain de sincérité et de vérité (1 Cor. 5:8). Ils devaient en outre reconnaître les droits de Dieu à la fois sur eux-mêmes et sur leur bétail. «Tout ce qui ouvre la matrice est à moi» (v. 19). Vient ensuite une disposition remarquable: tout premier-né devait être racheté, tant le premier-né de l’âne que le premier-né de leurs fils. L’homme dans sa nature se trouve ainsi associé à un animal impur (voir chap. 13:13) — indication d’une part de son état de perdition en tant que né dans ce monde, avec son besoin de la rédemption, et, d’autre part, de sa condamnation s’il n’est pas racheté. Le sabbat, la fête de la Pentecôte et celle des Tabernacles sont de nouveau ordonnés, avec l’adjonction que trois fois l’an, «tout mâle d’entre vous paraîtra devant la face du Seigneur, l’Éternel, le Dieu d’Israël»2.
1 Voir Exode 13 où cette fête a été présentée.
2 Ces statuts ont été considérés au chapitre 23:14-19.
«Selon la teneur de ces paroles» l’Éternel fit alliance avec Moïse et avec Israël (v. 27). Les mots«avec toi» sont significatifs. Ils montrent combien la place d’Israël avait été rendue dépendante du médiateur et indiquent, par conséquent, la position dans laquelle Moïse avait été introduit. Pour la seconde fois il avait été quarante jours et quarante nuits, dans un état hors de nature, dans la présence de Dieu. «Il ne mangea point de pain et il ne but point d’eau». Dieu entretint ainsi son serviteur dans sa propre présence, et le rendit à même d’entendre sa voix et de recevoir ses paroles. Finalement, il reçut une nouvelle fois les deux tables du témoignage sur lesquelles Dieu avait écrit les dix commandements, puis il redescendit de la montagne et revint vers le peuple.
34.21. La loi est assortie de grâce
Telle était l’alliance dans laquelle Dieu dans sa grâce entra avec son peuple après sa chute et son apostasie. «Israël (et c’est très important à remarquer) n’est jamais entré dans la terre promise sous l’alliance de Sinaï, autrement dit (puisque tout ceci se passe encore au pied du mont Sinaï), sous la loi seule: elle avait été violée dès l’instant où elle lui avait été donnée. C’est la médiation de Moïse qui le mit en état d’y entrer. Toutefois le peuple est replacé sous la loi, mais à la loi est ajouté un gouvernement de patience et de grâce» (*). Israël avait en fait tout perdu et s’était exposé à la destruction par le péché du veau d’or. Ils n’avaient dès lors plus aucun droit à la bénédiction ou à l’héritage. Par la médiation de Moïse, ils furent restaurés dans leur position officielle de peuple de Dieu et assurés de posséder le pays. De plus, Dieu proclama le nom de l’Éternel, la révélation de son caractère en relation avec Israël, et ensuite les replaça sous la loi. Ainsi donc Israël n’a jamais été effectivement sous l’alliance de Sinaï. Elle a été violée avant que ses termes, écrits sur les tables de pierre, parviennent dans le camp. Les termes de la seconde alliance sont au fond identiques, mais ils sont mélangés avec la grâce, la bonté et la patience qui avaient été proclamées dans le nom de l’Éternel. En fait, après avoir péché, Israël fut sauvé par la grâce, par l’intercession de Moïse; ensuite ils furent placés à nouveau sous la loi, avec les éléments supplémentaires qui viennent d’être mentionnés. Dès lors ils se trouvaient dans une position très semblable à celle de ces croyants d’aujourd’hui qui, ne connaissant pas la place nouvelle dans laquelle ils sont introduits par la mort et la résurrection de Christ, se placent sous la loi comme règle de leur conduite et de leur vie. Qu’y a-t-il d’étonnant alors si leur marche, aux uns comme aux autres, est caractérisée par une succession de manquements et de transgressions?
Cette section se termine par le récit remarquable des conséquences pour Moïse d’avoir été dans la présence de l’Éternel sur la montagne.
1 Études sur la Parole de Dieu, par J.N. Darby.
A suivre
Chapitre 34 versets 29 à 35
34.22. Le visage de Moïse rayonne
Ch. 34:29-35 — Trois points méritent d’être relevés dans cette description. D’abord, la peau du visage de Moïse rayonnait, parce qu’il avait été sur la montagne avec Dieu. Il avait été introduit dans la présence immédiate de la gloire de l’Éternel, et son visage avait capté, et conservé à son insu quelques-uns des rayons de cette gloire: il «ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu’il avait parlé avec Lui». Le contraste avec notre Seigneur sur la montagne de la transfiguration ne peut pas nous échapper. «Il fut transfiguré devant eux; et son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière» (Matt. 17:2). Mais là c’était le rayonnement de sa propre gloire, une gloire éblouissante qui l’illuminait tout entier aux yeux des disciples, de sorte qu’il leur apparut comme un Être de lumière. La gloire qui brillait sur le visage de Moïse n’était qu’extérieure, le reflet de celle de l’Éternel, l’effet de sa communion avec Dieu. Moïse, absorbé par les communications qu’il recevait et par la contemplation de celui dont il écoutait les paroles, ne savait pas que son visage était devenu rayonnant. Et le croyant d’aujourd’hui non plus ne connaît pas l’effet extérieur résultant du fait d’avoir été seul avec Dieu. D’autres le verront cela ne peut pas passer inaperçu; mais lui-même ne sera pas conscient de refléter la lumière de celui dans la présence de qui il s’est tenu.
Mais Aaron et tous les enfants d’Israël virent la gloire dont le visage de Moïse était illuminé; et cela nous amène au deuxième point, à savoir l’effet que cela produisit sur eux. Ils craignirent de s’approcher de lui; aussi lorsque Moïse s’adressait à eux, pour leur commander tout ce que l’Éternel lui avait dit sur la montagne de Sinaï, il mettait un voile sur son visage. C’est à cet incident que l’apôtre Paul fait allusion pour montrer le contraste entre «le ministère de la mort» et «le ministère de l’Esprit», ou entre «le ministère de la condamnation» et «le ministère de la justice», c’est-à-dire entre la dispensation de la loi et celle de la grâce. Remarquons que le visage de Moïse ne rayonnait pas la première fois qu’il descendit du Sinaï; il ne rayonna que lorsqu’il revint au camp après le succès de sa médiation en faveur du peuple qui était tombé dans le péché.
Pourquoi alors craignaient-ils de s’approcher de lui? Parce que la gloire même qui brillait sur son visage sondait leurs cœurs et leurs consciences; ils réalisaient qu’ils étaient pécheurs, incapables par eux-mêmes de répondre à la moindre exigence de l’alliance qui entrait maintenant en vigueur. C’était nécessairement un «ministère» de la condamnation et de la mort, car il exigeait d’eux une justice à laquelle ils ne pouvaient pas accéder et, dans cette mesure même, il prononcerait leur condamnation et les placerait sous le châtiment de la transgression, qui était la mort. La gloire qu’ils voyaient sur le visage de Moïse était ainsi pour eux l’expression de la sainteté de Dieu, cette sainteté qui attendait d’eux qu’ils atteignent son niveau, et qui sanctionnerait les violations de cette alliance maintenant établie. Aussi craignaient-ils, parce qu’ils savaient au fond d’eux-mêmes qu’ils étaient incapables de se tenir devant Celui dans la présence de qui Moïse avait été. Mais, dans le «ministère» de la justice et de l’Esprit tout est changé. Il n’exige aucune justice de l’homme, mais il révèle la justice de Dieu comme un don divin en Christ pour tout croyant, et en scelle la réception par le don du Saint Esprit.
34.23. La gloire de Dieu dans la face de Christ
Ainsi au lieu de craindre, nous nous réjouissons dans la contemplation de la gloire dans la face de Jésus Christ à la droite de Dieu; chaque rayon de cette gloire parle en effet de l’expiation accomplie et proclame que nos péchés, à nous croyants, ont été complètement ôtés. Car celui qui a été livré pour nos fautes a été ressuscité pour notre justification; celui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois a été ressuscité par Dieu lui-même et exalté à sa droite. Dieu l’a glorifié en lui-même. Oui, il est intervenu, et il a ressuscité celui qui a porté nos péchés, qui, à cause d’eux, est descendu dans la mort; comme signe de sa satisfaction à l’égard de l’œuvre accomplie, Dieu l’a élevé dans la gloire, de sorte que la gloire de Dieu resplendit dans la face de Jésus Christ. C’est ce fait qui donne de l’assurance à notre âme, qui nous donne pleine liberté pour nous approcher en paix, car la gloire même que nous contemplons est pour nous la preuve que tout ce qui était contre nous a été ôté.
Aussi, contrairement à Moïse qui devait mettre un voile sur son visage parce que les enfants d’Israël craignaient de s’approcher, Christ est lui à face découverte à la droite de Dieu où nous contemplons avec joie sa gloire, et en la contemplant, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en Esprit (2 Cor. 3; 4). L’effet produit sur les enfants d’Israël par la gloire qui brillait sur le visage de Moïse est donc en contraste absolu avec ce que connaît aujourd’hui le croyant qui voit la gloire du Seigneur. Il est parfaitement vrai qu’Israël n’était plus sous la loi pure, que la bonté et la grâce y étaient maintenant mélangées; mais ce fait même rendrait leur péché d’autant plus odieux s’ils rompaient une seconde fois l’alliance. Dans ce cas, il ne s’agirait plus seulement d’un péché contre la justice, mais d’un péché contre la grâce qui les avait épargnés et qui les avait restaurés dans leur relation avec Dieu. Cela ne diminue pas le contraste, mais au contraire le renforce; et le fait que nous avons été amenés dans une telle place, une place dans laquelle nous contemplons à face découverte la gloire du Seigneur, devrait stimuler nos cœurs à la reconnaissance et à l’adoration, la gloire même que nous voyons nous donnant l’assurance que nos péchés ont été enlevés pour toujours de devant Dieu.
Relevons encore un dernier point. Lorsque Moïse entrait devant l’Éternel pour parler avec lui, il ôtait le voile jusqu’à ce qu’il sortît (v. 34). Il dévoile son visage pour parler avec l’Éternel, alors qu’il le recouvre pour parler au peuple. Sous cet aspect, Moïse devient plutôt un type de la position actuelle du croyant, position à laquelle il a déjà été fait allusion. Moïse était introduit sans voile dans la présence même de Dieu, de même que le croyant est placé maintenant dans la lumière comme Christ est dans la lumière. Mais malgré l’intimité d’accès dont Moïse jouissait, c’était sous son nom d’Éternel que Dieu parlait avec lui; tandis que le croyant est devant Dieu selon tout ce que Dieu est, selon cette révélation pleine et parfaite de lui-même en Christ, comme notre Dieu et Père. De plus, alors qu’il était accordé à Moïse d’entrer occasionnellement devant l’Éternel pour parler avec lui, le croyant quant à sa position est introduit continuellement dans la présence de Dieu. Il est toujours devant Dieu en Christ.
A suivre
Chapitres 35 à 38
35. Exode 35 à 40 — Consécration et obéissance
Nous sommes maintenant parvenus à la dernière section de ce livre. Les chapitres 32 à 34 constituent une parenthèse. Le début du chapitre 35 se rattache par conséquent au chapitre 31, mais s’il en est la continuation, ce n’est que par la grâce de Dieu. Car s’il avait puni Israël pour son péché selon les termes de l’alliance dans laquelle ils étaient entrés volontairement, leur histoire comme nation et le récit des voies de Dieu envers eux se seraient terminés avec le chapitre 31. Mais nous avons vu comment, malgré leur grave chute et en réponse à la médiation et à l’intercession de Moïse, l’Éternel dans sa tendre miséricorde, les épargna et les restaura dans leur relation de peuple avec Lui. Aussi, après avoir exposé les termes de sa seconde alliance, il est libre, en grâce, de maintenir sa présence au milieu d’eux. Nous trouvons de ce fait dans ces derniers chapitres l’exécution effective des commandements que Moïse avait reçus sur la montagne quant à la construction du tabernacle. Mais auparavant, le sabbat est à nouveau introduit.
Chap. 35:1-3 — Comme cela a été relevé précédemment, l’Éternel rappelle toujours au peuple le but de toutes ses voies envers eux, à savoir, qu’ils entrent dans son repos. C’était là qu’il voulait les conduire, même si à cause de leur incrédulité ils ne purent pas l’atteindre. C’est la raison pour laquelle nous retrouvons le sabbat ici, comme chaque fois qu’une nouvelle relation est établie entre Dieu et son peuple. Il est ainsi une sorte de préface au récit de la construction du sanctuaire.
35.1. Les offrandes du peuple
Moïse proclame ensuite le désir de l’Éternel de recevoir une offrande de son peuple, l’offrande des nombreux matériaux nécessaires pour faire le tabernacle (v. 5-19). Dieu veut que son peuple entre dans ses propres pensées de bénédiction pour eux, et il leur accorde, dans sa grâce, le privilège d’apporter ces matériaux comme une offrande. Il leur indique ce qu’ils devaient donner, bien que tout ce qu’ils possédaient vînt de Lui (voir 1 Chron. 29:14), et ensuite, il le considère comme une offrande de leur part. Il en est toujours ainsi. Les croyants ne peuvent faire la moindre bonne chose d’eux-mêmes. Toutes les bonnes œuvres sont le fruit de l’Esprit de Dieu, et sont préparées à l’avance par Dieu (Éph. 2:10); pourtant une fois qu’elles ont été accomplies, Dieu dans sa grâce les leur attribue et les revêt du fin lin qui est les justices des saints.
La volonté de Dieu de recevoir une offrande de son peuple est donc proclamée. La grâce de Dieu manifestée ainsi touche et ouvre leurs cœurs. «Et tout homme que son cœur y porta, et tous ceux qui avaient un esprit libéral, vinrent et apportèrent l’offrande de l’Éternel pour l’œuvre de la tente d’assignation et pour tout son service, et pour les saints vêtements» (v. 21). Et encore: «Les fils d’Israël, tout homme et toute femme qui eurent un esprit libéral pour apporter pour toute l’œuvre que, par Moïse, l’Éternel avait commandé de faire, apportèrent une offrande volontaire à l’Éternel» (v. 29). Ces déclarations contiennent certains principes applicables à toutes les dispensations. L’apôtre Paul le confirme lorsqu’il dit: «Que chacun fasse selon qu’il se l’est proposé dans son cœur, non à regret, ou par contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement» (2 Cor. 9:7; lire tout le chapitre). Il est donc très important de se souvenir que tout ce qui est offert à Dieu doit procéder de cœurs qui ont été disposés par son Esprit; que l’offrande doit être spontanée, et non pas arrachée par la persuasion ou une pression extérieure; elle doit venir du cœur.
35.2. L’Église et l’argent
L’Église de Dieu aurait été dans un état bien différent aujourd’hui si ce principe avait été observé. Les innombrables moyens humains imaginés pour collecter de l’argent ne sont-ils pas une des causes de la ruine? Et qu’y a-t-il de plus humiliant que le fait de devoir recourir à des sollicitations de toutes sortes pour pousser les enfants de Dieu à offrir leurs dons? Moïse se contenta d’annoncer que l’Éternel désirait recevoir et il laissa cette communication bienveillante produire son effet sur les cœurs des enfants d’Israël. Il n’eut pas besoin d’en faire plus; et si aujourd’hui les saints connaissaient les pensées de Dieu, ils suivraient l’exemple de Moïse et refuseraient l’idée même de recevoir le moindre don qui ne serait pas apporté volontairement, comme fruit de l’opération de l’Esprit de Dieu dans les cœurs. Et remarquons que rien ne manqua. Nous lisons en effet dans le chapitre suivant que les hommes sages qui faisaient l’ouvrage vinrent vers Moïse et dirent: «Le peuple apporte beaucoup plus qu’il ne faut pour le service de l’œuvre que l’Éternel a commandé de faire. Et Moïse commanda, et on fit crier dans le camp: Que ni homme ni femme ne fasse plus d’ouvrage pour l’offrande pour le lieu saint. Et le peuple cessa d’apporter; car le travail était suffisant pour tout l’ouvrage à faire, et il y en avait de reste» (chap. 36:5-7).
À l’exception des premiers jours qui ont suivi la Pentecôte, rien n’a probablement jamais répondu à cela, même dans l’histoire de l’Église. L’insuffisance des moyens pour poursuivre l’œuvre du Seigneur est devenue une plainte chronique. Mais ne perdons jamais de vue les points suivants: premièrement, que l’Église de Dieu n’est en aucun cas responsable d’obtenir des moyens; deuxièmement, que si l’Éternel demande un travail, il mettra lui-même au cœur des siens d’apporter ce qui est nécessaire; troisièmement, que si nous n’entreprenons rien avant d’avoir les ressources nécessaires, nous abandonnons le terrain de la dépendance pour agir selon nos propres pensées; et enfin, que les dons procurés par des efforts humains peuvent rarement être employés pour la bénédiction.
35.3. La sagesse des ouvriers
De plus, si la libéralité était le fruit de l’action de l’Esprit de Dieu, la sagesse l’était également. La libéralité pourvoyait aux matériaux nécessaires et la sagesse les employait selon la pensée divine. L’Éternel avait rempli Betsaleël de l’esprit de Dieu, en sagesse, en intelligence, et en connaissance, et pour toute espèce d’ouvrages; et à lui et à Oholiab, fils d’Akhisamac, de la tribu de Dan, il avait aussi mis au cœur d’enseigner (chap. 35:31-35). Les ouvriers étaient donnés par Dieu; la sagesse et la connaissance nécessaires à l’exécution de leur travail venaient aussi de lui par l’action de son Esprit; et la capacité d’enseigner les autres était encore un don de sa part. Associé à ces deux hommes, nous trouvons «tout homme sage de cœur à qui l’Éternel avait donné de la sagesse et de l’intelligence pour savoir faire toute l’œuvre du service du lieu saint», pour faire selon tout ce que l’Éternel avait commandé (chap. 36:1).
Nous avons certainement dans ces ouvriers le modèle des vrais serviteurs de toutes les dispensations. Ils ont été eux-mêmes appelés par Dieu, comme cela a été relevé au chapitre 31, et toute leur activité était le fruit de l’Esprit de Dieu. Ils ne se sentaient pas à la hauteur d’une telle tâche, mais leur capacité venait de Dieu (2 Cor. 3:5). L’habileté humaine, la sagesse ou les inventions de l’homme, n’auraient fait que gâter la perfection du modèle divin; aussi les ouvriers ne devaient-ils être que des «vases», pour la manifestation de la sagesse, de la connaissance et de l’enseignement divins. Puisse l’ouvrier se souvenir pour son profit que, comme Betsaleël et Oholiab, il n’est qu’un vase; car alors seulement le Seigneur pourra se servir de lui, pour Sa gloire, dans l’exécution de sa volonté.
A suivre
Chapitre 39 et 40
35.4. Conformité au modèle
Au chapitre 39, nous apprenons que toute l’œuvre fut achevée selon tout ce que l’Éternel avait commandé à Moïse. Le ressort d’un service quel qu’il soit est l’obéissance, et le test de tout ce qui est exécuté est sa conformité ou, au contraire, sa divergence avec la pensée révélée de Dieu. L’Éternel avait donné certaines directives à Moïse, et des instructions à ses serviteurs pour l’ouvrage; par conséquent, la seule question qui se posait une fois leur travail achevé était la suivante: répondait-il dans chaque détail au modèle qui leur avait été communiqué? L’Esprit de Dieu a répondu à cette question en affirmant pas moins de dix fois dans ce chapitre que le travail fut achevé selon tout ce que l’Éternel avait commandé à Moïse (v. 1, 5, 7, 21, 26, 29, 31, 32, 42, 43). Ils s’étaient acquittés de leur responsabilité envers Dieu et avaient par conséquent son approbation et son appréciation comme en témoigne la répétition de cette déclaration significative: que tout leur travail était caractérisé par l’obéissance.
Nous avons là le principe important que tout ce qui se réclame être de Dieu doit se soumettre au test de la parole de Dieu. Le Seigneur affirme ce même principe dans son message aux sept assemblées: «Que celui qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux assemblées» (Apoc. 2:11, etc.). Et son application ne s’est jamais avérée plus nécessaire qu’aujourd’hui. On ne peut pas concevoir que Moïse — et combien moins le Seigneur — aurait accepté aucun ouvrage, aussi minime ou beau en lui-même, qui n’aurait pas correspondu au modèle qui lui avait été montré sur la montagne. Pourquoi alors voudrait-on que les croyants acceptent ou approuvent maintenant en relation avec l’Église de Dieu quoi que ce soit qui ne réponde pas aux Écritures? Tout ce qui ne porte pas le sceau de la parole de Dieu doit être impitoyablement rejeté, même s’il s’agit de quelque chose qui est profondément ancré dans les habitudes. Oserait-on supposer un seul instant que le Seigneur se montrera moins jaloux à l’égard de son Église, l’Assemblée qu’il a aimée et pour laquelle il s’est donné lui-même, qu’il ne l’a été pour ce qui concernait le tabernacle? Ou qu’il tolérerait l’intrusion de la sagesse humaine et de l’ordre de l’homme dans l’une alors qu’il les a si entièrement exclus de l’autre? N’oublions donc jamais que le Seigneur mesure tout, et qu’il nous incombe par conséquent aussi de mesurer tout, par sa propre Parole.
35.5. Construction du tabernacle
Dans le dernier chapitre, nous assistons à la construction effective du tabernacle, et nous voyons l’Éternel venir en prendre possession et y établir sa demeure au milieu d’Israël. Plusieurs points demandent à être relevés. On remarquera d’abord que le tabernacle devait être dressé le jour anniversaire de leur sortie d’Égypte (chap. 12:2), le premier jour du premier mois (chap. 40:2). Leur délivrance de la maison de leur servitude constituait le commencement de leur histoire spirituelle, et l’habitation de l’Éternel au milieu d’eux inaugurait spirituellement une nouvelle période de temps. Les deux choses sont liées dans le christianisme. Lorsqu’une âme est délivrée de la condamnation et jouit de la paix avec Dieu, du pardon des péchés par le sang de Christ, Dieu la scelle par le don de son Esprit venant demeurer en elle. Le début de la vie spirituelle connue et goûtée, et le fait de devenir un temple du Saint Esprit coïncident.
L’ordre selon lequel les saints ustensiles devaient être arrangés diffère à la fois de celui qui est indiqué dans les directives données sur la montagne et de celui de leur construction. Après que le tabernacle a été dressé, l’arche du témoignage est le premier objet à être mis à sa place; c’était elle qui faisait spécialement du tabernacle le sanctuaire de Dieu, parce qu’elle était le trône de Dieu sur la terre. Puis l’arche était couverte avec le voile, c’est-à-dire mise à l’abri des regards. Le saint des saints se trouvait ainsi constitué. Puis la table des pains de proposition était placée dans le lieu saint, le compartiment adjacent au lieu très saint, et les pains y étaient arrangés; le chandelier d’or pur était apporté et ses lampes étaient allumées devant l’Éternel; l’autel d’or sur lequel on faisait fumer l’encens, était mis «devant le voile», devant l’arche du témoignage; enfin, le rideau était placé à l’entrée du tabernacle. Tout ceci constituait le lieu saint. Ensuite, à l’entrée du tabernacle de la tente d’assignation, venait l’autel de l’holocauste sur lequel étaient offerts l’holocauste et l’offrande de gâteau. Puis la cuve était amenée et placée entre la tente et l’autel; on y mettait de l’eau, pour que Moïse, Aaron et ses fils puissent s’y laver les mains et les pieds (v. 30, 31). Après cela, le parvis tout autour du tabernacle et de l’autel était dressé et le rideau à l’entrée du parvis mis à sa place: le tabernacle était alors achevé avec tout ce qu’il comportait. Mais il devait encore être oint de l’huile de l’onction ainsi que tout ce qu’il contenait et consacré avec tous ses ustensiles. Il devait être saint. L’autel de l’holocauste devait également être oint, ainsi que tous ses ustensiles, afin que l’autel fût sanctifié. L’autel devait être une chose très sainte. La cuve et son soubassement étaient aussi oints pour être sanctifiés. Enfin, Aaron et ses fils devaient être consacrés et revêtus, afin de pouvoir exercer la sacrificature devant l’Éternel; «et leur onction leur sera pour exercer une sacrificature perpétuelle en leurs générations» (v. 9-15).
35.6. Comme l’Éternel l’avait commandé
Ainsi qu’il l’avait fait dans le cas de Betsaleël, d’Oholiab, et de leurs collaborateurs, l’Esprit de Dieu met le sceau de son approbation sur la manière dont Moïse s’est acquitté de l’œuvre qui lui avait été confiée. Et quelle est la teneur de l’éloge qu’il décerne? C’est que tout a été fait dans l’obéissance, «comme l’Éternel l’avait commandé à Moïse». Il est répété huit fois que tout a été accompli selon les instructions qu’il avait reçues (v. 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32). Cela nous rappelle une fois de plus l’importance de l’obéissance aux yeux du Seigneur. Samuel le dira à Saül: «Écouter est meilleur que sacrifice, prêter l’oreille, meilleur que la graisse des béliers». Le Seigneur lui-même a déclaré: «Si vous m’aimez, gardez mes commandements» (Jean 14). Malgré tout le dévouement et le zèle possibles, aucun service ne sera acceptable pour Dieu si l’obéissance fait défaut. Et c’est là précisément que tant de chrétiens manquent. À nulle époque on n’a connu un plus grand déploiement d’énergie et d’activité, ni de plus grands rassemblements religieux. Mais lorsque ces manifestations sont soumises au test que nous fournissent ces mots: «comme l’Éternel l’avait commandé à Moïse», on s’aperçoit que la volonté de l’homme, et non pas celle du Seigneur, est souvent le principal ressort de tout.
Remarquons encore — nous l’avons déjà mentionné plus d’une fois — que cette parole d’approbation est donnée à Moïse par l’Esprit, en relation avec ce qu’il a fait pour la maison de Dieu. L’Église est maintenant la maison de Dieu, l’habitation de Dieu par l’Esprit (Éph. 2:22). S’il était donc absolument indispensable que Moïse exécute scrupuleusement les instructions qu’il avait reçues au sujet du tabernacle, il est tout aussi important que la parole de Dieu soit notre seul guide dans tout ce qui touche à l’Église. C’est ainsi que dans le message que le Seigneur ressuscité envoie à l’assemblée qui est à Philadelphie, le fait qu’ils ont gardé sa Parole est un motif spécial de son approbation (Apoc. 3:8). Il ne peut y avoir un éloge plus grand. «Et Moïse acheva l’œuvre»; il acheva tout dans l’obéissance à la parole de l’Éternel.
35.7. La gloire remplit le tabernacle
Enfin, l’Éternel prend possession du sanctuaire qui a été fait afin qu’il demeure au milieu de son peuple. La liaison est très remarquable. «Moïse acheva l’œuvre. Et la nuée couvrit la tente d’assignation, et la gloire de l’Éternel remplit le tabernacle; et Moïse ne pouvait entrer dans la tente d’assignation; car la nuée demeura dessus, et la gloire de l’Éternel remplissait le tabernacle» (v. 34, 35). L’Éternel ne donnait pas seulement publiquement son approbation sur l’œuvre qui avait été accomplie, mais il prenait aussi possession de sa maison à la vue de tout Israël; car la nuée, symbole de sa présence, couvrit la tente d’assignation extérieurement, et sa gloire remplit le tabernacle à l’intérieur. Il en fut de même d’une manière encore plus frappante, lorsque le temple fut achevé. «Il arriva, lorsque les trompettes et les chantres furent comme un seul homme pour faire entendre une même voix en louant et en célébrant l’Éternel, et qu’ils élevèrent la voix avec des trompettes, et des cymbales, et des instruments de musique, en louant l’Éternel de ce qu’il est bon, parce que sa bonté demeure à toujours, il arriva que la maison, la maison de l’Éternel, fut remplie d’une nuée; et les sacrificateurs ne pouvaient pas s’y tenir pour faire le service, à cause de la nuée, car la gloire de l’Éternel remplissait la maison de Dieu» (2 Chron. 5:13, 14). Ces deux scènes nous parlent certainement en type de ce qui aura lieu à la Pentecôte, selon le récit que nous en donne le livre des Actes: «Et comme le jour de la Pentecôte s’accomplissait, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et il se fit tout à coup du ciel un son, comme d’un souffle violent et impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues divisées, comme de feu; et elles se posèrent sur chacun d’eux. Et ils furent tous remplis de l’Esprit Saint, et commencèrent à parler d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’énoncer» (Actes 2:1-4). Les deux choses ici vont ensemble. La maison de Dieu est formée et remplie par la descente du Saint Esprit. Toutefois, dans les deux cas, Dieu prenait possession de la maison préparée pour lui; car dès ce moment tous les croyants qui ensemble constituaient l’habitation de Dieu par l’Esprit, devenaient aussi individuellement son temple, parce que le Saint Esprit habitait en eux. Nous avons déjà donné la signification de l’habitation de Dieu sur la terre (chap. 25:8); et nous avions relevé alors que sa maison dans toutes les dispensations parle de l’état éternel, lorsque l’habitation de Dieu sera avec les hommes, et que sa gloire remplira toute la scène (Apoc. 21).
35.8. Un peuple conduit par la nuée
En outre, la nuée de la présence de l’Éternel devient le guide de son peuple à travers le désert. «La nuée de l’Éternel était sur le tabernacle le jour, et un feu y était la nuit, aux yeux de toute la maison d’Israël, dans toutes leurs traites» (v. 38; voir aussi Nomb. 9). Il leur suffisait donc de garder les yeux fixés sur la nuée; car «quand la nuée se levait de dessus le tabernacle, les fils d’Israël partaient, dans toutes leurs traites; et si la nuée ne se levait pas, ils ne partaient pas, jusqu’au jour où elle se levait» (v. 36, 37). L’Éternel prenait ainsi son peuple en charge. Il les avait visités dans leur affliction en Égypte; il les avait fait monter de ce pays à main forte et à bras étendu; il les avait fait traverser la mer Rouge et les avait introduits dans le désert. Mais lui-même les conduirait «dans un chemin droit, pour aller dans une ville habitable» (Ps. 107:7). Nous pouvons bien nous exclamer: «Bienheureux le peuple pour qui il en est ainsi! Bienheureux le peuple qui a l’Éternel pour son Dieu!» (Ps. 144:15). Car assurément rien ne manquait maintenant à la bénédiction d’Israël. L’Éternel était au milieu d’eux. La nuée de sa présence reposait sur le tabernacle et sa gloire le remplissait. Certes la période de bénédiction sans mélange, l’accomplissement du désir de Dieu d’être entouré de son peuple racheté a été de courte durée. D’autres livres nous rapportent combien rapidement cette scène si belle et lumineuse a été gâtée; mais le fait même que l’Exode se termine ainsi parle prophétiquement du temps où «l’habitation de Dieu [sera] avec les hommes, et il habitera avec eux; et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux; et la mort ne sera plus; et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées» (Apoc. 21:3, 4).
Fin