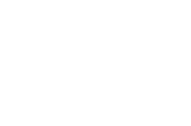Lectures hebdomadaires
Étude sur la seconde épître à Timothée
Intoduction
Cette épître à Timothée est le complément admirable de la première. Les hommes ont longuement discuté au sujet de l’intervalle de temps qui les sépare ; mais même s’il était plus bref que ce que beaucoup supposent, le changement est immense quant aux circonstances, et donc quant au but, au ton et à la manière de traiter les questions : pourtant, nous savons par toute l’Écriture et par expérience également, que de grandes révolutions peuvent se produire dans un court laps de temps. C’est la dernière parole écrite de l’apôtre, et cela confère à tout ce qu’il avait à dire une solennité, une gravité et une tendresse particulières. Aucune autre forme n’est aussi bonne pour une exhortation appropriée, et cela de la part de celui qui avait été fait « serviteur de l’assemblée » (Col. 1:24, 25) dans un sens plus complet que tout autre.
Avec le sérieux qui convenait à son sujet, la première épître insistait sur l’ordre dans l’assemblée, le poids moral et la valeur de chacun, en particulier de ceux qui gouvernent ou administrent publiquement. Ici l’apôtre, dont le départ était proche, désirait ardemment la présence de Timothée (1:4 ; 4:9, 11, 13, 21), et place sur le cœur de son bien-aimé compagnon de travail ses dernières injonctions et un appel personnel en vue du désordre profond et croissant qui s’installait. Il laisse entendre qu’un tel état de ruine (incomparablement plus mauvais aujourd’hui), ne ferait que donner une meilleure occasion de manifester ceux qui demeurent fidèles à Christ et s’attachent à Sa grâce au milieu du déclin fatal général qui prévalait et qu’il ne pouvait que décrire. Ce déclin fournirait sans doute toute facilité pour la chair et pour le monde se prévalant du nom du Seigneur ; mais c’était une raison de plus pour que les personnes dévouées et pieuses déploient encore plus d’énergie, d’endurance et de courage pour le Seigneur.
Chapitre 1
Cela explique l’attitude extraordinairement sublime et la tendre sollicitude de l’apôtre, le souvenir des larmes de Timothée [1:4] et de sa fidélité consciencieuse dans le passé, la reconnaissance de tout cœur d’une foi réelle, même dans un environnement fâcheux. C’est pourquoi Paul rappelle à Timothée le don de Dieu qui était en lui par l’imposition de ses propres mains [1:6]. À un moment aussi critique, il lui était particulièrement demandé de servir avec hardiesse dans la foi, et la conscience de cette grâce spéciale qui avait daigné se servir de lui et travailler par lui à la gloire de Christ. En fait, si la puissance et la position ainsi données à Timothée étaient bien particulières, elles étaient en plein accord avec le caractère du don du Saint Esprit accordé à tout chrétien ; car « Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte (lâcheté), mais de puissance, et d’amour, et de pensées saines » [1:7]. Ce que tous ont et devraient manifester, Timothée devait l’accomplir dans sa propre position éminente, et souffrir les tribulations qui accompagnent l’évangile [1:8], lequel est si détestable pour l’orgueil et la religiosité du monde qui persécute ses hérauts. Combien il serait vain d’endurer tout cela si ce n’est avec et selon la puissance de Dieu !
C’est pourquoi Timothée plus que tout autre, ne devait pas avoir honte du témoignage de notre Seigneur, ni de Paul Son prisonnier [1:8]. Pour ceux qui se contentent de regarder de loin, pour les lecteurs de salons ou les étudiants dans une bibliothèque, une telle honte peut sembler impossible, sauf pour les plus lâches et les plus vils. Mais l’ennemi sait provoquer, même chez les chrétiens, un état d’âme où il faut la foi la plus simple et la plus ferme pour tenir du côté de ceux qui souffrent pour Christ et pour l’évangile, comme Paul le faisait à ce moment-là. Cette marée s’était installée depuis longtemps et était maintenant arrivée à son apogée, en ce qui concerne l’apôtre. Mille excuses pouvaient être avancées, toutes sortes de raisons apparemment bonnes pouvaient être invoquées, le résultat était, quoi qu’il en soit, que la masse des frères avait honte de Paul ! et pis que cela, ils avaient honte du témoignage de notre Seigneur que lui, Paul, cherchait à promouvoir avant lui-même, à un point que, sans doute, ils ignoraient et oubliaient en face du péril et de la disgrâce.
Quelle profondeur dans ce témoignage, pourtant béni ! un salut déjà possédé de la part de Dieu, et un saint appel, « non pas selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa propre grâce, qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant que le temps ne commence, mais qui a été rendue manifeste maintenant par l’apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a annulé la mort et a mis en lumière la vie et l’incorruptibilité par l’évangile, pour lequel j’ai été établi prédicateur, apôtre et instructeur (des nations) » (1:9-11). Voilà la cause pour laquelle Paul souffrait ces choses [1:12]. Il n’y a jamais eu de raison plus honorable. Lui, n’avait certainement pas honte : combien il est terrible de penser qu’un chrétien puisse avoir de la honte ! combien il était humiliant que cela soit le cas même de ceux qui avaient connu Paul ! Car s’il y a jamais eu un serviteur dont la vie, les labeurs, l’esprit, les voies et les discours ont été en harmonie avec l’évangile, n’est-ce pas Paul ? Pourtant des frères avaient honte du témoignage de notre Seigneur et de Paul Son prisonnier, alors que ceux qui avaient du zèle et de l’affection auraient dû être puissamment attirés vers lui. Beaucoup de serviteurs fidèles se montraient complètement affaiblis à l’heure de l’épreuve ; un bon nombre étaient malheureusement incohérents dans le détail, même s’ils étaient sincères et honorés de Dieu pour le principal. Paul était presque seul, selon sa vive attente et son espérance qu’il ne serait confus en rien, mais qu’avec toute hardiesse, maintenant comme toujours jusqu’à la fin, Christ serait magnifié dans son corps, soit par la vie, soit par la mort (Phil. 1:20). C’était alors sa première incarcération ; son désir de partir et d’être avec Christ, ce qui est bien meilleur, n’allait pas encore être satisfait. Demeurer dans la chair était plus nécessaire pour les saints ; et, ayant cette confiance, il savait qu’il allait demeurer et continuer avec tous [Phil. 1:23-25]. Maintenant c’était sa deuxième incarcération ; et Christ allait être magnifié par sa mort, mais rien ne lui faisait honte, et surtout il n’avait pas honte de l’évangile ou de la dureté de la prison et de la mort que l’évangile entraînait.
Paul était lié à l’évangile, au témoignage de notre Seigneur à tous égards, et à Christ Lui-même. Il connaissait celui qu’il avait cru et était persuadé de Sa capacité à garder ce qu’il Lui avait confié jusqu’à ce jour-là [1:12]. C’est pourquoi il exhortait Timothée à avoir un modèle des saines paroles qu’il avait entendues de lui dans la foi et l’amour qui sont dans le Christ Jésus [1:13], et à garder, par le Saint Esprit qui habite en nous, le bon dépôt qui lui était confié [1:14].
Ce dépôt [1:14] ne se réfère à aucune tradition non écrite, ni à aucune formule humainement élaborée, mais à la parole écrite depuis Christ. Ce dépôt était d’autant plus important que Timothée savait comment tous ceux en Asie (la province romaine où il avait travaillé si longtemps et avec tant de zèle) s’étaient détournés de Paul, — non pas de Christ ou de l’évangile, bien sûr, mais de celui qui, plus que tous, avait présenté la vérité de l’évangile de manière nette et non frelatée, et qui avait le mieux présenté les travaux inlassables et les souffrances de l’évangile. Si plusieurs blessaient le cœur de l’apôtre, il rappelle avec émotion la fidélité d’un seul, Onésiphore, pour la maison duquel il implore la miséricorde du Seigneur, « car il m’a souvent consolé et n’a pas eu honte de ma chaîne, mais quand il était à Rome, il m’a cherché très soigneusement et il m’a trouvé (que le Seigneur lui accorde de trouver miséricorde de la part du Seigneur en ce jour-là) » [1:16-18a]. C’était en effet tout à fait conforme à l’amour qu’Onésiphore montrait habituellement là où il habitait normalement ; car l’apôtre ajoute : « et tu sais très bien combien de services il a rendu à Éphèse » [1:18b]. Si nous aimons la vérité, nous ne manquerons pas d’affection envers ceux qui sont identifiés avec elle. Le zèle partisan n’en est qu’une parodie provenant de la chair. Dieu veut que l’amour et la foi soient une réalité vivante ici-bas ; et, dans le monde tel qu’il est, on doit souffrir de plus en plus. Or Il veut être sanctifié dans ceux qui sont proches de Lui, et qui tiennent toujours compte de ce qu’Il apprécie et de ce qu’Il déteste.
Chapitre 2
L’apôtre appelle son enfant à se fortifier dans la grâce qui est en Christ, par rapport aux autres, non seulement en tenant ferme la vérité, mais en la transmettant dûment — un travail aussi délicat qu’important. « Et les choses que tu as entendues de moi devant beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles capables d’instruire aussi les autres » [2:2]. Il s’agit ici de la communication de la vérité, et non de conférer une autorité comme à des anciens et des diacres au niveau local. Les hommes fidèles devaient être les objets de ses soins pour cette fonction d’instruire ; or ils devaient aussi être enseignés par quelqu’un comme Timothée, lui-même enseigné par l’apôtre, afin qu’ils puissent enseigner les autres. Ici aussi, l’apôtre l’appelle à prendre sa part de souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ ; car, à l’intérieur comme à l’extérieur, quelles sont les choses qui exigent une plus grande abnégation ou qui exposent à de plus grandes épreuves ? L’apôtre expose par trois images ce dont ont besoin ceux qui veulent ainsi servir le Seigneur correctement. « Nul homme qui va à la guerre ne s’embarrasse des affaires de la vie, afin de plaire à celui qui l’a enrôlé comme soldat » [2:4]. Le serviteur doit se décider à refuser toute distraction. Ensuite, « si un homme combat dans les jeux de l’arène, il n’est pas couronné s’il n’a pas combattu selon les règles » [2:5]. La manière dont il sert est de la plus haute importance et requiert une soumission totale à la volonté du Seigneur qui est servi ; l’athlète est donc tenu à suivre les règles des jeux. Enfin, « c’est le laboureur qui travaille qui doit premièrement avoir part aux fruits ». Si l’amour mène au labeur, le travail doit certainement précéder les fruits. Tout cela, l’apôtre voulait que Timothée le considère, et il l’assure de la grâce du Seigneur qui lui donnerait de l’intelligence en toutes choses [2:7]. La foi doit être intelligente.
C’est ensuite une transition facile qui fait passer de celui qui travaille dans l’enseignement, jusqu’à la vérité enseignée ; le sommaire de celle-ci est condensé heureusement (car Dieu pense aux plus simples) en peu de mots, mais des mots profonds, et dans cette Personne unique qui est l’objet de notre foi, l’émerveillement des anges, le délice et la satisfaction de Dieu. « Souviens-toi de Jésus Christ ressuscité d’entre les morts, de la semence de David, selon mon évangile » [2:8]. Ce n’est pas ainsi que les théologiens le présenteraient, et les prophètes ne l’ont pas ainsi fait non plus ; mais c’est de cette manière que Dieu voulait que l’apôtre l’inculque à Timothée et à nous. L’ordre historique aurait commencé par la relation de Jésus Christ selon la chair, Sa position messianique, l’accomplissement des promesses et des prophéties quant à Sa Personne ; mais l’évangile de Paul, qui affirme fidèlement cette vérité fondamentale, mettait l’accent sur la résurrection d’entre les morts qui suppose l’œuvre de rédemption déjà accomplie et l’homme entré en Lui dans un nouvel état selon les conseils célestes de Dieu. Cela élargit le caractère de la souffrance de Christ, à laquelle l’ouvrier ne doit surtout pas se soustraire, comme le bienheureux apôtre l’a goûté si profondément dans son service de l’évangile : « dans lequel je souffre jusqu’à être lié de chaines comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n’est pas liée. C’est pourquoi je supporte tout pour l’amour des élus, afin qu’eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus Christ avec une gloire éternelle. Cette parole est certaine ; car si nous sommes morts avec Lui, nous vivrons aussi avec Lui ; si nous endurons, nous régnerons aussi avec Lui ; si nous Le renions, Lui aussi nous reniera ; si nous sommes infidèles, Lui demeure fidèle, car Il ne peut pas se renier Lui-même » [2:9-13].
Là-dessus Paul lance un appel personnel jusqu’à la fin du chapitre pour que Timothée ne se contente pas d’insister sur la vérité fondamentale et pratique, mais qu’il évite les disputes de mots [2:14] et les bavardages profanes à effets encore plus destructeurs [2:16] ; il en donne un exemple spécifique avec le cas de la rêverie profane selon laquelle la résurrection est considérée comme tellement passée que le présent devient une scène agréable. C’est ce que certains des pères de l’église ont enseigné, et la religion mondaine a ainsi prospéré, à l’époque comme aujourd’hui [2:17-18].
Cela conduit à un développement aussi instructif en soi que caractéristique de l’épître. L’apôtre répond à ce faux enseignement, en montrant les deux côtés du sceau comme le sûr fondement de Dieu : « Le Seigneur connaît ceux qui sont à Lui ; et que quiconque invoque le nom du Seigneur s’éloigne de l’iniquité » [2:19]. Quoi qu’il arrive, le Seigneur est souverain, et celui qui Le confesse est responsable vis-à-vis de Lui. Puis il est donné une anticipation de l’état de l’église de manière très parlante : « Mais dans une grande maison, il n’y a pas que des vases d’or et d’argent, mais aussi de bois et de terre, les uns pour l’honneur et les autres pour le déshonneur. Si donc quelqu’un se purifie de ceux-ci (les vases pour le déshonneur), il sera un vase pour l’honneur, sanctifié, propre au service du Maître, préparé à toute bonne œuvre » [2:20-21]. Le zèle d’un bon ouvrier, cependant, ne suffirait pas. Timothée doit fuir les convoitises de la jeunesse (pas seulement les convoitises charnelles ou mondaines), et poursuivre la justice, la foi, l’amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur [2:22]. L’isolement n’est jamais juste en tant qu’objectif, bien que le péché ne doive jamais être approuvé. Mais il faut éviter les questions insensées [2:23], cultiver la douceur [2:24], notamment en redressant les opposants, attendant si Dieu pourrait leur donner la repentance [2:25] et les réveiller du piège du diable pour se mettre à faire Sa volonté [2:26].
Chapitre 3
Mais en 2 Tim. 3, un tableau affreux est étalé : il ne s’agit plus simplement de quelques erreurs ici et là, mais d’un état de déchéance qui prévaut et où l’on ne peut plus parler des gens comme de disciples ou de fidèles, mais simplement comme des « hommes » [3:2], — non pas bien sûr des païens ou des Juifs, mais hélas ! des gens qui se disent chrétiens, car il est dit d’eux qu’ils ont une forme de piété, mais qu’ils en renient la puissance [3:5] : le fait moralement affreux est qu’on se trouve en présence d’hommes, avec la lumière extérieure et les privilèges de la chrétienté, et pourtant pas meilleurs au fond que les païens, bien que moins grossiers ; le tableau est tracé dans le même style que la fin de Romains 1. Ces gens peuvent prétendre haut et fort être l’Église selon une succession ininterrompue ; mais le mot d’ordre est : « détourne-toi de tels gens ». Sans doute tous ne sont pas pareillement malfaisants : il y a des victimes faibles, avec des fautes morales [3:6], et des meneurs comme ceux qui ont résisté à Moïse [3:8]. Mais Timothée était intimement familier avec une vie de piété, de souffrance et de dévouement patient, ainsi qu’avec la vérité dans une forme et une puissance données de Dieu [3:10] ; tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ subiraient des persécutions [3:12], aussi sûrement que les hommes mauvais et les imposteurs deviendraient de plus en plus mauvais [3:13].
D’où la valeur inestimable de ceux dont Timothée avait appris, et de la parole écrite qu’il connaissait depuis l’enfance [3:14-15]. Cela donne à l’apôtre l’occasion d’annoncer pour toute écriture (qu’il s’agisse de l’Ancien ou du Nouveau Testament) les qualités qui en font la seule règle de foi permanente, non seulement la source la plus complète, mais l’unique norme de vérité parfaite et infaillible. Pour l’esprit qui connaît Dieu, voilà ce qu’implique la simple expression « inspirée de Dieu » [3:16-17].
Chapitre 4
Dès lors (2 Tim. 4), l’apôtre missionne très solennellement Timothée devant Dieu et Jésus Christ qui jugera les vivants et les morts ; et ceci par Son apparition et par Son règne, car il n’est pas question ici de grâce céleste, mais de service responsable [4:1]. C’est donc un puissant motif pour stimuler et fortifier son enfant bien-aimé, tant dans la prédication que dans la répréhension, la réprimande et l’exhortation, avec toute longanimité et doctrine [4:2]. Car il y aura un temps où ils n’écouteront pas la saine doctrine, mais selon leurs propres convoitises, ils s’amasseront des enseignants, ayant des oreilles qui leur démangent [4:3] ; et ils détourneront leur oreille de la vérité et se tourneront vers les fables [4:4]. Cette déviation de la vérité n’est peut-être pas l’apostasie, ni la révélation de l’homme de péché ; mais elle semble être le pire développement des derniers jours avant cette crise future, et sans doute elle est déjà arrivée depuis longtemps. Pour faire encore plus impression sur Timothée, l’apôtre parle de son propre départ comme d’un moment tout proche [4:6]. Sa course était achevée. Il attendait l’apparition du Seigneur pour être couronné, et il ne serait pas seul à être couronné, mais aussi tous ceux qui aiment Son apparition [4:8].
La lettre se termine par une série de considérations personnelles profondément intéressantes à bien des égards. Il voulait hâter la venue de Timothée avant l’hiver [4:9], et il semblerait que l’envoi de Tychique à Éphèse avait pour rôle de faciliter cette venue [4:12], Luc seul étant avec l’apôtre [4:11]. C’est avec peine qu’il parle du départ de Démas ; de celui des autres il en parle simplement comme d’un fait [4:10]. Il supplie qu’on lui apporte son manteau laissé à Troas, les livres, et surtout les parchemins : la mort proche devant lui n’entravait en rien le devoir, l’apparition du Seigneur l’exigeait [4:13]. Il n’oublie pas un homme dangereux [4:14], ni le fait que personne ne s’est tenu auprès de lui à l’heure du danger [4:16], mais le Seigneur qui, Lui, s’était tenu près de lui, le ferait jusqu’au bout, le préservant pour Son royaume céleste [4:17-18]. S’ensuit la salutation de sa part et de la part d’autres [4:19-21], et le souhait que la présence du Seigneur soit avec l’esprit de Timothée ; c’était le Seigneur qui l’avait délivré [4:17], et il voulait que Sa grâce soit avec eux tous [4:22].
Chapitre 1 versets 1 et 2
La salutation au début de l’épître est, comme d’habitude, empreinte de l’esprit de tout ce qui va suivre. Une profonde gravité et une tendre affection imprègnent l’ensemble. Il n’est plus question d’ordre dans la maison de Dieu sur la terre dans le moment où l’apôtre est obligé de parler d’une grande maison où se trouvent, non seulement des vases d’or et d’argent, mais aussi de bois et de terre, les uns à honneur et les autres à déshonneur. Dès lors il n’y a plus seulement le devoir de discipline, mais en tout premier lieu le devoir est de se purifier à tout prix des vases à déshonneur si l’on veut être personnellement un vase à honneur, sanctifié, propre à l’usage du Maître, préparé pour toute bonne œuvre. Ce qui est en cause, en bref, c’est le solide fondement de Dieu, avec d’un côté sa consolation infaillible et de l’autre sa responsabilité inaliénable. Or, grâce à Dieu, quoi qu’il arrive, ce fondement tient bon, quel que soit le désordre de la maison ; et en conséquence, l’obligation pesant sur les fidèles demeure, d’autant plus péremptoire pour Sa gloire qu’il y a eu défection générale. La foi ne désespère jamais du bien, ne méconnait jamais le mal, et n’est libre que pour plaire à Dieu, au lieu de se faciliter la tâche par le choix du moindre mal.
Il est inévitable, dans ces circonstances, que prévale un ton de solennité insistante jusqu’à l’importunité. C’est pourquoi il est plus que jamais nécessaire de faire preuve de courage et d’endurance, ainsi que d’une grande jalousie pour la volonté de Dieu et d’une grande détestation des voies mauvaises de l’homme — spécialement de l’homme d’aujourd’hui qui, hélas ! associe le nom du Seigneur à la pire méchanceté de Satan. Le caractère modeste, mais apparemment timide de Timothée, faisait appel au cœur de l’apôtre par l’effet de la puissance du Saint Esprit, pour le préparer au travail ardu et aux conflits qui l’attendaient après le départ prochain de son père spirituel. Les exhortations de la seconde épître s’adressent aux fidèles d’aujourd’hui, plus à fond et de manière moins exceptionnelle, que celles de la première épître, car le côté officiel était davantage présent dans la première, alors que ce qui est moral prédomine dans la seconde. Profitons donc plus pleinement de cette considération. Car il est incontestable que les temps difficiles des derniers jours sont arrivés depuis longtemps, et les ténèbres des scènes finales de l’iniquité sans frein jettent déjà leur ombre devant nous.
Ch. 1:1-2
« Paul, apôtre de Jésus Christ, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est dans le Christ Jésus, à Timothée mon enfant bien-aimé : Grâce, miséricorde, paix, de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur » (1:1, 2).
On peut observer qu’ici, comme dans la première épître, Paul met en avant sa grande mission. L’intimité n’a jamais censé affaiblir la position et l’autorité données de Dieu. Parfois l’apôtre pouvait les fusionner, comme nous le voyons dans la beauté gracieuse de l’épitre à Philémon, où l’autorité risquait de faire grincer la corde qu’il cherchait à faire vibrer dans le cœur de ce précieux croyant. Ici, l’apostolat était nécessaire, non seulement en raison de la nature de l’épître comme dans la première épître, mais aussi pour donner du poids aux directives morales de cette seconde épître. Le sentier de Christ à travers les dilemmes périlleux des derniers jours nécessitait la plus haute expression de l’autorité divine. Sans cette caution, faire par la foi un pas de justice, même le plus nécessaire, expose l’homme de Dieu à être accusé de faire de l’innovation, d’avoir de la présomption et surtout de causer du désordre, — parce que l’état général de la chrétienté était lui-même un état dérogeant à la parole de Dieu, un état figé, fait de tradition.
Ch. 1:1a
Dans la première épitre, Paul se présentait comme « apôtre selon le commandement de Dieu notre Sauveur et du Christ Jésus notre espérance ». Ceci est évidemment plus en rapport avec l’ensemble de l’humanité, car beaucoup de ce qui se rapporte aux saints est extérieur par comparaison aux termes de la deuxième épître. On a ici « par la volonté de Dieu », comme en 1 et 2 Corinthiens, Éphésiens et Colossiens. Cela était nécessaire et sage pour commencer, et cela le reste jusqu’à la fin. La « volonté » de Dieu a une application bien plus vaste et profonde que Son « commandement », si important que soit ce dernier à sa place. Nombreux sont ceux qui évitent de désobéir à un commandement de Dieu, mais qui ne sont guère exercés quant à Sa volonté ; celle-ci englobe une grande variété de situations de vie spirituelle qui surviennent en dehors du cadre d’une injonction formelle. Une distinction de ce genre est tracée par notre Seigneur en Jean 14 (v. 21, 23, 24) entre Ses commandements et Sa parole. Cet ajout « par la volonté de Dieu » dans la deuxième épître à Timothée correspond tout à fait à son caractère large et profond.
Ch. 1:1b
Mais la différence va encore plus loin. Paul était apôtre « selon la promesse de la vie qui est dans Christ Jésus » (2 Tim. 2:1b). Ceci relie clairement la dernière épître de Paul à la première de Jean, qui a comme doctrine caractéristique la vie éternelle dans toute sa plénitude en Christ. Non pas que cela ait jamais été absent des épîtres de Paul. On le voit dans celles aux Romains et aux Corinthiens, aux Galates, aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens, de façon encore plus brillante si cela est possible, et avec plus de force pratique. Mais ici en 2 Tim. 1, la « vie » est surtout liée à son apostolat et, bien sûr aussi à toute la portée de l’épître, qui est sa dernière communication écrite. Pour la première fois, l’Esprit de Dieu la met incontestablement au premier plan.
Mais je pense que la méthode employée n’a pas été du tout saisie correctement. La préposition (κατά) prend son sens le plus ordinaire — « selon » — « en conformité avec », plutôt que « en suivant » ou « en vue de l’accomplissement » etc. Ce n’est pas l’objet et l’intention de l’apostolat qui sont exprimés par « selon la promesse », mais son caractère. Il est certain que l’apostolat de Paul faisait avancer et faisait connaître les promesses de vie éternelle ; mais la vérité révélée ici est que Paul avait été ainsi appelé de Dieu selon, ou en conformité avec, cette promesse de vie. Sa fonction n’était pas seulement d’être serviteur de l’évangile dans toute la création sous le ciel, ni même seulement d’être aussi serviteur de l’assemblée qui est le corps de Christ (Col. 1:23, 24). Maintenant pour la première fois, il se décrit comme apôtre par la volonté de Dieu « selon la promesse de la vie qui est dans le Christ Jésus ». Jamais Timothée, jamais les fidèles, n’ont eu besoin de la connaissance réconfortante et fortifiante de cette vie autant qu’en face des horreurs et des dangers que cette épître contemple. S’il y a quelque chose de tant soit peu réel dans un monde où tout n’est qu’apparence vaine, c’est bien la vie qui est en Christ ; elle est éternelle, car elle est destinée à vaincre par la foi. En l’absence de cette vie, la puissance du Saint Esprit pourrait même agir dans un fils de perdition. « Beaucoup me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé en ton nom, et n’avons-nous pas chassé des démons en ton nom, et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? Et alors je leur déclarerai : je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, ouvriers d’iniquité » (Matt. 7:22, 23). La puissance sans la vie est quelque chose d’extrêmement sinistre et fatal ; la puissance avec la vie est quelque chose d’extrêmement béni et éminemment caractéristique du christianisme. Cela va être soigneusement mis en avant pour notre consolation justement dans ce chapitre de notre épitre. Mais la vie occupe incontestablement la place d’honneur dans le caractère donné ici à l’apostolat de Paul. Personne n’avait la prophétie comme lui, personne ne connaissait comme lui tous les mystères et toute connaissance ; qui, comme lui, avait toute la foi pour transporter des montagnes [1 Cor. 13:2] ? Mais il avait aussi cet amour qui est de Dieu, surpassé peut-être par personne, car il vivait la vie qui est dans le Christ Jésus. Nous ne pouvons donc qu’admirer que son apostolat soit caractérisé, comme nous lisons ici, non par un étalage d’énergie spirituelle, mais « selon la promesse de la vie qui est dans Christ Jésus ».
La vie, comme la foi, est individuelle, mais néanmoins obéissante et donc elle met en honneur et en valeur Christ d’abord, et, immédiatement après, la marche à Sa gloire avec ceux qui sont Siens. Or peut-on vraiment marcher ensemble avec ceux qui n’ont pas la foi pour rester seuls debout si Sa volonté l’exige ? La vie est donc mise en avant dans cette position capitale. Si jamais on a ressenti sa valeur plus qu’auparavant, c’est bien maintenant : la sévérité des temps fait appel à tout ce qui est de Christ. La gloire sur terre avait été l’idole des Juifs à leur sommet ; la gloire céleste dans et avec Christ est l’espérance chrétienne ; mais on a maintenant la vie en Christ, une « promesse » incomparablement plus grande que celles faites à Abraham, à David et autres dignités. Nous l’avons en Lui maintenant, et nous l’aurons manifestement avec Lui, quand nous serons glorifiés. La terre, le monde, ont été la scène des actions de Dieu, et seront celle de Son royaume en puissance et en gloire lorsque Christ apparaîtra et régnera. Mais de même que Paul était l’apôtre selon la promesse de la vie qui est en Christ, de même nous, en L’ayant Lui, nous avons cette vie éternelle dont nous jouirons dans sa propre sphère au-dessus du monde lors de Sa venue ; la nature de cette vie éternelle est totalement indépendante du monde.
Ch. 1:2a
« À Timothée, mon enfant bien-aimé ».
Dans la première épître, il est désigné comme « véritable » enfant (γνησίῳ). On aurait pu croire impossible de ne pas voir une différence intentionnelle. Car les mots utilisés dans la première épître indiquent que Timothée n’était pas un faux fils, mais était son enfant véritable, non seulement dans « la » foi comme possession objective, mais en « foi » en tant que principe vivant réel dans l’âme [1 Tim. 1:2 JND rend ce « en foi » par « dans la foi », l’absence d’article n’étant guère possible en français]. Dans la seconde épître (2 Tim. 1:2), il y a la déclaration expresse de l’affection positive et personnelle de l’apôtre, ce qui n’était visiblement pas une phrase formelle sans signification. Pourtant, un annotateur allemand de quelque réputation (Mack) demande : « Est-il par hasard qu’au lieu de γνησίῳ τέκνῳ [véritable enfant], comme Timothée est appelé dans la première épître 1:2, et Tite dans Tite 1:4, on trouve ici ἀγαπητῳ [enfant bien-aimé] ? Ou se peut-il qu’une raison de ce changement provienne de ce qu’il incombait désormais à Timothée de raviver la foi et la grâce en lui, avant d’être de nouveau digne du nom γνησίον τέκνον [véritable enfant] dans son plein sens ? » Cette remarque superficielle passe à côté de ce qu’on déduit de la manière dont Tite est désigné (lui n’a jamais suscité des sentiments forts de la part de l’apôtre contrairement à Timothée dans les deux épîtres ; pourtant Tite est bien nommé γνησίον τέκνον) ; cette remarque superficielle de l’annotateur allemand a eu une influence des plus néfastes sur la comparaison générale entre les deux épîtres faite par le doyen Alford : il a été induit en erreur sur bien des détails importants. Bengel, Ellicott et d’autres sont beaucoup plus corrects sur ce sujet, de sorte que le regret que le doyen exprime pour leur erreur aurait bien pu être évité. Le manque de discernement est vraiment du côté de ceux qui affectent de voir dans la deuxième épître une perte de confiance de Paul par rapport à Timothée ; cela est rendu encore plus visible en ce qu’ils estiment qu’il y a davantage d’amour. « Plus d’amour simple » ! est une phrase étrange et indigne d’un saint qui devrait mieux en connaître la valeur réelle et inestimable.
Ch. 1:2b
« Grâce, miséricorde, paix de la part de Dieu le Père et de Christ Jésus notre Seigneur ».
Nous avons ici exactement les mêmes expressions que dans la première épître ; or un commentateur aussi célèbre que Calvin a osé chercher à excuser l’apôtre pour toutes les deux, si ce n’est pour le censurer. « Il n’observe pas l’ordre exact ; car il place en premier ce qui aurait dû être en dernier, à savoir la grâce qui découle de la miséricorde. Car la raison pour laquelle Dieu nous reçoit d’abord favorablement et pour laquelle Il aime, c’est qu’Il est miséricordieux. Mais il n’est pas rare que la cause soit mentionnée après l’effet, quand on cherche à donner des explications » (Calvin, Opp. vii. 438. Amstel. 1667). Tel est le commentaire qu’il a fait sur la première épître, et qui est répété en substance dans la seconde. Il est évident que la portée du souhait béni de l’apôtre lui a échappé. Car la grâce est le terme général qui désigne cette énergie et cet épanchement de bonté divine qui s’élève au-dessus du mal et de la ruine des hommes, et qui aime en dépit de tout ; et ainsi il est tout à fait correct et habituel de mettre la grâce en premier lieu dans la salutation, qu’elle soit adressée à des assemblées ou à des saints individuels. La « miséricorde » trouve sa place de manière tout à fait appropriée dans le désir de Dieu de considération et de pitié pour la faiblesse, pour les besoins et les dangers encourus par l’individu, et on la trouve ainsi non seulement en 1 et 2 Timothée, mais aussi en Jude par exception et dans un but spécial, tandis qu’elle disparaît en Philémon où l’assemblée dans la maison modifie la formule à juste titre. La miséricorde étant ainsi subordonnée, aussi douce soit-elle individuellement, occupe la seconde place par une raison incontestablement bonne. Quant à la « paix », s’agissant d’un effet plutôt que d’une cause, elle se trouve là où elle doit être comme personne n’en doute.
Combien il est triste et humiliant que ce manque de respect pour l’Écriture, apparemment inconscient mais néanmoins réel, ait été maintenu sans remise en question dans l’édition et la traduction moderne des écrits de Calvin qu’on admet généralement être au rang des plus grands réformateurs ! Si la révérence pour Dieu se prouve par le fait de trembler à Sa parole, qu’un tel exemple nous soit en avertissement.
Chapitre 1 versets 3 à 7
Ch. 1:3-5
Il est intéressant de noter combien de fois, dans les dernières paroles d’un homme âgé, on entend le rappel de faits antérieurs de sa vie ou des souvenirs. L’inspiration ne met pas cela de côté. L’apôtre parle maintenant de ses « ancêtres », comme il rappelle à Timothée les fidèles prédécesseurs de sa famille :
« Je rends grâce à Dieu, que je sers dès mes ancêtres avec une conscience pure, de ce que je me souviens si constamment de toi dans mes supplications, nuit et jour, désirant ardemment de te voir, me souvenant de tes larmes, afin que je sois rempli de joie, me rappelant la foi sincère qui est en toi, qui a d’abord habité dans ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et, j’en suis persuadé, en toi aussi » (1:3-5).
Ch. 1:3
Il y a une différence dans la manière dont Paul parle de ses ancêtres par rapport à celle dont il parle de la lignée féminine des croyants antérieurs à Timothée. Il n’affirme pas que ses ancêtres étaient fidèles dans le même sens que les ancêtres de son enfant dans la foi. Il ne semble pas aller plus loin que ce qu’il prêche au sujet de « nos douze tribus » en Actes 26:7. Paul servait assurément Dieu avec une conscience pure, et pouvait rendre grâce à Dieu de ce qu’il se souvenait de Timothée. Ce n’était pas seulement une affection remplie de grâce pour son compagnon de travail triste et anxieux ; mais dans ses supplications il avait sans cesse le souvenir de Timothée, désirant nuit et jour ardemment de le voir. Les deux choses étaient vraies. On ne peut concevoir une erreur plus grossière que de croire que la foi détruit l’affection. Il n’y a pas de vie aussi influente que celle de Christ, pas de lien égal à celui du Saint Esprit.
Ch. 1:4b
Mais il y a plus à observer ici : Paul se souvenait des larmes de Timothée, sans nous dire particulièrement pourquoi il les versait. Le contexte implique cependant que c’était l’amertume d’être séparé de son vénéré conducteur ; car la joie, dont l’apôtre désirait être rempli, était de se revoir ensemble. Sans doute il y avait l’affection de Paul pour Timothée, mais l’Esprit de prophétie avait maintes fois prédit les liens et l’emprisonnement, voire la mort, qui attendaient Paul.
Ch. 1:5
Nous pouvons remarquer qu’il y avait en outre ce sujet de reconnaissance de l’apôtre envers Dieu : « me rappelant la foi sincère qui est en toi » — une foi bien nécessaire au vu des perplexités croissantes du peuple de Dieu ici-bas.
C’est en effet une grande joie de penser à quelqu’un de bien-aimé ici ou là, distingué ainsi par l’Esprit, non seulement dans le temps mais pour l’éternité ; et de le considérer comme un objet de l’amour de Dieu, en relation très étroite avec Christ. C’est une douce consolation dans la honte et la douleur que de regarder à un ami qui, par une « foi sincère », est témoin pour Dieu dans un monde incroyant. Tel était Timothée aux yeux de l’apôtre, lesquels, s’ils étaient sur le point de se fermer bientôt sur ce monde, regardaient en arrière la foi qui avait habité d’abord dans sa grand-mère Loïs et sa mère Eunice, et il ajoute avec insistance, « et, j’en suis persuadé, en toi aussi ». Timothée était d’autant plus cher à l’apôtre qu’il avait été profondément exercé et sévèrement passé au crible.
Ch. 1:6
L’apôtre ne pouvait pas le laisser dans un éventuel découragement, ni simplement lui présenter ceux qui l’avaient précédé dans la foi, ni l’encourager d’une manière simplement générale. Il ajoute : « C’est pourquoi je te rappelle de ranimer le don de grâce de Dieu, qui est en toi par l’imposition de mes mains » (1:6).
Ce don (χάρισμα) était l’énergie spéciale du Saint Esprit communiquée à Timothée. Il n’y a aucune raison valable pour douter qu’il s’agit du don évoqué en 1 Tim. 4:14. Seulement là, il est dit que ce don a été donné par prophétie avec l’imposition des mains des anciens ; ici, par l’imposition des mains de Paul. Les anciens étaient associés à Paul, mais la puissance était uniquement dans l’apôtre. Il était seulement le canal divinement employé pour un si grand don. Cela est indiqué par la différence des prépositions « avec » et « par ».
Ch. 1:7
Mais l’apôtre profite de l’occasion pour parler de ce qui, grâce à Dieu, n’est pas spécial et ne fait appel à aucune prophétie. Il s’agit plutôt de la source permanente de puissance pour l’Église de Dieu, le privilège constant garanti par le Seigneur (Jean 14 à 16) à tout croyant dans le Seigneur qui se repose sur la rédemption pendant l’intervalle de temps actuel depuis la Pentecôte. D’où le changement de langage : « car Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais de puissance et d’amour et de sobriété d’esprit » (1:7) [JND : … un esprit de crainte, mais de puissance, et d’amour, et de conseil].
Quoi de plus réconfortant aujourd’hui au milieu de la ruine totale du caractère extérieur de l’église, qui causait déjà à l’apôtre un chagrin si intense lorsqu’il en décrivait les débuts ! Les signes et les prodiges, s’ils pouvaient être en accord avec la volonté et la gloire de Dieu, n’avaient pas été tellement une source de joie et de bénédiction. Ils étaient très importants en leur temps et pour leur but. Ils témoignaient de la victoire de l’Homme ressuscité sur Satan ; ils proclamaient la puissance bienfaisante de Dieu remise aux mains de ceux qui étaient les Siens, au milieu d’une création en ruine. Ces signes et prodiges étaient calculés et utilisés pour attirer l’attention d’une race ténébreuse et endormie vers les nouvelles voies de Dieu agissant en bonté, et qui mettait à l’honneur Celui que l’homme avait rejeté à sa propre honte et s’infligeant une perte irréparable.
Or il y a une grâce encore plus profonde dans la permanence du Saint Esprit donné au chrétien comme à l’église. Cela est d’autant plus vrai quand nous apprenons combien toute la vérité a été affaiblie, tous les principes ont été corrompus, toutes les voies de Dieu ont été à la fois mal comprises et mal interprétées, de sorte que l’ensemble de Son témoignage a fait naufrage dans la chrétienté. Néanmoins, de même que le solide fondement de Dieu demeure, et que le Chef (la Tête) de l’église est exalté à la droite de Dieu de manière infaillible pour aimer, chérir et nourrir Son corps, — de même Son grand don pour nous [le Saint Esprit] est irrévocable et n’est pas un esprit de lâcheté. Le supplanter, hélas ! pourrait bien sembler nous convenir quand on réalise la ruine actuelle de tout ce qui porte le nom du Seigneur ici-bas. Au contraire, Il est donné pour demeurer en nous et avec nous pour toujours, et Son don est celui de la puissance, de l’amour et de pensées saines. Ceci était destiné à encourager Timothée ; et nous, nous en avons encore plus besoin. Cela devrait d’autant plus nous encourager que rien d’autre ne peut le faire.
Car nous devons nous rappeler que l’Esprit de Dieu nous est donné pour que nous en jouissions présentement et pour le service actuel. Il ne nous convient donc ni de nous asseoir sans ressource dans la poussière et la cendre, ni de nous faire valoir comme inébranlables, sinon profanes en continuant à nous tromper en disant que Christ redressera tout quand Il apparaîtra en gloire. Plus nous serons conduits par Lui, plus nous sentirons profondément que le mal environnant est irréparable et que nous devons dès maintenant nous accrocher à Son nom, nous séparer du mal et être associés à ce qui est pieux. Nous ne nous abandonnerons pas au désespoir, mais nous nous croîtrons en foi et en fidélité. Nous serons fortifiés dans l’obéissance, et remplis de l’encouragement divin de la présence du Seigneur, tandis que nous garderons Ses paroles et que nous L’attendrons du ciel.
La conscience du Saint Esprit en nous sera une puissance, non pas pour faire des miracles, mais pour faire la volonté de Dieu, car cela nous attirera dans l’amour de Dieu, et nous conférera un jugement sobre sur tout ce qui convient à Ses saints au milieu de la ruine. Cela est digne de Christ dans un jour mauvais ; et que pouvons-nous désirer de plus jusqu’à ce qu’Il vienne Lui-même, la couronne de bonté et de gloire divine ?
Sur le chemin de Christ, il est inévitable qu’arrive un moment où la foi est mise à l’épreuve. C’est une chose que de tourner le dos aux plus belles prétentions opposées à Son nom, en étant pénétré de la confiance de la grâce et en suivant ce que la vérité commande ; c’en est une autre que de rester ferme et imperturbable lorsque non seulement le monde se détourne de nous, mais que ceux qui confessent Christ se mettent à déserter. Combien rares sont ceux qui peuvent tenir le coup malgré la perte de relations de valeur, sans parler des railleries et des persécutions ! Cet état anormal commençait à faire son effet sur l’esprit sensible et angoissé de Timothée. Cela a longtemps été l’expérience ordinaire des fidèles dans la chrétienté. Ces dernières années en ont fourni d’effroyables illustrations !
Chapitre 1 versets 8 à 11
« N’aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais prends part aux souffrances de l’évangile, selon la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a appelés d’un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein, et sa propre grâce qui nous a été donnée dans le christ Jésus avant les temps éternels [des siècles], mais qui a été manifestée maintenant par l’apparition de notre Sauveur Jésus Christ, qui a annulé la mort et a fait luire la vie et l’incorruptibilité par l’évangile ; pour lequel moi j’ai été établi prédicateur et apôtre et docteur des nations » (1:8-11).
Ch. 1:8a
Il n’y a que l’ignorance de ce que nous sommes qui rend difficile, pour beaucoup, de comprendre les raisons qui portaient Timothée à avoir honte. Lorsque la marée de la bénédiction est à son maximum, il n’y a pas ou peu de place pour la honte. Il en va tout autrement lorsque les rassemblements sont petits et que l’amour de ceux du grand nombre se refroidit, lorsque le monde s’endurcit et devient plus méprisant et que les saints se recroquevillent sous ses reproches. Seule la foi garde à la fois le regard sur Christ et le cœur réchauffé par Son amour dans une atmosphère si glaciale. Son opprobre (car c’est bien celui de Christ) devient alors glorieux à nos yeux ; et « en toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés » (Rom. 8:37). Car le témoignage, si défaillant qu’il puisse paraître, n’en est pas moins le témoignage de notre Seigneur, et le témoin souffrant sous la main injuste de l’autorité humaine est le prisonnier du Seigneur. « N’aie donc pas honte » est le mot d’ordre. La grâce identifie le témoin, qui n’est peut-être pas parfait, avec Son témoignage, qui, lui, est absolument parfait. Devrions-nous jamais défendre ce qui est moins que divin ? Nous ne sommes pas appelés à souffrir ou à porter la honte pour autre chose que pour Christ. Il a encore ici-bas Ses objets précieux à ses yeux. Puissions-nous ne trouver notre part que là, et n’ayons pas honte en ce jour de défection douloureuse.
Ch. 1:8b
Mais il y a plus encore, Timothée était appelé à prendre sa part aux souffrances de l’évangile comme étant assailli et impliqué dans toutes les épreuves possibles. C’est une carence douloureuse si un serviteur de Dieu n’a que l’évangile devant son âme, s’il manque de cœur pour la gloire de Christ en tant que chef (tête) de l’Église, s’il n’entre pas par la foi dans le mystère de Christ et de Son corps, et s’il se désintéresse des joies et des peines qui se rattachent à ces relations bénies. C’est une faute d’être absorbé même par l’évangile au point de renoncer à notre part dans ces privilèges élevés et célestes et aux devoirs qui en découlent, pourtant si proches de Christ et inséparables des conseils de Dieu et de l’amour de Christ. Mais il y a l’erreur inverse, certes plus rare, mais au moins aussi dangereuse et encore plus déshonorante pour Christ parce qu’elle est plus prétentieuse et plus séduisante, — c’est le danger d’occuper les pensées et la vie avec la vérité de l’église et de ses merveilleuses associations au point de déprécier l’évangile et de mépriser ceux qui s’adonnent fidèlement à cette œuvre. L’apôtre à qui nous sommes redevables, plus qu’à tout autre instrument inspiré, de la révélation de l’Église, insiste non moins vigoureusement sur l’importance majeure de l’évangile. Christ est très activement et suprêmement concerné par les deux, et Ses serviteurs devraient l’être aussi, quoi qu’on puisse ne pas être enseignant (docteur) d’un côté, ou ne pas être évangéliste d’un autre côté. Timothée était encore plus responsable en raison de la grâce qui lui avait été accordée, étant à la fois évangéliste et enseignant (docteur). Il lui est enjoint ici de prendre sa part de souffrances de l’évangile, mais selon la puissance de Dieu. Rien ne peut montrer avec plus de force le profond intérêt dans ce à quoi il avait été appelé. Lorsque la mondanité s’installe, les souffrances disparaissent. Lorsque l’église devient mondaine, on y gagne en honneur, en facilités, en émoluments ; et il en est de même avec l’évangile lorsqu’il devient populaire. Si l’évangile et l’église engagent le cœur et le témoignage selon Christ, la souffrance et le rejet sont inévitables. Timothée était donc appelé à prendre la part de Christ dans l’évangile ; et la puissance de Dieu ne ferait pas défaut, même s’il avait à souffrir.
Ch. 1:9a
L’évangile en vaut la peine, « car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit » ; il est entièrement au-dessus de la distinction [Juifs / Gentils] qu’ont fait la loi ou la circoncision. Il provient de l’Esprit, non pas de la chair ; il n’est pas national, mais personnel. Dieu « nous a sauvés ». C’est le fruit de Son œuvre en Christ ; et cette œuvre a été achevée sur la terre, et agréée dans le ciel, et elle demeure pour toujours, complète et immuable. Les hommes peuvent s’éloigner de l’espérance de l’évangile soit par des ordonnances, soit par la philosophie. Les deux sont du monde et presque autant dépourvu de valeur l’un que l’autre ; les deux sont absolument incapables de sauver, bien que l’un soit un signe, et que l’autre soit purement humain. Mais Dieu « nous a sauvés et nous a appelés d’un saint appel ». Ici, « saint » est emphatique et convient parfaitement à cette épitre et à l’état de choses envisagé. Il est toujours vrai que cet appel est saint, mais il était urgent maintenant d’insister sur ce caractère. Il s’agit d’un appel « en haut » ou « vers en haut », comme on lit en Phil. 3:14 [JND « appel céleste »], en contraste avec les choses terrestres dans lesquelles les hommes trouvent leur gloire à leur honte. C’est un appel céleste, comme on le voit encore en Héb. 3:1 ; ceux qui étaient habitués à l’appel extérieur d’Israël dans le pays avaient tout particulièrement besoin de prendre en considération cet appel. C’est l’appel de Dieu avec son espérance dans et avec Christ, où la créature disparaît de la vue et où Ses conseils éternels pour la gloire de Son Fils sont développés pour l’âme, comme en Éph. 1 et 4. Mais maintenant, dans le déclin croissant de ceux qui portent le nom du Seigneur, l’apôtre lie le salut de Dieu à Son saint appel. Un temps mauvais n’est pas du tout un temps pour abaisser la norme, mais un temps pour dévoiler son importance et insister dessus.
Ch. 1:9b
De plus, étant divins, le salut et l’appel de Dieu ne sont pas selon nos œuvres, mais selon Son propre dessein et Sa propre grâce. Même le saint devait prier : « N’entre pas en jugement avec ton serviteur, car devant toi, nul homme vivant ne sera justifié » (Ps. 143:2). Il y a des bonnes œuvres dans tous les saints : « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l’avance, afin que nous marchions en elles » (Éph. 2:10) ; elles ne doivent pas seulement être justes moralement, mais elles doivent aussi convenir à ceux qui, sur la terre, sont unis à Christ dans le ciel, et sont chargés de refléter la grâce céleste — et non plus simplement la justice terrestre. Seules de telles œuvres sont proprement chrétiennes. « Contre de telles choses il n’y a pas de loi » (Gal. 5:23). Or elles sont tout à fait distinctes de celles faites par obéissance légale, aussi exacte que puisse être cette obéissance. Néanmoins, le salut de Dieu est selon l’œuvre de Christ, et non pas selon nos œuvres. Le salut n’est pas non plus de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde (Rom. 9:16), selon Son propre dessein et Sa propre grâce — de Lui qui voulait honorer ainsi parfaitement le Fils comme nous le faisons dans notre mesure par notre foi.
Ch. 1:9c
Cela, encore une fois, nous a été donné dans le Christ Jésus avant les temps éternels [JND les temps des siècles], une vérité très forte et bénie. Ce n’est pas seulement l’assurance d’une sécurité sans fin, mais c’est une grâce donnée en Jésus Christ avant que le temps commence. Il n’en était pas ainsi avec Israël : ils ont été appelés dans le temps. Le dessein de Dieu envers nous, les chrétiens, était dans l’éternité avant qu’aucune créature n’existât. N’en faire qu’une question de sécurité sans fin dans le futur, c’est perdre ce fait merveilleux de la volonté divine concernant les saints qui sont maintenant appelés en Christ à Sa gloire. Leur bénédiction a été un conseil lié à Christ avant que le monde fût et avant que ne soit soulevée aucune question de responsabilité de la créature : Dieu avait le propos de Sa grâce souveraine, de justifier Son amour et de Se glorifier en nous ayant, nous, avec Christ en Sa présence et comme Lui ; c’est pourquoi nous sommes d’autant plus tenus de marcher, maintenant et ici-bas, comme Lui a marché, en justice et sainteté de la vérité, comme l’homme nouveau créé selon Dieu (Éph. 4:24).
Ch. 1:10
Or la manifestation de cette grâce et de ce propos de grâce envers nous, est apparue avec Celui qui a été manifesté en chair et justifié en Esprit (1 Tim. 3:16). Cependant tout dépendait de la dignité de Sa personne, et attendait l’achèvement de Son œuvre, et Son retour en tant qu’homme dans cette gloire d’où Il était venu en tant que Dieu le Fils, afin que ce soit le Fils de l’homme qui ait glorifié Dieu en Lui-même ; et ceci directement (Jean 13:31, 32). Maintenant que l’œuvre infinie de souffrir pour le péché était accomplie, l’humanité était enfin, dans Sa personne, ressuscitée d’entre les morts et glorifiée en haut selon le conseil le plus complet de Dieu. Son dessein et Sa grâce n’étaient plus seulement une question de don comme avant les siècles, mais se manifestaient maintenant par l’apparition de notre Sauveur Jésus Christ, ayant annulé la mort et mis en lumière la vie et l’incorruptibilité par l’évangile.
Cela permet de mieux comprendre le verset 1, car il s’agit de l’accomplissement de la promesse de la vie qui est dans le Christ Jésus. La grâce distribuait ainsi ses réserves incomparables. La mort était annulée en tant qu’empire de Satan sur l’homme pécheur, et Jésus était manifestement Seigneur de tout et Vainqueur de toutes les puissances hostiles et Donateur d’une bénédiction infinie en communion avec Dieu Son Père — et tout ceci en vérité et en justice. Car le péché était porté et emporté, comme l’évangile le déclare à tous les hommes et nous applique la bonne nouvelle par la foi individuellement.
Où est alors la sagesse de l’homme ? Elle était rendue pour toujours honteuse dans Sa croix dont elle avait honte. Où est l’obligation écrite dans des ordonnances qui était contre nous, et qui nous était contraire (Col. 2:14) ? Effacée pour toujours et ôtée du chemin par Celui qui l’avait clouée à la croix, comme la résurrection a jeté sa lumière glorieuse sur l’incorruptibilité du corps qui nous est promis en Lui ressuscité. Il n’est pas étonnant que l’apôtre ait dit aux saints romains, longtemps auparavant (Rom. 1:16), qu’il n’avait pas honte de l’évangile, destiné à être emprisonné, tué et chassé en la personne de ses témoins dans cette ville plus que dans toute autre qui l’ait professé — sans parler de l’ignoble imposture et de la prostitution qui l’ont supplanté et qui l’y supplantent encore.
Ch. 1:11
Il n’est pas étonnant que l’apôtre emprisonné dans cette ville à cause de l’évangile, anticipant que son sang allait bientôt être versé comme une libation (2 Tim. 4:6), ajoute avec une reconnaissance triomphante, « pour lequel [l’évangile] j’ai été établi prédicateur, et apôtre et docteur des Gentils [JND nations] ». Quelques autorités variées et de haute qualité (aleph A 17) omettent « des Gentils [nations] » : d’après le caractère de l’épitre, cela me semble probablement juste ; d’autant plus que les copistes étaient profondément insensibles à un tel détail, mais disposés à assimiler la seconde épitre à la première, où « des Gentils [nations] » a sa place convenable et certaine (1 Tim. 2:7).
Chapitre 1 versets 12 à 14
À peine l’apôtre s’est-il présenté et a-t-il indiqué sa place dans le service, voilà qu’il évoque les souffrances qu’il y endurait et qui étaient au moins aussi extraordinaires que ses travaux.
« C’est pourquoi aussi je souffre ces choses, mais je n’ai pas de honte, car je sais qui j’ai cru, et je suis persuadé qu’il est capable de garder ce que je lui ai confié (ou : mon dépôt) jusqu’à ce jour-là. Aie un aperçu [JND : modèle] des saines paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l’amour qui sont dans le Christ Jésus. Garde la bonne chose (ou : le bon dépôt) qui t’a été confié par l’Esprit Saint qui habite en nous » (1:12-14).
Ch. 1:12a
Personne n’était plus éloigné des châtiments superstitieux ou des peines de la propre justice ; pourtant, où a-t-on jamais vu une telle endurance pendant toute la vie, sous les formes les plus variées, pour le témoignage de Christ ? « Dans les travaux surabondamment, sous les coups excessivement, dans les prisons surabondamment, dans les morts souvent, (cinq fois j’ai reçu des Juifs quarante [coups] moins un ; trois fois j’ai été battu de verges ; une fois j’ai été lapidé ; trois fois j’ai fait naufrage ; j’ai passé un jour et une nuit dans les profondeurs de la mer) ; en voyages souvent, dans les périls sur les fleuves, dans les périls de la part des brigands, dans les périls de la part de mes compatriotes, dans les périls de la part des nations, dans les périls à la ville, dans les périls au désert, dans les périls en mer, dans les périls parmi de faux frères, en peine et en labeur, en veilles souvent, dans la faim et la soif, dans les jeûnes souvent, dans le froid et la nudité » (2 Cor. 11:21-27). Et ce n’est là que la partie extérieure de ce qu’il appelle sa « folie », c’est-à-dire le fait de parler de lui-même au lieu de Christ, à quoi il était forcé par ses détracteurs à Corinthe. Mais quelle vie d’amour indiquent de telles souffrances, quel dévouement à Celui qui l’avait désigné pour être un héraut, un apôtre et un enseignant (docteur) !
Ch. 1:12b
Avait-il alors « honte » ? Il se glorifiait plutôt de ce qui, humainement parlant, était une humiliation. S’il est nécessaire de se glorifier, dit-il, « je me glorifierai de mon infirmité » : « c’est pourquoi je me glorifierai plutôt dans mes infirmités (et non de mes fautes ou de mes péchés), afin que la puissance de Christ demeure sur moi. C’est pourquoi je prends plaisir dans les infirmités, dans les outrages, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ ; car quand je suis faible, alors je suis fort » (2 Cor. 12:9-10). De même que ce qui est hautement estimé parmi les hommes est une abomination aux yeux de Dieu (Luc 16:15), de même, pour l’esprit spirituel, rien n’est aussi glorieux pour un saint ici-bas que l’opprobre, le rejet et la souffrance à cause de Christ et de Son témoignage. C’est la raison pour laquelle Paul souffrait alors comme tout au long de Sa course, car le Seigneur avait dit : « Je lui montrerai combien il doit souffrir pour Mon nom » (Actes 9:16). Mais c’était aussi une grande grâce que, au lieu de se plaindre comme Jérémie, il abondait en courage, en joie et en triomphe, SANS honte.
Paul était-il alors un homme à la constitution de fer, un cœur de chêne, qui rejetait tous les coups et toutes les blessures, comme s’il était insensible ? « Vous savez », dit-il à ceux qui auraient dû bien le connaître, « que dans l’infirmité de la chair je vous ai évangélisé au commencement ; et vous n’avez point méprisé, ni rejeté avec dégoût ma tentation qui était en ma chair ; mais vous m’avez reçu comme un ange de Dieu, comme le christ Jésus » (Gal. 4:13-14). Ses circonstances étaient aussi éprouvantes que sa santé était défaillante ; cependant il continua pendant des années, nuit et jour, avertissant chacun avec larmes, ne convoitant ni l’argent, ni l’or, ni les vêtements de personne, mais ses mains travaillant pour répondre aux besoins des autres aussi bien que de lui-même. En vérité, il n’avait honte de rien, mais avec toute la hardiesse de la grâce, comme toujours, il magnifiait Christ dans son corps, que ce soit par la vie ou par la mort.
Ch. 1:12c
Qu’est-ce qui le soutenait ? « Car je sais qui j’ai cru ». C’est la foi, mais c’est la Personne qui est crue, et une réelle connaissance intérieure de Lui s’était ainsi formée. Aucune autre connaissance n’a une pareille valeur pour l’éternité ; cependant il y a en elle de la communion avec Dieu, comme maintenant le Saint Esprit la communique par la parole. La voix de Christ est entendue, crue et connue ; car même si les canaux sont nombreux, Christ est unique, et la voix de tout autre n’est que la voix des étrangers (Jean 10:5). Ses paroles sont esprit, et elles sont vie (Jean 6:63) ; et cette vie dépend de Lui qui en est la source — de Lui qui suscite la confiance d’autant plus qu’Il est connu sans amoindrir la dépendance. En Lui, nous avons la rédemption par Son sang ; et comme Il est Lui, nous sommes nous aussi dans ce monde (1 Jean 4:17) : l’acceptation est complète et parfaite, selon la gloire de Sa personne et l’efficace de Son œuvre.
Ch. 1:12d
C’est pourquoi l’apôtre ajoute : « et je suis persuadé qu’il est capable [JND : il a la puissance] de garder mon dépôt — ce que je lui ai confié — jusqu’à ce jour-là ». Par « mon dépôt », il faut entendre tout ce que, comme croyant, je confie à la garde de Dieu, non seulement la sécurité, mais aussi la bénédiction de l’âme et du corps, de la marche et de l’œuvre, avec toutes les questions que l’on peut imaginer devoir se poser quant au passé, au présent et à l’avenir. Comme il est clairement question de responsabilité, il est fait référence comme d’habitude à « ce jour-là », qui déclarera la mesure de la fidélité de tous les saints lorsque chacun recevra sa louange de la part de Dieu. La venue ou « présence » du Seigneur, comme cela est bien connu, est l’aspect de la grâce pure lorsque tous seront faits à la ressemblance du Seigneur pour être avec Lui pour toujours.
Ch. 1:13
Cela conduit l’apôtre à insister auprès de son compagnon de travail sur une exhortation de la plus haute importance concernant son propre service de Christ auprès des autres. « Aie un aperçu [JND modèle, et en note : exposé, sommaire] des saines paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l’amour qui sont dans le Christ Jésus » (1:13).
La version autorisée anglaise (KJV) donne « Tiens ferme la formule des saines paroles » ; or « tiens ferme » va bien au-delà de la force du premier mot, et également l’article « le » devant le mot « aperçu / formule / form » est aussi injustifié. Timothée avait eu l’habitude d’entendre les choses qui nous sont librement données par Dieu, dites en paroles non pas enseignées de sagesse humaine, mais en paroles enseignées de l’Esprit (1 Cor. 2:12-13), ce qui est décrit ici comme étant des « saines paroles ». Or il n’y avait pas de formule qu’il était appelé à garder et tenu de garder ; il y avait simplement la vérité transmise dans des expressions divinement enseignées, qu’il avait entendues auparavant de Paul, et dont il devait tenir compte jalousement maintenant que la fin de ce puissant témoignage était proche.
Car l’homme n’est pas compétent pour donner la vérité sous de nouvelles formes sans la modifier et ainsi altérer, sinon corrompre, le témoignage de Dieu. Il ne suffit pas d’avoir les choses de l’Esprit ; les paroles dans lesquelles elles sont transmises doivent être de l’Esprit également, afin de communiquer les pensées de Dieu en perfection ; et donc, pour qu’elles soient une règle de foi, nous devons avoir la parole de Dieu. Maintenant que les autorités inspirées n’existent plus, l’Écriture seule est parole de Dieu ; et elle est tout à fait distincte à la fois du ministère et de l’assemblée.
Le ministère est le service régulier de Christ exercé par un don pour communiquer la vérité, que ce soit l’évangile communiqué au monde, ou la vérité en général communiquée aux saints. Mais même si aucune parole n’était erronée (ce qui est rarement le cas — on en est même loin), il ne s’agit pas d’une inspiration et donc nullement d’une règle de foi.
Quant à l’assemblée, elle peut encore moins être considérée à juste titre comme inspiration ou règle de foi. Elle est responsable de recevoir et de refléter la parole de Dieu. Elle est colonne et soutien de la vérité, le gardien responsable et le témoin collectif de l’Écriture sainte ; c’est ce qu’était Israël autrefois vis-à-vis de la loi et des prophètes, les oracles vivants leur étant confiés. Mais c’est l’Écriture elle-même qui demeure la règle de foi.
C’est pourquoi, dans cette dernière épître de Paul, nous avons les formules répétées qui insistent sur le devoir de prêter attention aux saines paroles entendues de l’apôtre. Timothée devait avoir un aperçu ou un échantillon de ces paroles, dont l’autorité était gravée dessus de la part de Dieu ; car Timothée n’avait pas une telle autorité, et encore moins les saints qui devaient en tirer profit. Or l’état d’âme de Timothée jouait un grand rôle pour qu’il en soit fait un heureux usage auprès des autres ; d’où l’importance de « avec la foi et l’amour qui sont dans le Christ Jésus ». La mémoire, aussi exacte soit-elle, ne suffit pas. La foi et l’amour, qui ont leur puissance en Jésus Christ, allaient les rendre d’autant plus en mesure de faire impression.
Ch. 1:14
Le verset qui suit me semble résumer ce à quoi le v. précédent exhorte en détail : « Garde le bon dépôt par l’Esprit Saint qui habite en nous » (1:14), ce qui est une sorte de contrepartie du v. 12.
Au v. 12 l’apôtre se reposait avec une sainte satisfaction sur ce que Dieu gardait ce qu’il Lui avait confié. Ici c’est l’autre face : Timothée est appelé à garder ce qu’il lui a été confié, Dieu y apportant Son aide par l’Esprit Saint qui habite en nous. Car l’Esprit donné demeure avec nous pour toujours. Il peut être affligé par nos péchés et notre folie ; mais Il n’abandonne pas le saint depuis la rédemption. Il est là, lorsque le jugement de soi corrige les obstacles, pour agir dans sa propre puissance de grâce à la gloire de Christ qui L’a envoyé justement dans ce but.
On remarquera qu’il n’est pas dit que l’Esprit demeure « en toi », mais « en nous ». C’est une expression habituelle dans l’Écriture, et c’est incomparablement mieux que si cela était dit de Timothée seul. Un don spécial lui avait été conféré par prérogative apostolique ; mais Timothée comme tout autre saint partageait l’inexprimable privilège, pour la mission duquel il était avantageux que Jésus même s’en aille (Jean 16:7). C’est la puissance commune et caractéristique du chrétien ; et il était donc approprié que, tout en rappelant à Timothée Celui qui est tellement en mesure d’aider à notre infirmité, il ait clairement devant son âme que les saints en général ont réellement l’Esprit divin habitant en eux. Il était bon pour lui et pour eux d’avoir devant eux le réconfort et le stimulant d’un fait si béni, et pourtant si solennel.
Nous ne saurions trop insister sur ce que les précieux privilèges dont la grâce de Dieu en Christ a investi les croyants sont des faits permanents, et non de simples idées ou sentiments passagers. Ils sont en effet prévus pour exercer et remplir pleinement les pensées ; c’est un état bien misérable si l’on possède ce qui dépasse tellement la pensée et l’affection humaine, et qu’on semble l’estimer moins que les choses passagères du jour et les objets insignifiants qui nous occupent. La vie de Christ, Sa mort et Sa résurrection, la rédemption par Son sang, l’union avec Lui en haut, Son intercession à la droite de Dieu, — voilà des faits sur lesquels l’âme peut se reposer, autant que sur Sa Déité et Son humanité en une seule personne. Il en est de même avec la présence du Saint Esprit envoyé du ciel, et Ses diverses opérations dans l’assemblée et dans l’individu. Le croyant se trouve dans une relation vivante présente avec tous ces éléments, qui sont aussi certains et infiniment plus importants que les liens de parenté naturelle ou de pays d’origine, que personne de sensé ne conteste. Combien il est blâmable de ne pas y penser ! et quel encouragement solide pour les cœurs tremblants ! Il suffit de réfléchir à ce que la grâce a fait nôtre en Christ pour déborder d’action de grâce et de louange.
Cependant le témoignage de notre Seigneur comporte davantage que des épreuves ou des souffrances, et personne ne l’a autant éprouvé que l’apôtre. Être persécuté par des ennemis peut être amer, mais c’est glorieux si c’est pour l’amour de Celui qui l’occasionne du fait du monde actuel. Mais qu’est-ce que cela par comparaison avec l’abandon par des amis ? Ici, la vie qui est en Christ trouve un nouveau champ d’action. Pour glorifier le Seigneur au travers d’une telle épreuve, combien il faut que la parole ait une profonde valeur, et combien il faut l’énergie de la puissance du Saint Esprit qui habite en nous ! L’œil simple qui regarde à Christ seul, peut soutenir dans cette épreuve ; comme l’apôtre le ressentait alors au plus haut point, il n’hésite pas à en faire état devant l’esprit sensible de son enfant bien-aimé.
Chapitre 1 versets 15 à 18
Ch. 1:15
« Tu sais ceci que tous ceux qui sont en Asie se sont détournés de moi, dont Phygelle et Hermogène » (1:15).
Nous ne savons rien sur ces deux personnes, mais Timothée était au courant, comme Paul, qui cite leur nom comme étant les exemples les plus douloureux de l’abandon qui déchirait le cœur de l’apôtre. Timothée savait bien ce que leur absence de cœur causait comme détresse pour le serviteur du Seigneur et comme déshonneur pour le Maître. L’attitude du chrétien vis-à-vis d’une telle conduite ne consiste pas avoir du mépris ou de la rancœur. On peut tout entendre, même si c’est humiliant et douloureux. Car nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon Son dessein (Rom. 8:28). Leur défection préparait Timothée et de nombreux autres à sa suite à d’autres défections du même genre. L’Écriture ne rapporte rien en vain. Il est vrai que nous sommes encouragés et fortifiés pour les conflits en regardant au Chef du salut et non pas aux déserteurs. Mais il est bon d’être préparé à ce qui a été, à ce qui pourrait être, pour ne pas dire à ce qui sera et aura lieu de temps en temps pour les mêmes raisons. C’était d’autant plus important d’en parler à Timothée à ce moment-là, du fait qu’il allait bientôt perdre la présence encourageante et les exhortations brûlantes de celui qui lui écrivait ; s’il allait perdre sa voix d’homme vivant, celle-ci resterait toujours entendue et elle demeure toujours comme la parole du Dieu vivant.
Examinons plus précisément ce que semblent signifier ces paroles touchantes. L’Asie, ou Asie proconsulaire, avait été la scène d’un triomphe éclatant de l’évangile. C’est là que la parole du Seigneur avait pu croître puissamment et prévaloir, spécialement dans sa capitale d’Éphèse. C’est aux saints de cette localité que l’apôtre avait écrit son épître la plus élevée et la plus riche, avec la particularité unique qu’il n’y avait aucune faute ou danger au milieu d’eux dont il fallait s’occuper ; néanmoins il n’y manquait pas de les mettre en garde contre les maux les pires et les plus vils dans lesquels Satan pourrait les entrainer, ce dont le risque serait d’autant plus fort si ce sommet de grâce et de vérité était écarté ou méprisé. Timothée connaissait bien l’Asie, en particulier Éphèse. C’est là que l’apôtre le fit rester lorsqu’il se rendit lui-même en Macédoine (1 Tim. 1:3) ; il avait eu à maintenir le témoignage qui y avait été planté et à préserver les saints contre tous les désordres de l’homme que Satan voulait utiliser pour le supplanter.
Mais maintenant, l’apôtre peut considérer que Timothée connaissait cette désertion par lui-même, et qu’elle remplissait son cœur de chagrin, non pas de consternation. Tel est l’effet de l’amour divin répandu dans le cœur, et Paul voulait que Timothée le ressente selon Christ. Cela ajoute sans doute à l’angoisse, mais délivre de l’égoïsme comme de la rancœur. Timothée avait besoin qu’on le lui présente ainsi, même s’il connaissait les faits. Les expressions utilisées par l’apôtre font supposer, semble-t-il, un acte précis, plutôt qu’un état général ; néanmoins il y avait sans doute eu un état antérieur qui avait préparé la voie pour que cet acte les indigne pareillement.
Il est vrai que se détourner de Paul est très différent d’abandonner l’évangile ou l’église, ou de renoncer à telle ou telle vérité. Mais au moment où le Seigneur donnait à Son serviteur très honoré de souffrir, non pas en raison d’une quelconque défaillance de sa part, mais à cause du dépôt divin, à cause de Son témoignage ici-bas, il était lamentable que qui que ce soit déserte un tel serviteur en un tel moment : combien plus si la désertion était générale et moralement universelle là où la vérité avait été le mieux connue et où la grâce avait pu être mise en lumière dans toute sa hauteur, sa profondeur et son ampleur comme nulle part ailleurs ! Le contexte me fait juger que cette désertion déplorable et coupable était due à l’emprisonnement de l’apôtre. L’ennemi a tiré profit de la honte humaine déversée sur le plus grand serviteur de l’Église et de l’évangile. Ceux qui avaient été le fruit abondant de ses travaux dans la puissance divine s’étaient en fait joints au monde en esprit, se recroquevillant sous la honte, alors que la foi et l’amour auraient dû leur permettre de s’identifier aux souffrances de l’apôtre comme contribuant à glorifier le nom de Jésus.
Ch. 1:16
Mais se détourner de Paul n’était pas le fait de tous, même en Asie. Il y avait au moins une brillante exception, car une période de mal généralisé est toujours utilisée par la grâce de Dieu pour faire ressortir une fidélité et un dévouement exceptionnels.
« Le Seigneur fasse miséricorde à la maison d’Onésiphore, car il m’a souvent consolé et n’a point eu honte de ma chaîne ; mais quand il a été à Rome, il m’a cherché très soigneusement et il m’a trouvé (le Seigneur lui fasse trouver miséricorde de la part du Seigneur dans ce jour-là). Et tu sais très bien combien de services il a rendus à Éphèse » (1:16-18).
Le contraste aide beaucoup à montrer avec précision où se situe la défection générale ; et c’est avec des intérêts composés que le Seigneur rémunéra « la maison d’Onesiphorus » pour la grâce qu’Il avait accordée à son chef. « Il m’a souvent consolé », dit l’apôtre plein de grâce, faisant comme le Maître quand Il disait aux pauvres disciples : « Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes tentations, et moi, je vous confère un royaume, comme mon Père m’en a conféré un… » ! (Luc 22:28, 29).
Mais Paul souligne également le fait crucial : « et il n’a pas eu honte de ma chaîne ». L’amour témoigne de sa vérité, de son caractère et de sa puissance à l’heure du besoin. Comment agissaient « tous ceux qui étaient en Asie » ? Eux en avaient manifestement honte. La prudence charnelle blâmait le zèle pour Christ qui en était à l’origine ; et l’esprit mondain se désolidarisait entièrement de l’apôtre emprisonné. Comment le Seigneur considérait-Il une telle timidité égoïste ? Le Saint Esprit en marque la bassesse de façon indélébile sur la page éternelle de l’Écriture.
Ch. 1:17
Mais Il souligne l’exception bénie de celui dont le cœur s’attacha d’autant plus à l’apôtre, non seulement dans la province d’Asie, mais dans la métropole orgueilleuse où l’apôtre était dans les liens. « Mais étant à Rome, il m’a cherché très soigneusement1 » ; et non pas en vain.
1 Il s’agit d’un comparatif dans les versets 17 et 18, et non du positif ni du superlatif : une formule idiomatique grecque typique, qui, si on développe l’ellipse, s’exprimerait ainsi : « avec plus de diligence qu’on ne pouvait s’y attendre » (1:17) et « sachant mieux que d’exiger qu’on en dise davantage » (1:18).
Ch. 1:18
Il a trouvé l’apôtre abandonné : « Que le Seigneur lui fasse trouver miséricorde de la part du Seigneur en ce jour-là » ! Il est vrai que c’est ce que nous attendons tous par la foi (Jude 21) ; mais la prière de l’apôtre n’en est pas moins douce et réconfortante, certainement aussi efficace que celle d’Abraham autrefois en rapport avec le gouvernement actuel de Dieu. Mais ce n’est pas tout ce qui est dit ; car il fait appel à Timothée comme sachant très bien combien Onésiphore avait rendu de services à Éphèse. L’apôtre ne se limite pas, comme le fait la Version Autorisée KJV avec d’autres, aux services rendus à lui-même : la formulation générale de la phrase laisse de la place pour ce qui était personnel, bien sûr, mais elle implique beaucoup plus, comme l’apôtre prend bien soin de le dire. Personne ne le savait mieux2 que Timothée qui n’avait pas besoin d’explications supplémentaires.
2 voir note au paragraphe précédent
Chapitre 2 versets 1 à 7
Ch. 2:1-2
L’appel à Timothée par lequel le ch. 2 débute, forme un contraste fort avec la désertion de l’apôtre qui s’était répandue parmi les saints de l’Asie proconsulaire.
« Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est dans Christ Jésus. Et les choses que tu as entendues de moi devant beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles, capables d’instruire aussi les autres » (2:1, 2).
Ch. 2:1
Voilà la source de toute fortification réelle de l’âme venant de Dieu : « la grâce qui est dans le Christ Jésus ». La présence et l’enseignement de l’apôtre ont contribué de façon inestimable à la bénédiction des saints ; mais il pouvait dire aux chers Philippiens, « comme vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement » (Phil. 2:12). En tout cas, même si les autorités disparaissent, que ce soit les plus hautes ou les plus basses dépendantes de la nomination par les premières, Dieu continuait à opérer dans les saints pour qu’ils veuillent et à la fois pour qu’ils agissent selon, ou pour, Son bon plaisir. Ainsi les saints de Philippes nous donnent la preuve de la puissance de la grâce en Christ pour garder et pour fortifier en toute obéissance ; à l’inverse le fait de se détourner de celui qui les avait appelés par la grâce de Christ, pour se tourner vers un autre évangile qui n’en était pas un autre, a fait l’objet d’un avertissement triste mais ferme auprès des Galates. Les Galates étaient autant que les Philippiens le fruit du travail de l’apôtre, et malgré l’infirmité dans laquelle Paul leur avait prêché au commencement (ce qui n’était pas une petite épreuve ni pour lui ni pour eux), ils l’avaient reçu comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus, au lieu de manquer d’égards ou de le repousser. Depuis, ils étaient si affaiblis par le zèle légal de ceux qui voulaient les écarter de l’apôtre qu’il lui fallait leur demander s’il était devenu leur ennemi en leur disant la vérité, alors qu’au commencement ils se seraient arraché leurs propres yeux, si cela avait été possible, pour les lui donner. Il est bon, ajoutait-il solennellement, d’être zélé pour le bien en tout temps, et pas seulement quand je suis présent avec vous (Gal. 4:13-18).
Voilà donc le secret en tout temps et en toutes circonstances ; mais il était tout spécialement opportun d’insister vis-à-vis d’un compagnon de travail de confiance ayant un caractère timide et de rang modeste, alors que l’apôtre se rendait pleinement compte de la ruine du témoignage de l’église et de la proximité de son départ personnel. Il n’y a pas lieu de s’étonner des termes emphatiques par lesquels il exhorte son enfant à puiser dans le riche et incessant courant de la grâce. La foi dans la seule grâce de Christ s’abreuve librement et a en elle cette fontaine d’eau vive qui jaillit en vie éternelle (Jean 4:14) ; la foi en Celui qui seul est maintenant glorifié, est seule à avoir des fleuves d’eau vive coulant de son intérieur (Jean 7:38). Quel que soit le besoin, Sa plénitude est la même, sans limite, accessible et gratuite ; quel que soit le danger, Il a vaincu le monde et le diable, Lui qui a souffert pour nous, pour nos péchés une fois pour toutes ; et Celui qui entend tous nos appels et qui nous aime sans variation, c’est Lui qui connaît tout et a toute puissance et toute autorité. Timothée avait besoin de cette grâce pour le fortifier. Elle nous est révélée, et elle est aussi vraie pour nous qui n’en avons pas moins besoin à notre place. Elle nous est également ouverte et sûre. Oh, puissions-nous nous regarder à Lui en toute confiance pour nos besoins, les nôtres et ceux des autres !
Ch. 2:2
Mais il y a plus que nous encourager dans le Seigneur quand la détresse abonde et que les difficultés s’accumulent et que les dangers nous menacent et nous effraient. Si la vérité en Christ est nécessaire pour traiter et vivifier les âmes mortes, elle n’en est pas moins nécessaire et valable pour les saints. Il s’agit ici de former et d’équiper ceux qui doivent instruire les autres.
Nous devons distinguer les divers usages de la révélation divine. La parole de Dieu est la norme de la vérité : rien d’autre ne sert ou ne peut servir à tester pareillement, et dans sa merveilleuse plénitude, aucun mot n’est superflu ou vain ; il s’y trouve la pierre de touche spéciale de Jésus Christ venu en chair, que l’Esprit Saint conduit toujours tout vrai témoin à confesser, tandis que l’esprit d’erreur l’esquive ou le nie toujours. Or d’une manière générale, on peut dire que le dépôt apostolique met la foi et l’incrédulité à l’épreuve. Un Juif aujourd’hui reconnaitrait peut-être sincèrement tous les anciens oracles appelés Ancien Testament. Est-il croyant pour autant ? Assurément non, car il n’écoute pas les apôtres, il les rejette (1 Jean 4:6). Vous êtes de Dieu, dit le disciple bien-aimé aux petits enfants (1 Jean 4:1-6), la vraie famille de la foi, et vous avez vaincu les nombreux faux prophètes qui sont sortis dans le monde et l’esprit mauvais qui les anime : parce que Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ils sont du monde : c’est pourquoi ils parlent selon les principes du monde, et le monde les écoute. Mais cela ne suffit pas pour terminer ce qu’il avait à dire, et ce que, eux, devaient peser et tenir fermement : Nous, nous sommes de Dieu ; et non pas « vous » seulement, qui êtes nés de Lui, étant engendrés par la parole de la vérité (Jacq. 1:18) ; nous, nous sommes comme Ses témoins inspirés en communiquant cette vérité qui, depuis le rejet de Christ, met les âmes à l’épreuve plus que tout. Celui qui connaît Dieu nous écoute ; celui qui n’est pas de Dieu ne nous écoute pas : à cela nous connaissons l’esprit de vérité et l’esprit d’erreur.
Ici cependant, il s’agit des moyens de communiquer la vérité, plutôt que de la parole agissant ou employée comme sa norme. Quand il s’agit d’édifier, il n’est pas nécessaire de faire des appels si tranchants et solennels. L’Écriture est sans aucun doute le moyen le plus complet, le plus exact et le plus fiable pour transmettre les pensées de Dieu ; mais Sa grâce utilise bien d’autres choses depuis le berceau jusqu’au lit de mort. Parmi celles-ci, une place capitale revient à un ministère sain, compétent, plein de grâce et intelligent. Et la mission donnée ici par l’apôtre à son associé bien-aimé a vraiment pour but d’assurer un service efficace de ce genre. Personne sur terre, nous pouvons le supposer, n’avait autant que Timothée bénéficié des paroles entendues du plus grand des apôtres. Ici il est interpellé pour garder à l’esprit que ce qu’il avait reçu n’était pas pour lui seulement, mais pour les autres, et que les meilleurs résultats devaient être obtenus par grâce au moyen de ceux qui avaient la capacité d’enseigner fidèlement. Dans le ministère ou le service de la parole, c’est seulement le fanatisme, et non la foi, qui nie l’importance de la compétence ; dans la parabole des talents, le Seigneur donne souverainement des talents à Ses serviteurs (à l’un cinq, à un autre deux, à un autre un), mais à chacun selon sa propre capacité (Matt. 25:15). Ce n’est pas que la capacité soit un don, ni que les talents (Ses biens) doivent être confondus avec les diverses capacités de chaque serviteur, comme le fait le langage populaire et même la théologie marquée par la vaine gloire. Non seulement toutes les écritures qui traitent de ce thème parlent de « dons » comme étant totalement différents de la capacité de chacun en termes de source et de caractère, mais même dans la parabole ils sont distingués de la manière la plus claire, tandis que l’ignorance savante considère cette parabole comme abondant en vagues décors.
Nous devons également prendre note d’une autre idée fausse très courante sur ce verset. Selon de nombreuses personnes excellentes et érudites, l’apôtre serait censé confier à Timothée la responsabilité de faire des ordinations à des fonctions ecclésiastiques. Or ce verset n’en dit rien du tout. 1 Tim. 3:1-7 présente les qualités requises pour un surveillant, ou évêque ; et sans aucun doute l’évêque doit être apte à enseigner (διδακτικός, mais pas nécessairement un enseignant διδασκαλός). Or gouverner était leur devoir caractéristique ; c’est ce qui est dit en 1 Tim. 5:17 : « Que les anciens qui gouvernent bien [JND qui président dûment] soient estimés dignes d’un double honneur, spécialement ceux qui travaillent dans la parole et l’enseignement ». Le sophisme est que d’autres personnes qui n’étaient pas des anciens pouvaient enseigner et n’enseignaient pas, ce qui est en contradiction directe avec les faits, les paroles et les principes du Nouveau Testament sur ce point. Aucune expression de notre v. 2 n’énonce ou ne sous-entend la notion d’ancien. La pleine signification de l’ensemble et de chaque partie est satisfaite en n’allant pas au-delà des hommes fidèles instruits par Timothée, comme l’apôtre le prescrit, afin qu’ils soient compétents pour enseigner aussi les autres.
Pesons un peu la belle formulation des paroles de l’apôtre afin de mieux apprécier leur sagesse et leur cohérence avec la vérité révélée ailleurs. L’apôtre n’avait rien caché des choses profitables (Actes 20:20) à un tel compagnon de confiance. Il avait presque achevé sa course et le ministère qu’il avait reçu du Seigneur Jésus pour témoigner de l’évangile de la grâce de Dieu (Actes 20:24). Il n’avait mis aucune réserve pour annoncer tout le conseil de Dieu (Actes 20:27) à d’autres personnes moins proches et moins honorées que Timothée. Voilà donc ce que Timothée avait entendu de sa part devant de nombreux témoins, et qu’il devait confier à des hommes fidèles. Comme les sujets dont il était témoigné n’avaient pas été faits dans un coin, l’apôtre avait discouru ouvertement de la précieuse vérité en présence de nombreux témoins. Le Seigneur avait déjà fait remarquer que les hommes ne mettent pas une lampe allumée dans un lieu caché (Luc 8:16 ; Marc 4:21), ni sous le boisseau, ni sous le lit ; l’apôtre était un témoin infatigable et de tout son cœur pour Christ auprès de tous les hommes au sujet de ce qu’il avait vu et entendu, ainsi que des choses pour lesquelles le Seigneur lui était apparu. Les « nombreux témoins » devant lesquels Timothée avait entendu ces choses de la part de Paul, n’étaient pas seulement un encouragement à une plus grande diffusion de la vérité, mais étaient là pour confirmer les communications faites. Car ici, les nombreux témoins ne sont pas là comme ayant contribué à l’inspiration, mais ils sont là pour confirmer l’exactitude de l’information et pour la propagation de la vérité. Si Christ est la vraie Lumière, les Siens sont aussi la lumière du monde. Il ne suffit pas d’être le sel de la terre, aussi bon soit-il : il faut agir en grâce — la lumière se diffusant et dissipant les ténèbres. Pour cela, il faut des vases adaptés, non pas des hommes instruits, ni même éduqués, mais des « hommes fidèles ». C’est à eux que Timothée devait confier ce qui était révélé de Dieu, afin d’édifier les âmes et de leur donner un héritage avec tous les sanctifiés (Actes 20:32). Au niveau des faits, il n’est pas supposé que les hommes fidèles soient nécessairement des hommes capables d’enseigner. Il s’agit plutôt de dire des hommes fidèles « tels qu’ils soient » capables pour enseigner aussi aux autres. Tout est aussi simple que magnifiquement précis.
Ch. 2:3-6
L’apôtre reprend maintenant ce qui est plus personnel que relatif, bien qu’il s’élargisse progressivement à ce qui est général et de la plus grande importance pour les serviteurs de Christ.
« Prends ta part de souffrance comme un bon soldat de Jésus Christ. Personne en service ne se mêle des affaires de la vie, afin de plaire à celui qui l’a enrôlé. Mais si quelqu’un combat [dans les jeux], il n’est pas couronné s’il n’a pas combattu selon les lois. Le laboureur doit premièrement avoir part aux fruits [JND Il faut que laboureur travaille premièrement, pour qu’il jouisse des fruits] » (2:3-6).
Ch. 2:3
On remarquera que les mots « Toi donc » disparaissent. Ces mots [qui figurent dans la version autorisée KJV] sont probablement une importation, peut-être par inadvertance, du v. 1, où l’accent est mis sur l’intention et le moment. Ici, une telle insistance est non seulement injustifiée, mais elle serait impropre. La sensibilité timide de Timothée nécessitait (v. 1) un appel personnel à se rejeter sur la grâce dans le Christ Jésus pour se fortifier intérieurement ; et cela tout particulièrement pour communiquer la vérité à des hommes fidèles tels qu’ils soient qualifiés pour enseigner aussi aux autres. Ceci est une tâche spécialement délicate, qui exige beaucoup de courage moral et de tact que seule Sa grâce peut fournir, quelle que soit la compétence. D’où l’insistance auprès de Timothée sur ce point.
Ici (2:3) Timothée est exhorté, mais sans autant d’insistance, à prendre sa part de souffrances — mais non pas « avec moi » comme beaucoup le comprennent outre la Version Révisée. En réalité, ces mots rétrécissent et polluent la force. Le grec ne justifie que l’idée générale de partager les souffrances avec ses compagnons, Paul ou d’autres. C’est volontairement laissé large. Cette association est perdue par la fausse leçon du Texte Reçu, suivie par la Version Autorisée KJV, comme déjà évoqué. L’accent n’a pas un caractère personnel, mais la pensée est celle d’un partage général plutôt qu’avec Paul en particulier. Le passage particulier de 2 Tim. 1:8 ne supporte pas non plus « avec moi », mais expressément « avec l’évangile (ou : de l’évangile) » qui est personnifié par le grand apôtre. Il y a cependant une différence : notre verset n’exprime pas avec qui Timothée était appelé à partager l’affliction, et nous ne devons pas suppléer à cette absence. La construction est évidemment différente de celle du ch. 1, et il vaut mieux laisser le sens dans le vague de l’original.
La part de souffrance de Timothée est précisée. Il s’agissait d’être un bon soldat de Jésus Christ. Le « compagnon d’armes » du manuscrit de Clermont va trop loin, outre que c’est aussi irrévérencieux. Dans un pays ennemi, qui pourrait s’étonner que Timothée soit appelé à prendre sa part de souffrance ?
Ch. 2:4
Cela conduit naturellement à la figure appliquée de manière plus générale au v. 4. « Nul homme qui va à la guerre ne s’embarrasse des affaires de la vie, afin qu’il plaise à celui qui l’a enrôlé ».
La force de l’allusion est évidente du fait que c’est une vérité universelle. Qui dans l’empire romain ignorait ce fait ? Sans doute un congé de permission pouvait permettre une détente et un service complet, et une liberté parfaite ; mais pour le serviteur de Christ, ici-bas, il n’y a pas de permission ni de décharge de son devoir. C’est pourquoi l’apôtre ne parle pas simplement d’un « homme qui fait la guerre » comme dans la version autorisée KJV, mais d’un homme en service effectif, et c’est pourquoi il peut asseoir la vérité avec un négatif absolu : « Nul homme quand il va à la guerre ne s’embarrasse des affaires de la vie ». Il est surprenant que la Version Révisée suive la Version Autorisée qui est la seule parmi toutes les versions anglaises à ajouter la qualification inutile de « cette vie ». Elle est d’autant plus inappropriée que l’Écriture avait déjà adjoint de manière appropriée le pronom démonstratif non pas à βίος (bios) mais à ζωή (Zoé – Actes 5:20). Ce serait cependant une erreur grossière de penser que pour le serviteur de Christ, cela exclut d’avoir un métier, s’il juge qu’en toutes circonstances il est appelé à fournir des choses honnêtes de ses mains ou de sa tête. L’apôtre lui-même en est la meilleure réfutation. L’ouvrier, que ce soit dans l’évangile ou dans l’église, est digne de son salaire. Or beaucoup d’hommes estimés peuvent servir Christ dans l’un ou l’autre de ces domaines, ou les deux, sans renoncer à leur emploi dit séculier. Il pourrait même s’assurer que la mesure de son don n’en devienne pas une exigence auprès de l’assemblée. Même le plus grand des ouvriers, [Paul,] le ressentait comme une joie [de travailler pour ses besoins] et ne voulait pas que s’en glorifier soit rendu vain en refusant de profiter pour lui-même de sa puissance dans l’évangile : il était ainsi pénétré et rempli de l’esprit de cette grâce en Dieu qui est la source de l’évangile lui-même (2 Cor. 11:7-9). S’embarrasser dans les affaires de la vie signifie en réalité abandonner la séparation du monde en s’occupant d’affaires extérieures comme un vrai partenaire. Le serviteur de Christ est tenu, quoi qu’il fasse, de le faire pour le Seigneur et donc en conformité avec Sa parole. En tout, il sert le Seigneur Christ ; et ceci n’est pas la servitude de la loi, mais la liberté dans l’Esprit, bien que lui soit l’esclave du Seigneur. De même que le soldat en campagne de guerre doit plaire à celui qui l’a enrôlé, de même le serviteur chrétien doit toujours plaire au Seigneur. Il a lui-même dit : « Mon joug est facile, et mon fardeau est léger » (Matt. 11:30).
Ch. 2:5
Il y a ensuite une deuxième illustration de grande importance. « Et si quelqu’un combat dans les jeux, il n’est pas couronné s’il n’a pas combattu selon les lois [ou : règles] ».
Quoi de plus nécessaire et de plus important en pratique ? Le serviteur de Christ est appelé à être aussi soigneux qu’un athlète ; or dans ces conditions, il est tenu d’observer la volonté révélée du Seigneur aussi rigoureusement que ceux qui prenaient part aux jeux de la Grèce. La fidélité en général ne doit jamais être recherchée ou permise pour couvrir de la délinquance. Être le plus excellent dans les choses les plus élevées ne peut être une excuse pour faire un écart, même minime, par rapport à la vérité ou à la justice ; celui qui enfreignait les règles des jeux en une manière quelconque était exclu de la couronne de la victoire.
Ch. 2:6
La troisième maxime a été singulièrement mal comprise par des esprits vraiment spirituels. Pourtant, la structure de la phrase n’est pas vraiment obscure1, la difficulté est plutôt due à un certain préjugé quant à son sens ou à son application. La figure est tirée de l’agriculture, non du service militaire ni des jeux de l’arène. L’accent est mis sur le « laboureur ». L’amour de Christ doit étreindre et l’amour fraternel doit demeurer (2Cor. 5:14 ; Héb. 13:1), afin que le serviteur de Christ persévère sans interruption dans ses travaux. C’est pourquoi nous trouvons dans la première épître (1 Tim. 5:17) que les anciens qui gouvernent bien [JND qui président dûment] doivent être estimés dignes d’un double honneur, et il y a une distinction « spéciale » pour ceux qui travaillent dans la parole et dans l’enseignement. Ainsi ici où il est question du service de Christ en général, le laboureur doit premièrement avoir part aux [JND jouir des] fruits. Il est impossible que Dieu veuille être le débiteur de qui que ce soit. « Chacun recevra sa propre récompense selon son travail », que ce soit celui qui plante ou celui qui arrose ou tout autre (1 Cor. 3:8). Car Dieu n’est pas injuste en tout cas d’oublier notre travail et l’amour montré pour Son nom. Mais le travail d’amour a une valeur particulière à Ses yeux. Ceci peut se trouver chez des saints très jeunes (1 Thess. 1:3), tout comme l’œuvre de foi et la patience d’espérance. Il est très heureux que le serviteur de Christ soit soutenu dans un tel travail. « Le laboureur doit premièrement (quoi qu’il en soit des autres, et avant tout) avoir part aux [JND jouir des] fruits ». C’est une lapalissade de dire qu’on doit travailler avant d’avoir part aux fruits, ou de dire que le premier à travailler doit participer aux fruits, comme le dit la note en marge de la Version Autorisée KJV. Mais ce n’est pas le sens de cette phrase suivant n’importe quelle construction grammaticale possible, et, si c’était le cas, elle ne pourrait pas lancer un appel aussi grave ou aussi encourageant au laboureur.
1 L’idée d’une transposition de κοπιῶντα πρῶτον est indigne du Silva Critica i. 155 de Wakefield et n’est pas confirmée par la référence de Winer à Xenoph. Cyrop. I. iii. 18. Et la version éthiopienne ne présente qu’une paraphrase vague, pas un vrai rendu. Les anciens commentateurs sont aussi incertains que la plupart des modernes.
Ainsi, dans les trois maximes des versets 4-6, nous avons d’abord l’objet ou le point de départ ; puis les voies ou les moyens qu’on garde, ainsi que la fin ; et enfin l’encouragement sur la route pour celui qui travaille dans l’amour, comme le fait la foi.
Ch. 2:7
La portée de ce que l’apôtre vient de nous inculquer était d’une signification profonde et d’une grande valeur, mais nullement évidente. C’est la raison semble-t-il pour laquelle il ajoute : « Considère ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l’intelligence en toutes choses » (2:7). Tel est le vrai texte, non pas « Considère les choses que je dis » (ἅ) en détail, comme le texte Reçu, mais « ce que je dis » (ὅ) comme un tout. Cela rend d’autant plus pertinente l’assurance, et non la simple prière, qui suit : « Et le Seigneur te donnera l’intelligence en toutes choses », aussi large dans sa portée que détaillée dans ses ramifications. Celui qui a une onction de la part du Saint peut compter là-dessus, car l’Esprit sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu (1 Cor. 2:10).
Chapitre 2 versets 8 à 13
Ch. 2:8-13
« Souviens-toi de Jésus Christ ressuscité d’entre les morts, de la semence de David, selon mon évangile, dans lequel j’endure des souffrances jusqu’à être lié de chaînes comme un malfaiteur ; toutefois la parole de Dieu n’est pas liée. C’est pourquoi j’endure tout pour l’amour des élus, afin qu’eux aussi obtiennent le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine : car si nous sommes morts avec [Lui], nous vivrons aussi ensemble [JND avec Lui] ; si nous endurons, nous régnerons aussi ensemble [JND avec Lui] ; si nous le renions, Lui aussi nous reniera ; si nous sommes incrédules, Lui demeure fidèle, car Il ne peut pas se renier Lui-même » (2:8-13).
Ch. 2:8
Dans ces versets l’apôtre ramène à la personne de Christ, la pierre de touche et la substance de la vérité, — mais à Sa personne selon l’évangile de Paul liée indissolublement à Son œuvre. « Souviens-toi de Jésus Christ, de la semence de David, ressuscité des morts selon mon évangile ».
Le Christ est à la fois l’objet des promesses et leur accomplissement, mais Il est infiniment plus. Il est ressuscité d’entre les morts, Il est le Commencement, le Premier-né de la nouvelle création. Comme ressuscité, Il est la tête (chef) d’un système entièrement nouveau. Du début à la fin, c’est là l’enseignement de Paul. Quant à Jésus, le Fils de Dieu, il affirme qu’Il est né de la semence de David selon la chair, mais qu’Il a été caractérisé comme Fils de Dieu en puissance, selon l’Esprit de sainteté, par la résurrection des morts, comme il est dit au début de l’épitre aux Romains (Rom. 1:3, 4).
L’Esprit de Dieu n’a-t-il pas devant Lui, ici, un but pratique plutôt que dogmatique ? Même en tant que Messie, le Seigneur Jésus devait être ressuscité d’entre les morts. Si quelqu’un avait droit à l’honneur et à la gloire terrestres, c’était le Fils de David ; mais, selon l’évangile de Paul, il traverse la mort jusque dans la résurrection. Tel est la seule matrice de bénédiction, vu ce que sont le monde et l’homme. Aucune affirmation ne peut être plus forte. En tant que Chef (tête) de l’Église, il n’y a rien d’étonnant à cela ; mais pour la Semence de David, c’est surprenant, et pourtant très vrai. Car l’église elle-même n’a pas d’existence, si ce n’est sur la base de la Sienne à Lui comme la Tête ressuscitée, et dans les lieux célestes. Dans le ciel, seule la Tête pouvait y être, afin de donner un caractère céleste à ceux qui sont unis à Lui par le Saint Esprit sur terre. Mais l’évangile de Paul insiste sur le grand fait de la résurrection d’entre les morts — même pour le Messie. Et dans ce caractère c’est la seule chose qui est vraie de Lui maintenant — Il est ressuscité, mais Il ne règne pas. Le chrétien règne encore bien moins.
Ch. 2:9a
Au contraire, à la suite de cet évangile, l’apôtre dit : « J’endure des souffrances jusqu’à être lié de chaînes comme un malfaiteur ». Les choses dans le monde sont totalement mises de côté. Rien n’y est en ordre selon Dieu, bien que Sa providence gouverne, et que toutes les âmes soient appelées à être soumises aux autorités en place. Ces autorités peuvent régner, et il nous est commandé d’honorer le roi de façon habituelle, et aussi tous les hommes en passant ; mais nous sommes appelés à renoncer à toute pensée d’honneur maintenant pour nous-mêmes. Nous sommes appelés à la communion de Christ (1 Cor. 1:9) ; l’honneur qui nous revient, c’est de partager dans notre mesure ce que l’apôtre a si largement souffert. Toute pensée d’avoir nos aises actuellement, de nous établir ici-bas, d’avoir une constitution établie et stable aux yeux des hommes, viole la vérité qui est placée devant nous, comme d’ailleurs toute autre présentation de celle-ci maintenant au saint individuellement ou à l’église dans son ensemble. Celui qui a eu le plus de vrai honneur en tant que chrétien dans l’évangile déclare qu’il souffre comme un malfaiteur jusqu’à être lié de chaînes.
En contraste flagrant avec cela, nous lisons que les saints de Corinthe régnaient sans l’apôtre, et celui-ci parle aussi de ce que Dieu a produit « nous les apôtres » en derniers comme des hommes voués à la mort (1 Cor. 4:8, 9). Christ a connu la mort de la croix comme personne ne l’a jamais fait ni ne le pouvait ; et Paul n’avait pas encore connu la mort, comme Son fidèle martyr. Tout était vrai pour lui. Avec les Corinthiens, hélas ! il y avait beaucoup de faux. Ils avaient glissé dans leur cœur en ne partageant pas Son rejet. En effet, ils ne l’avaient encore guère connu. Ils avaient reçu Christ pour la vie éternelle et la rédemption ; ils ne savaient encore rien de la mort quotidienne (1 Cor. 15:31).
L’apôtre anticipe donc solennellement le danger, pour les chrétiens en général, de s’installer ici-bas. Ceci est incomparablement plus grave. La légèreté de pensée et de sentiments, la puissance de la nature, l’activité de la chair, peuvent être tristes chez de jeunes saints ; mais c’est infiniment pire quand des saints âgés s’écartent de la norme élevée et céleste qu’ils ont apprise. Tel était le danger maintenant, et l’apôtre est ici en train d’éveiller Timothée quant à son anxiété à ce sujet. Nous voyons le mal sous une forme grossière lorsque le corps chrétien a acquis le pouvoir, l’honneur et la gloire terrestre au temps de Constantin et de ses successeurs ; mais selon cette épître, il semble que la malice d’égarement était largement à l’œuvre au temps où l’apôtre écrivait. La puissance de la résurrection d’entre les morts pare au mal pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Elle est entièrement finie en tant que chose vivante, pour ceux qui acceptent maintenant la grandeur terrestre comme un état bon et valable pour le chrétien. Celui qui est tout à fait juste devant Dieu doit être content de souffrir au maximum devant les hommes, comme l’apôtre qu’on voyait en train de le subir jusqu’à être lié de chaînes.
Ch. 2:9b
Mais souffrir injustement, jusqu’à être même lié comme un malfaiteur, n’a pas empêché la bénédiction. « La parole de Dieu n’est pas liée ». Au contraire, de telles circonstances attirent l’attention. Une classe entièrement nouvelle a vu son attention attirée par la révélation de Dieu. Le nom du Seigneur a été discuté devant les magistrats, les juristes officiels, les soldats, les marins, les gouverneurs, et peut-être même les têtes couronnées. C’est peut-être la honte du monde qu’il en soit ainsi, mais le rejet est la voie du chrétien, la vraie gloire de l’église, jusqu’à ce que Jésus règne. Le prédicateur lui-même peut être un prisonnier ; « mais la parole de Dieu n’est pas liée ».
Ch. 2:10
« C’est pourquoi j’endure tout pour l’amour des élus, afin qu’eux aussi obtiennent le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle ».
Voilà un cœur nullement décontenancé, et l’œil n’était pas obscurci par la douleur présente ; car l’œil était simple et le corps tout entier était plein de lumière (Luc 11:34-36). Si Christ aimait les élus — Christ qui a souffert pour leurs péchés, Paul pouvait bien utiliser ce langage hardi, mais vrai, car il partageait Son amour, bien que ce soit Christ seul qui ait « porté nos péchés en son corps sur le bois ». Aucun homme, aucun saint, aucun apôtre n’a participé à cette œuvre expiatoire ; pourtant, ce n’est pas de la présomption, même pour le plus humble des saints, que de dire qu’on souffre avec Lui, pas plus que d’avoir l’espérance d’être glorifié avec Lui. Si nous sommes enfants, alors nous sommes héritiers — héritiers de Dieu et cohéritiers avec Christ ; s’il en est ainsi, souffrons avec Lui afin d’être aussi glorifiés ensemble (Rom. 8:17).
Mais l’apôtre va plus loin : « J’endure tout pour l’amour des élus, afin qu’eux aussi obtiennent le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle ». Bien peu de gens se risqueraient à parler de cette manière au sujet de l’expérience de leur âme depuis ce jour-là jusqu’à aujourd’hui ! Néanmoins, nous pouvons le désirer sincèrement dans notre mesure ; mais cela suppose chez le croyant non seulement une bonne conscience et un cœur brûlant d’amour, mais aussi un profond jugement de soi-même, et Christ ayant vraiment sa demeure dans le cœur par la foi. L’apôtre le déclare ouvertement à Timothée ; et certainement, c’était censé agir puissamment sur l’âme de son compagnon de travail, comme aussi sur la nôtre. Ce n’est pas que le salut des élus soit incertain : le Seigneur Jésus veillera sûrement à ce « qu’ils obtiennent le salut » selon toute Sa puissance en grâce et selon les conseils infaillibles de Dieu. Mais comme le dit un autre apôtre : « Si le juste est sauvé difficilement, où paraîtra l’impie et le pécheur ? » (1 Pierre 4:18). C’est en effet avec difficulté que les élus sont sauvés, même s’ils le seront certainement ; or cela nécessite toutes les ressources de la grâce divine, et cela fait également appel à tout l’amour de Christ dans un service laborieux ; et, ce qui est aussi très efficace, cela appelle à tout endurer par amour pour ces élus.
Ch. 2:11
Ce n’est pas non plus tout ce sur quoi l’apôtre a à insister en rapport avec ce sujet. « Cette parole est certaine : car si nous sommes morts avec [Lui], nous vivrons aussi ensemble [JND avec Lui] ; si nous endurons [JND souffrons], nous régnerons aussi ensemble [JND avec Lui] ».
Il ne précise pas que cette parole est « digne de toute acceptation » [1 Tim 1:15 ; 4:9] ; car il s’agit d’une parole pour les saints plutôt que pour les pécheurs comme tels ; mais l’affirmation, sans aucun doute, est certaine ; car « si nous sommes morts avec Lui, nous vivrons aussi ensemble ». Il n’y a pas de chrétien qui ne soit pas mort avec Christ. C’est la vérité même que tout baptisé confesse à son baptême, même s’il est muet. Ce qui peut la rendre fausse chez quelqu’un, ce n’est pas faute d’avoir prononcé certaine parole, mais c’est le manque de foi.
C’est pourquoi l’apôtre insiste, non pas sur ce que presque n’importe qui n’oserait dire de peur que ce soit présomptueux et vain, — mais il insiste sur ce à quoi doivent se joindre tous ceux qui sont vrais dans la confession de la grâce et de la vérité dès le commencement. La phrase hypothétique [commençant par « si »] est décisive ; pourtant aucun chrétien ne doit s’y soustraire, ni ne peut s’y soustraire en vérité ; car Christ est Celui qui, ayant tout souffert, a tout donné gratuitement. Et « si nous sommes morts avec Lui », ce qui est incontestable pour le croyant maintenant, « nous vivrons aussi avec Lui ». Paul nous donne ici l’assurance de l’avenir brillant et béni, bien qu’il soit également vrai que nous vivons maintenant parce que Lui vit, ou, comme il est dit ailleurs, parce que Christ vit en nous. Mais ici, le fait de vivre avec Lui reste devant nous comme une espérance. Ici et maintenant, nous devons porter dans notre corps la mort (le mourir) du Seigneur Jésus (2 Cor. 4:10) ; bientôt il n’y aura rien que vivre avec Lui.
Ch. 2:12a
Ainsi, « si nous endurons [JND souffrons], nous régnerons aussi ensemble [JND avec Lui] ». Ici, il n’y a pas de doute, il s’agit de souffrir maintenant, non pas encore de régner avec Lui. La lecture que font certaines autorités anciennes de Apoc. 5 ou 20, selon laquelle les saints règnent maintenant, est indiscutablement une erreur. Elle est erronée tant sur le plan moral que sur le plan dogmatique. Nous régnerons avec Christ ; mais Lui est encore assis sur le trône du Père. Il attend de recevoir Son propre trône ; et nous, nous attendons encore bien plus. Si nos cœurs étaient droits, nous ne souhaiterions pas régner sans Lui ; pareillement nous devrions avoir une foi plus solide, étant assurés qu’Il ne règne pas encore, mais qu’Il est parti pour recevoir un royaume et revenir (Luc 19:12). Il viendra dans Son royaume, qu’Il n’a pas encore reçu. Jusque-là, nous sommes appelés à endurer (souffrir), et non pas à régner ; quand Il apparaîtra, nous apparaîtrons avec Lui ; quand Il règnera, nous aussi avec Lui.
Ch. 2:12b-13
Puis il y a à la fois une mise en garde solennelle, et une attente certaine de gloire. « Si nous le renions, Lui aussi nous reniera ; si nous sommes incrédules, Lui demeure fidèle, car Il ne peut pas se renier Lui-même ».
Dans un jour de déclin, le danger était en particulier de s’écarter non seulement de tel ou tel principe divin, mais de s’éloigner de Lui, et ce de façon permanente. L’apôtre ne conforte pas non plus les saints dans ce qui est la plus dangereuse des illusions, à savoir qu’il n’y a pas de danger. Car les dangers abondent de tous côtés, et il faut savoir que des temps fâcheux vont arriver dans les derniers temps. Il est tout à fait possible qu’un serviteur du Seigneur Le renie, et c’est exactement ce que l’Écriture nous montre avoir été fait par l’un des plus honorés, alors que celui-ci avait justement pensé que c’était impossible pour lui, contrairement à tous les autres hommes ; pourtant Pierre était à la veille de le faire. Sans doute cela n’a été qu’un acte passager, même s’il a été honteux et déplorable ; cependant ce reniement a été répété et aggravé, mais la grâce de Christ, qui surmonte tout et pardonne tout, s’est élevée au-dessus et l’a effacé, le transformant même en un profit inoubliable et en une bénédiction féconde. Mais lorsqu’il s’agit d’une pratique de vie, comme ici (« si nous le renions », et non pas simplement « si nous l’avons renié » comme un acte ponctuel), la conséquence est inéluctable, que Dieu se doit de défendre Sa majesté blessée : « Lui aussi nous reniera ». Dieu cesserait d’être Dieu, s’Il consentait au déshonneur de Son Fils. Le croyant s’incline et croit, adore et sert. L’incroyant peut insulter maintenant, et celui qui renie le peut encore plus si c’est possible, mais tous deux devront bientôt L’honorer dans le jugement, « afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père » (Jean 5:23).
La phrase finale est d’un grand poids : « Si nous sommes incrédules, Lui demeure fidèle » ; et cela pour la plus convaincante et la plus glorieuse des raisons : « car Il ne peut se renier lui-même ». À première vue, il peut sembler que ce « car » nuit à la facilité et à la fluidité de la phrase ; [bien qu’il soit absent dans la version autorisée KJV], il est à sa place selon une autorité ancienne et solide. En y réfléchissant, ce « car » ajoute beaucoup à la force de la phrase, car ce n’est pas une simple addition indépendante pour confirmer ce qui précède : le fondement ou la preuve de Sa fidélité qui demeure, réside dans le fait béni de Sa vérité immuable.
Chapitre 2 verset 14 à 18
Ch. 2:14-18
Paul passe maintenant à une autre classe de dangers, moins fréquents, mais qui se développent en partant de disputes verbales et qui vont jusqu’à ce qui est profane, à l’audace impie et à la corruption de la vérité fondamentale. Certains se refusent à accorder la moindre considération à de tels pièges ; mais on ne gagne rien à reculer devant ce qu’on doit affronter, si nous trouvons notre plaisir dans ce qui est saint, bon et vrai, au lieu de fouiner dans le mal avec curiosité. C’est la lumière qui manifeste tout ; et nous sommes lumière dans le Seigneur. La lumière est l’élément qui convient au nouvel homme, comme l’amour est son activité.
« Remets ces choses en mémoire, en témoignant sincèrement [JND protestant] devant le Seigneur qu’on n’ait pas de disputes de mots, ce qui est sans profit, pour la subversion des auditeurs. Sois diligent pour te présenter approuvé à Dieu, ouvrier qui n’a pas à avoir honte, découpant droit la parole de la vérité. Mais évite les discours vains et profanes, car ils progressent vers une plus grande impiété, et leur parole rongera comme une gangrène, desquels sont Hyménée et Philète qui se sont écartés quant à la vérité, disant que la résurrection a déjà eu lieu, et qui renversent la foi de quelques-uns » (2:14-18).
Ch. 2:14
Ici, Timothée est appelé non pas à comprendre simplement, mais à rappeler aux autres les grandes vérités vitales que l’apôtre a établies. Il est également chargé, aux yeux du Seigneur, de mettre en garde contre les querelles de mots, qui ne servent à rien et qui sont destinées à bouleverser les auditeurs. C’est là une mise en garde des plus salutaires, dont il y a beaucoup besoin et cela dans tous les âges. Il y a des différences réelles même parmi les chrétiens ; elles sont plus ou moins graves quant au fait de déguiser ou pervertir la vérité. Et ceux qui apprécient la vérité, surtout s’ils ne sont pas en face d’un zèle agressif, sont particulièrement enclins à tomber dans des distinctions sans vraies différences. Un tel zèle fait d’eux de redoutables batailleurs de mots. Combien il est vrai que cela ne sert à rien, mais que cela réussit sans tarder à subvertir ceux qui entendent ! Car le batailleur de mots sait quand s’arrêter, mais les simples qui entendent poursuivent et en sortent froissés. Il y a beaucoup de vanité, et peu, sinon aucune, sincérité dans de telles disputes ; elles ne tendent pas à l’édification, mais à un dommage réel et très grave. Le mandat donné à Timothée est en même temps un devoir pour ceux qui ont une influence morale dans l’assemblée et qui y cherchent en tout temps la gloire du Seigneur.
Ch. 2:15
Mais il y a aussi un appel plus positif et plus personnel au verset 15 : « Efforce-toi (ou : sois diligent pour ; JND étudie-toi à) de te présenter approuvé à Dieu, un ouvrier qui n’a pas à avoir honte, découpant droit la parole de vérité ».
L’exemple a plus de poids qu’une prescription, et ceux qui enseignent les autres ont particulièrement raison de craindre que l’échec ou la négligence provienne d’eux-mêmes. En outre, tout homme pieux sait que la première de toutes les obligations est d’être droit devant Dieu. Timothée devait donc s’appliquer à se présenter d’abord comme approuvé par Dieu. Si ce n’était pas le cas, ses paroles pourraient être justes en elles-mêmes, mais son œuvre manquerait de bénédiction, et lui-même serait toujours exposé à la honte. En fait, sa conduite serait plus ou moins hypocrite. Il ne peut pas y avoir de courage devant l’ennemi, quand la conscience n’est pas bonne devant Dieu. Il faut chercher à être approuvé par Dieu dans sa conduite et dans son service, si l’on veut éviter la honte déjà maintenant. Encore une fois, si la conscience n’est pas bonne devant Dieu, quelle confiance peut-on avoir pour tirer des applications de la parole de vérité d’un cœur et d’une main inébranlables ? On risque de se faire condamner par l’Écriture dont on a besoin. Un homme sans conscience peut parler avec hardiesse ; celui qui craint Dieu doit trembler s’il blâme autrui pour une faute qu’il connaît chez lui-même. Il est donc de la plus haute importance que l’ouvrier se présente à Dieu en étant approuvé, sinon son témoignage ne peut être que timide, faible et incertain.
Ch. 2:16a
Or il peut y avoir encore un autre devoir en rapport avec les discours vains et profanes des hommes prétentieux qui, plus ils se trompent, plus ils sont satisfaits d’eux-mêmes. Ce mal s’était déjà installé, comme l’article semble le montrer (les discours). Il ne s’agissait pas d’un mal inconnu, mais de folies existant parmi ceux qui portaient le nom du Seigneur. Timothée n’était pas appelé à s’occuper d’eux, et encore moins à s’engager dans des controverses avec eux. Le mot de l’apôtre est « éviter » ou « fuir ». Il s’agit là encore d’une exhortation dont la sagesse est divine. Certains, conscients de leur capacité à disséquer et à s’opposer au mal, sont enclins à se mêler de ces discours vains et profanes. Ce n’est pas sain pour eux, et cela peut blesser les saints qui, parce qu’ils apprécient les ouvriers, peuvent saturer leur esprit de leurs tristes efforts ; or ceux-ci, en règle générale, enflent au lieu de convaincre les coupables. Notre apôtre adresse à Tite une exhortation très similaire pour un mal analogue (Tite 3:9). Le temps est trop précieux, sauf pour ce qui édifie ; et celui qui s’engage à lutter contre tous les mauvais rêveurs peut réussir à les vaincre, mais il court le danger imminent de subir lui-même un grand dommage. Il est bon de toujours prendre à cœur le bien avec zèle ; il n’est pas bon de se détourner pour s’occuper du mal, à moins que ce ne soit le devoir le plus critique.
Ch. 2:16b-17a
L’apôtre ajoute une autre raison dans ce cas : « Car ils iront plus avant dans l’impiété, et leur parole rongera comme une gangrène ».
Cette déclaration prouve clairement l’inutilité de se mêler de ce qui est non seulement vain mais profane. Il n’y avait pas de crainte de Dieu chez ceux qui se livraient à de tels actes, et la crainte de Dieu est le commencement de tout ce qui est bon pour l’homme déchu. Tant que la conscience n’est pas atteinte, il est inutile de s’attendre à ce que les précieuses révélations de Dieu ne soient pas mal utilisées ; et cela est particulièrement vrai pour ceux qui professent croire l’évangile. Coupables de profanité, ils n’ont pas besoin d’arguments mais de repentance. Rien n’est plus propre à toucher leur conscience que de voir un ouvrier doux et plein de grâce comme Timothée fuir leurs propos. « Ils iront plus avant dans l’impiété, et leur parole rongera comme une gangrène ». Discuter flatterait plutôt leur suffisance, et un mal aussi destructeur ne pourrait que progresser.
Ch. 2:17b-18
De plus, l’apôtre souligne que ce mal effroyable qui avait eu lieu au milieu des saints, s’il n’était plus là, n’était pas un mal imaginaire destiné à hanter les âmes, mais un fait propre à causer une peur et une horreur salutaires : « desquels sont Hyménée et Philète, qui se sont écartés de la vérité, », ou littéralement, « qui ont manqué la cible », disant que « la résurrection avait déjà eu lieu, et ils renversaient la foi de quelques-uns ».
Il est d’un grand intérêt de peser le caractère de cette erreur. Il ne s’agissait pas tant d’une ignorance de la vérité que plutôt d’une exagération. C’était l’exaltation d’un privilège présent poussé jusqu’au déni de notre espérance en la venue de Christ. Il ne fait aucun doute qu’ils se piquaient d’une vérité plus élevée que celle enseignée par d’autres, et d’une intelligence supérieure. C’est un danger extrême pour ceux qui ont une soif et une appréciation réelles pour la vérité de Dieu ; s’ils ne sont pas vigilants, ils sont les plus susceptibles d’être piégés.
Or le remède est simple et sûr lorsque des hommes font valoir leur marchandise comme « précieuse » par-dessus tout, et qu’ils discréditent les serviteurs du Seigneur fidèles dans l’épreuve comme étant des gens dont l’enseignement se situe à un niveau tout à fait inférieur. Les saints trouveront inestimable de s’accrocher à la vérité qu’ils ont toujours reçue depuis qu’ils connaissent Dieu, ou plutôt qu’ils ont été connus de Lui. Tôt ou tard ces prétentions vaniteuses s’avéreront subversives par rapport à la vérité fondamentale et au simple devoir. Les saints ne seront peut-être pas capables de discerner tout de suite le caractère inutile ou mauvais de ce qui est vanté ; mais ils connaissent le trésor qu’ils possèdent déjà, dont ces nouvelles vues les priveraient. Ils n’ont qu’à tenir ferme la foi, la foi commune, que les grands maîtres méprisent ; et comme ainsi ils résistent au diable, celui-ci s’enfuira loin d’eux.
Mais ceux qui, par grâce, sont dotés d’un œil plus perspicace sont en mesure de voir davantage. Le fait que la résurrection soit déjà passée, bien qu’il soit mis en avant comme l’expression du privilège actuel le plus élevé, sape en fait la vérité présentée de manière prééminente tout le long de cette épitre pour aider et guider. Dieu nous a sauvés par un saint appel selon Son propre dessein et Sa propre grâce qui nous a été donnée dans le Christ Jésus avant que le temps ne commence. Christ a annulé la mort, et a mis en lumière la vie et l’incorruptibilité par l’évangile. C’est ce que nous croyons et savons, sans parler du mystère de Christ et de l’assemblée. Or ces privilèges vrais et bénis nous sont donnés pour que nous puissions d’autant plus souffrir avec joie et endurer, maintenant, dans la foi et la patience, et attendre Christ et Son apparition pour introduire Son royaume, quand nous régnerons aussi avec Lui.
Or l’erreur de la résurrection déjà passée est fatale à cette endurance du temps présent. Si elle était vraie, elle nous donnerait le droit de régner maintenant comme des rois, de prendre nos aises, de jouir présentement de l’honneur et de la gloire ; et ainsi cette erreur est directement positionnée et calculée par l’ennemi pour contrecarrer la volonté de notre Seigneur, qui nous appelle à partager Ses souffrances jusqu’à ce que nous soyons glorifiés avec Lui. Elle est donc fausse en tant que doctrine, elle est ruineuse pour la pratique, et elle détruit toute communion avec Christ, et tout partage de Ses affections dans la séparation du monde. Il n’est guère d’illusion plus opposée à la vérité dans son caractère et dans ses conséquences pour l’âme et pour la marche, et en même temps nocive contre la gloire morale du Seigneur. On peut donc bien comprendre que ceux qui enseignaient cette doctrine « renversaient la foi de quelques-uns ». Et s’il en était ainsi à l’époque, combien plus, maintenant, cette nuisance est largement étendue et établie, tandis que la venue de Christ n’est plus devant les saints comme une espérance constante et vivante, et que la résurrection du corps a perdu tout intérêt pour eux, satisfaits que leurs âmes aillent au ciel après la mort ! Le monde devient dès lors une scène de jouissance présente. L’association avec un Christ autrefois mort et rejeté, est impensable. Ils se flattent d’avoir atteint une sagesse supérieure à celle connue des apôtres à cette époque, ayant maintenant appris à jouir du meilleur des deux mondes.
La vérité ne peut être sapée sans conséquences des plus fâcheuses, tant sur le plan moral qu’ecclésiastique. Il ne s’agit pas seulement d’une interruption de communion entre Christ et les Siens, mais d’une divergence et même d’une opposition plus ou moins franche à Ses pensées. Ceux qui sapent peuvent bien sûr être eux-mêmes trompés ; ils peuvent se flatter de contribuer à une élévation du témoignage. Mais une vérité n’est jamais en conflit avec une autre vérité : en Christ, tout est en harmonie. Dire que la résurrection est déjà passée est à la fois l’indice d’une grave hétérodoxie agissant en destruction de notre espérance, tout en professant faire progresser un privilège ; c’est aussi un instrument favorisant un progrès profond et rapide dans le mal. Car lorsque la résurrection viendra, il n’y aura plus besoin de veiller pour prier, plus d’endurance dans l’affliction, plus de bon combat de la foi : tout sera réglé en puissance, gloire, repos et jouissance.
Que nous soyons morts et ressuscités avec Christ est vrai et saint, et on ne peut trop insister là-dessus pour le croyant du début à la fin de sa carrière ; mais nous, nous soupirons en nous-mêmes, ayant les prémices de l’Esprit, et attendant aussi l’adoption, la rédemption de notre corps (Rom. 8:23). Ceci n’aura lieu qu’à la venue de Christ ; aussi l’ennemi voudrait nous la dissimuler et nous en dépouiller, car c’est la plus influente de toutes les espérances pour ceux qui L’aiment et qui voudraient connaître la communion de Ses souffrances. Quelle ruse et quelle perversité que ce moyen de transformer notre espérance en une expression de grand privilège maintenant, alors que cela annule notre espérance céleste, détruit la communion et la marche, cache Christ comme aspiration de notre cœur, et que cela ferait du repos dans les choses présentes une chose sage et juste !
Telle était l’erreur d’Hyménée et Philète : en vérité des discours vains et profanes, faisant progresser à coup sûr l’impiété, et rongeant comme une gangrène de corruption dévorante. Une telle erreur est le renversement de la foi partout où on l’accepte.
Chapitre 2 versets 19 à 22
Ch. 2:19-22
« Cependant, le fondement solide de Dieu demeure, ayant ce sceau : Le Seigneur connaît ceux qui sont Siens ; et qu’il se retire de l’iniquité (l’injustice) quiconque prononce le nom du Seigneur. Or, dans une grande maison, il y a des vases non seulement d’or et d’argent, mais aussi de bois et de terre, les uns pour l’honneur, les autres pour le déshonneur. Si donc quelqu’un se purifie de ceux-ci, il sera un vase à honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. Mais fuis les convoitises de la jeunesse, et poursuis la justice, la foi, l’amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur » (2:19-22).
Ch. 2:19 — ce qu’est le solide fondement
Il est bon que le lecteur sache combien on a fait de spéculations sur « le solide fondement de Dieu ». Certains ont imaginé qu’il s’agit de la doctrine de la résurrection, d’autres des promesses, d’autres encore de l’élection. On a aussi supposé qu’il s’agissait de l’Église, ou encore, avec une meilleure raison, de Christ Lui-même. Mais il semble qu’il n’y a pas dans ce passage de base suffisante pour définir le fondement. Si le Saint Esprit a laissé l’expression sous forme générale, pourquoi chercher à limiter la pensée ? Le but est clairement de marquer ce qui demeure ferme et qui est selon Dieu au milieu de la confusion et de la ruine, — et d’utiliser ce fondement immuable pour la consolation et l’encouragement de tous ceux qui désirent faire Sa volonté. Il est hors de question que le solide fondement soient des doctrines, des promesses ou l’élection ; l’église ou le croyant sont plutôt ce pour quoi des ressources sont données au milieu du désordre existant. À l’évidence, la maison ne peut pas être le fondement ; et il semble déraisonnable d’affirmer que Christ lui-même devrait avoir ce sceau : « Le Seigneur connaît ceux qui sont Siens (à Lui) » ; et « qu’il se retire de l’iniquité, quiconque invoque le nom du Seigneur ».
Rien de plus simple ni de plus important si le solide fondement de Dieu est pris dans l’abstrait ; ceux qui se tiennent dessus sont d’un côté réconfortés, et d’un autre côté solennellement exhortés et avertis. L’état de choses était tel que l’on ne pouvait plus supposer que tous ceux qui composaient l’église étaient membres du corps de Christ. La négligence avait conduit à une récolte de faiblesse et de honte ; les éléments pieux étaient contraints de se rabattre sur l’assurance que le Seigneur connaît ceux qui sont à Lui, mais en même temps ils ne pouvaient qu’insister sur la responsabilité chrétienne — « Qu’il se retire de l’iniquité, quiconque invoque le nom du Seigneur ».
On remarquera qu’il n’est pas question ici de « Christ » [comme dans la version autorisée KJV], mais du « Seigneur ». « Christ » est le terme qui convient lorsque la grâce connue et appréciée est devant le cœur ; « le Seigneur » est utilisé de manière appropriée lorsque la profession et la responsabilité prévalent. Même s’il n’y avait pas de véritable communion, il ne fait aucun doute qu’il y en a dans la phrase qui nous occupe ; la leçon qui lit le mot « Seigneur » au lieu de « Christ » est la leçon des meilleures et plus anciennes autorités suivies par tous les critiques modernes, même s’ils n’ont aucune notion de la différence que cela implique quant à la vérité.
Ch. 2:20
Mais il y a beaucoup plus, et ce que l’apôtre ajoute est d’une importance capitale : « Or dans une grande maison, il n’y a pas que des vases d’or et d’argent, mais aussi de bois et de terre, les uns pour l’honneur, les autres pour le déshonneur ».
Nous avons là une image vivante de ce que l’église était en train de devenir. Quelle différence d’avec la vision donnée dans la première épître au ch. 3 v.15 ! Il y est dit que la maison de Dieu est l’église du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité. C’est l’église sur terre, l’habitation de Dieu par l’Esprit, comme ce qui est seul ici-bas à présenter et maintenir la vérité devant tous les hommes. Les Juifs n’avaient pas la vérité, mais la loi ; les Gentils n’avaient que des vanités, des corruptions et des rêveries d’hommes. L’assemblée du Dieu vivant présentait la vérité devant tous les yeux. Mais maintenant, dans la seconde épître, l’afflux, non seulement des aises au lieu des souffrances, de la timidité au lieu du courage, et des fausses doctrines, y compris dans les domaines fondamentaux, a donné l’occasion à l’Esprit de Dieu de représenter une condition tout à fait différente. Ce n’est pas que l’Esprit de Dieu ait abandonné Son siège, mais il ne caractérise plus la maison comme celle du Dieu vivant. Elle peut prendre une apparence plus grande, mais il y a beaucoup moins de réalité. « Dans une grande maison, il n’y a pas que des vases d’or et d’argent, mais aussi de bois et de terre ».
Bien auparavant, l’apôtre (1 Cor. 3:5) nous avait préparés à ce qui pouvait même être construit sur Christ Lui-même. Qui, parmi les vrais serviteurs, est comme Paul, un sage maître d’œuvre [JND : architecte] ? Chacun doit donc faire attention à la façon dont il construit dessus. Sur ce fondement, l’un peut édifier de l’or, de l’argent, des pierres précieuses ; un autre, au contraire, peut bâtir sur elle du bois, du foin, du chaume ; beaucoup aussi construisent avec un mélange des deux. Et le jour le fera connaître, quand le feu éprouvera l’œuvre de chacun pour manifester de quelle sorte elle est. Ce qui demeure sera démontré agréable à Dieu ; ce qui ne supporte pas le feu sera une perte pour l’ouvrier, même si lui sera quand même sauvé. Ici dans la deuxième épître à Timothée, l’apôtre ne se penche pas sur le processus, mais sur le résultat. Dans une grande maison, il n’y a pas que des vases précieux, mais aussi les vases les plus communs — « et certains pour l’honneur, d’autres pour le déshonneur ». La maison de Dieu est donc ici considérée comme réduite à une comparaison humaine. Elle était en train de devenir juste comme ce qu’on trouve parmi les hommes sur la terre ; elle n’a plus cette empreinte exclusivement divine à laquelle on s’attendait dans la maison de Dieu. Des échecs à bien des égards ont vicié le témoignage ; et le résultat est ce mélange si détestable pour Dieu et pour ceux qui aiment Sa volonté et qui L’aiment Lui.
Ch. 2:21a
Que faut-il faire alors ? Devons-nous accepter Son déshonneur et nous plonger dans le désespoir ? Ou bien faut-il être pieds et poings liés à l’unité et fermer les yeux sur tout le péché et toute la honte ? Un saint, humble d’esprit, ressentira ce dilemme de manière aigüe, et ne pourra pas satisfaire son âme par des protestations verbales contre le mal qu’il sanctionne par sa vie et ses manières pratiques. Dans un tel état, il est bon de s’humilier, et comme Daniel de confesser les péchés de tous ceux qui y sont associés, ainsi que ses propres péchés. Mais est-ce tout ? Dieu merci, ce n’est pas tout ; l’apôtre donne immédiatement une orientation précise et autoritaire. Les plus timides n’ont pas à craindre de la suivre ; le cœur le plus oppressé a le droit d’avoir bon courage ; et ceux qui s’attachent à la tolérance du mal sous le prétexte de ne pas rompre l’unité sont réprimandés et confondus par l’appel de l’apôtre : « Si donc quelqu’un se purge [JND purifie] de ceux-ci, il sera un vase à honneur ».
Lorsque l’assemblée est dans sa condition normale et qu’un malfaiteur, aussi grossier soit-il, se trouve parmi les saints, la parole est : « Ôtez le méchant du milieu de vous-mêmes » (1 Cor. 5:13). Ici, c’est l’inverse. Le mal peut prévaloir dans une assemblée, et la sensibilité morale est si basse que la masse refuse de se purifier du vieux levain : les vases à déshonneur ont assez d’influence pour rester en dépit de tous les efforts pour les ôter. Que faire alors ? L’apôtre ordonne que l’homme qui craint Dieu se purifie d’eux. Cela satisfait la conscience ne serait-ce que d’un seul homme ; mais il est clair que le même principe s’applique à tous ceux qui discernent le mal, après avoir attendu patiemment que l’assemblée le discerne et que tous les moyens scripturaires également aient été utilisés et se soient révélés vains pour éveiller les consciences. Au fond, c’est le même principe de séparation du mal qui, en 1 Cor. 5, est appliqué pour ôter le méchant. En 2 Tim. 2, il s’agit d’un cas beaucoup plus avancé où celui qui agit bien, après s’être efforcé sans effet de corriger les maux supportés au dedans, est tenu de se purifier en se retirant. Il est impossible que l’Esprit de Dieu mette Son sceau sur le mal commis sous le nom du Seigneur Jésus. Nous sommes sans levain aussi sûrement que Christ notre Pâque a été sacrifiée pour nous. « C’est pourquoi célébrons la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de sincérité et de vérité » (1 Cor. 5:7-8). L’assemblée qui professe être de Dieu ne peut pas lier ensemble Christ avec un mal connu. Si donc une assemblée porte le nom du Seigneur et que, sous prétexte d’unité, par amour de la facilité ou par partialité pour ses amis, elle tolère le mal que l’Écriture montre comme odieux pour Dieu, un homme pieux n’a pas le choix, mais il est tenu d’écouter la parole divine et de se purifier de ces vases à déshonneur.
Sans doute c’est une nouveauté que cette application de la sainteté immuable de Dieu pour guider le saint dans ces circonstances tristes et difficiles. L’apôtre ne l’a donnée que dans la dernière épître qu’il ait jamais écrite. La raison en est évidente : aucune occasion ne s’était encore présentée pour faire un appel aussi grave. Il y avait souvent eu des désordres, et certains de caractère extrême ; mais jusqu’alors, les saints, même fautifs, s’étaient humiliés, et l’obéissance avait finalement prévalu. Il n’y avait jamais eu besoin d’un abandon justifié de ceux avec lesquels on avait marché ensemble dans l’assemblée. Mais ici, l’Esprit de Dieu met sous les yeux de l’apôtre un résultat nouveau et encore plus effrayant de la puissance croissante du mal. Toutes les fois qu’on nous impose d’accepter des vases à déshonneur, nous n’avons pas le choix : l’honneur du Seigneur est au-dessus de toute autre considération ; et, le plus vaillant comme le plus timide d’entre nous, nous sommes pareillement appelés à obéir au commandement de l’apôtre qui s’applique à cet état. Soyons seulement sûrs que le mal appelle vraiment une séparation absolue ; et de plus, que des remontrances patientes et pieuses soient dûment appliquées pour faire juger le mal, plutôt que pour agir en séparation. Mais si le mal est abrité et soutenu au déshonneur du Seigneur et de Sa parole, il n’y a pas d’autre alternative que de se purifier en se retirant.
Ch. 2:21b
Dans ces circonstances, renoncer à la conscience, c’est en fait renoncer à Dieu et à Son Christ ; se purifier humblement mais fermement des vases à déshonneur, c’est être un vase à honneur, sanctifié, utile au service du Maître, préparé pour toute bonne œuvre. C’est ce que l’on retrouve toujours par expérience : la séparation divine coûte beaucoup, mais gagne davantage. Celui qui se sépare à la légère pour une simple idée ou pour des raisons de son cru, n’est qu’un airain qui résonne, et il n’en tire profit ni pour lui-même ni pour personne d’autre ; il est un opprobre permanent contre le Seigneur et contre Sa parole là où elle s’applique vraiment. Mais le saint qui se purifie en se retirant avec une peine profonde pour lui-même et une douleur selon Dieu pour les autres, d’autant plus qu’il croit qu’ils appartiennent au Seigneur, — celui-là entre dans une nouvelle bénédiction, et renouvelle, pour ainsi dire, tout ce qui est propre à un saint, avec une nouvelle force pour son âme. « Il sera un vase à honneur, sanctifié, utile au service du Maître, préparé pour toute bonne œuvre ». Une telle assurance est d’autant plus réconfortante qu’il doit s’adapter aux flèches les plus aigües de ceux qu’il a laissés en arrière, ainsi que de tous ceux qui confondent l’indifférence facile avec l’amour pour l’église de Dieu. En outre, il a à craindre de rétrécir le cercle de ses affections, et de contracter la sphère de son travail. Quelle grâce que le Seigneur prévienne toutes ces appréhensions et lui donne la promesse, s’il a traversé la grande épreuve avec Dieu, d’élargir son cœur dans tout ce qui est pour Sa gloire !
Ch. 2:21 — On ne quitte pas la maison
On peut remarquer qu’il n’est pas question de quitter la maison, bien que certains soient tombés dans cette idée fausse par zèle pour la sainteté. Mais nous ne le pouvons pas, ni ne le voulons tant que nous portons le nom du Seigneur. Sans doute un apostat abandonne Son nom. Mais se purifier des vases à déshonneur est posé ici comme un devoir positif, et, loin d’être de la présomption, c’est une simple obéissance à la parole du Seigneur si c’est fait correctement. C’est donc la voie de l’humilité vraie et divinement donnée, quel que soit le terrorisme que cherchent à exercer ceux qui cherchent à dominer sur la foi des saints. Se purifier de ceux qui agissent mal dans la maison n’est pas quitter la maison, mais y marcher comme il se doit selon l’Écriture.
C’est ce qui s’est passé à la Réforme. Luther, Calvin, Zwingli, Cranmer, n’ont pas quitté la maison de Dieu quand ils ont rejeté la messe, le culte des saints, l’autorité du pape, et d’autres doctrines et pratiques mauvaises. Au contraire, ils ont appris, même si c’était lentement et imparfaitement, à renoncer à ce qui défigurait cette maison, et était le plus opposé à Celui qui y habitait. Ce n’est que l’ignorance grossièrement bigote des Romanistes qui les a taxés de quitter la maison de Dieu. Le parti papal considérait, et d’autres prétendants aussi sont capables de le faire, qu’eux seuls formaient cette maison à titre exclusif — alors que, tant que la Réforme s’est poursuivie, les pieux parmi les protestants ont cherché à se purifier des vases à déshonneur, tandis que les Romanistes se sont accrochés d’autant plus obstinément au mal, et ont donc accru leur culpabilité. Mais des deux côtés on était tout de même dans la maison, seulement les uns de manière plus acceptable pour Dieu, et les autres de manière plus offensante qu’auparavant.
Le principe ne s’applique pas moins lorsque les pieux parmi les protestants et les romanistes ont commencé à discerner le vrai caractère de l’église, et le dommage que les erreurs et les mauvaises pratiques courantes causaient, non seulement aux membres, mais aussi à la Tête du corps. Cela a conduit, grâce à une meilleure connaissance de la parole écrite, à la conviction nette qu’on lésait les droits du Saint Esprit dans l’assemblée et dans le ministère. Ceux qui étaient ainsi enseignés de Dieu voyaient clairement qu’ils devaient mettre en pratique la vérité par la foi, et chercher ainsi à glorifier le Seigneur. Il était misérable et ingrat d’attrister l’Esprit en traitant tout ce qu’ils avaient appris comme de simples idées servant à discuter ou critiquer les pensées et les voies existantes. Mais en agissant ainsi fidèlement selon ce qu’ils connaissaient, quittaient-ils la maison ? Au contraire, ils s’efforçaient seulement, par respect pour l’Écriture et dans la dépendance du Seigneur, de mieux se comporter dans cette maison. On ne renonce pas à la chrétienté en marchant davantage selon la volonté de Dieu dans le vrai chemin pour les chrétiens, que ce soit individuellement ou collectivement. Et ce même principe n’est pas moins valable à tout moment, quelle que soit la fidélité avec laquelle les saints ont été rassemblés autrefois. Les vases à déshonneur ne peuvent pas jouir de l’approbation de Christ, et doivent être intolérables pour les fidèles. « Si quelqu’un se purifie de ceux-ci, il sera un vase à honneur ».
Ch. 2:21 — Autres dangers
Mais la tendance est grande à faire pression sur les autres pour qu’ils recherchent pareillement cette vérité, et à prétendre, sans le dire, à une immunité pour nous-mêmes : ainsi l’assemblée qui s’appuie réellement sur le Seigneur glisse facilement loin de cette fidélité jusqu’à instaurer une allégation croissante d’indéfectibilité. Car la foi dégénère en superstition d’autant plus rapidement que la spiritualité décline, que l’amour se dégrade, que la connaissance vire à l’autosatisfaction et que les formes prennent la place de la réalité. Une nouvelle Rome, en petit, se développe rapidement et est proclamée comme la seule chose juste. Pourtant, la vérité demeure pour que l’Esprit l’utilise pour la gloire de Christ, chaque fois que l’œil est, ou est rendu, simple. Nous sommes tenus, si nous voulons Lui plaire, de nous cribler par Sa parole encore plus rigoureusement que les autres.
Ch. 2:22a
L’apôtre n’oublie pas non plus les dangers personnels si on se préoccupe de maux publics : « Mais fuis les convoitises de la jeunesse, et poursuis la justice, la foi, l’amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur » (2:22).
Dans des circonstances où on est en train de se libérer de ce qui piège beaucoup de saints (et où peut-être on s’est soi-même aussi fait plus ou moins piéger dans le passé), il est très important de ne pas donner occasion à ceux qui en cherchent une. Il ne sert à rien de témoigner contre ce qui, ecclésiastiquement, est offensant pour Dieu, si on est soi-même défaillant dans sa conduite au point que ceux qu’on a virtuellement censurés le voient. D’où le soin de Paul d’exhorter vivement Timothée à se méfier de ce qui pourrait entraver ou troubler, d’autant plus à ce moment-là et de cette manière. Il faut éviter les convoitises de jeunesse, non seulement les convoitises mondaines ou charnelles, mais aussi celles « de jeunesse », comme l’impétuosité, la confiance en soi, la légèreté, l’impatience, ou autres. Il ne suffit pas non plus de veiller sur ce qui pourrait fâcher des anciens : il faut rechercher la cohérence pratique ou justice pratique, – la marche par la foi, et non pas la simple prudence ou politique humaine, – tenir ferme l’amour, et non pas les intérêts égoïstes, – maintenir la paix, et ne pas laisser faire les conflits ni pousser sa propre volonté.
Ch. 2:22b
Mais plus encore, il est encouragé à faire tout cela dans le cadre d’une association personnelle et d’une action mutuelle « avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur ».
Je ne peux pas accepter la suggestion d’un allemand (suivi par Alford, Ellicott, et al.) d’enlever la virgule après « paix », afin de séparer « avec ceux qui invoquent … » du verbe « poursuis », et de ne le relier qu’au mot « paix », qui précède immédiatement. Héb. 12:14 n’a pas d’analogie réelle avec cette phrase, car limiter la recherche de la paix à ceux qui invoquent le Seigneur donnerait le sens le plus pauvre possible, celui où il y a le moins de tension. Il n’en est rien : si l’homme fidèle se purifie des vases à déshonneur, et s’il marche dans le jugement de soi et qu’il cultive des voies agréables au Seigneur, il est encouragé par la perspective d’avoir des compagnons de route. Il n’a pas à craindre l’isolement, car il aime la communion des saints. Dieu ne manquera pas d’opérer chez ceux dont le cœur est purifié par la foi. Qu’il poursuive donc ce chemin, sans douter, mais de bon gré. Il ne sera pas seul ; il doit suivre la voie qui est agréable à Dieu « avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur », c’est-à-dire avec des saints au cœur vrai, par opposition aux promoteurs ou aux défenseurs du laisser-aller en paroles ou en actes.
C’est ainsi que la volonté du Seigneur est rendue évidente pour un jour de ruine. Il n’appartient pas aux fidèles de demeurer dans le mal en l’accompagnant de protestations creuses, une fois que les ressources de la patience ont été épuisées. Face à l’Écriture il serait présomptueux de rester sans bouger dans le vain espoir d’amender ce qui est publiquement maintenu et justifié. L’appel indubitable de Dieu est de se purifier en se retirant, et, en veillant soigneusement à éviter les dangers qu’on court soi-même, de suivre le chemin de la justice, de la foi, de l’amour, de la paix, non pas dans l’orgueil ou l’insouciance de l’isolement, mais dans la communion des personnes qui ont les mêmes pensées et qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur.
Chapitre 2 versets 23 à 26
Ch. 2:23-26
Après avoir achevé les instructions d’ordre général de manière si impressionnante et si opportune tant à cette époque que pour tous les temps, l’apôtre revient à des exhortations d’ordre plus personnel qui ne demeurent pas moins de toute valeur pour nous.
« Mais évite les questions folles et insensées, sachant qu’elles engendrent des contestations. Et il ne faut pas que l’esclave du Seigneur conteste, mais qu’il soit doux envers tous, propre à enseigner, ayant du support ; enseignant avec douceur les opposants, attendant si Dieu, peut-être, ne leur donnera pas la repentance pour reconnaître la vérité, et s’ils ne se réveilleront pas du piège du diable, par qui ils ont été pris, pour faire Sa volonté » (2:23-26).
Ch. 2:23a
Au début, comme en Romains 14 et 15, les disputes étaient très différentes, et bien plus respectables moralement. En effet, elles découlaient principalement du respect de la révélation de l’Ancien Testament chez des âmes qui connaissaient depuis longtemps les habitudes formées par elle, et qui étaient plus ou moins jalouses de cette liberté dans laquelle les païens étaient entrés avec joie en quittant la servitude avilissante des idoles. Mais l’esprit grec, habitué aux discussions frivoles de la philosophie, lorsqu’il n’était pas totalement émancipé de la simple activité intellectuelle, ou qu’il ne restait pas vraiment soumis à la parole de Dieu, s’avérait être une source fertile de danger et de mal, même pour ceux qui n’étaient pas séduits par une hétérodoxie comme celle des v. 14-18. La grâce et la vérité venues par Jésus Christ nourrissent l’âme, laissent entrer la lumière éclatante de Dieu, suscitent l’adoration et aboutissent à des voies fécondes de bonté et de justice. Il n’en va pas de même pour les questions « folles et insensées (ou : stupides) », que Timothée est enjoint ici d’éviter. Aucun qualificatif ne saurait mieux caractériser ces discutailleurs, ni de manière plus tranchante ceux qui tolèrent ou admirent ces futilités pernicieuses dans les choses de Dieu ; c’est comme les incrédules qui font la grimace devant les preuves de leur irrationalisme, et les sceptiques blessés quand leur crédulité est manifestée.
L’article [les] devant « questions folles et insensées » implique qu’il s’agissait d’une habitude bien connue chez ceux auxquels il est fait allusion, – un fruit de leur volonté et de leur confiance en soi.
Ch. 2:23b
Or l’apôtre y adjoint une conséquence que réprouve fortement quiconque aime la paix parmi les saints et cherche leur édification. De telles questions « engendrent des contestations » ou disputes, combats. C’est assez naturel parmi les hommes : ce qui est humain éclate ainsi, et prend même plaisir à se battre pour être maître. « D’où viennent les guerres, et les batailles parmi vous ? » dit Jacques ; « n’est-ce pas de cela, — de vos voluptés qui combattent dans vos membres ? » (Jacques 4:1). Au fond, c’est l’esprit du monde qui est en inimitié contre Dieu. Parmi ceux qui portent le nom du Seigneur, c’est déplorable, un témoignage vraiment contre Lui au lieu de l’être pour Lui et de Lui. Pourtant, le sérieux même d’une conviction peut exposer à ce danger, quand Christ n’est pas devant les yeux, et que nous ne sommes pas accrochés à Sa grâce. N’oublions jamais que la grâce et la vérité sont venues par Lui, non pas l’une ou l’autre seulement, mais les deux. Si la grâce est un piège lorsqu’elle est divorcée de la vérité, la vérité ne parvient pas à gagner si elle est séparée de la grâce ; elle peut même repousser et endurcir : combien plus les questions folles et insensées qui engendrent la contestation ! Elles font la promotion des objectifs de Satan, non pas des intérêts de Christ.
Ch. 2:24
Mais, de plus, « il ne faut pas qu’un esclave du Seigneur conteste [ou : se batte], mais qu’il soit doux envers tous » (2:24).
C’est ce que le Seigneur avait enseigné et pratiqué ; le disciple n’est pas au-dessus de son maître, mais tout homme accompli sera comme son maître (Luc 6:40) ; il doit s’attendre à recevoir la pareille en paroles et en actes, non pas à les rendre en retour. Mais n’y a-t-il pas des gens qui sont éprouvants au point de mériter au moins une rebuffade ? L’esclave du Seigneur doit être « doux envers tous », car il ne s’agit pas d’être désagréable humainement, mais de présenter Christ comme il se doit. Il est assez facile de blesser ou de renverser un homme ; mais qu’en est-il si cela afflige le Saint Esprit de Dieu et déshonore Christ ? Sommes-nous, comme il se doit, résolus à supporter avec patience et à gagner par la force irrésistible de la douceur ?
Ch. 2:25a
Il faut aussi qu’il soit « apte [JND : propre] à enseigner ». De nombreux saints sont lents de cœur pour recevoir quelque vérité nouvelle et pour faire des distinctions dans ce qui diffère. La tendance naturelle est de critiquer, et même de se moquer, pour certains. L’aptitude à enseigner suppose non seulement d’être capable de parler, mais d’avoir aussi l’amour des saints et la foi au Seigneur Jésus qui est l’objet du service. Cette aptitude se cultive, car les épreuves et les difficultés suffisent à faire qu’on se lasse. Avoir le Seigneur devant nous encourage le cœur. Combien Il a dû supporter, même des plus fidèles !
C’est pourquoi l’expression « ayant du support » est tout à fait appropriée. Il est triste de penser à l’arrogance des uns, à l’ingratitude des autres, sans parler du mal positif rendu pour le bien au service des saints. Mais le service du Maître ne vaut-il pas tous les troubles qu’on subit, même déjà maintenant ? Et quelle bénédiction inattendue Il donne en passant ! Et quelle joie et quelle gloire à Sa venue !
Ch. 2:25b
En conséquence, il est bon de rechercher la grâce qu’on trouve en « instruisant avec douceur les opposants ». Car le chemin de Christ n’était pas différent de cela, et c’est ainsi seulement que l’on peut espérer corriger ceux qui se positionnent en opposants. Il n’y a que cela pour les désarmer ; la grâce est heureuse d’opérer ainsi. Et l’apôtre présente ceci comme un résultat éventuel, possible et désiré : « … si Dieu, peut-être, ne leur donnera pas la repentance pour reconnaitre la vérité ».
Ch. 2:25b — la vérité
Ce dernier membre de phrase se retrouve dans la première épître (1 Tim. 2:4 « … que … les hommes… viennent à la connaissance de la vérité »), ainsi que dans la seconde épître une deuxième fois (2 Tim. 3:7 « parvenir à la connaissance de la vérité »), et toujours sous cette forme sans article devant le mot vérité. La raison n’en est pas que la préposition (εἰς ou autre) autorise l’omission de l’article là où autrement il serait nécessaire, ce qui est une notion tout à fait déraisonnable et même barbare, — bien qu’elle soit énoncée, comme nous le savons, par l’évêque Middleton dans son ouvrage compétent « Doctrine de l’article grec », et approuvée par des commentateurs aussi respectables que le doyen Alford et l’évêque Ellicott, sans parler de quelqu’un de peu solide sur ce sujet tel que Winer. Quoi qu’il en soit, c’est une erreur qui est réfutée partout dans le Nouveau Testament, dans la version des Septante et dans toute la littérature grecque, comme tout érudit peut le découvrir en testant de près ne serait-ce qu’un seul chapitre. L’omission de l’article dépend d’un principe totalement indépendant de la préposition : seulement l’absence de l’article grec dans ce genre de construction est plus fréquente qu’ailleurs, car les prépositions sont très souvent utilisées là où ce qui est considéré est le caractère, plutôt qu’un objet défini placé devant les pensées. Lorsqu’un objet défini est visé, l’article doit être présent, qu’il y ait préposition ou non ; lorsque le but est en rapport avec un caractère, l’article n’a pas sa place ; et tel est le cas dans la phrase qui nous occupe.
Ch. 2:25b — la repentance
Il peut être utile de parler brièvement de la « repentance » ; car elle va bien plus loin que ce que beaucoup pensent. Il s’agit plutôt d’une question morale que d’une question mentale, bien que, sans aucun doute, il y ait un changement de pensées de la plus grande gravité. Mais dans la repentance, l’âme est soumise à Dieu. Sa parole juge, au lieu d’être jugée. Il y a donc une révolution morale dans le cœur qui prend le parti de Dieu contre lui-même, et qui condamne non seulement les actes mauvais qui s’élèvent devant la conscience, mais tout le fond et l’état de l’être qui leur a donné naissance. La repentance est donc nettement envers Dieu comme la foi est envers notre Seigneur Jésus Christ, qui est en fait exalté par la droite de Dieu pour donner la repentance ainsi que la rémission des péchés (Actes 5:31 ; 20:21). La reconnaissance de la vérité fait suite à la repentance, comme un fruit ; sans la repentance aucune vérité n’est reçue divinement, et la reconnaissance de la vérité n’a aucune valeur aux yeux de Dieu. La vie, la vie éternelle,
Ch. 2:26
Le serviteur du Seigneur devait donc chercher « dans la douceur », non pas à remettre à sa place l’opposant, ce que l’esprit vif et la volonté obstinée voudraient naturellement faire, mais si possible à redresser ceux qui s’opposent, comme la grâce aime à le faire ; se débarrasser des personnes, même si elles causent du trouble, ne vient pas à l’esprit de celui qui est patient. Néanmoins, cette opposition est des plus sérieuses ; et l’apôtre nous le fait voir par ce qu’il rajoute immédiatement — « et qu’ils puissent se réveiller du piège du diable, par qui ils ont été mis captivité par lui, pour faire Sa volonté ».
C’est une phrase remarquablement compliquée, et des saints éminents en piété et en érudition l’ont comprise de manière très différente. Ainsi, la version autorisée n’est pas la seule à considérer que les mots ne se réfèrent qu’à l’ennemi ; ainsi font la version Syriaque et la Vulgate, suivies par Wiclif, Tyndale, Cranmer et la Rhemish (version de Reims). La Version Révisée, en revanche, avec Wetstein, Bengel, Wakefield et Mack, bien que légèrement différente par ailleurs, suppose qu’il n’y a pas un seul acteur, mais trois, le diable, le serviteur du Seigneur et Dieu. Leur version du v. 26 est donc la suivante : « Et ils pourront se délivrer du piège du diable, ayant été pris captifs par lui (le serviteur du Seigneur) pour faire la volonté de Dieu ». En marge, ils donnent ce qui semble être le sens le plus vrai, « par le diable » (et non le serviteur du Seigneur) pour faire la volonté de Dieu ; c’est ce que donne la version de Genève, Alford, Ellicott, Hammond, Wells, et al. Les deux pronoms en grec étant différents visent naturellement (mais pas nécessairement) deux parties : mais introduire ici « le serviteur du Seigneur » semble forcé tandis que la référence à l’ennemi est simple et cohérente, bien que le Dr Bloomfield pense « qu’une construction si violente est totalement inadmissible » ! Ainsi, Bèze traduit correctement dans sa cinquième édition de 1598, ayant préféré en 1588 la même chose que d’autres, de peur de paraître quelque peu audacieux dans une matière aussi sacrée.
Chapitre 3 verset 1
L’annonce de temps fâcheux
Les disputes de mots, les discours vains (bavardages) et profanes, avec la perspective d’une plus grande impiété, la fausse doctrine de quelques-uns affirmant que la résurrection avait déjà eu lieu, la grande maison de plus en plus caractérisée par des vases à déshonneur rendant la séparation d’avec eux impérative, les questions folles et insensées qui engendraient des contestations, et tout ce qui trahissait le piège du diable, — tout cela amenait à l’annonce solennelle du début du ch. 3 : « Or sache ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps fâcheux » (3:1).
Portée et importance de l’annonce de temps fâcheux
Prenons le temps de peser un peu plus longuement la portée et l’importance de cette annonce, ainsi que le témoignage général du Nouveau Testament, car :
- d’une part, aucune déclaration n’est plus opposée à l’estimation qui prévaut dans l’humanité, y compris aux attentes chéries de beaucoup d’enfants de Dieu de nos jours,
- d’autre part, juste après la vérité fondamentale individuelle et collective, il est de la plus haute importance d’avoir une estimation juste et vraie de ce qui se passe, et comment cela va se terminer : vivons-nous un progrès vers une bénédiction triomphante, ou vivons-nous le déroulement de la plus humiliante et coupable décadence loin de Dieu, courant au-devant de Son jugement impitoyable ?
L’Écriture ne laisse pas le moindre doute sur le sujet. La différence est complète sur le plan moral, car elle affecte les objectifs habituels de notre travail et de notre témoignage, ainsi que le caractère de notre relation avec Dieu : une communion dans ou en dehors de Ses pensées ? La foi en notre Seigneur et en Son œuvre est sans doute l’essentiel ; mais une attente erronée fait un immense tort à l’âme en proportion de son influence. L’espérance d’un homme est ce qui détermine sa vie pratique principalement. Il s’identifie à ce sur quoi son cœur se fixe.
Fâcheux ou périlleux
L’Écriture qui est devant nous est des plus explicites. Des temps difficiles ou fâcheux allaient arriver ; pas seulement des temps « périlleux », comme dans la version anglaise autorisée KJV et toutes les versions anglaises plus anciennes, y compris la Rhemish (de Reims ; fidèle à la Vulgate). Ces temps sont ainsi qualifiés en raison d’une iniquité abondante sous une apparence chrétienne pas mauvaise, « une forme de piété » jointe à une réelle négation de sa puissance. Peut-on concevoir un état plus répugnant pour Celui qui habite dans l’assemblée ? un état où l’homme pieux a beaucoup de difficultés à juger et à déterminer comment agir justement ? Il déteste la présomption, il recherche l’humilité, il aime ses frères, il est tenu d’être fidèle à Christ, et il ne peut pas poursuivre sa route avec le mal, individuel ou collectif. C’est un temps où le cœur et la conscience sont vraiment à l’étroit.
Absence de l’article avant « derniers jours »
Cette condition éprouvante pour le chrétien est annoncée pour « [les] derniers jours ». Winer (Grammaire grecque du N.T. iii. xix.) a tenté de justifier l’omission de l’article usuel, en le classant dans une catégorie de mots très divers qui dispensent de son insertion. On est surpris de voir avec quelle facilité des hommes comme le doyen Alford et l’évêque Ellicott se sont facilement contentés que la question soit éludée de manière aussi irrationnelle et peu fondée. Car cette longue liste de mots reste soumise aux principes invariables de la langue ; et dans chaque cas on peut justifier aussi bien l’insertion que l’omission ; de sorte que l’exposé des faits est non seulement partial, mais trompeur. La véritable solution est que le grec présente régulièrement la forme sans article lorsqu’il s’agit de désigner un état caractéristique plutôt qu’un fait positif, un lieu, une condition, une personne ou une date. L’article ici aurait rendu la période trop restreinte ; son absence élargit la sphère, comme le voulait le Saint Esprit, qui connaissait la fin dès le commencement. Dans notre langue, nous pouvons difficilement éviter de dire « les derniers jours » ; mais les Grecs pouvaient s’exprimer avec plus d’exactitude.
L’expression couvre clairement les derniers jours de la dispensation chrétienne, aussi longtemps qu’il plaît à Dieu de les prolonger ; autrement dit il s’agit du temps, en général, qui précède la venue du Seigneur, lorsque les voies actuelles de Dieu prendront fin, et que le royaume sera manifesté en puissance et en gloire. La suggestion de Waterland « à la fin de l’état juif » selon qu’il la positionne, est une erreur1 ; car « les derniers jours » seront à l’approche de la fin à la fois de la profession chrétienne et de la profession juive. Si d’un côté les Juifs ne croient pas encore, les chrétiens doivent s’attendre à ce que le royaume revienne à Israël au temps voulu par Dieu, lorsque notre Seigneur apparaîtra pour recevoir l’hommage et la bénédiction du résidu pieux, sur le point de devenir désormais une nation forte et sainte, — Son fils premier-né, élu, ici-bas. Mais comme il y avait déjà un début d’action du mal apparent pour Celui qui inspirait Paul à écrire ces paroles à Timothée, nous pouvons d’autant mieux sentir à quel point la construction sans article [derniers jours] est plus correcte que si l’insertion d’un article l’avait fixée exclusivement aux jours précédant immédiatement le futur avènement de notre Seigneur.
1 Quand on comprend bien, le jugement d’Israël, des Gentils et de la chrétienté a lieu à peu près au même moment à la consommation du siècle, comme le montre notre Seigneur en Matthieu 24 et 25 ; et à cela s’accordent Gen. 49:1 ; Nb. 24:14 ; Deut. 4:30 ; Deut. 31:29, Job 19:25 ; Ésaïe 2:2 ; Éz. 38:16 ; Dan. 2:28 ; 10:14 ; 12:13 ; Michée 4:1, dans tous ces passages sont prédits la « fin des jours » ou les « derniers jours ».
Rappel de 1 Tim. 4 : une évolution du mal encore limitée à quelques-uns
Dans l’épître précédente (1 Tim. 4:1-3), un avertissement prophétique avait été donné, mais au sujet d’un mal tout à fait distinct de ce que nous avons ici, à la fois dans le temps, le caractère et l’étendue. Au lieu des « derniers jours », l’Esprit parlait expressément de « derniers temps », ou temps ultérieurs, c’est-à-dire des temps postérieurs au temps où l’apôtre a écrit. Au lieu d’une condition répandue parmi les « hommes » dans la chrétienté (2 Tim. 3:1-2), il ne parlait en 1 Tim. 4:1 que de « quelques-uns ». Les expressions utilisées correspondaient à cela ; elles ne supposaient qu’un nombre relativement faible, et ce n’est qu’un zèle porté à la controverse qui a pu négliger le langage précis, et le transformer en une prédiction de la vaste percée du romanisme, sinon pire. 1 Tim. 4:1-3 fait une description de certains qui se sont écartés de la foi pour se tourner vers l’ascétisme charnel, en prêtant attention aux esprits séducteurs et aux doctrines de démons, disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur conscience cautérisée, défendant de se marier et prescrivant de s’abstenir des viandes que Dieu a créées pour être prises avec actions de grâces. Il s’agissait d’un abus flagrant de la grâce visant à renier la créature et à dissocier le Dieu de grâce du Dieu créateur et de la loi ; mais les adeptes sont soigneusement distingués des trompeurs les plus effrontés et corrompus. Le gnosticisme était le mal visé en réalité ; il commençait à agir selon ce qui ressort de 1 Tim. 6:20 dans la même épitre. Mais comme les expressions utilisées dans le texte de 1 Tim. 4 sont restreintes, et vu le mal tel qu’il est devenu dans les faits, tout cela nous montre, si nous tenons compte de l’Écriture, comment l’Esprit de Dieu nous met en garde d’anticiper une victoire de l’évangile, et comment Il nous prépare plutôt à l’abandon qui est pour le déshonneur de Dieu.
2 Tim. 3 — Un état général où le mal s’étale sans réserve. Il faut s’en détourner
Mais dans 2 Tim. 3:1 la vue porte sur un champ plus large, qui n’exclut évidemment pas les âmes fidèles et pieuses ; mais l’œil parcourt un état général de décadence par rapport à la puissance de la grâce et de la vérité, où, comme nous le verrons au cours de l’examen des détails, ceux qui portent le nom du Seigneur (et qui sont donc responsables de marcher comme morts au péché et comme vivants pour Dieu dans le Christ Jésus notre Seigneur, Rom. 6:11), retournent à un état dont la description générale correspond à celui où se trouvaient les Gentils avant d’entendre l’évangile et de professer le croire. Cela fait la paire avec la grande maison de 2 Tim. 2:20, où l’on trouve non seulement des vases d’or et d’argent, mais aussi de bois et de terre, les uns à honneur, les autres à déshonneur. Ici, cependant, nous avons, non pas une figure symbolique, mais un compte-rendu simple et concret d’un retour au paganisme quant à la pratique. Les Corinthiens, qui avaient sombré très bas, se voyaient reprocher par l’apôtre leur caractère charnel et le fait de marcher « comme des hommes », au lieu de marcher comme des enfants de Dieu dans la puissance de l’Esprit qui les habitait. Il est parlé ici (3:2-5) d’« hommes », qui sont coupables d’indifférence vis-à-vis du christianisme et qui en répudie toute la saveur, tout en conservant la forme. Vis-à-vis de tels hommes, si peu développé que ce soit à l’époque, Timothée était appelé à se détourner : maintenant que le mal s’étale sans réserve, à combien plus forte raison un homme fidèle devrait-il se détourner ?
2 Thes. 2 — L’apostasie, le mal sans borne tombant sous le jugement du Seigneur à Son apparition
Pourtant 2 Thess. 2 nous fait apercevoir quelque chose de bien pire bientôt. Nous ne devons en aucune façon nous laisser tromper de quelque manière que ce soit par le succès des faux docteurs auprès de certains des saints de Thessalonique si jeunes dans la foi. Nous savons que le Seigneur vient et nous rassemblera auprès de Lui, à la fois ceux qui sont endormis et les vivants ; c’est la raison pour laquelle nous ne devons pas nous laisser promptement bouleverser ni troubler dans nos pensées par aucune puissance ou aucun moyen quelconque, sous prétexte que le jour du Seigneur serait arrivé. Nous savons qu’il ne peut l’être que si premièrement « l’apostasie » est là. L’apostasie est « l’apostasie » et rien d’autre : il ne s’agit pas de « chute loin », comme dans toutes les versions anglaises bien connues ainsi que dans la version autorisée KJV. Il ne s’agit pas de distanciation ni de « révolte ». Il ne peut rien y avoir de pire que « l’apostasie », hormis la personne qui sera à sa tête au stade final, en opposition directe avec Dieu et Son Oint, l’homme de péché, le fils de perdition, que le Seigneur Jésus consumera par le souffle (l’Esprit) de Sa bouche et qu’Il anéantira par l’apparition de Sa présence.
« L’apostasie » est un état général, bien que l’on soit loin de nier qu’il y aura même en ce temps-là des personnes pieuses, certaines devant souffrir jusqu’à la mort, et acquérir une récompense céleste, tandis que d’autres échapperont pour bénéficier ultérieurement de bénédiction et de gloire divines ici-bas. Mais l’apostasie signifie l’abandon du christianisme et le renversement presque universel du témoignage pour Dieu dans la sphère de la profession chrétienne. C’est là l’état aboutissant à la revendication la plus effrontée jamais faite sur terre, celle de la position messianique et de la gloire divine ; celle-ci précède immédiatement l’apparition du Seigneur Jésus du ciel, exerçant la vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Dieu (les Gentils), et sur ceux qui n’obéissent pas à l’évangile de notre Seigneur Jésus (les Juifs) — 2 Thes. 1:7-8.
Nous continuons ainsi la preuve claire, harmonieuse, et qui amoncelle ce dont le Saint Esprit rend témoignage, à savoir non pas la croissance du bien ni le triomphe terrestre final de l’évangile et de l’Église ici-bas, mais bien plutôt la croissance irrémédiable du mal en général (même si l’œuvre de grâce de Dieu reste active ordinairement, surtout à certaines grandes époques de bénédiction) ; cela finira par sombrer si bas que la masse abandonnera même le nom et la forme de la profession chrétienne dans l’apostasie ; et l’antichrist, le dernier chef de l’hostilité se dressant contre Dieu, s’élèvera si haut que le Seigneur apparaîtra du ciel avec les anges de Sa puissance, en flammes de feu, pour exercer le châtiment d’une destruction éternelle de devant la présence du Seigneur et la gloire de Sa force (2 Thes. 1:7-9). Attendre que le bien prévale partout dans le monde grâce à des moyens humains et avant l’apparition du Seigneur, n’est pas seulement un rêve de vanité, mais c’est le renversement du tableau terrible que l’Écriture dépeint de l’aggravation sans borne de ce qui appellera impérativement le jugement divin ; c’est ensuite seulement que la terre sera pleine de la connaissance de l’Éternel comme les eaux couvrent le fond de la mer (És. 11:9 ; Hab. 2:14).
Le Seigneur avait aussi prédit le développement du mal — Matt. 13
Le Seigneur avait en effet déjà tranché la question tant par des paraboles que par des prophéties. Car quelle est l’instruction à ce sujet donnée par la parabole du champ de blé de Matt. 13:24-30, 36-43 ? Pendant que les hommes dormaient, l’ennemi de celui qui semait de la bonne semence dans son champ y a semé de l’ivraie ; l’homme n’a pas été capable de porter remède au tort qui lui avait été fait dès les premiers jours : seul le jugement divin peut s’en occuper correctement. Or le champ, c’est le monde sous le royaume des cieux, le Fils de l’homme étant exalté ; Son ennemi est le diable, c’est lui qui, par le moyen des fils du méchant, cause un dommage fatal par ce qu’il insinue : le légalisme, le ritualisme, le gnosticisme, l’ascétisme, l’hérésie, l’antichrist, le romanisme, Babylone, et toute sorte d’autres maux ; toutes les causes de trébuchement ou de scandale ne peuvent être éliminées avant que le Fils de l’homme envoie Ses anges à la consommation du siècle ou achèvement de l’ère (non pas à « la fin du monde », ce qui est tout à fait trompeur, car « le siècle » se termine plus de mille ans avant « le monde »).
Il s’ensuit donc incontestablement que le Seigneur prédit (Matt. 13:38-43) la continuation inéluctable du mal qui prévaudra dans la sphère de la profession chrétienne jusqu’à la consommation du siècle (ou fin de l’ère) ; à ce moment-là, Il emploiera Ses anges pour exécuter le jugement sur les vivants ; alors les maux diaboliques, et tous les autres, seront ainsi éliminés de Son royaume, tandis que les justes brilleront dans le royaume de leur Père. Car tout doit être dirigé et réuni en Christ, les choses dans les cieux et les choses sur la terre — en Lui en qui nous avons obtenu un héritage, étant héritiers de Dieu, et cohéritiers avec Christ (nous ne sommes pas simplement Son héritage comme Israël ici-bas) (Éph 1:10, 11 ; Rom. 8:17). La notion du bien régnant dans le monde à un moment quelconque sous l’évangile ou l’église, est tout à fait fausse ; est également fausse la notion selon laquelle la justice ne régnera pas lorsqu’Il prendra le royaume en gloire visible sur la terre, et la notion que la nouvelle ère commencera bien avant l’éternité dans le plein sens d’un nouveau ciel et d’une nouvelle terre. Il n’est donc pas étonnant que nous lisions au sujet de temps fâcheux dans les derniers jours qui précèdent la colère venant du ciel.
Et qu’est-ce que le Seigneur indiquait sur l’état moral avant la venue du Fils de l’homme en son jour, simplement selon Sa prophétie de Luc 17:22-37 ? « Et comme il arriva aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il aux jours du Fils de l’homme. Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils étaient donnés en mariage, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche et le déluge vint et les fit tous périr. De même aussi, comme il arriva aux jours de Lot, ils mangeaient, buvaient, ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient, ils bâtissaient ; mais au jour où Lot sortit de Sodome, il plut du feu et du soufre du ciel et les fit tous périr ; il en sera de même au jour où le Fils de l’homme sera révélé ».
Il est clair que le Seigneur compare l’état des hommes (négligents, égoïstes, impies, coupables, morts aussi à ce que Lui, le Messie rejeté, avait souffert pour eux) à celui qui a entraîné les deux jugements les plus solennels que la Genèse rapporte, le déluge et la destruction de Sodome par le feu. La révélation du Fils de l’homme en son jour sera-t-elle moins opportune ? Non ; les derniers jours de l’ère chrétienne seront des temps d’iniquité (marche sans loi, sans frein) extraordinaire, abondante et effrontée, — des temps d’impiété où il deviendra impossible que la patience de Dieu dure plus longtemps ; le temps sera alors venu selon Ses conseils que le premier homme marqué par le péché, la faiblesse et la honte, soit remplacé par le second Homme, exalté sur Son propre trône au-dessus de toute la création en puissance et en gloire visibles, tandis que maintenant Il est dans les cieux sur le trône du Père.
Ne pas faire de confusion à propos des événements à venir
Il est notoire qu’il ne manque pas de théologiens — en effet leur nom est Légion — pour émousser l’épée dans leurs mains en appliquant à tort les paroles de notre Sauveur : les uns les applique à la destruction de Jérusalem par Titus, les autres les applique à la fin du monde lorsque le Seigneur sera assis sur le grand trône blanc. Un homme représentatif, qu’il n’est pas nécessaire de nommer, aussi remarquable par la splendeur de son oratoire que, hélas ! par l’erreur mortelle contre la personne de Christ (erreur dans laquelle il s’est trahi), a cherché à englober ces deux événements dans l’apparition du Seigneur pour le jugement des vivants. Mais l’Écriture n’est pas flexible et imprécise comme la fausseté l’aime, mais elle est vivante et opérante, et plus pénétrante qu’une épée à deux tranchants (Héb. 4:12). Elle coupe d’un côté et préserve de l’autre, comme on peut le constater dans le cas de la discrimination remarquable entre les deux hommes et les deux femmes respectivement (Luc 17:34, 35) ; cette discrimination est incompatible à la fois avec le massacre impitoyable des Romains, et avec la comparution de tous les morts pour être jugés à la fin. Le jugement des vivants à l’apparition du Seigneur sera en vérité aussi soudain et tranchant « que l’éclair qui brille, et luit de l’un des côtés de dessous le ciel jusqu’à l’autre côté de dessous le ciel » (Luc 17:24). Ceci ne s’applique en aucune manière à l’invasion de Titus, qui a notoirement permis aux Juifs croyants de s’échapper ; et Luc 21:20-24 distingue soigneusement cette invasion par Titus d’avec la venue du Fils de l’homme sur une nuée avec puissance et grande gloire (Luc 21:27). Confondre cette dernière venue, comme Luc 17:22-37, avec la mise à sac de Jérusalem par Titus, n’est pas une vraie exégèse, mais une confusion abjecte et sans équivoque ; et il en est de même avec les circonstances tout à fait opposées d’Apoc. 20:11-15, où il ne sera pas question de retourner à la maison ou au champ, il n’y aura pas de différence au lit ou au moulin. Le Seigneur se réfère ici (en Luc 17) exclusivement au jour où Il apparaitra pour juger les hommes vivants sur la terre, et les Juifs en particulier ; et Ses paroles ne laissent aucune place à un progrès en bien auparavant, mais seulement en mal.
Progrès dans le mal aux derniers jours : ce qu’en disent les divers apôtres
Les disciples et les serviteurs inspirés de notre Seigneur ne parlent pas différemment.
Jacques
À cause du mal, de la corruption et de la violence qui prévalent, Jacques exhorte : « Usez donc de patience, frères, jusqu’à la venue du Seigneur… Voici, le Juge se tient à la porte » (Jacq. 5:7, 9). Ils devaient donc prendre, comme exemple de souffrance et de patience, les prophètes qui avaient parlé au nom du Seigneur. Ce n’allait pas être un temps de triomphe pour une justice extérieure jusqu’à la venue du Seigneur. Les jours étaient mauvais, les derniers jours seraient des temps fâcheux. Ceux qui enduraient l’épreuve avec patience seraient appelés bienheureux. C’est tout l’inverse de la justice à l’aise et en honneur dans le temps présent.
Pierre
Pierre, dans sa deuxième épître en particulier, est encore plus explicite : « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, comme il y aura parmi vous de faux docteurs, qui introduiront furtivement des hérésies de destruction (ou : sectes de perdition), reniant même le Maître qui les a achetés, faisant venir sur eux une prompte destruction » (2 Pierre 2:1). Les caractéristiques mauvaises, avec de solennels avertissements, sont exposés tout au long du ch. 2 ; et en 2 Pierre 3:3, 4, Pierre ajoute que « dans les derniers jours, des moqueurs viendront, marchant avec raillerie selon leurs propres convoitises, et disant : Où est la promesse de sa venue ? car depuis que les pères se sont endormis, toutes choses demeurent au même état que depuis le commencement de la création ». Aujourd’hui encore, le matérialisme et la moquerie prévalent de façon surprenante parmi les hommes du monde ; et, selon l’apôtre, ce sera encore pire juste avant le jour du Seigneur. C’est une merveilleuse longanimité de Dieu de sauver même de telles personnes ; mais le jour viendra sûrement d’une juste vengeance sur la chrétienté qui s’enivre ainsi de la plus basse lie du positivisme et de la moquerie impie. Quels temps fâcheux que ces derniers jours !
Jude
Jude, frère de Jacques, dépeint le mal avec des couleurs plus sombres que Pierre, si tant est que cela soit possible, ; car par l’Esprit il fixe les yeux, non seulement sur l’iniquité qui doit prévaloir à l’approche du temps du jugement du monde, mais sur l’apostasie ingrate, qui ignore les très hauts privilèges de la bonté divine, et qui « change la grâce de notre Dieu en dissolution, reniant notre seul Maître et Seigneur Jésus Christ » (Jude 4). Rien de plus terrible que cette courte épître dans son ensemble, rien de plus simple que le fait qu’elle identifie ceux qui sont devant les yeux des saints à ceux desquels Énoch a prophétisé comme étant les objets du jugement du Seigneur : « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des paroles que les apôtres de notre Seigneur Jésus Christ vous ont dites auparavant, qu’à la fin des temps il y aurait des moqueurs marchant selon leurs propres convoitises d’impiété » (Jude 17, 18). Cette sainte écriture ne donne-t-elle pas une pleine certitude à l’avertissement de temps fâcheux aux derniers jours ? Être placé irréprochable avec abondance de joie devant la gloire divine à la venue de Christ, n’est pas l’espérance de l’église ou de l’évangile qui auraient au préalable triomphé sur la terre.
1 Jean
Il ne reste qu’un de plus à citer, « le disciple que Jésus aimait » ; il écrit avec autant de clarté : « Petits enfants, c’est la dernière heure, et comme vous avez entendu dire que l’antichrist vient, maintenant aussi il y a beaucoup d’antichrists, par quoi nous savons que c’est la dernière heure » (1 Jean 2:18). Voilà quelque chose assurément d’irrécusable. L’antichrist sera l’objet principal du jugement consumant et anéantissant du Seigneur lorsqu’en Son jour Il viendra brillant comme l’éclair ; or les nombreux antichrists faisaient déjà sans cesse à l’époque, leur œuvre rusée et destructrice de méchanceté, et ils le feront jusqu’à l’exécution de Son jugement qui balaiera la scène pour faire place au règne de justice et de paix. Entre temps la grâce ne manquera pas de sauver et d’associer avec Christ en haut. Car « comme est le Céleste, ainsi sont aussi les célestes ; et comme nous avons porté l’image du terrestre [JND : de celui qui est poussière], nous porterons aussi l’image du céleste » (1 Cor. 15:48, 49). La croix a moralement fermé l’espérance et l’histoire de la terre en relation avec Dieu ; le Saint Esprit envoyé du ciel donne un dernier appel : quand celui-ci est rejeté, tout est désormais lié à Christ dans et pour le ciel, auquel l’évangile appelle tous ceux qui croient maintenant. Et le monde, en particulier l’église-monde Babylone, devient l’objet du jugement de Dieu qui sera exécuté par le Seigneur à Son apparition, comme nous l’avons montré par un témoignage surabondant, mais pas encore exhaustif. Le coup tombe quand l’iniquité est à son comble. Les temps sont fâcheux maintenant ; combien plus juste avant ce jour-là !
Chapitre 3 verset 2
Ch. 3:2-5
Il nous faut maintenant entrer dans l’examen détaillé des caractéristiques mauvaises que l’apôtre signale comme marquant les derniers jours de l’estampille « temps fâcheux ». Les premiers et les derniers mots sont remarquablement et douloureusement instructifs. C’est la chrétienté qui est placée devant nous ; pourtant, ceux qui portent le nom du Seigneur ne peuvent être désignés que comme des « hommes », moralement aussi corrompus et violents que les païens (Rom. 1:29-31) ; même si ce n’est pas aussi grossièrement, néanmoins ils ont seulement une forme de piété, et ils en ont renié la puissance.
« Car les hommes seront égoïstes (amants de soi), avares (amants de l’argent), vantards, hautains, blasphémateurs [JND : outrageux], désobéissants à leurs parents, ingrats, profanes (JND : sans piété), sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, incontrôlés (incontinents), cruels, n’aimant pas le bien, traîtres, téméraires (fortes têtes), enflés d’orgueil, amis des voluptés plutôt qu’amis de Dieu, ayant une forme de piété [JND : la forme de la piété], mais en ayant renié la puissance. Or détourne-toi de telles gens » (3:2-5).
Si le Saint Esprit a ainsi minutieusement qualifié les maux qui rendent les temps fâcheux, il me semble que ce serait manquer de révérence de les survoler superficiellement, comme si Ses désignations étaient soit évidentes à comprendre, soit indignes d’une méditation profonde pour notre profit. Le réformateur Genevois a fait preuve de légèreté sur ce point, et il vaut mieux admirer l’esprit d’un de nos contemporains qui a consacré tout un traité à l’effort louable de nous faire apprendre ce que l’apôtre voulait que Timothée sache — d’autant plus que les jours où nous vivons affichent à un degré beaucoup plus avancé les traits sombres qu’on pouvait voir en germe déjà dans des temps anciens.
L’apôtre avait prévu d’autres choses de première importance ; mais Timothée devait « savoir ceci aussi » [version autorisée KJV, bien que non repris dans la traduction donnée par WK], et il est certain que nous ne connaissons qu’imparfaitement ce que nous ne saisissons que sous une lumière faible et embrumée. Celui [Paul] qui nous écrit avec la plus grande précision voudrait que nous lisions et étudions avec attention. Le devoir pratique (« détourne-toi de telles gens ») ne peut être qu’imparfaitement rempli si nous ne savons pas clairement qui sont et quels sont les caractères des personnes dont on est appelé à se détourner. Nous sommes ainsi tenus de discerner, non pas dans un seul des cas, mais dans tous, afin qu’il n’y ait pas d’erreur. Si la charité peut plaider, la sainteté et l’obéissance sont impératives, surtout de la part de ceux qui, comme Timothée, sont justement chargés de veiller à la bonne doctrine, à l’ordre et à la piété.
Ch. 3:2
Égoïstes
« Car les hommes seront égoïstes (amants d’eux-mêmes) ». Telle est la première caractéristique qui, pour le Seigneur et les Siens, est si fâcheuse chez ceux qui portent Son nom. C’est à juste titre que cette caractéristique des professants qui déshonorent Christ, occupe la première place dans cette liste ; car elle est la mère de tous les maux, en ce qu’elle contrevient directement à la volonté de Dieu dans le Christ Jésus concernant Ses enfants. Christ, en effet, est mort pour tous ; mais le but moral ultime était que ceux qui vivent (quoi que fassent les autres qui restent morts) « ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour Celui qui pour eux est mort et a été ressuscité » (2 Cor. 5:15). « Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez l’un l’autre ; comme je vous ai aimés, que vous aussi vous vous aimiez l’un l’autre. À ceci tous connaitront que vous êtes Mes disciples, si vous avez de l’amour entre vous » (Jean 13:34, 35). Car « quiconque aime celui qui a engendré, aime aussi celui qui est engendré de Lui. Par ceci nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, c’est quand nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements ; et ses commandements ne sont pas pénibles » (1 Jean 5:1-3).
Ainsi, aimer Dieu prouve que nous aimons vraiment Ses enfants ; et obéir à Ses commandements prouve que nous aimons vraiment Dieu. Ainsi, la première condition pour être disciple (ou : discipulat) selon ce que dit notre Seigneur (Matt. 16:24 ; Marc 8:34), est de se renoncer soi-même, c’est-à-dire le pur contraire de s’aimer soi-même. Oh ! quel modèle en Celui qui, bien que riche, est devenu pauvre pour nous, afin que par Sa pauvreté nous fussions enrichis ! (2 Cor. 8:9). Cet amour auquel nous sommes appelés, n’est pas la condition originelle d’innocence d’Adam non déchu, et encore moins, bien sûr, l’état de de l’homme à présent, haïssable et haïssant ; c’est au contraire ce que nous voyons et connaissons dans le Second Homme, le dernier Adam ; c’est être des imitateurs de Dieu, comme de bien-aimés enfants, marchant dans l’amour comme Christ nous a aussi aimés et s’est donné Lui-même pour nous, comme offrande et sacrifice à Dieu, en parfum de bonne odeur (Éph. 5:1, 2). Ayant revêtu le nouvel homme et étant scellés par le Saint Esprit de Dieu, aucune autre norme ne pouvait nous être présentée, et cela fait un contraste terrible avec l’état des égoïstes, lequel est d’autant plus triste quand ils ont été baptisés pour le nom de Christ et pour Sa mort.
Ne dites pas que le moi ne règne qu’à l’extérieur parmi les profanes ; montrez-moi où il ne règne pas parmi les vrais croyants dans toute la chrétienté. Le monde aime les siens, dit le Seigneur (Jean 15:19) : est-ce aussi vrai de Ses membres dispersés dans les partis, nationaux et dissidents, chacun étant rival de l’autre ? Or cette fausse position, avec son effet d’isolement, a puissamment incité les âmes à flétrir tout vrai sens de l’unité sur terre — à se préoccuper du simple progrès de partis, — ou au mieux à travailler pour la bénédiction individuelle — au lieu de travailler pour la gloire de Christ dans l’église qui est Son corps.
Avares
Ensuite, ils seront « avares (ou : aimant l’argent) ». Que les croyants écoutent le jugement de quelqu’un qui a scruté leurs voies en vérité, sans favoritisme : « Pour autant que nous puissions le vérifier, ils témoignent qu’ils ne refusent pas de suivre les traces des mondains sur le chemin de la richesse. C’est en vain qu’on chercherait un signe distinctif à cet égard entre les deux classes de la société, celle qui est « du monde » et celle qui n’est « pas du monde ». Tous apparaissent animés du même ressort pour pousser leur fortune dans la vie ; tous font preuve du même zèle ardent, actif et entreprenant dans leurs poursuites respectives ».
Un homme sérieux peut-il nier l’énorme impulsion donnée à l’amour de l’argent de nos jours, y compris parmi ceux qui professent le nom du Seigneur, et cela aussi vivement et couramment que dans le monde indifférent à Dieu ? Sans doute, comme on l’a remarqué, les découvertes récentes de nouvelles sources de richesse, les inventions remarquables des hommes, les habitudes d’entreprises à grande échelle qui ont suivi ce mouvement, sans parler du luxe croissant, — tout cela a contribué à cette quête avide de gain. Mais le fait est incontestable, et l’effet des plus pernicieux ; pourtant, qui le prend à cœur, et qui le juge comme un péché de premier ordre ? Et cela n’a-t-il pas été accéléré et justifié par cette particularité nouvelle et croissante du dernier (18ème) siècle, à savoir les institutions religieuses et philanthropiques ? or elles sont le produit et l’orgueil des divisions ecclésiastiques, et elles reconnaissent ouvertement dépendre des collectes, des souscriptions et des donations d’argent ! Il est certain que notre Seigneur a statué autrement dans le Sermon sur la Montagne, et Ses serviteurs inspirés ont à la fois agi et écrit pour notre avertissement en des termes destinés à rendre intolérable le service de mammon, et à refuser aux cupides une place dans l’église (Éph 5:5).
Vantards
Les « vantards » suivent ; qui n’entend pas leur voix qui résonne aujourd’hui ? Cela suit de près les pas de l’amour de l’argent (des avares), comme cet amour de l’argent suit de près l’amour de soi (des égoïstes). Et les matériaux qui fournissent de quoi satisfaire l’amour de l’argent servent à construire le piédestal d’où l’on entend de tous côtés clamer les vanteries vaines des vantards. Si vous en doutez de la part de la profession religieuse, vous êtes assurément durs d’oreille, et vos yeux regardent sans voir. Car tout est claironné devant le monde, qu’il s’agisse des contributions religieuses, de la charité envers les pauvres, ou de tout ce qui occupe les hommes publiquement.
Quelle époque éclairée que la nôtre — dit-on ! Qui ne chante pas ses réalisations ? Qui ne loue pas sa science physique, voire métaphysique, sa chimie et son savoir ? N’allez pas dire que ces vantards sont les simples adeptes de la philosophie naturelle. Hélas ! ce sont des théologiens prétendument pieux qui annoncent avec hâte et ignorance que la Géologie déclare une chose, et la Genèse une autre ; leur conclusion de base est que la Genèse doit s’incliner, et vénérer la Géologie à l’heure où l’on entend le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuque, du psaltérion, de la musette, et toute espèce de musique [application de Daniel 3:5] ! Car l’esprit de vaine gloire a banni tout sentiment de peine et de honte que la parole de Dieu soit ainsi déshonorée ; même ceux qui prêchent cette parole n’ont pas honte d’aller renforcer le chœur des « vantards ».
Hautains
Peut-on s’étonner d’avoir ensuite des « hautains » ? Ils présentent un mal ancré plus profondément que celui des « vantards », bien qu’on les entendent moins. Ce sont les orgueilleux contre lesquels Dieu se dresse, les plus proches de la faute de Satan, les plus étrangers à la pensée qui était dans le Christ Jésus lequel, étant en forme de Dieu, n’a pas considéré comme un objet à ravir d’être égal à Dieu, mais s’est anéanti Lui-même, prenant la forme d’un esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, et, étant trouvé en figure comme un homme, s’est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu’à la mort, et même à la mort de la croix (Phil. 2:5-8). C’est ainsi qu’apprécier Christ est notre seule délivrance sûre et sainte ; car l’orgueil se cache sous tant de voiles, qui font illusion pour soi personnellement autant que pour les autres, spécialement chez les simples professants ou même les vrais chrétiens qui marchent avec le monde. La grâce donne la vraie humilité, qui consiste non pas tant à penser tout le mal possible de nous-mêmes qu’à penser à Christ et pas du tout à soi-même. Quand nous L’avons vu, tel qu’Il est, nous pouvons nous voir comme ne méritant pas qu’on pense à nous, sauf devant Dieu pour juger nos voies quand elles sont fautives. Chacun peut alors, facilement et sans effort, estimer l’autre plus excellent que soi, en considérant non pas ce qui est à soi, mais ce qui est aux autres. Est-il possible de faire une esquisse plus opposée à ce qui prévaut dans la chrétienté ? « Orgueilleux » ou « hautain » est la désignation la plus vraie de ce genre qui abonde.
Blasphémateurs et désobéissants à leurs parents
Viennent ensuite les « blasphémateurs » [JND : outrageux] et les « désobéissants à leurs parents » ; ils sont à leur place, juste après ce qui précède, et vont ensemble dans cet ordre. Car l’exaltation de soi ouvre la voie à des pensées indignes et à des propos qui sont des affronts contre Dieu ; la propre volonté s’élevant contre l’autorité parentale en est le résultat naturel. Certains traducteurs, très respectés pour leur jugement spirituel, ont estimé que le premier de la paire signifiait « des gens qui disent du mal » en général. Mais ceci ne semble pas en harmonie avec l’autre membre de la paire [les désobéissants à leurs parents], et pas non plus avec les « calomniateurs » du v. 3, qui deviendraient une répétition presque inutile. Le terme « blasphémateurs » semble donc être ici le terme juste, car il traduit la force naturelle et entière du mot, — sauf dans des cas où le contexte exige une atténuation, ce qui parfois est indiscutable.
C’est le libéralisme du jour qui a donné lieu à une diffusion sans précédent du blasphème d’une part, et de la désobéissance aux parents d’autre part. Car on considère toujours plus aujourd’hui que l’autorité — et surtout l’autorité divine — n’est que l’horreur des âges sombres ou siècles non éclairés, et qu’il n’existe pas de norme rigide de vérité et de justice ! Ainsi l’opinion publique se charge de décider, et la société devient le pouvoir suprême sur terre, avec ses ordonnances (c’est-à-dire les lois et les décisions des magistrats, qui agissent au nom de la société et pour son bien-être !), ces ordonnances s’imposant à tous ses membres, mais n’autorisant pas qu’une société nationale en gouverne une autre, et encore moins que ses fonctionnaires aient droit de gouverner contre la volonté de la société, ou d’exercer un pouvoir plus grand qu’il ne plaît à celle-ci !
J’ai délibérément adopté les idées et les paroles d’un défenseur compétent, savant et dévot de ce plan impie, qui contredit tout ce que les gens pieux du passé ont tiré de l’Écriture, en particulier à partir de passages tels que Rom. 13:1-7 et 1 Pierre 2:13-18. Sur les textes, il y a d’autant moins de raison de s’attarder que presque tous ceux qui lisent ces pages rejettent par principe ce misérable fruit de la Révolution française, ou plutôt de la philosophie incrédule qui lui donnait une impulsion si profonde et si forte, — cette impulsion a porté son fruit à la fois immédiatement et à la fois en provenance de la Grande Bretagne un siècle auparavant. Les blasphémateurs ont commencé à affirmer leur volonté sans frein, réprouvée pourtant par la loi publique et objet d’horreur pour les oreilles des croyants. Mais peu à peu, la retenue a cédé et les hommes se sont mis à penser que toutes les formes si nombreuses d’iniquité blasphématoire ont droit à figurer chez les hauts placés. Car après tout, ce que le chrétien appelle blasphème, c’est la religion ou l’école de pensée sincèrement acceptée par d’autres, qui ont autant le droit d’être entendus qu’eux-mêmes, et de gouverner s’ils représentent une majorité ! Car, comme le dit encore leur pieux oracle, quelle pouvoir humain peut se prononcer avec autorité sur la vérité d’une religion, quand toutes les nations ou parties de nations, veulent maintenir avec autant de zèle la vérité de la leur ? Ainsi, Dieu est exclu là où on en aurait le plus besoin, et la créature, dans toutes les aberrations de sa volonté coupable, est adorée plutôt que le Créateur qui est béni éternellement (Rom. 1:25). Amen.
De même que l’indifférence envers les blasphémateurs est désormais à l’ordre du jour, et même le droit de plaider la cause de leur parti, de même les hommes religieux, nationalistes et dissidents, cherchent leur soutien, faisant cause commune avec ces ennemis déclarés de Dieu et de Son Fils, afin de promouvoir les mesures et les objectifs politiques de leur parti. Toute la vieille haine du blasphème, toute l’indignation autrefois brûlante contre l’impiété audacieuse, a presque disparu de la chrétienté, et est traitée par la fausse charité diabolique de notre époque comme aussi caduc, déshonorant et cruel que brûler les sorcières, que poursuivre en justice les nécromanciens et dénoncer les astrologues. Vous n’avez pas le droit de diffamer un homme ; son caractère est sacré et de la plus haute importance. Mais sur Dieu le Père, le Fils et l’Esprit, dîtes ce que vous voulez ; vous pouvez même dénoncer leurs voies et leur caractère, nier leur existence, calomnier la révélation divine. C’est votre droit en tant qu’homme de dire ce que vous pensez de Dieu et de Sa parole, de Christ et de Sa croix ! Jamais avant ce dix-neuvième siècle le monde n’avait vu une telle licence illimitée donnée au blasphème ; et il est répandue et éhonté nulle part autant que dans la chrétienté, catholique ou protestante. Qui peut donc douter que des « blasphémateurs » caractérisent les temps fâcheux des derniers jours ? et qu’ils le font déjà sous une forme très aggravée ?
Désobéissants à leurs parents
Il est certain que le manque de respect direct et croissant envers les parents, la propre volonté croissante des jeunes, ne peuvent avoir échappé à l’attention des observateurs chrétiens. Cela ressort de l’avertissement inspiré où les « désobéissants à leurs parents » suivent « les blasphémateurs », très justement dans cet ordre ; car les parents se trouvent dans une position tout à fait unique vis-à-vis de leurs enfants. Comme il est écrit dans l’épitre aux Hébreux (12:9-10), « nous avons eu les pères de notre chair pour nous discipliner, et nous les avons respectés ; ne serons-nous pas beaucoup plutôt soumis au Père des esprits, et nous vivrons ? Car ceux-là disciplinaient pendant peu de jours, selon qu’ils le trouvaient bon ; mais celui-ci nous discipline pour notre profit, afin que nous participions à sa sainteté ». Si dans les pensées des hommes, il n’y a pas Dieu, mais des formes, la vraie obéissance aux parents n’est nulle part ; la soumission n’est que là où elle est inévitable ; où donc est le cœur consciencieux et aimant pour rendre honneur et obéissance ?
Ce qui est le plus grave dans cette ruine générale d’une relation aussi basique, c’est que les parents sont autant à blâmer que les enfants, sinon plus, et les mères pas moins que les pères ; et cette négligence n’est pas limitée à une classe particulière, mais elle imprègne toutes les branches de la race. La multitude de sociétés et de dispositifs pour s’occuper des jeunes de nos jours est la preuve frappante du fléau qui s’est installé de façon permanente ; car la croissance effroyable du mal a fait appel aux efforts des hommes pieux pour l’endiguer, même superficiellement, par les écoles du dimanche, les foyers, les maisons de correction, et autres. Et maintenant, ils aimeraient oublier l’effrayante racine de ce mal dans leur classe comme dans toutes les autres, glorifiant leur bonne volonté par un remède si partiel. Le relâchement de la discipline, voire son abandon, de la part des parents ne peut qu’engendrer la désobéissance chez les enfants ; et face à un tel piège, tous les autres moyens de correction ne sont que des roseaux ultra-faibles pour détourner une tempête qui se prépare.
Ingrats, profanes (sans piété)
Il ne faut pas non plus négliger la paire suivante de caractères humiliants de ces derniers jours : « ingrats, profanes (JND : sans piété) ». Ils vont aussi bien ensemble que leurs deux prédécesseurs, et comme tous ceux décrits jusqu’ici : certes ceux qui lisent ces caractères sans liens les uns avec les autres glanent quand même quelque instruction auprès de chacun, individuellement et tous ensemble, mais les observer en en faisant des associations met de l’ordre et ajoute à la récolte.
Ingrats
Quelle anomalie pour quelqu’un qui professe être chrétien, que d’être ingrat ! Il professe avoir la vie en Christ et le pardon des péchés ; il est baptisé pour la mort de Christ, par laquelle il est mort au péché avec Lui ; il est sous la grâce et non pas sous la loi, afin que le péché ne domine pas sur lui ; il est en Christ et ainsi libéré de la condamnation, et il a reçu l’Esprit d’adoption par lequel il peut crier Abba, Père. Car si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, celui-là n’est pas de Lui. Tout cela (Rom. 6 et 8) appartient au croyant individuellement. Pensez ensuite aux précieux privilèges dont il jouit en tant que membre du corps de Christ, dans le culte, dans la doctrine apostolique, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières (Actes 2:42) — sans parler de cette discipline sainte et salutaire, si nécessaire, qui s’attache inséparablement à ceux qui célèbrent le sacrifice de Christ. Mais pourquoi faut-il étaler ces innombrables bénédictions que tous les saints partagent en Son Nom et par l’Esprit de notre Dieu et qui foisonnent dans l’Écriture ? Ne pas être reconnaissant quand on porte ce Nom qui assure tout au croyant, c’est l’extrême de l’ingratitude.
Profane (Sans piété)]
L’état « sans piété » (état d’impiété, ou de celui qui est impie, profane) vient naturellement tout de suite après, et on pourrait dire, nécessairement. Car on ne peut être reconnaissant que si le cœur s’arrête tant soit peu sur les très grandes et précieuses promesses (2 Pierre 1:4), maintenant assurées en notre Seigneur et dont on jouit dans la puissance du Saint Esprit, dans l’attente de la gloire éternelle et impérissable, dont Celui qui nous a scellés est les arrhes. Professer ce que nous ne croyons pas, c’est faire l’hypocrite ; et si l’on peut parler d’honnêteté naturelle subsistant sous un masque chrétien, l’indifférence à la réalité et la familiarité avec ce qui n’est que des formes, contribuent toutes les deux à provoquer le mépris du Saint dont on fait un objet de badinage, et le mépris de tout ce qui se rapporte à Son service, à Son culte et à Sa volonté : voilà ce qui constitue le caractère du « profane (sans piété) ».
Le fait également que le mot désignant ici la « piété » ne soit pas ἅγιος (séparé du mal pour Dieu), mais ὅσιος (saint au sens de gracieux et miséricordieux), montre encore plus combien il est juste de classer les « sans piété » avec les « ingrats ». Car une grâce non ressentie se termine rapidement en une grâce méprisée, dédaignée et piétinée : la conséquence de l’ingratitude est la profanité.
Christ est Celui qui concentre toute grâce, et est ainsi désigné par le terme « chasid » (Ps. 16:10 ; Ps. 89:19 ; etc.) qui décrit des hommes qu’on considère comme pieusement intègres. C’est l’inverse qui est visé ici, et peut-être même que ces quelques mots suffisent à montrer combien est vraie cette description par l’apôtre des chrétiens professants de nos jours. Il n’y a pas seulement le manque d’affections de grâce, alors que la profession chrétienne implique la miséricorde de Dieu en Christ, mais la présomption impie qui se dresse en opposition frontale. Il ne s’agit ni d’injustice ni d’impureté.
Chapitre 3 versets 3 à 5
Ch. 3:3
Sans affection naturelle
Il nous faut maintenant examiner une liste encore plus longue de qualités (ou plutôt de défauts) qui suivent : — « Sans affection naturelle, implacable, calomniateur, incontrôlé (JND : incontinent), cruel, n’aimant pas le bien (haineux), traître, têtu (ou : tête forte ; JND : téméraire), enflé d’orgueil, ami des voluptés plutôt que de Dieu, ayant une forme de piété, mais en ayant renié la puissance. Détourne-toi de telles gens » (3:3-5).
Il est singulier que la version Autorisée (KJV), seule parmi les anciennes traductions anglaises, donne le sens simple, complet et sans ambiguïté de « sans affection naturelle » pour ἄστοργοι, tandis que la version de Wiclif et celle de Reims (Rhemish) qui suivent la Vulgate comme d’habitude, rendent l’expression par celle plus faible « sans affection ». Tyndale, suivi de Cranmer, a « non gentil », et la version de Genève a « sans charité ». Au-delà de la controverse, ces versions manquent de précision dans leur interprétation.
Quant à la caractéristique elle-même, il est difficile d’en exagérer la gravité, même chez les simples hommes naturels : combien plus chez ceux qui portent le nom du Seigneur ! Car il n’y a pas de centre humain de sauvegarde plus grand que le foyer familial (la maison) avec ses multiples affections et les devoirs qu’il implique. La lumière et la grâce de Christ vraiment connues donnent de la force, et fournissent un objectif nouveau qui place chaque élément dans sa vraie relation par rapport à Dieu et par rapport à l’homme. Il peut y avoir des occasions péremptoires pour Sa gloire où tout doit céder, et ensuite les choses qui sont, deviennent comme si elles n’étaient pas (cf. Rom. 4:17), plutôt que de se tourner à Son déshonneur ; mais de tels cas sont rares, et Son nom ajoute habituellement au-delà de toute mesure à tout ce que Dieu a toujours reconnu comme Son ordre ici-bas. Mais nous apprenons ici un changement sombre et inquiétant lorsque la chrétienté en général non seulement fait preuve d’indifférence à l’égard de tous ces liens de la vie familiale, mais les piétine comme étant méprisables et s’en débarrasserait comme étant des nuisances indignes. Elle affecte qu’être cosmopolite est le vrai idéal, et comme celui-ci est totalement irréaliste et inopérant, le résultat est un égoïsme absolu, un désert stérile sans objet donné par Dieu pour le cœur, et où la propre volonté peut se déchaîner à sa guise.
Implacables
À côté de ce vide d’affection naturelle, la qualité « implacable » vient à point ; issue de la même racine d’égoïsme, elle s’écoule dans un cercle beaucoup plus large, et même sans limite. Quelques rares manuscrits de toutes sortes inversent leur ordre relatif ; mais cela ferait un désordre moral étrange, surtout par comparaison avec la juste place de chaque qualité telle que représentée par les meilleurs manuscrits — le Sinaïticus n’est pas le seul à omettre le premier de la paire (« sans affection naturelle »), et la Version syriaque Peschito laisse tomber les deux, mais toutes ces variations sont de pures erreurs. Car le manque d’affection naturelle est le résultat horrible d’une fausse profession chrétienne, ainsi que l’implacabilité qui en est la conséquence plus vaste ; celle-ci en est l’accompagnement, en opposition à l’amour universel qui est en théorie le plus fort alors qu’il est le moins exercé en pratique. Non, la réalité est vraiment pire ; car ἄσπονδοι va au-delà de celui qui rompt la trêve, selon la traduction de ce mot dans la version autorisée (KJV) et d’autres traductions ; ce mot exprime plutôt l’état de refus de toute loi et de toute obligation. C’est déjà grave de ne pas être en accord avec la foi ; c’est bien pire quand le cœur des hommes dit, comme ici : « Rompons leurs liens et jetons loin de nous leurs cordes » (Ps. 2:3).
En Rom. 1:31, nous lisons que Dieu a abandonné les païens pour être ἀσυνθέτους, ἀστόργους (ne tenant pas ce qu’ils ont promis, sans affection naturelle) et le Texte Reçu ajoute ἀσπόδους (implacables) à l’encontre d’une ample autorité de très haut niveau. Là, l’apôtre passe de ce qui est plus externe (ceux « qui ne tiennent pas ce qu’ils ont promis » traduit aussi par « briseurs d’alliance »), ou (plus généralement) les « infidèles », à ceux qui manquent d’affection familiale (ἀστόργους) et à ceux qui sont « sans miséricorde » ou « impitoyables », ce qui est plus personnel ; ici en 2 Tim. 3, l’apôtre prédisant en quelque sorte le déraillement de la chrétienté, va de l’intérieur vers l’extérieur ; seulement au lieu de « briseurs d’alliance » ou « ne tenant pas ce qu’ils ont promis », il donne « implacable » ou « ceux qui défient l’obligation ». Et quel œil spirituel peut manquer de voir combien cette impatience à supporter une obligation imprègne maintenant les hommes, eux qui autrefois étaient rigidement fidèles à observer non seulement les promesses, mais tous les liens qu’implique la vie actuelle ? Rien ne dissout davantage que la grâce méprisée, alors que même la loi est une faiblesse comparée à la grâce régnant par la justice pour la vie éternelle par Jésus Christ notre Seigneur (Rom. 5:21). La corruption du bien est la pire forme de mal.
Calomniateurs
Puis en suivant l’ordre, vient le caractère de « calomniateurs », ou « faux accusateurs » (comme dans la version autorisée KJV), cette dernière désignation étant la même que pour le diable, l’ennemi juré, et elle est appropriée. N’est-il pas solennel que l’Esprit Saint se serve du même terme pour décrire non pas de simples païens, mais des hommes portant le nom du Seigneur dans les derniers jours ? Il est facile de dissiper et d’amoindrir le caractère terrible de ces accusations en plaidant que ces caractéristiques mauvaises ont toujours existé (ce plaidoyer est, pour l’ignorance, si naturel à faire et à recevoir !). Dans un sens, c’est vrai. Mais la parole du Seigneur ne peut être anéantie ; et, bien que ces caractéristiques mauvaises se soient élevées en nombre suffisant pendant la vie de l’apôtre de manière à en faire une question pratique, il est certainement vrai que ces maux se sont développés et répandus rapidement tandis qu’on continuait à s’écarter de la parole et de l’Esprit de Dieu ; et il est aussi vrai que nos jours voient une énorme augmentation de cette récolte de honte et de peines que tous les changements opérés n’arrivent pas à faire disparaitre (Ecclésiaste 7:10).
À notre époque, la généralisation du dénigrement et des mauvais propos est notoire et virulente, et bien pire dans le monde religieux que dans le monde profane ; les divisions sans fin ou les sectes lui donnent une impulsion incalculable. La valeur morale, le caractère chrétien, l’intelligence spirituelle, le service connu, peut-être depuis toujours, sont impuissants à désarmer la critique malveillante, et même ils poussent à l’action les partisans de l’égalitarisme moral, envieux de tout ce qui leur est supérieur. C’est d’autant plus vil quand ceux qu’on attaque ne se servent d’aucune ressource naturelle pour contre-attaquer ou même pour se défendre, à la suite de Celui qui, lorsqu’on l’outrageait, ne rendait pas l’outrage, lorsqu’il souffrait, ne menaçait pas, mais s’en remettait à Celui qui juge avec justice (1 Pierre 2:13).
Incontrôlés (plutôt que incontinents) – Cruels
Nous avons ensuite « incontrôlé », plutôt que « incontinent [selon JND] ». Incontinent se limite au manque de retenue dans l’impureté, alors que le mot a une portée qui couvre une pleine tolérance de l’action téméraire, comme le mot précédent « calomniateurs » pour le domaine de l’esprit et de la parole ; il s’ensuit que le lien moral est évident.
C’est sans forcer qu’à son tour « incontrôlés » semble être le précurseur de « cruels » ou « féroces », sans douceur et méprisant celle-ci, la cruauté étant même le contraire de cette douceur. Cela brise le cœur de savoir qu’il en est ainsi, puisque l’Esprit Saint a déclaré que cela devrait arriver parmi ceux qui professent Son nom, le Nom de Celui qui a dit en toute vérité : « Prenez mon joug sur vous, et apprenez de Moi, car je suis doux (débonnaire) et humble de cœur » (Matt. 11:29), ou selon ce qu’Ésaïe a dit de Lui : « Il ne criera pas, il n’élèvera pas la voix, et il ne fera pas entendre sa voix dans la rue » (És. 42:2). Mais hélas ! ils marchent, comme si souffrir, et surtout souffrir injustement, était le plus grand mal à redouter ; comme si Christ dans son chemin d’épreuve et de rejet et de grâce qui supporte tout, était un phare à éviter plutôt qu’un modèle à suivre pas à pas. La civilisation se targue de son long progrès graduel depuis l’état sauvage, lequel n’était certainement pas celui de l’homme des premiers âges, ni de l’homme sous le gouvernement de Dieu à travers tous les âges. Il est donc très humiliant de constater la chute dans un esprit véritablement sauvage de l’homme après des siècles de civilisation, et même des siècles de profession chrétienne.
Ch. 3:4
N’aimant pas le bien
Personne ne peut s’étonner que cela soit suivi par « n’aimant pas (haïssant) le bien », ce qui semble traduire plus exactement et plus complètement ἀφιλάγαθοι que « méprisant ceux qui sont bons » selon la version autorisée KJV. Il s’agit en effet d’une avancée très décisive dans le mal ; car beaucoup, dont la volonté non brisée les emporte passionnément, ont sincèrement honte de leur intempérance et déplorent les excès de ces brefs accès de folie, car ils apprécient et admirent ceux qui, dans la poursuite patiente des bonnes œuvres, cherchent la gloire et l’honneur et l’incorruptibilité, avec la vie éternelle pour fin (Rom. 2:7). Un païen pouvait dire : Je vois et j’approuve ce qui est mieux, mais je fais et suis ce qui est pire ; et un apôtre situe le dernier degré du mal chez ceux qui, non seulement commettent des choses méritant la mort, mais qui prennent plaisir en (ou : consentent avec) ceux qui les commettent (Rom. 1:32). Ici, chez des chrétiens professants, il y a une énormité du même genre : une totale aversion du bien. C’est comme chez les Juifs où l’impiété détruit les repères moraux : « Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal ; qui mettent les ténèbres pour la lumière, et la lumière pour les ténèbres ; qui mettent l’amer pour le doux et le doux pour l’amer ! » (Ésaïe 5:20). Il est certain que le nom du Seigneur est blasphémé à cause de ceux qui donnent une fausse représentation de Son Nom.
Traîtres
Cela introduit une autre nuance de méchanceté, le « traître » ou les « traîtres », cette forme de malice qui trahit les autres pour les ruiner sans scrupule. Le Seigneur a goûté cette bassesse amère parmi les douze, comme personne ne l’a jamais fait ni ne pouvait le faire ; et ici nous sommes avertis que c’est une caractéristique qui prévaudra dans la chrétienté ; elle existait déjà ici et là lorsque l’apôtre écrivait, mais comme le reste, elle se répandra et s’accentuera à mesure que les derniers jours s’écouleront. Il en a été ainsi et il en sera ainsi parmi les Juifs avant la fin, et pareillement il en sera ainsi parmi ceux qui corrompent l’évangile.
Téméraires (ou : fortes têtes) – Enflés d’orgueil
« Téméraires » décrit encore ceux qui se lancent inconsidérément et avec détermination à la poursuite de leur propre volonté, quel qu’en soit le coût ; c’est ce caractère plutôt que l’habitude d’abandonner, serait-ce même à la destruction, ceux qui se confient en eux-mêmes. Il est facile de comprendre que l’évangile, d’une manière et dans une mesure sans pareilles, communique la connaissance aux plus illettrés ; et cela a un effet puissant et blessant sur ceux qui, ignorant d’eux-mêmes et de Dieu, n’ont aucun sens vivant de la grâce envers les autres, ni n’en ressentent le besoin pour eux-mêmes. C’est d’une pareille source que semblent issus les « téméraires », lesquels sont endurcis par leur âmes « enflées d’orgueil », et abrutis par l’autosatisfaction : ces maux sont autant cruels que méprisables chez ceux qui, se présentant comme héritiers du royaume, devraient savoir que les bienheureux sont les pauvres en esprit, ceux qui mènent deuil, les débonnaires, ceux qui ont faim et soif de la justice, les miséricordieux, ceux qui sont purs de cœur, ceux qui procurent la paix, et ceux qui tressaillent de joie quand ils sont persécutés pour la « justice », et surtout pour l’amour de Christ (Matt. 5:1-11). Hélas ! l’entêtement et l’orgueil ne laissent aucune place à ces précieuses qualités que notre Seigneur forme chez tous ceux qui sont Siens. Les deux (téméraires et enflés d’orgueil) ne prévalent-ils pas maintenant partout où vous regardez dans la chrétienté ?
Amis des voluptés plutôt qu’amis de Dieu
Et qui peut nier le développement manifeste et extraordinaire, — non pas maintenant pour la première fois, bien sûr, mais plus que jamais à notre époque, — de « l’amour du plaisir (ou : des voluptés) plutôt que de l’amour de Dieu », chez ceux qui seraient profondément offensés s’ils n’étaient pas reconnus comme chrétiens ? En effet quand, dans la triste histoire de ce monde, a-t-on jamais connu un tel tourbillon incessant et généralisé d’excitation, dans le changement et les voyages, dans les sons doux, les beaux tableaux et les histoires sensationnelles, pour ne rien dire de ce qui est inférieur dans la jouissance des sens ? Sans aucun doute, la vapeur et le télégraphe ont contribué à cette quête universelle et enthousiaste du plaisir, plutôt qu’à se soucier de Dieu et de Sa volonté ; mais dans cette ère finale d’indifférence, l’amour du plaisir dans la chrétienté confirme remarquablement Sa parole.
Il fut un temps où la superstition alliée au goût de l’aventure entreprenait des pèlerinages et organisait des croisades, ni les uns ni les autres n’exprimant le moins du monde la grâce et la vérité venues par Jésus Christ ; mais tous les deux étaient naturellement plus nobles que les voyages de plaisir, privés ou collectifs, vers les pays les plus renommés, les plus étranges et les plus lointains, voire même des tours du monde, pour des gens avides d’un stimulant nouveau et piquant pour des esprits blasés et apathiques. Faut-il ajouter à cela l’appât du gain et même parfois des jeux de hasard offerts dans les bazars et autres, à l’aide d’objets dits chrétiens, et avec tout ce qu’il faut pour attirer les tendances naturelles ou mondaines en vue de gonfler les fonds ? Que dirons-nous, si tant est qu’il y ait quelque chose à dire, des appels au « christianisme musclé », une expression qui, à des oreilles pieuses, peut sembler une simple rigolade mondaine, mais que d’autres prennent avec sérieux et simplicité comme une chose juste et louable, bien qu’elle ne soit défendable que par une pure perversion de la parole de Dieu ?
Ch. 3:5
Ayant une forme de piété, mais en ayant nié la puissance
Car en vérité, le Saint Esprit dit ici au sujet de tous ces caractères du mal : « ayant une forme de piété, mais en ayant renié la puissance ». Voilà en quoi réside le caractère haïssable de tout cela. Rien d’étonnant à ce que l’injuste commette encore l’injustice, et que celui qui est souillé se souille encore (Apoc. 22:11). L’horreur, c’est que ceux qui font valoir les plus hautes prétentions sous le nom du Seigneur, ne pratiquent pas la justice ni ne sont sanctifiés. Car il vaudrait mieux pour eux de ne pas avoir connu la voie de la justice, que de se détourner, après l’avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé selon le vrai proverbe : Le chien retourne à ce qu’il avait vomi, et la truie lavée retourne à se vautrer dans la boue (2 Pierre 2:20, 21). Si vous voulez trouver tous ces maux non chrétiens sous une forme simple et concentrée, sans rougir, vous les trouverez nulle part aussi facilement que dans ce qui s’arroge le nom de « chrétien ». Pourtant ceux de notre pays comme du monde entier, qui en ont la preuve habituelle sous les yeux, peuvent n’y voir rien qui souille, et ils prétendent ne pas être souillés, — parce que leurs pensées et leur conscience sont tous les deux souillés.
Détourne-toi de telles gens
Mais on ne se moque pas de Dieu, et l’apôtre exhorte à la fidélité. Il avait déjà appelé Timothée à savoir de ce que la masse des chrétiens refuse maintenant d’apprendre. Mais cela ne suffit pas : « Or détourne-toi de telles gens ». C’était désormais le devoir, lorsque de telles personnes apparaissaient, de ne rien avoir à faire avec elles ; maintenant que le mal est incomparablement plus développé, ce devoir est encore plus impérieux. Pourtant, je suis peiné de constater l’étrange erreur de quelqu’un qui a écrit sur le sujet avec une compétence hors du commun. Il voudrait faire croire que l’injonction apostolique, correctement traduite, signifie que Timothée devait « éloigner de telles gens ». Il est difficile d’expliquer ou de concevoir comment quelqu’un ayant une connaissance réelle, même modérée, de la langue grecque puisse se méprendre à ce point sur une phrase très simple ; mais tel est le fait. Aucune version que je connaisse ne soutient une telle opinion. Cette instruction « détourne-toi de telles gens » n’est pas un acte d’autorité, et encore moins une action ecclésiastique, mais il s’agit d’une direction apostolique pour la conscience de Timothée (ou, en principe, pour tout « homme de Dieu ») qui ne voudrait pas cautionner ce qui est haïssable pour le Seigneur et corrupteur pour les âmes
À suivre
Chapitre 3 versets 6 à 9
Ch. 3:6-9
Les maux au sujet desquels l’apôtre lançait ses avertissements étaient déjà à l’œuvre. Cela ressort encore plus dans la description qui suit.
« Car d’entre eux sont ceux qui s’introduisent dans les maisons et qui mènent captives des femmes stupides [JND : femmelettes] chargées de péchés, entraînées par des convoitises diverses, qui apprennent toujours et qui ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Or de la même manière dont Jannès et Jambrès résistèrent à Moïse, ainsi aussi ceux-ci résistent à la vérité, hommes corrompus dans leur entendement, réprouvés quant à la foi : mais ils n’iront pas plus avant, car leur folie sera manifeste pour tous, comme a été celle de ceux-là aussi » (3:6-9)
Il ne suffit pas, dans le ministère de Christ, d’avoir devant soi des objectifs bons et saints ; les moyens n’ont pas à être exceptionnels, mais le but doit être avoué : s’il n’en est pas ainsi, si les mesures prises pour atteindre le but sont indignes de Christ, il est à craindre que la fin réellement en vue ne soit pas meilleure. En tout cas, et toujours, l’homme de Dieu doit considérer avec habitude et rigueur, comme devant Dieu, les voies qu’il poursuit, de peur que l’ennemi ne le prenne dans le piège haïssable de faire le mal pour qu’arrive le bien, — ce qui ne peut tarder à tourner à l’aveuglement vis-à-vis d’un mal sans limite dans les voies et les buts, au profond déshonneur de Celui dont le nom est utilisé pour tout camoufler. Oh ! que n’a-t-on pas fait « pour Sa plus grande gloire » ! [devise des jésuites]. Le jour arrivera où seront manifestés les grands torts commis contre Dieu et contre l’homme, et ces torts sont aussi grands dans la chrétienté que dans le paganisme, mais avec une hypocrisie bien plus grande.
Ch. 3:6
« Car d’entre eux sont ceux qui s’introduisent dans les maisons et qui mènent captives des femmes stupides (JND : femmelettes) chargées de péchés, entraînées par des convoitises diverses » (3:6).
Les œuvres du chrétien ne doivent pas être uniquement ἀγαθὰ, mais καλά, c’est-à-dire des bonnes œuvres non seulement animées par la bonté et la bienveillance, mais caractérisées par la rectitude et la bienséance. Rien ne peut justifier les manœuvres par en-dessous : Christ ne demande pas un tel service de la part de quiconque ; Il le répudie. « Que votre lumière brille donc devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes (c’est-à-dire honorables) œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux » (Matt. 5:16). Elles devaient être comme une lampe sur un chandelier qui brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Le malfaiteur fuit et déteste naturellement la lumière, et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient réprouvées et montrées telles qu’elles sont. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient rendues manifestes qu’elles ont été faites en Dieu (Jean 3:20, 21). Quelle tristesse lorsque ceux qui professent Christ, la seule vraie Lumière, sont animés par l’esprit des ténèbres en s’introduisant dans les maisons (celles des saints, je présume) et en menant captives des femmes stupides !
Le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité, et ses voies sont agréables au Seigneur (Éph. 5:9, 10). Mais condescendre à la voie de l’intrigue afin de gagner les plus faibles du sexe faible, est en dessous de la grâce et de la vérité qui sont venues par Jésus Christ. Même si ceux qui cherchent à faire avancer ainsi la vérité étaient purs de cœur, entrer ainsi dans les maisons est indéfendable tant à cause de la mauvaise apparence que de la mauvaise renommée : et c’est pire encore si l’on veut faire des adeptes personnels de ceux qui sont si exposés au piège que l’apôtre les qualifie de « femmes stupides, chargées de péchés, entrainées par des convoitises diverses », même si ces convoitises n’ont pas nécessairement un caractère grossier. À toutes les époques, les autorités religieuses ont trouvé une oreille attentive chez les femmes, qui deviennent efficaces par leur influence dans les familles : c’est alors non pas la vérité, mais le levain de doctrine qui se répand à grande vitesse jusqu’à ce que tous soient contaminés.
Le matériau adapté à subir ce travail subtil, est celui où la nature joue un grand rôle, tout en prétendant lui être particulièrement supérieur ; et dans une foule, les plus malléables et persuasifs sont les « femmes stupides », qui cherchent ainsi avec zèle à camoufler les péchés dont elles sont chargées, tandis qu’elles se livrent à de nouvelles convoitises différentes de celles du passé. C’est de cette manière que des changements désastreux se sont accomplis dans les temps primitifs. L’ennemi a-t-il mis de côté ces moyens à notre époque ? Certains se souviennent d’un tableau ressemblant à l’original il y a de nombreuses années, lorsque presque toute vérité distinctive a été complètement détruite. Allons-nous nous flatter de ce que le même genre d’erreur, si opérant dans le passé en tous milieux, ne se reproduira pas à maintes reprises dans le présent pendant que le Seigneur tarde ?
Or leurs voies secrètes et charnelles ne sont jamais celles que l’Esprit de vérité produit ; elles conviennent aux propagateurs de la tradition et de la forme, dans lesquelles les sentiments ou l’intellect de l’homme peuvent trouver des objets tangibles par lesquels il peut se distinguer. Nous comprenons donc la sagesse divine qui a consisté à enterrer Moïse et à cacher le lieu de sa sépulture à ceux qui, de son vivant, étaient loin d’apprécier correctement ce serviteur béni de Dieu qui parlait et agissait pour son Maître. Et le Seigneur Lui-même nous a averti que c’est le même esprit d’incrédulité qui tuait les prophètes et les justes (car ceux-ci n’épargnaient pas leurs péchés), et qui pourtant construisait et ornait leur tombeau après leur mort (Matt. 23:29-31). Les scribes juifs et les pharisiens du temps du Seigneur s’enorgueillissaient de cela ; mais la preuve de Sa vérité dans leur hypocrisie apparut bientôt lorsqu’Il leur envoya des apôtres et des prophètes, des enseignants et des prédicateurs, et qu’ils tuèrent les uns et persécutèrent les autres de ville en ville, de sorte que tout le sang juste, depuis Abel jusqu’à eux retombât sur cette génération qui rejetait Christ (Matt. 23:34-35), comme ce sera bientôt le cas sur la Babylone encore plus coupable, avant que Jérusalem ne redevienne la sainte cité, pleinement et véritablement ; la maison ne sera plus déserte, ni les leurs non plus, mais elle sera la maison de l’Éternel Dieu ; et Israël verra son Messie, longtemps méprisé, mais très miséricordieux et glorieux, et Le bénira comme Celui qui vient au nom de l’Éternel.
Ch. 3:7
Mais, pour revenir à notre douloureux sujet, il y a une autre particularité de ces victimes et des instruments du mal qui mérite d’être pesée : « qui apprennent toujours et qui ne peuvent jamais parvenir à la connaissance (ἐπίγνωσιν, pleine connaissance, ou reconnaissance) de la vérité » (3:7).
En mettant toute leur rapidité de compréhension, ces femmes manquaient de pensées spirituelles, confondant des choses qui diffèrent au lieu de les distinguer, faute de quoi il est impossible de faire de vrais progrès et d’avoir une vraie connaissance. Il s’agit d’avoir Christ devant l’âme, la Parole écrite Lui correspond par la puissance du Saint Esprit ; c’est cela seul qui fait découvrir la vérité et donne du courage quand on la reconnaît à la gloire de Dieu. Sans cela, il peut y avoir une occupation constante des pensées, de la fierté de ses acquisitions, mais il n’y a pas de croissance ni de puissance en séparation par la Parole, ni de joie en Dieu par notre Seigneur Jésus, ni jamais la capacité de parvenir à la pleine connaissance de la vérité, selon la formule utilisée ici.
Ch. 3:8
Les magiciens d’Égypte sont évoqués comme le modèle des conducteurs qui égarent, et ceci est remarquable du fait de leurs noms inconnus par ailleurs dans l’Écriture : « Et de la même manière dont Jannès et Jambrès résistèrent à Moïse, ainsi ceux-ci résistent aussi à la vérité, hommes corrompus dans leur entendement, réprouvés quant à la foi » (3:8).
Or, la manière dont ces adversaires agissaient consistait à imiter Moïse autant que possible. Ils ne pouvaient le faire que dans certaines limites, jusqu’à ce que leurs efforts pour le suivre soient rendus impuissants du fait de la manifestation croissante de la puissance de Dieu. Dans la chrétienté, l’imitation est plus facile, car il ne s’agit pas de miracle, mais d’apparence de vérité ; et ce qui est frappant, c’est que les séductions nouvelles et desséchantes de l’ennemi sont typiquement des imitations de la vérité, proches au point de pouvoir séduire, si cela était possible, même les élus (comme ce sera bientôt le cas des Juifs, Marc13:22). Les anciens corps de la chrétienté contiennent dans une large mesure les fondements de la foi ; les tromperies les plus flagrantes offrent des promesses plus élevées quant à l’espérance des saints, quant à l’église et quant aux privilèges chrétiens, mais elles s’enfoncent bien en dessous de l’orthodoxie ordinaire ou manquent quant à la justice ordinaire. Il n’est pas étonnant que leurs meneurs soient « des hommes corrompus dans leur entendement, réprouvés quant à la foi ». S’élevant bien plus haut et séduisant les naïfs et les instables surtout dans ce qui est moins connu, ils trahissent et ruinent les vérités bénies et vitales auxquelles s’accrochent tous les saints, aussi ignorants et remplis de préjugés qu’ils puissent être par ailleurs.
Ch. 3:9
C’est pourquoi Dieu ne manque pas d’élever une bannière contre l’ennemi, et Ses saints en danger profitent de l’avertissement. C’est ce que l’apôtre déclare ici : « Mais ils n’iront pas plus avant ; car leur folie sera très manifeste pour tous, comme a été celle de ceux-là aussi » (3:9).
La comparaison parle autant par le camouflage de la contrefaçon (laquelle était calculée pour rendre perplexe et égarer), qu’en dévoilant le piège lui-même. Ceci étant, son efficacité pour mal faire arrive à sa fin et la folie de ses auteurs et de ses défenseurs est trop évidente pour nuire davantage. N’avons-nous pas connu l’ennemi courant ainsi à sa propre défaite sous la puissante main de Dieu ? N’oublions pas tout ce que nous devons à la vigilante grâce de notre Seigneur, qui justifie ainsi Sa parole et Son Esprit après que l’homme ait fait mauvais usage tant de l’un que de l’autre. Si Satan cite les Écritures pour le mal ou faussement, le Seigneur ne délaisse pas les Écritures pour se mettre à argumenter, mais Il répond de manière absolue et convaincante immédiatement : « Il est encore écrit » (Matt. 4:7).
Chapitre 3 versets 10 à 13
Ch. 3:10-13
Après avoir démasqué ces diverses formes de mal qui germaient alors dans la sphère de la profession chrétienne, l’apôtre se tourne vers le chemin et la marche si différents de son compagnon de travail.
« Mais tu as suivi de près mon enseignement [JND : ma doctrine], ma conduite, mon but, ma foi, mon endurance [JND : mon support], mon amour, ma patience, mes persécutions, mes souffrances ; ce qui m’est arrivé à Antioche, à Iconium, à Lystre ; les persécutions que j’ai endurées, et le Seigneur m’a délivré de toutes. Oui, et tous ceux qui désirent vivre pieusement dans le Christ Jésus seront persécutés. Mais les méchants et les imposteurs avanceront pour le pire, trompant et étant trompés » (3:10-13).
C’était une énergie de foi et d’amour sincères, agissant par l’Esprit dans la vie qui est dans le Christ Jésus, qui avait ainsi attiré Timothée. L’incrédulité trébuchait et suscitait non seulement des difficultés, mais elle s’opposait à ce qui attirait et soutenait le jeune compagnon de travail, car cela était pour son âme le témoignage vivant d’un Christ rejeté mais glorifié. Contrairement à beaucoup d’autres, il n’avait pas honte du témoignage de notre Seigneur ni de Paul Son prisonnier. Quelle que soit la timidité de son caractère naturel, il trouvait dans la foi la force de rendre gloire à Dieu. La promesse de vie était une réalité assurée, et lui aussi a souffert du mal qui accompagnait l’évangile selon la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a appelés par un saint appel, non pas selon nos œuvres, mais selon son dessein et sa grâce, qui nous ont été donnés dans le Christ Jésus avant les temps des siècles, mais qui étaient maintenant manifestés par l’apparition de notre Sauveur (2 Tim. 1:8, 9). En bref, Christ l’avait décidé et l’avait tiré en avant sur un chemin autrement impossible.
3:10 — La doctrine ou « enseignement » de Paul
Or, la doctrine ou « enseignement » de Paul occupe à juste titre la première place dans ce qui avait agi sur Timothée : non pas la vérité seulement, mais l’enseignement coulé dans le moule des pensées de l’apôtre, de son cœur et de sa force morale, dans lesquels la personne et la gloire céleste de Christ gouvernaient avec une puissance sans égale. Et cela, nous l’avons aussi pour l’essentiel, car il a plu à Dieu de le donner en permanence dans les épîtres de Paul pour notre instruction, et pour l’encouragement et l’avertissement et la bénédiction générale, sans dire davantage ; certes nous ne pouvons pas avoir ce dont Timothée avait si abondamment joui, à savoir de parler « bouche à bouche », comme l’exprime un autre apôtre qui accordait une grande importance à de telles communications, par rapport au papier, à l’encre et à la plume (2 Jean 12 ; 3 Jean 13, 14). Cependant, chacun de ces moyens a ce qui est excellent en soi, et tout est sûrement ordonné en son temps ; de sorte que, tout en reconnaissant ce que Timothée avait pour lui-même quant au soutien et l’édification de son âme, nous pouvons reconnaître la sagesse du Seigneur dans ce qui est notre part.
3:10 — La « conduite »
Ensuite la « conduite » de l’apôtre avait une grande valeur en tant qu’expression pratique de la vérité qui influençait habituellement ses jugements et ses sentiments. Il n’y a pas de meilleur commentaire sur la parole inspirée que celui que l’on trouve dans la marche de ceux qui y sont soumis, que ce soit individuellement ou en assemblée. Si cela est vrai en général de tous ceux qui sont spirituels et intelligents, pour autant qu’ils soient conduits dans l’obéissance, quelle brillante illumination de la Sainte Écriture n’y avait-il pas chez un privilégié comme Timothée, peut-être plus que chez tout autre, du fait de son intimité avec le grand apôtre qui avait duré si longtemps et de manière si variée !
3:10 — Le « but »
Le « but » brillait dans cette vie de service incessant du Seigneur Christ avec une splendeur que seuls les malintentionnés pouvaient mal interpréter, et que seuls les enténébrés et les aveugles pouvaient ignorer. Dès qu’il tomba de ses yeux comme des écailles, et qu’il fut rempli du Saint Esprit, Paul ne désobéit pas à la vision céleste, mais il déclara à ceux de Damas d’abord, puis à Jérusalem, et dans tout le pays de Judée, et aussi aux Gentils, qu’ils devaient se repentir et croire à l’Évangile (Actes 26:19, 20). Il prêchait le royaume avec hardiesse ; il ne mettait aucune réserve à annoncer tout le conseil de Dieu (Actes 20:25-27). Et au milieu de tous ces travaux, nuit et jour, il pouvait dire, comme peut-être personne d’autre avec autant de vérité : « Je fais Une chose, oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort vers celles qui sont devant, je cours droit au but pour le prix de l’appel céleste dans le Christ Jésus » (Phil. 3:13, l 4).
3:10 — La « foi » pratique
La « foi » pratique, présente, vivante, voilà ce qui maintenait vivant le feu sacré dans le cœur de l’apôtre ; et c’est pourquoi elle est ici signalée pour rester gravée dans la mémoire de Timothée, et le stimuler à persévérer dans la même voie. En effet, de même qu’il n’y a qu’un seul chemin, Christ lui-même (Jean 14:6), pour tous ceux qui sont à Lui, de même c’est la foi seule qui trouve ce chemin et le poursuit avec patience : c’est par la foi que nous marchons, et non par la vue, comme c’est par la foi que nous sommes debout (2 Cor. 5:7 ; 1:24). Aucun autre moyen ne convient aux enfants de Dieu, et aucun autre ne glorifie Dieu Lui-même, qui voudrait être reconnu immédiatement par eux, du fait qu’ils en tirent une bénédiction nouvelle dans la jouissance de Sa lumière et de Son amour. Si la « foi » est alors le moyen toujours prêt et toujours nécessaire, de direction et de puissance pour tous, combien plus pour ceux qui ont le service de la parole, service supplémentaire et très éprouvant du Seigneur ! Combien cela rappelle à Son véritable enfant dans la foi (1 Tim. 1:2) de compter calmement sur Dieu malgré toutes les apparences contraires ! Combien il y a eu de réponses de grâce surpassant même toute attente ! Car Dieu ne sera pas dépassé, même par le cœur le plus sincère, et la grâce coulera toujours au-delà de la foi qu’elle crée et exerce.
3:10 — Le « support » ou « endurance »
Timothée avait aussi vu le « support » ou « endurance » chez Paul comme nulle part ailleurs. Car en vérité, ce n’est pas un fruit qui vient d’une source terrestre, mais ce qui vient de Celui qui en était et en est la plénitude, maintenant sur le trône de Dieu. C’était d’autant moins naturel pour Saul de Tarse, car il parle de lui comme ayant été autrefois un blasphémateur, un persécuteur et un outrageux, c’est-à-dire un homme ayant le caractère d’un dominateur insolent. Mais une miséricorde sans limite a été manifestée, et le fruit chez Paul en a été un merveilleux support.
3:10 — L’« amour »
L’« amour » opérait chez Paul, un amour vu et connu et prouvé en Jésus notre Seigneur, un amour reproduit par l’Esprit comme l’énergie de cette nature qui est lumière dans son principe. Car si tous ceux qui sont pieux deviennent par grâce participants de la nature divine, l’amour avait vraiment puissamment agi dans celui à qui il a été donné d’écrire 1 Cor. 13. Et si la connaissance parlait avec arrogance et était une pierre d’achoppement pour les faibles, y a-t-il jamais eu un homme qui s’en soit occupé de manière aussi tranchante que Paul, lui qui, plus que tous ceux de son âge (Gal. 1:14), connaissait tous les mystères et avait toute connaissance (1 Cor. 13:2) ? Timothée avait vraiment un riche échantillon d’« amour » sous les yeux.
3:10 — La « patience »
La « patience » ne manquait pas, bien qu’elle fût mise à l’épreuve sous des formes et à des degrés très divers. En lisant 2 Cor. 11, nous pensons un peu à ce que Timothée avait vu ou connu en tant de détails. Les « signes d’un apôtre » avaient été opérés au milieu des saints avec toute patience, par des signes et des prodiges, et par des œuvres de puissance (ou miracles — 2 Cor. 12:12).
3:11 — Les « persécutions », les « souffrances »
Suivent les « persécutions », et les « souffrances » comme des épreuves dans lesquelles la « patience » ou l’endurance se manifestaient. Le même chapitre de 2 Cor. 11 en fournit, de la manière la plus discrète, un registre qu’aucun héros du monde ne pourrait égaler. Mais l’apôtre était peiné à l’idée de dire un mot au sujet de ces épreuves : « Je suis devenu insensé », disait-il, « vous m’y avez contraint » (2 Cor. 12:11). Pour lui, c’était une véritable douleur que de raconter ce qu’ils auraient dû apprendre ou se rappeler autrement ; cependant il pouvait ajouter : « Je prends plaisir dans les infirmités, dans les outrages, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les détresses pour l’amour de Christ » (2 Cor. 12:10).
Timothée connaissait parfaitement ce qui était arrivé à l’apôtre à Antioche (de Pisidie), à Iconium et à Lystre. C’est dans cet ordre que la persécution s’était abattue sur Paul ; à l’inverse, lui et Barnabas firent leur voyage de retour, en établissant les âmes des disciples convertis depuis peu (Actes 14). Dans toutes ces souffrances et oppositions, les Juifs ont joué le rôle coupable d’inciter les Gentils à s’opposer à la parole de vie et à ceux qui la prêchaient. C’est pourquoi, lorsqu’ils venaient dans les parages, leur méthode était de se mettre à lapider. Quelle occupation pour l’ancien peuple de Dieu ! Quelle angoisse pour celui qui les aimait tant, même quand aucun coup ne l’atteignait ! L’apôtre ravivait ces souvenirs vivants chez Timothée, car il était de Lycaonie, et avait été amené à la connaissance de Christ par l’intermédiaire de l’apôtre justement dans ce temps-là ; Paul pouvait dire : « … quelles persécutions j’ai endurées, et le Seigneur m’a délivré de toutes ».
Ch. 3:12-13
Une double déclaration conclut cette partie de l’épître, que feraient bien de méditer ceux qui s’attendent à un progrès de la chrétienté dans son ensemble. Car l’apôtre parle de manière générale tout en établissant la vérité positivement. Il ne laisse rien qui permette d’imaginer une interruption temporaire qui serait suivie d’une bénédiction et d’un triomphe de l’Évangile. Que la terre soit remplie de la connaissance de l’Éternel, comme les eaux couvrent la mer, c’est certain (És. 11:9) ; que la nation cherche le Messie, et que Son repos soit glorieux, ne saurait être mis en doute par le croyant ; mais rien de tout cela n’arrivera avant qu’Il ne frappe la terre avec la verge de Sa bouche (És. 11:4), et qu’il ne consume le méchant avec le souffle de ses lèvres (2 Thes. 2:8). Jusque-là, l’évangile sauvera des individus ici et là, ou même affectera des communautés, surtout quand il est mêlé à la loi et qu’il est rendu terrestre — jusqu’à ce que le Seigneur soit révélé dans le jugement des vivants, ceux qui ont le cœur pieux devront souffrir, et les hommes mauvais avanceront vers une plus grande impiété. Les apparences partielles trompent ; la parole de Dieu demeure pour toujours.
Ch. 3:12 — Persécutions de tous ceux qui vivent pieusement
Ainsi, d’une part, l’apôtre déclare : « Tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus seront persécutés » (3:12).
Il est sage, et c’est même le devoir des saints, de se décider ainsi à souffrir pour la justice, et pour Christ. Ils ne trouveront donc pas étrange l’épreuve ardente qui s’abat sur eux pour les éprouver, comme si une chose extraordinaire leur arrivait (1 Pierre 4:12).
Ch. 3:13 — Aggravation de la méchanceté
D’autre part, ils ne seront pas effrayés de voir le monde, et même la masse de ceux qui professent croire, aller nettement de mal en pis, dans son ensemble, en face de tous les témoignages de la grâce et de la vérité de Dieu. Au contraire, les saints s’attacheront d’autant plus à la parole que la prévalence du mal ne fait que la confirmer, tandis que l’évolution du mal se poursuit activement. « Mais les hommes méchants et les imposteurs iront de mal en pis, séduisant et étant séduits » (3:13). Pour celui qui s’incline devant l’Écriture, peut-on faire ressortir de façon plus expressive et précise le caractère réel du progrès ? Si nous refusons d’être soumis à l’Écriture, une puissance aveuglante est déjà sur nous, et nous nous égarons nous-mêmes en égarant les autres selon la mesure de l’erreur et de notre influence.
À suivre
Chapitre 3 versets 14 à 17
Ch. 3:14-17
Il ne devait pas être donné à Timothée de changer. La vérité reste immuable, même si les plus spirituels doivent se l’approprier de plus en plus : ce n’est pas l’église, ni un apôtre, mais Christ qui est la Vérité objectivement, et le Saint Esprit comme puissance intérieure. Il faut s’attendre à ce que les méchants et les manipulateurs de l’imposture changent, car tous n’ont pas la foi, laquelle vit et grandit et prospère dans la soumission à la vérité. D’où la responsabilité suivante confiée à Timothée :
« Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été persuadé, sachant de qui tu les as apprises, et que dès l’enfance tu connais les écrits sacrés qui peuvent te rendre sage pour le salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. Toute Écriture est inspirée de Dieu et profitable pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli, entièrement équipé pour toute bonne œuvre » (3:14-17).
Ch. 3:14 — demeure… sachant de qui tu les as apprises
Il n’y a pas d’indication plus sûre de l’énergie du Saint Esprit que lorsqu’un esprit actif (la vérité révélée donne à la fois une sainte liberté et l’exercice sans limite de l’activité) demeure dans les choses que nous sont enseignées de Dieu. Certains sont incontestablement plus que d’autres enclins à douter en raison de difficultés, imaginées ou pratiques. Heureux le cœur qui fait face à n’importe quelle parole ou événement, sans penser à abandonner ce dont il a été précédemment persuadé sur la base de l’autorité divine, ou, comme le dit l’apôtre ici, « sachant de qui tu les as apprises » !
[Sachant de QUI…] : Si l’on préfère la forme plurielle (τίνων), qui repose certainement sur de très bons et anciens manuscrits, ce n’est pas Paul seul, mais Paul avec les autres que le Seigneur a choisis pour témoigner de la grâce et de la vérité venues par Jésus Christ. Les hommes inspirés du Nouveau Testament ont présenté une révélation entièrement nouvelle, profonde et céleste, correspondant à la personne et à l’œuvre de Christ manifestées, et aux relations dépendantes de Christ pour lesquelles le Saint Esprit descendu du ciel donne de l’énergie. Ainsi, la puissance est pour obéir. Timothée, comme tout autre, était sanctifié par l’Esprit pour obéir (1 Pierre 1:2). Il avait une position très honorable, mais il n’avait pas la permission d’agir sans la parole du Seigneur, lequel a envoyé l’Esprit pour guider dans toute la vérité (Jean 16:13), – aussi bien au sujet des choses qui allaient arriver que de celles qui concernaient plus directement Christ et l’église dans un témoignage effectif. L’Esprit a glorifié donc Christ, annonçant tout aux saints, comme Lui seul pouvait le faire, et ce par des témoins choisis, de sorte que notre joie première, pour ne pas dire notre devoir, est de croire et d’obéir. Sans doute Dieu a-t-Il placé dans l’église, comme il Lui a plu : d’abord ceux-ci, ensuite ceux-là, et ainsi de suite, dans une grande variété de lieux selon Sa volonté souveraine et Sa sagesse infaillible ; mais l’obéissance de la foi court à travers la vie de chacun, s’ils marchent et servent selon Dieu. Et c’est ce que l’apôtre place ici devant Timothée avec le plus grand soin. Pouvons-nous penser que l’exhortation n’était pas profondément nécessaire ? d’autant plus qu’elle est donnée dans une épître destinée à faire ressouvenir, non seulement ceux qui pourraient avoir en partage le service de Timothée, mais tous ceux qui cherchent à plaire au Maître.
Ch. 3:15a — dès l’enfance tu connais les saintes lettres
Or il n’y avait pas eu que le fait que Timothée avait écouté avec révérence les paroles de Dieu. Pour des milliers de saints et beaucoup de ministres de la parole d’entre les Gentils, ces paroles étaient une chose nouvelle ; et l’évangile reçu dans le cœur ouvrait la voie à la mise en valeur et à profit des anciens oracles de Dieu. Avec Timothée, l’ordre était différent, bien que le résultat puisse être au fond semblable. En fait, l’apôtre lui rappelle « que dès l’enfance tu connais les écrits sacrés qui peuvent te rendre sage pour le salut par la foi qui est dans le Christ Jésus » (3:15).
Ch. 3:15b — les saintes lettres qui peuvent rendre sage à salut : déjà pour les enfants
Il est douloureux d’observer le mépris des écritures dans la chrétienté, même lorsque le sentiment protestant prévaut. L’importance de la Bible pour les pauvres, beaucoup veulent l’accepter alors qu’ils sont loin d’en profiter pour eux-mêmes. Non seulement le papisme en a proscrit la lecture simple et habituelle (comme si le livre de Dieu était un poison pour l’homme du fait qu’il est surement efficace pour saper et renverser le dogme et la pratique romanistes), mais un bon nombre de personnes qui se considèrent comme très éloignées de l’église latine, découragent sa prise en compte dès les premières années, alors qu’ici, la plus haute autorité [Paul], en fait l’éloge dans le cas de Timothée. Il est vain de dénigrer ces encouragements comme ne faisant partie que d’une « lettre », ou de décourager les jeunes vis-à-vis d’écrits qu’on qualifie de non renouvelés. Celui qui a été inspiré pour mettre en place des garde-fous contre les difficultés des derniers jours, n’hésite pas à exprimer sans réserve sa satisfaction dans ce que la sagesse de ces gens ose dénigrer. Il devrait suffire à la foi de savoir qu’un Coleridge se joint à l’orgueil sacerdotal d’un côté, et à l’indifférence rationaliste d’un autre coté, en attaquant ce qu’ils n’aiment pas comme étant de la « bibliolâtrie ».
Ch. 3:15b — droit d’accès de l’homme à l’Écriture ou droit de Dieu à s’adresser à l’homme ?
Ceux qui sont vrais et humbles de cœur n’ont qu’à aller de l’avant et rester impassibles au milieu de ces modes changeantes d’opinions hostiles, s’attachant à Dieu et à la parole de Sa grâce (Actes 20:32), renonçant à tout argument de défense plausible de l’homme. Car la vraie raison n’est pas le droit de l’homme aux écritures, ni la compétence de l’homme à les interpréter, mais le droit de Dieu de s’occuper, dans la Bible, de tous les cœurs et toutes les consciences que seul le Saint Esprit peut guider dans toute vérité. Ceux qui interdisent la libre lecture des Écritures s’efforcent aveuglément d’empêcher Dieu de s’adresser Lui-même à l’homme. Qu’ils jugent de la gravité d’un tel péché contre Dieu et contre l’homme. Ils peuvent raisonner maintenant, mais que diront-ils un autre jour pour leur rébellion contre Ses droits ? Bien sûr l’apôtre était aussi loin qu’il est possible du rationalisme. Il ne croyait pas que l’homme avait le pouvoir de s’approprier la vérité divine. Même la capacité des écrits sacrés à rendre sage pour le salut, n’est que par la foi dans le Christ Jésus. Et cela, quelles que soient les circonstances. Sans la foi en Christ, le salut et la sagesse d’en haut sont pareillement impossibles.
Ch. 3:16-17 — Importance extrême de l’Écriture
Les versets 16 et 17 nous emmènent beaucoup plus loin : « Toute écriture est inspirée de Dieu et profitable [Darby : utile] pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit complet [Darby : accompli] et entièrement équipé [Darby : parfaitement accompli] pour toute bonne œuvre ».
Aucune phrase, dans aucune partie de la parole de Dieu, ici ou ailleurs, n’apparaît plus adaptée, plus précieuse et plus lourde de sens. Il y a des sentiments similaires d’importance extrême, qui sont toujours très appropriés là où on les trouve dans leur cadre ; mais ce qui nous est présenté ici est clair, complet et impressionnant au plus haut degré. Cela donne un caractère divin à toutes les parties de la Bible, à l’exclusion bien sûr des mots ou des phrases qui peuvent être considérés comme des interpolations sur la base de preuves suffisantes.
Chaque écriture – absence de l’article
Tout d’abord, il est important d’observer que le sujet de la première phrase est sans article [Toute écriture]. Le sens n’est donc pas exactement « toute », mais « chaque » écriture. Si l’article avait été inséré, les mots qui suivent auraient affirmé que, ce qui est dit, était dit de l’ensemble des écritures saintes dont l’existence était connue. L’absence de l’article a pour effet de caractériser ainsi chaque partie de la parole inspirée à venir, autant que celles qui existaient déjà. Est-ce l’Écriture ? Alors c’est inspiré de Dieu et profitable [Darby : utile], etc. Cela est affirmé de chaque atome.
inspirée de Dieu, et utile…
Ensuite, il est connu que les versions et les critiques réputés diffèrent quelque peu quand il faut insérer une copule [conjonction de coordination] non exprimée, mais parce qu’elle est implicite et nécessaire. On ne le voit pas toujours du fait qu’il s’agit d’une différence relativement minime. Le sens de fond subsiste. La version révisée, avec d’autres, préfère rendre ainsi [« Chaque » en anglais est traduit ici en français par « toute »] : « Toute écriture inspirée de Dieu est aussi profitable… ». La Version Autorisée KJV, avec d’autres, a ceci : « Toute écriture est donnée par inspiration de Dieu, et est profitable… ». Je ne doute pas que ce soit plus correctement traduit par : « Toute écriture est inspirée de Dieu et profitable… » Ce qui est commun ici à la Version Autorisée et à la mienne est que l’apôtre affirme l’inspiration de Dieu et le caractère profitable au sujet de l’Écriture ; alors que, selon les Réviseurs, l’inspiration divine est admise, et son caractère profitable semble assez maladroitement affirmé, « est aussi… ». Après tout, la différence est pratiquement minime. Dans la version révisée, l’inspiration divine est supposée, alors que dans l’autre, elle est directement affirmée en premier lieu, avec un profit délimité et varié qui s’ensuit.
écriture inspirée
L’Écriture, c’est-à-dire tout ce qui relève de la désignation d’écriture, est donc inspiré de Dieu ; non seulement de saints hommes de Dieu ont parlé, portés par — sous la puissance de — l’Esprit Saint ; or tout ce qui est écrit par l’Esprit en vue de guider en permanence les fidèles est inspiré de Dieu. Ceci étant simplement cru, toute erreur doit nécessairement être exclue de l’écriture sainte ; car qui voudrait dire que Dieu inspire des erreurs, petites ou grandes ? Ceux qui le pensent ne peuvent pas vraiment croire que toute écriture est inspirée de Dieu. Il fut un temps où la parole de Dieu était bien sûr inspirée, mais pas encore écrite ; maintenant, par une miséricorde infinie, elle est écrite par la puissance en grâce de Celui qui connaissait la fin depuis le commencement, et qui voulait fournir une norme adéquate, parfaite et permanente pour chaque besoin spirituel sur terre. C’est pourquoi elle est écrite et, pour faire divinement autorité, elle est inspirée de Dieu : non seulement les lettres sacrées de l’Ancien Testament, mais les écrits des apôtres et prophètes du Nouveau Testament, le fondement sur lequel l’église est bâtie (Éph. 2:20).
Nouveau Testament comme écriture inspirée
En effet, c’est le caractère prophétique du don qui est spécialement en exercice pour écrire l’Écriture. Les apôtres, en tant que tels, ont gouverné et débuté l’église. Certains étaient prophètes sans être apôtres ; et l’église ou assemblée a été bâtie sur le fondement des deux (Éph. 2:20). Cela explique la véritable source de l’autorité dans les saints écrits de Marc et de Luc. Les attribuer à Pierre pour l’un, et à Paul pour l’autre, trahit le caractère insignifiant de la tradition primitive, telle qu’elle apparaît dans les spéculations d’Eusèbe de Césarée. Car quelle que soit la valeur de l’histoire qu’il a donné de son temps, ou de celui précédant de peu, son récit de l’âge apostolique a plus de valeur par contraste avec le récit inspiré fort bref, qu’en tant que réflexion véritable. Il regorge même d’ignorance et d’erreurs, et ne s’élève jamais à la portée spirituelle de ce qu’il présente. Le récit inspiré de ce qu’on appelle « Les Actes des Apôtres » est empreint de dignité, de profondeur, de puissance et du dessein de l’écriture, aussi franchement que tout autre livre de la Bible. Une remarque similaire s’applique à l’évangile de Luc et à celui de Marc. Il s’agit d’une écriture inspirée de Dieu, dont le contenu révèle un but tout à fait différent de celui de Matthieu et de Jean, mais qui n’en est pas moins divin ; chacun y apporte ses propres éléments profitables, lesquels lui sont spécifiques et que l’on ne retrouve chez aucun autre, bien que d’autres fournissent ce qui ne s’y trouve pas. C’est ce qui caractérise l’inspiration, et qu’on ne trouve nulle part ailleurs que dans l’Écriture.
citation tirée de Luc
Il est intéressant d’observer qu’en 1 Tim. 5:18, l’apôtre cite Luc comme étant l’Écriture. Certains pourraient affirmer à la hâte que la dernière phrase du verset a été tirée de l’apôtre Matthieu (10:10). Mais un examen plus approfondi prouve que Paul cite Luc 10:7, bien que celui qui ne croit pas à l’inspiration verbale puisse se dérober et échapper à sa force. Cependant celui qui est assuré de l’autorité de Dieu qui a inspiré les hommes qui ont parlé, reconnait volontiers que l’apôtre des Gentils [Paul] cite littéralement l’évangile de son compagnon de travail [Luc] ; les hommes inspirés parlaient non pas en paroles enseignées de sagesse humaine, mais enseignées de l’Esprit (1 Cor. 2:13). En citant comme étant « l’Écriture » à la fois l’évangile de Luc et Deut. 35:4, c’est comme si Dieu voulait confirmer le principe de l’inspiration verbale énoncé par Paul en 1 Cor. 2:13. Il connaissait et réfutait à l’avance les théories sceptiques qui cherchent aveuglément à nier l’autorité des deux.
Paul auteur de l’épître aux Hébreux, selon Pierre
Nous savons tous que Pierre dans sa deuxième épître (2 Pierre 3:16) parle de toutes les épîtres de Paul comme étant des « écritures ». C’est de nouveau très beau dans cette communication tardive du grand apôtre de la circoncision. Mais on ne voit généralement pas, bien que ce ne soit pas moins certain, que dans le verset précédent, Pierre rend témoignage du fait que Paul a écrit aux Juifs croyants auxquels s’adressaient ses deux propres épîtres. Ainsi, nous avons l’autorité inspirée que ni Barnabé, ni Silas, ni Apollos, ni aucun autre que Paul n’a écrit l’épître aux Hébreux. Quelques mots d’inspiration sont décisifs à l’encontre d’une argumentation sans fin.
Retour sur ce qui précède 3:16 (ch. 3:10 à 3:15)
Les v. 10 et 11 avaient rappelé à Timothée les occasions particulières qu’il avait eues et sa connaissance personnelle de l’enseignement, de la conduite et de la vie de l’apôtre, comme individu et dans son ministère ; un supplément solennel (3:12, 13) était rajouté au sujet des hommes pieux et des méchants, soit par ressemblance soit par contraste. Le v. 14 est une exhortation solennelle pour Timothée à s’en tenir aux choses qu’il avait ainsi apprises et dont il était assuré, en se basant sur sa connaissance de leur caractère et de l’autorité de ceux de qui il les avait apprises, ainsi que sur sa familiarité dès l’enfance avec les anciens oracles de Dieu — oracles anciens mais vivants, ils étaient certes incapables par eux-mêmes de vivifier ou de transmettre une puissance spirituelle, mais ils pouvaient rendre Timothée sage pour le salut par la foi qui est dans le Christ Jésus (3:15).
Ch. 3:16
Puis, au v. 16, vient une conclusion dogmatique du sujet, aussi claire que capitale, sous la forme d’une formule concise très naturelle que reflète la Version Autorisée KJV, hormis dans le mot d’introduction qui, mieux traduit, en élargirait considérablement la portée : « Chaque [= toute] écriture est inspirée de Dieu et profitable [= utile]… » Cette formule couvre donc tout ce qui pouvait être ajouté par inspiration de Dieu, aussi bien que ce qui avait déjà été donné. Elle expulse du champ non seulement ceux qui ergotent hardiment sur la parole divine, mais aussi péremptoirement les apologistes indignes, qui se prétendent orthodoxes et pourtant abandonnent les saintes Écritures ; par compromis avec l’adversaire, ils les abandonnent soit en détail un peu partout dans la Bible, soit en bloc, par livres entiers.
À quoi l’écriture est-elle utile ou « profitable » ? Ce passage n’est pas à considérer comme une exception au principe général qui régit toute la Bible. Il n’établit que ce qui est en harmonie avec le contexte. Il n’y a pas non plus d’autre endroit où l’on puisse aller au-delà de ce principe en sagesse et puissance et intérêt. Nous sommes donc contraints d’éviter toute recherche partielle, si nous voulons vraiment chercher à comprendre les pensées de Dieu révélées dans Sa parole écrite ; nous devons lire et étudier les Écritures dans leur ensemble. Avec Christ devant nous, nous n’allons pas lire en vain. En commençant par Moïse et tous les prophètes, notre Seigneur ressuscité exposait dans toutes les écritures les choses qui Le regardent (Luc 24:27) ; et si cela est dit de l’Ancien Testament, il est évident que c’est encore plus vrai du Nouveau. Nous nous trompons donc si Lui, l’objet constant de l’Esprit inspirateur, n’est pas notre objet à nous ; mais la manière est aussi différente que les livres qui composent la Bible ; chaque livre a son propre plan, et tous contribuent à former un ensemble parfait. Le terme « profitable » ou utile est donc limité selon le caractère de cette épître. D’autres utilisations sont indiquées ailleurs.
pour enseigner
En premier lieu, il y a le profit de chaque écriture « pour l’enseignement », ou la doctrine. Il ne peut y avoir d’exemple plus beau et plus riche de cela que l’épître aux Hébreux, où les grandes vérités de l’évangile sont tirées de manière également simple et profonde des paroles et des figures de l’Ancien Testament. Peut-on trouver dans d’autres parties de l’Écriture un moyen aussi bien adapté pour aider le croyant à mieux comprendre et appliquer l’évangile ? Une vérité correctement saisie prépare la voie à une autre. Car aucune vérité nouvelle ne supplante ce qu’on a déjà, mais elle la confirme et aide à aller plus loin.
pour convaincre
Vient ensuite l’usage de l’Écriture « pour convaincre ». L’épître aux Galates peut être prise comme exemple marquant de cela. Voyez comment l’apôtre utilise admirablement « la bénédiction » et « la malédiction » au ch. 3 de Galates, pour illustrer la promesse et la loi, que ces saints confondaient comme des millions d’autres l’ont fait depuis, et encore plus. Reprenez la Semence, non pas les « plusieurs » ou les « nombreuses », mais celle qui est unique (Gal. 3:16) ; et le principe d’un médiateur dans la loi correspondant au seul Dieu qui promet et accomplit surement. Prenez dans Gal. 4 l’application encore plus évidente des deux fils d’Abraham à la délivrance de la loi, avec la prophétie introduite pour illustrer, et la sentence finale tirée de Gen. 21:10 pour convaincre les judaïsants de leur erreur ruineuse.
pour corriger
Vient, en troisième position, « pour corriger ». Une illustration remarquable de cet usage peut se voir dans l’utilisation fréquente et parlante de l’Ancien Testament dans les épîtres aux Corinthiens. Presque tous les chapitres de la première épître en fournissent des exemples, et 1 Corinthiens 10 en regorge.
pour instruire dans la justice
Quatrièmement, qui peut ne pas voir dans l’épître aux Romains le spécimen le plus brillant et le plus concret d’écriture utilisée « pour instruire dans la justice » ? Dans cette écriture comme dans les autres, non seulement l’Ancien Testament est appliqué avec une habileté divine, mais ses propres éléments d’instruction vont dans le même sens.
Ch. 3:17
Ainsi, l’objectif est clairement et parfaitement atteint : « afin que l’homme de Dieu soit accompli, et parfaitement adapté à [accompli pour] toute bonne œuvre ». C’était le cas de Timothée, et aussi de tous ceux qui suivent un chemin similaire. C’est l’injonction du Saint Esprit, expressément en vue des temps fâcheux des derniers jours.
Chapitre 4 versets 1 et 2
Après avoir ainsi établi l’autorité divine du dépôt sacré [l’Écriture], nouveau comme ancien [AT & NT], et sa plénitude pour édifier, l’apôtre se met, au début du ch. 4, à engager d’une manière très solennelle à l’exercice pressant du ministère de ce dépôt sacré.
« Je témoigne solennellement (ou : charge) [JND : adjure] devant Dieu et le Christ Jésus qui va juger vivants et morts, et par son apparition et son règne : prêche la parole ; insiste en temps et hors de temps ; convaincs, reprends, encourage [JND : exhorte] avec toute patience [JND : longanimité] et doctrine » (4:1-2).
[Texte de la version autorisée KJV : « C’est pourquoi je te charge devant Dieu et le Seigneur Jésus Christ qui jugera les vivants et les morts à son apparition et son règne »]
Ch. 4:1 — Discussion sur le texte et la traduction
Il y a ici une forte divergence, tant sur ce qu’il faut réellement lire parmi les anciens manuscrits, que quant à la manière juste de refléter le texte original. Le « texte reçu » a accrédité une particule de connexion avec le chapitre précédent, ou du moins avec son sujet final [il s’agit de l’ajout de « c’est pourquoi » figurant dans la KJV]. Un examen plus attentif, ou un jugement certainement plus spirituel, aurait montré que cela n’était pas nécessaire et même déplacé. Au contraire, Paul souhaitait manifestement mettre en avant Dieu lui-même et l’Homme ressuscité, qui doit avoir la suprématie pour s’occuper de l’humanité dans le jour à venir. L’ordre de Son nom et l’omission du mot « Seigneur » [autrement dit « le Christ Jésus » au lieu « le Seigneur Jésus Christ] sont soutenus par les meilleurs manuscrits faisant autorité et s’inscrivent admirablement dans le contexte. Il semblerait également que la conjonction [et] avant τὴν ἐπιφάνειαν [son apparition] n’ait pas été comprise, et ait été supplantée par la préposition [« à son apparition » au lieu de « et par son apparition »] afin de faciliter la construction ; ce qui a eu pour effet de modifier le lien de la phrase en séparant « Son apparition et Son règne » du verbe [charge, adjure] au début, et en les rattachant au jugement des vivants et des morts comme à une date.
C’est ainsi que cela figure dans la version autorisée et d’autres versions ; mais si nous relions « Son apparition et Son règne » au verbe [charge, adjure], un choix de version reste à trancher. En effet, nous pouvons considérer les accusatifs [Son apparition et Son règne] comme le complément de διαμαρτύρομαι [je te charge, ou je t’adjure], et les traduire comme en Deut. 4:26 [J’appelle aujourd’hui à témoin contre vous les cieux et la terre…], ce que certains préfèrent, dans le sens d’appeler l’apparition du Christ et Son règne à témoigner contre la chrétienté. Or cela semble loin d’être juste une analogie. Le ciel et la terre peuvent facilement être saisis quand on les invoque ; mais que dire d’une convocation de l’apparition de Christ et de son règne ? Ce serait en effet discordant. Comment Paul pourrait-il faire appel à l’apparition future de Christ et à Son règne pour témoigner, comme Moïse a invoqué le ciel et la terre ce jour-là pour témoigner contre Israël ? Les deux sortes d’invocation ne se ressemblent pas.
L’apparition de Christ et Son règne sont donc des motifs d’appel appropriés et très impressionnants par lesquels l’apôtre chargeait solennellement Timothée de prêcher la parole — que ce soit Timothée ou d’autres responsables animés des mêmes pensées. Prendre l’apparition et le règne comme des complément d’objet direct (accusatifs) accompagnant le verbe « charger ou adjurer » semble donc tout à fait intenable. C’est pourquoi la plupart préfèrent, avec les Réviseurs, comprendre que l’apôtre témoigne (ou : charge) solennellement, sans préciser qu’il s’adresse à Timothée, devant Dieu et Jésus-Christ, et par Son apparition et Son règne, — comme ce qui donnait une force et un motif de crainte extrêmes.
Ch. 4:1 — motivation de l’appel : « qui va juger vivants et morts »
Après cette brève discussion sur le texte et la traduction, qui est pourtant un devoir pour avoir une bonne clarification de l’Écriture (celle-ci ayant été obscurcie par une connaissance et une perspicacité défectueuses), nous pouvons maintenant admirer d’autant plus intelligemment l’appel apostolique. Cette charge [ou : adjuration] solennelle exprimée par Paul, est devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui est sur le point de juger vivants et morts. Ceci est vu comme toujours imminent ; ou, comme le dit un autre apôtre, le Christ « est prêt à juger les vivants et les morts » (1 Pierre 4:5). Seulement notre texte parle du jugement comme un processus continu, tandis que Pierre le résume dans sa conclusion. Le caractère continu du jugement de notre Seigneur est rendu encore plus évident, si cela est possible, en Actes 17:31, où son objet est clairement défini comme étant la terre habitable, — non pas les morts (dont le jugement suivra en son temps) mais les vivants : c’est une vérité qui, bien que figurant dans les symboles ordinaires de la chrétienté, a pratiquement disparu de l’esprit même de chrétiens sérieux et sobres, qui sont enclins à fixer leurs yeux exclusivement sur le grand trône blanc (Apoc. 20:11-15).
Dans cette affaire solennelle, eux et les Juifs tombent dans des fautes opposées. En effet, les Juifs étaient pleins du jugement terrestre que le Messie doit certainement exécuter sur toute la terre, aucune nation ne pouvant y échapper ; ils ne pensaient guère ou pas du tout au jugement éternel des morts. Mais le Seigneur Jésus, comme Pierre en rend solennellement témoignage à Corneille, est Celui qui a été ordonné par Dieu comme Juge des vivants et des morts (Actes 10:42).
Comme nous savons que la plupart des chrétiens passent légèrement sur le jugement des hommes vivants sur la terre, il est d’autant plus important de le développer quelque peu. Rien n’en démontre plus la nécessité que la citation de 1 Cor. 15:51, 52, et 1 Thess. 4:16, 17 par rapport au jugement des vivants et des morts. « Nous, les vivants qui demeurons », nous qui serons changés sans nous être endormis, nous ne sommes pas le moins du monde inclus dans les simples vivants, et bien sûr pas dans les morts, du texte qui est devant nous (2 Tim. 4:1). « Nous » sommes des croyants chrétiens qui, par conséquent, ne viennent pas en jugement, comme notre Seigneur l’a décidé en Jean 5:24, mais qui seront changés sans mort ni jugement, et qui seront amenés avec les saints morts et ressuscités pour rencontrer le Seigneur Jésus lors de Sa venue.
L’idée d’un jugement futur de ceux qui sont spirituellement vivants, ne figure pas dans l’Écriture, bien que tous doivent être manifestés devant le tribunal de Christ. Pour ceux qui sont « spirituellement morts », ceci ne sera bien sûr rien d’autre que la comparution en jugement ; quant aux saints, ils y seront néanmoins manifestés, afin qu’ils connaissent comme ils ont été connus (1 Cor. 13:12), et que chacun reçoive les choses faites dans le corps, selon ce qu’ils auront faits, soit bien soit mal (2 Cor. 5:10). Ayant Christ comme leur vie et ayant Sa rédemption, ils sont déjà sauvés ici-bas par la grâce par la foi ; ils ne seront pas mis en jugement à ce tribunal comme si le salut de Dieu était chose douteuse. Pour ceux-là, ce sera simplement une manifestation de cette manière solennelle mais bénie, avec spécialement en vue la place de chacun dans le règne ; car parmi les sauvés, il est révélé avec certitude que chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Mais l’idée d’un jugement prochain pour celui qui a la vie éternelle et qui est sauvé, est non seulement en contradiction flagrante avec la parole expresse de Christ (Jean 5:24), mais est inconciliable avec toute la bénédiction éternelle pour le croyant, que l’évangile atteste comme due à Christ et à Son œuvre.
Le passage (4:1) ne parle donc pas des saints célestes, et encore moins des privilèges de grâce qui sont les leurs en Christ, mais du jugement à venir qui attend vivants et morts lorsque Christ sera révélé à cette fin selon l’Écriture. D’autres passages des saintes écritures montrent que les vivants doivent être jugés, non seulement lorsque Christ apparaitra en gloire, mais aussi tout le long de Son règne, — ce règne qui est dit durer « pour toujours », car il ne se clôt qu’avec la dissolution du ciel et de la terre de maintenant, et avec le jugement subséquent des morts (les méchants morts, qui, petits et grands, se tiendront devant le trône). Leur manifestation est le jugement au sens le plus complet et éternel du terme ; car, ayant rejeté Christ, ou du moins ayant manqué de profiter d’un quelconque des témoignages que Dieu leur a donnés, il ne leur reste plus qu’à être jugés chacun selon ses œuvres. Leurs œuvres étant mauvaises d’une part, et leur nom ne se trouvant pas écrit dans le livre de vie d’autre part, ils sont tous jetés dans l’étang de feu (Apoc. 20:12-15). Leur résurrection est donc une résurrection de jugement : c’est ainsi que le Sauveur l’appelle en Jean 5:29, tandis que celle des croyants est une résurrection de vie — la vie pour les corps de tous ceux qui, ici-bas, ont reçu par la foi la vie en Christ pour leurs âmes. Mais l’apôtre traite ici (2 Tim. 4:1) du jugement, d’abord des vivants sur terre au moment du règne de Christ et pendant ce règne, et enfin du jugement des morts avant que le royaume ne soit remis à Celui qui est Dieu et Père, afin que Dieu (Père, Fils et Saint Esprit) soit tout en tous dans l’état éternel (1 Cor. 15:24,28).
Ch. 4:1 — par Son apparition et par Son règne
On remarquera que le langage contextuel de l’apôtre est tout à fait précis et explicite. Lorsqu’il charge [adjure] devant Dieu et Christ qui est sur le point de juger vivants et morts, il ajoute « et par Son apparition et par Son règne ». « Sa venue », ou présence, n’aurait pas du tout convenu ; car, à moins d’être suivi d’un qualificatif spécial (par exemple l’expression « du Fils de l’homme » ou autres), ce terme n’a pas de relation propre avec l’action de Dieu en jugement, mais plutôt avec les conseils de Dieu en grâce. La présence ou la venue de Christ est liée à l’enlèvement des saints en haut. Quand il est question d’action judiciaire, « Son apparition » est l’expression juste, comme ici ; on trouvera également soit Sa révélation, soit Son jour dans un tel contexte.
C’est pourquoi « Son apparition » est suivie de « et Son règne », avec autant de justesse, car « Son apparition » seule n’aurait pas suffi à faire davantage que faire tomber les premiers jugements sur la génération vivante coupable de ce jour-là. Pour couvrir Son jugement du monde tout au long de Son règne, et en particulier le jugement des morts qui restent à ressusciter pour le jugement à la fin, il est nécessaire qu’il y ait aussi « Son règne », et nous l’avons. Chaque mot est écrit avec sagesse ; tout est nécessaire pour que le tableau de Son jugement soit complet. Cela fait voir l’erreur de ceux qui parlent de « l’éternité modifiée » de Son règne médiatorial (règne de grâce) auquel succéderait le règne de gloire qui commencerait à Son ἐπιφάνεια, épiphanie ou apparition. Il n’en est rien ; le règne de mille ans (Apoc. 20:1-7) commence, pour parler de manière générale, lorsque Christ est manifesté en gloire (comme le ch. 19 précédent le fait ressortir clairement). On peut le décrire comme une « éternité modifiée », parce qu’il introduit Son règne, un règne qui ne sera jamais détruit, et dont la souveraineté ne sera jamais laissée à un autre peuple ; mais ce règne brisera en morceaux et consumera tous les royaumes précédents, et il subsistera à jamais, c’est-à-dire aussi longtemps que la terre durera (Dan. 2:44). Il est absurde d’appliquer cela à l’église (ou à l’évangile) maintenant ; car l’église, si elle est fidèle à ses principes, est toujours appelée à souffrir, et non à régner, jusqu’à ce que Lui apparaisse en gloire. L’épouse doit se comporter en sainte séparation du monde, rejetée comme son Maître crucifié, jusqu’à ce qu’elle soit glorifiée avec Lui à Sa venue. La scène éternelle qui ne connaît ni fin ni modification est après que le royaume soit remis, — le royaume qui lui a été donné en tant qu’Homme, et qu’Il partage avec les saints ressuscités, régnant ensemble comme ils ont souffert ensemble (2:12) ; mais le royaume est remis à la fin, quand Il aura aboli toute principauté et toute autorité et toute puissance. Car il faut que Christ règne jusque-là ; pendant toute l’éternité, c’est Dieu en tant que tel, et non l’Homme exalté, qui sera tout en tous (1 Cor. 15:28).
Ch. 4:2
Dans cette perspective, l’apôtre donne donc l’ordre suivant : « Prêche la parole ; insiste en temps et hors de temps ; convaincs, reprends, exhorte, avec toute longanimité et doctrine ». La structure de chaque verbe implique une action rapide. Bien sûr, cela est tout à fait cohérent avec la persévérance sans cesse ; mais la persévérance peut être, et est souvent, avec moins d’intensité de dévouement, comme l’insinue ici la succession rapide d’instructions pressantes adressées à Timothée, sans aucune particule pour les relier les unes aux autres.
La proclamation de la parole a la première place ;
s’astreindre en urgence à l’œuvre en temps et hors de temps, fait suite à la prédication ;
convaincre dans le sens de toucher au plus profond ou blâmer, est enjoint comme un devoir salutaire, même si c’est pénible pour un esprit tendre ;
la répréhension vient ensuite, et est nécessaire quand la faute est nette et manifeste ;
par ailleurs l’encouragement ou l’exhortation sont nécessaires, là où c’est plutôt cela qui a sa place ;
dans tous les cas, il fallait toute longanimité et doctrine.
Qui était suffisant pour ces choses ? [2 Cor. 2:16]. La suffisance de Timothée, comme celle de l’apôtre, venait de Dieu. Qu’il en soit de même pour nous dans notre petite mesure !
À suivre
Chapitre 4 versets 3 et 4
L’apôtre avance maintenant une nouvelle raison pour justifier un zèle urgent et assidu de toutes les manières possibles : une autre caractéristique fâcheuse des temps fâcheux des derniers jours.
« Car il y aura un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine ; mais ayant l’oreille qui leur démange et selon leurs propres convoitises, ils s’amasseront des enseignants (*) ; et ils détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables » (4:3, 4).
Ch. 4:3 — ils ne supporteront plus le sain enseignement
Ce ne sont pas les conducteurs qui sont en faute au premier plan, mais les gens. Ailleurs on voit des faux docteurs et des chefs autoproclamés, qui égarent ceux qui mettent leur confiance en eux. Ici, bien que le temps ne soit pas encore venu pour que ce mal soit aussi répandu, l’Esprit de Dieu en parle comme étant imminent : « Car il y aura un temps où ils ne supporteront pas le sain enseignement ». Cela décrit clairement l’état qui envahira la chrétienté, non pas les Juifs ni les païens. Cela suppose des gens qui avaient l’habitude d’entendre la vérité. Mais maintenant, la vérité devient imbuvable et « le sain enseignement » de celle-ci ne peut être supporté : une époque vraiment effrayante pour des gens qui portent le nom du Seigneur. Car il est évident qu’ils L’invoquent d’un cœur impur. Le sain enseignement est toujours le bienvenu pour ceux qui désirent croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ (2 Pierre 3:18) ; et cela afin que tout aboutisse à une vie d’obéissance et de dévouement croissants.
Quelle profondeur et quelle audace dans l’inimitié du cœur quand ceux qui ont toutes les raisons d’aimer la vérité, bien au-delà de ceux d’autrefois, ne veulent plus la supporter ! « Combien j’aime Ta loi ! tout le jour je la médite » (Ps. 119:97). « Que Tes paroles ont été douces à mon palais ! oui, plus que le miel à ma bouche ! » (Ps. 119:103). « Il est temps que l’Éternel agisse : ils ont annulé Ta loi. C’est pourquoi j’aime Tes commandements plus que l’or, et que l’or épuré. C’est pourquoi j’estime droits tous Tes préceptes, à l’égard de toutes choses ; je hais toute voie de mensonge » (Ps. 119:126-128). « Tes témoignages sont merveilleux ; c’est pourquoi mon âme les observe. L’entrée de Tes paroles illumine, donnant de l’intelligence aux simples. J’ai ouvert ma bouche, et j’ai soupiré ; car j’ai un ardent désir de Tes commandements » (Ps. 119:129-131). « Ta parole est bien affinée, et Ton serviteur l’aime. Je suis petit et méprisé ; je n’ai pas oublié Tes préceptes. Ta justice est une justice à toujours, et Ta loi est vérité. La détresse et l’angoisse m’avaient atteint ; Tes commandements sont mes délices. La justice de Tes témoignages est à toujours ; donne-moi de l’intelligence, et je vivrai » (Ps. 119:140-144).
Ce ne sont là que quelques extraits d’un psaume (Ps. 119:97-144) consacré dans son ensemble à l’exposé des vertus caractéristiques de la révélation divine telles que possédées par la maison d’Israël avant Christ — et donc très en-deçà des communications ultérieures, encore plus profondes depuis la rédemption, l’ascension de Christ et la présence personnelle du Saint Esprit envoyé du ciel, — des faits tous infiniment bénis qui rehaussent ce que Dieu a révélé depuis. Et spécialement du fait qu’il s’agit d’une composition qui exprime par l’Esprit les sentiments du cœur, nous pouvons voir à quel point le sain enseignement de ces temps d’autrefois était apprécié, — comme il le sera tout autant, voire plus, lorsque Dieu, dans les derniers jours, stimulera le résidu pieux à dire en son cœur : « Béni soit celui qui vient au nom de l’Éternel » (Ps. 118:26). Le témoignage chrétien complet se situe entre les deux venues du Seigneur, et donc davantage après les premiers jours de réjouissance juive, avant que les enfants ne savourent la Parole au-delà de ce que leurs pères ont fait. C’est dans cet intervalle que le christianisme s’est manifesté, ainsi que sa corruption dans la chrétienté, dont l’un des symptômes directs est le dégoût et l’intolérance à l’égard du « sain enseignement » annoncés ici.
Ch. 4:3 — selon leurs propres convoitises
Or il y a aussi un mal positif, et de l’antipathie pour ce qui est divin. Ces deux maux ont depuis longtemps confirmé l’avertissement solennel de l’apôtre, et on comprend donc aisément que la sombre esquisse d’une époque alors proche, devienne de plus en plus noire à mesure que le Seigneur tarde et que l’iniquité sans loi et sans frein acquiert audace et force. La prédominance de l’éducation dans les temps modernes fait qu’on lit beaucoup, même dans les classes les plus humbles ; il s’ensuit que le désir d’entendre ce qui plaît à l’esprit, au goût et aux aspirations naturelles de l’homme, évolue, comme tout, selon l’esprit qui gouverne ce siècle, devenant toujours plus actif et prétentieux. « Selon leurs propres convoitises, ils s’amasseront des docteurs, ayant une oreille qui leur démange ». Quelle anticipation concrète de ce qu’on trouve partout de nos jours, au moins là où la Bible est universellement diffusée ? Il arrive même que celle-ci soit ouvertement délaissée par des hommes qui se disent chrétiens. Satan peut la neutraliser, et il y arrive malheureusement, lorsqu’elle est utilisée comme simple suggestion de sujets pour l’esprit aventureux et profane de l’homme. En effet, aucun autre livre n’est aussi fécond pour susciter et satisfaire les interrogations les plus profondes sur Dieu, sur l’homme et sur toutes choses. Et l’intellect peut facilement mettre de côté son autorité tandis qu’il s’envole dans des discussions universelles, se plaçant dans le doute de ce qui est divin et dans la crédulité de ce qui vient de l’homme. Christ comme centre et expression de la grâce et de la vérité, est alors pratiquement perdu, — de manière d’autant plus coupable que cela se passe dans la sphère où Lui était autrefois tout.
Ch. 4:3 — ils s’amasseront des docteurs
Que deviennent ceux qui, ayant connu un jour Sa gloire, lui tournent ensuite le dos ? D’abord, comme nous l’avons vu, selon leurs propres convoitises, ils s’amassent des docteurs, ayant une oreille qui leur démange. La pleine révélation de Dieu, bien qu’elle ne soit plus retenue par la foi, laisse un désir ardent d’entendre quelque chose de nouveau ; et dans ce but, on a recours à des masses de docteurs, dans une profonde incrédulité de la parole de Dieu et de la puissance de l’Esprit pour guider dans toute la vérité. On ne peut jouir de l’efficacité ni de l’une ni de l’autre, là où la rédemption ne purifie pas la conscience et où Christ lui-même n’est pas l’objet et le repos du cœur. On ne se moque pas de Dieu ; car tout ce qu’un homme sème, il le moissonne aussi ; car celui qui sème pour sa propre chair moissonnera de la chair la corruption ; mais celui qui sème pour l’Esprit moissonnera de l’Esprit la vie éternelle (Gal. 6:8). Si l’homme ouvertement injuste s’adonne au plaisir, l’homme religieusement injuste s’occupe avec zèle avec des docteurs, tous deux faute d’avoir Christ. En Lui seul, Dieu ou l’homme peuvent trouver la vie, des objets et de la satisfaction ; en Lui, la foi trouve tout pleinement. Sans cela, tout est gaspillage au profit de ses propres convoitises, pour accumuler ce qui ne peut jamais satisfaire ; et qui satisfait d’autant moins si on s’écarte de cœur de Lui, même connu tant soit peu : une oreille qui démange aggrave, mais n’apporte jamais aucun remède.
« S’amasser des docteurs » n’est que la mise en œuvre excessive d’un principe mauvais qui prévaut chez les évangéliques de toutes sortes, qu’ils fassent partie de l’église officielle ou que ce soient des dissidents. Leur principe, c’est que l’on est aussi libre de choisir son enseignant (docteur), ou son ministre (pasteur), que de choisir son médecin, son avocat, ou toute autre aide professionnelle ; et ce, au motif qu’ils sont rémunérés pour leurs services. Il n’est pas étonnant que la superstition se soit révoltée contre des idées aussi grossières dans les choses spirituelles, et contre un ministère en habit avec des rites mystiques pour élever ce ministère au-dessus des affaires de la vie quotidienne et le maintenir dans un cadre strictement clérical ; d’autres se sont rabattus sur un patronage pour le racheter du vulgaire et le garder autant que possible entre des mains plus raffinées, directement ou indirectement.
Ch. 4:3 — les dons de Christ selon Éph. 4
Mais l’Écriture s’élève bien au-dessus de ces arrangements terrestres et conflictuels des hommes, et nous montre que Christ est la source du ministère, non seulement au point de départ, lorsqu’Il a choisi les douze et les soixante-dix pour les envoyer dans leurs missions respectives, mais comme le Chef (Tête) ressuscité, glorifié et toujours-vivant, Celui qui a donné les uns comme apôtres, d’autres comme prophètes, d’autres comme évangélistes, d’autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour l’œuvre du service, pour l’édification du corps de Christ (Éph. 4:11, 12).
Il est vain d’affirmer que ce mode de fonctionnement ne pouvait exister que lorsque Christ était ici-bas sur terre. Car le fait remarquable est que la grande révélation dont il vient d’être fait référence en Éph. 4:8-13, ignore toute action de ce genre sur la terre, et ne parle que des dons ministériels conférés à l’église par notre Seigneur, depuis qu’Il est monté en haut. Or le but en est de les établir sur une base qui ne peut pas changer jusqu’à ce que notre Seigneur revienne. Jusque-là, Il ne cesse d’être la source intarissable pour fournir les ressources ; et, comme pour rendre cela certain et clair même à des oreilles réticentes, il est ajouté, « jusqu’à ce que nous parvenions tous à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme adulte, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ » (Éph. 4:13). L’Écriture ne permet aucune autre source, et en donne l’assurance pour tout besoin des saints maintenant sur la terre. Mais nous devons toujours garder à l’esprit, ce que la même épître (Éph. 2:20) distingue, à savoir que les apôtres et les prophètes constituent le fondement sur lequel nous sommes édifiés, tandis que les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, sont les dons qui poursuivent l’œuvre. Ceci étant l’indication non forcée et sans équivoque de la parole de Dieu, la foi compte sur la fidélité de Christ vis-à-vis des besoins des âmes et sur Son amour pour l’Église qui est Son corps.
Il n’y a donc pas place pour les convoitises des hommes dans le choix ou le rejet de ceux que le Christ a donnés pour faire le travail ministériel (= l’œuvre du service). Le don est prouvé par l’énergie de l’Esprit qui accomplit ce pour quoi il est donné : l’évangéliste en gagnant les non-convertis à Dieu ; le pasteur et l’enseignant (pas toujours combinés, bien qu’ils le soient souvent) en dirigeant et en instruisant les saints. C’est sur le même principe qu’un croyant est reconnu par sa bonne confession de Christ, non pas en parole seulement, mais en action et en vérité. Ni une couronne royale, ni une congrégation, ni un évêque, ni un patron n’ont rien à voir avec ce choix1. Tous ces dons ou appels humains sont totalement contraires aux règles ; non seulement ils ne sont pas bibliques, mais ils sont anti-scripturaires, quels que soient les arguments que des hommes de bien ont pu faire en faveur de chacun d’eux. Le chrétien est tenu de reconnaitre ceux que Christ donne pour le service spirituel, mais il doit aussi se garder de tous ceux que Christ n’a pas donnés. Les brebis connaissent Sa voix dans Ses serviteurs, et elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Assurément, les brebis peuvent se tromper dans tel ou tel cas ; car elles ne sont aucunement infaillibles, et elles doivent agir de manière responsable par la grâce. Mais les yeux du Seigneur sont sur tous, et Il honore Sa parole, comme Il aime Ses brebis. Le fait triste et honteux est que pendant des siècles, les brebis ont manqué à regarder à Lui dans cette affaire, et ont accepté l’une ou l’autre de ces manières humaines qui ignorent que Lui donne les ressources spirituellement nécessaires. Et comme certains ont péché par le système injustifiable d’un seul homme concentrant tous les dons dans sa personne ou son autorité, d’autres se sont mis à amasser des docteurs selon leurs propres convoitises.
1 Ceci est tout à fait compatible avec le fait que la congrégation choisisse des personnes pour distribuer leurs dons ou aides, car nous voyons clairement que cela est du Seigneur selon Actes 6. Le service de diacre est tout à fait distinct des dons de Christ pour le service spirituel de la Parole. Quand l’homme donne, il est fondé à choisir ; quand le Seigneur donne, l’homme n’a aucun droit, il a l’obligation de recevoir. Voilà le principe que soutient toute l’Écriture. Le choix des anciens dans l’Écriture était clairement du ressort des apôtres, directement (Actes 14:23) ou par des délégués (Tite 1:5), comme étant une question de gouvernement que le Seigneur a confié aux apôtres. Les dons descendent directement de Christ, même si certains hommes doués peuvent être en même temps anciens ou diacres ; mais les dons eux-mêmes sont tout à fait distincts de ces charges. Un apôtre était, au sens le plus élevé du terme, à la fois un organe de gouvernement et un don de Christ monté en haut.
Le seul remède est de se tourner, par la foi, vers Dieu et vers la parole de Sa grâce qui fournit la vraie clé du fait que les dons subsistent, mais sont rarement concentrés ; en règle générale, ils sont distribués en une grande variété et mesure de puissance spirituelle. Dans l’état actuel de l’église de Dieu, les dons sont, comme les saints, douloureusement dispersés, mais aussi voilés et entravés. Mais aucun changement de circonstances n’altère la constitution vitale de l’Église, pas plus qu’il n’altère le principe que des membres de celle-ci soient si importants pour son extension et son bien-être, à savoir les dons que nous considérons maintenant. Ce que les fidèles doivent faire, c’est de se juger eux-mêmes selon la parole de Dieu pour apprendre jusqu’à quel point ils se sont écartés, et pour se soumettre à Sa volonté, sachant que celui qui la fait demeure éternellement (1 Jean 2:17). Seuls les dons de Christ ont le droit et la compétence par l’Esprit ; et aucun saint ne peut se justifier s’il refuse de tels dons ou s’il accepte d’autres hommes que Christ n’a pas ainsi donnés ; car d’une façon ou de l’autre, c’est nier Ses droits et préférer la volonté de l’homme à la Sienne. Mais s’amasser des docteurs (est-il concevable que ceux-là soient Ses dons s’ils consentent à Son déshonneur ?), c’est céder aux convoitises des hommes, aux excès de la propre volonté en dépit de Christ.
Ch. 4:4 — Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables
Mais il y a plus encore. « Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables » (4:4).
Voici le résultat fatal. Qui peut mesurer le déshonneur ainsi fait à Dieu et à Sa parole ? Qui peut dire la perte subie par leurs âmes, non seulement par leur aliénation d’avec la vérité, mais aussi par leur appétit effectif pour la fausseté imaginaire ? C’est ce que voudrait Satan, qui n’aime rien tant qu’un affront direct fait à Christ, — ce que tout cela implique. Ainsi, le mal s’ensuit de toutes les manières. La conscience n’est plus gouvernée par le sentiment de la présence de Dieu. La grâce n’est plus ressentie, et ainsi la force contraignante de l’amour de Christ n’opère plus. La sainte crainte de déplaire à Dieu disparaît. Il n’y a plus la conscience d’être mis à part par l’Esprit pour l’obéissance et l’aspersion du sang de Jésus Christ (1 Pierre 1:2). Comme Christ n’est rien du tout pour de telles personnes, de même le dieu de ce monde aveugle leurs pensées afin que le rayonnement de l’évangile de Christ ne brille pas. Il n’y a donc pas de trésor dans les vases de terre, pas plus qu’ils n’ont jamais porté partout dans le corps le mourir de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée aussi dans le corps ; et encore moins sont-ils livrés à la mort pour l’amour de Jésus, afin que Sa vie soit aussi manifestée dans leur chair mortelle, de sorte que la mort agisse en eux, mais la vie dans les objets de l’amour divin ([expressions reprises de] 2 Cor. 4:4-12).
C’est pourquoi les choses présentes ne manquent pas de se précipiter pour remplir le vide selon le plaisir de Satan. L’âge a de l’influence, et on aime le monde et les choses qui y sont (1 Jean 2:15). D’un côté les saints pauvres paraissent vulgaires et effrontés, et les épreuves de l’assemblée deviennent odieuses et méprisables. D’un autre côté, combien de choses du monde commencent à paraître belles et agréables ! Alors on trouve des excuses plausibles pour la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie (1 Jean 2:16). Les raisons autrefois décisives pour se tenir à l’écart semblent être de l’étroitesse d’esprit et de la faiblesse ! Ainsi, de même que la parole de vérité est le moyen de sanctification pratique, de même les artifices de l’ennemi sapent et supplantent jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien que le Saint Esprit puisse utiliser pour avertir l’âme ou délivrer de cette puissance corruptrice et maligne.
Les « fables » ici ne sont pas qualifiées de « judaïques » comme en Tite 1:14, et elles ne sont pas non plus rattachées à des « généalogies » comme en 1 Tim. 1:4 qui vise la même direction. Il semble donc judicieux de les considérer comme ayant un caractère plus large, et ouvertes à la fantaisie des Gentils autant que celle des Juifs. Mais il est vain de spéculer sur ce qui était alors imminent. Il nous suffit de savoir que ces fables sont ici illimitées et qu’elles accompagnent certainement le fait de se détourner de la vérité. Comme en 1 Tim. 1:6 et 5:15, la structure de la phrase suggère que le fait de s’être déjà écarté vers des fables les amène à détourner leur oreille de la vérité.
Chapitre 4 versets 5 à 8
Ch. 4:5-8
Très différente de cette image attristante et humiliante de la conduite de la chrétienté est la position à laquelle l’apôtre se met à exhorter Timothée.
« Mais toi, sois sobre en toutes choses, endure les souffrances (tribulations), fais l’œuvre d’un évangéliste, accomplis pleinement ton ministère. Car pour moi, je suis déjà déversé [= JND je sers déjà de libation], et le temps de mon départ est arrivé. J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi : désormais m'est réservée la couronne de justice, que le Seigneur, juste juge, m’attribuera en ce jour-là ; et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment Son apparition » (4:5-8).
Ch. 4:5 — Sois sobre
Ici donc, comme en 2 Tim. 2:1, la charge donnée est résolument personnelle [Mais toi… toi donc]. Être fortifié dans la grâce qui est dans le Christ Jésus a son importance (2:1). Mais il faut davantage pour un ouvrier et un conducteur dans un jour de déclin général et dangereux où les influences toxiques sont aussi nombreuses que variées : « Mais toi, sois sobre en toutes choses » (4:5). La pensée n’est pas la vigilance (γρηγορεῖν) comme dans la version autorisée KJV, ni un esprit sain (σωφρονισμός) même si cela s’y rattache, mais il s’agit de sobriété de jugement. Le sens premier de ne pas boire de vin s’applique à la métaphore d’être sobre, ou précautionneux, en toutes choses. Timothée devait se tenir à l’écart de ce qui pourrait exciter ou engourdir, contrairement à ceux qui dérivent dans une masse emportée vers les fables loin de la vérité.
Ch. 4:5 — Endure les souffrances
De plus, il est appelé à « endurer les souffrances »1, ou des tribulations, et ce de manière très générale. En 2 Tim. 1:8, il devait « prendre part aux souffrances de l’évangile », une sorte de personnification [de l’évangile] favorite de l’apôtre, qui n’en avait pas honte, et voulait que le fidèle serviteur soit identifié avec les afflictions de l’évangile ici-bas. 2 Tim. 2:3 présente la pensée différente de Timothée prenant part aux souffrances en tant que bon soldat de Jésus-Christ, sans exprimer ni sous-entendre aucun compagnon particulier. Ici, toute idée de « prendre part » est laissée de côté. Être prêt à endurer des maux à sa place et à son service, c’est ce que l’apôtre réclamait. Paul ne charge pas son jeune collègue d’un fardeau que lui-même n’ait pas pleinement porté depuis longtemps. Il ne s’agit que d’avoir communion avec les souffrances du Maître ici-bas : seulement celles-ci, sans parler bien sûr des douleurs uniques de l’expiation, sont allées bien plus loin que celles de Ses serviteurs ; ceux qui ont vécu de telles souffrances reconnaitraient très franchement les différences d’avec celles du Seigneur.
1 Le verbe ici est à l’aoriste ainsi que dans les deux exhortations qui suivent : elles portent donc sur l’acte simple quand l’occasion se présente, et non pas sur un devoir constant comme dans νῆφε « sois sobre », qui précède.
Ch. 4:5 — Fais l’œuvre d’un évangéliste
L’appel qui suit est souvent étrangement mal compris, comme si l’apôtre voulait dire que Timothée devait faire un travail d’évangéliste, alors qu’il n’en avait pas le don, et qu’il n’était donc pas vraiment un évangéliste ! Il n’y a pas l’ombre d’une raison valable pour soutenir une telle construction. Le danger était plutôt que les difficultés et les troubles croissants de l’assemblée pouvaient distraire le jeune ouvrier sensible, et l’appeler, à cause des exigences de l’intérieur, à renoncer à l’exercice de ce qui était vraiment son don à l’extérieur, bien que ce ne fût pas son seul don. Le travail si béni auquel le Seigneur l’avait appelé ne devait pas être interrompu. L’évangéliste n’est pas seulement un prédicateur : l’œuvre de foi et le travail d’amour à la recherche des âmes le caractérisent pour inculquer la bonne nouvelle aux âmes individuellement comme publiquement.
Il y a une erreur à ne pas passer sous silence : les évangélistes ne formaient pas une classe spéciale, à part. Il est correct de les désigner quand même par cette appellation. Éph. 4:11 joint les pasteurs avec les enseignants (docteurs), tandis qu’il ne joint pas les évangélistes à aucune autre classe ; pourtant l’enseignant (docteur) est considéré ailleurs comme un don distinct, bien qu’en Éph. 4, comme souvent dans les faits, il soit combiné avec le pastorat. Tous les dons étaient certainement subordonnés aux apôtres ; cependant ni les évangélistes ni aucun autre n’étaient missionnaires des apôtres, mais du Seigneur. C’est Lui qui envoie les ouvriers dans Sa moisson, car Il est le Seigneur de la moisson. Les apôtres étaient des serviteurs, même s’ils ont été mis par Dieu en premier dans l’église. Ils ne pouvaient pas envoyer, et l’église le pouvait encore moins dans ce sens. Il n’est pas non plus fondé de dire que, lorsqu’il voyageait avec les apôtres, c’était l’œuvre à laquelle Timothée était appelé. Selon toute vraisemblance, Timothée évangélisait quand il avait le privilège d’être dans leur compagnie ; mais le don en soi était sans rapport avec un tel voyage. Au contraire, Timothée devait vouloir apprendre tout ce qu’il pouvait dans de telles circonstances, et cela devait être aussi sa joie de servir de toutes les manières, soit envers les personnes soit dans le ministère, afin, si l’on peut dire, de renforcer l’effet de l’activité du conducteur bien-aimé et honoré, comme l’impliquent Actes 16:3 et 19:22.
Le fait qu’il n’était pas question de travailler comme subordonnés et missionnaires des apôtres est encore plus clair dans le cas du seul dont le parcours d’évangéliste soit rapporté dans les Actes. Philippe était officiellement un « des sept » (Actes 6:5), mais en tant que don, il était évangéliste, et c’est de cette manière qu’il est désigné (Actes 21:8). Lorsque sa fonction a disparu du fait de la dispersion de tous les membres de l’assemblée à Jérusalem, on le voit (Actes 8) dans l’exercice actif de son don d’« évangéliste », et avec une bénédiction remarquable à la fois pour une ville entière et pour un individu. Philippe n’est en aucun cas vu comme voyageant avec un apôtre, mais plutôt comme quelqu’un d’une classe spéciale et distincte. Les apôtres, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, envoyèrent Pierre et Jean pour mettre le sceau de l’Esprit sur l’œuvre de Philippe (Actes 8:14-17) ; car en effet, l’humble amour avait opéré, et la rivalité était aussi loin de l’évangéliste que l’esprit de domination l’était chez les apôtres. La caractéristique de ce qui est décrit est l’action libre et souveraine du Seigneur ; et tandis que les deux apôtres ne pensèrent pas qu’il était indigne de leur position élevée d’évangéliser « de nombreux villages » des Samaritains lors de leur retour à Jérusalem (Actes 8:25), Philippe poursuivit son chemin sans entrave sous la direction du Seigneur, évangélisant « toutes les villes » jusqu’à son arrivée à Césarée (Actes 8:40). Il n’était pas question d’une sphère circonscrite par la présence ou l’absence d’un apôtre. Le monde est en principe la province de l’évangéliste : le voyage ou le séjour ici ou là est une question de dépendance du Seigneur.
Ch. 4:5 — Accomplis pleinement ton service
Enfin, il est dit à Timothée « d’accomplir pleinement (πληροφόρησον) son ministère » (4:5). Il semble que ce soit plus que πλήρωσον (Actes 12:25 ; Col. 4:17), à en juger par l’usage emphatique du mot lorsqu’il se présente ailleurs comme verbe ou comme substantif. Traduire avec Bèze « donne une pleine assurance de ton ministère » peut sembler plus littéral, mais ne convient guère au sujet qui nous occupe, qui diffère complètement de la foi, de l’espérance ou de la compréhension. Car ceux-ci impliquent une jouissance subjective ; pour le ministère, ce serait une preuve objective ; ni l’un ni l’autre ne peuvent s’appliquer correctement ici, sauf remplir pleinement la mesure de son service. Même si évangéliser incombe à celui qui en a le don, ce n’était pas la totalité du ministère que Timothée avait reçu dans le Seigneur : c’est son accomplissement complet qui lui est enjoint ici.
Ch. 4:6 — Je sers déjà de libation
Le départ prochain de l’apôtre s’accompagne de circonstances lourdes et bouleversantes : « Car je suis déjà en train d’être déversé [JND : je sers déjà de libation], et le temps de mon départ est presque arrivé » (4:6).
La version autorisée ne traduit pas du tout correctement la formule du texte : « car je suis maintenant prêt à être offert » est à plusieurs égards différent de « je suis déjà déversé » qui reproduit exactement l’original. Ce n’est pas la première fois que l’apôtre utilise cette même figure de la libation (offrande de boisson). À ses frères Philippiens bien-aimés, il avait écrit un peu auparavant : « Mais si même je suis versé comme une libation sur le sacrifice et le service de votre foi… » (Phil. 2:17). Maintenant, il laisse tomber toute condition, ayant sous les yeux son élargissement. Il parle comme si la libation était déjà faite.
Là encore, ἐφέστηκεν n’est guère identique à ἐνέστηκεν, bien que la différence soit une très petite nuance, que l’on cherche à exprimer par « est presque arrivé » par rapport à « est présent » ou « est arrivé ». « Est tout proche », comme dans la version autorisée KJV, n’est le véritable rendu ni de l’un ni de l’autre, mais de ἐγγύς ou ἠγγικεν.
Ch. 4:7 — J’ai combattu le bon combat
Peu nombreux, même parmi les apôtres, ont pu dire comme Paul en ce moment solennel : « J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi » (4:7). Imputer de la vaine gloire à l’apôtre, avec la mort (et quelle mort !) sous les yeux, est indigne de quiconque sauf un rationaliste. Il était d’une importance suprême, non seulement pour Timothée mais pour tous ceux qui pourraient suivre, de savoir ce que la grâce peut accomplir, et accomplit effectivement, au milieu du naufrage général. 1 Cor. 4:3, 4 et Phil. 3:12-14 restent cohérents avec ce v. 7, tandis que Phil. 4:13 fournit la base directe de sa réalisation [« je puis toutes choses en Celui qui me fortifie »].
Comment expliquer une telle incapacité chez certains à concevoir la puissance de la grâce par la foi ? N’est-ce pas que tant d’hommes excellents, se trainent encore dans les combats charnels de Rom. 7 à cause d’un faux système, et ils ignorent la délivrance que Rom. 8 proclame en vertu d’un Sauveur mort et ressuscité, c’est-à-dire en vertu de notre mort avec Lui et de la puissance de l’Esprit de vie en Lui. Sous la loi, ils s’attendent à l’échec, et l’échec arrive selon leur incrédulité ; cependant la grâce peut intervenir souverainement malgré l’erreur.
Mais ce combat dont parle l’apôtre est le combat honorable qui convient à l’âme affranchie, qui a Christ devant elle, et qui doit affronter dans sa mesure ce que Christ a affronté aux jours de Sa chair. C’est le saint combat pour la gloire de Dieu dans un monde hostile, — un combat qui ne se limite pas à la lutte contre soi-même dans le combat désespéré de Rom. 7. Dans ce dernier, nous apprenons expérimentalement ce que nous sommes, même une fois convertis ; et nous apprenons aussi que la loi aggrave notre détresse au lieu de nous donner une victoire pratique. Nous découvrons alors que la victoire vient uniquement en s’abandonnant soi-même comme des bons à rien pour trouver tout en Christ mort et ressuscité. Dès lors commence le bon et juste combat de nous, chrétiens, non seulement convertis mais affranchis, ceux en qui l’Esprit Saint opère en puissance avec Christ sous nos yeux, dont la grâce est suffisante pour nous. Paul avait triomphé jour après jour, et nous aussi sommes ainsi appelés à vaincre l’ennemi ici-bas.
Ch. 4:7 — J’ai achevé la course
Paul écrit ensuite : « j’ai achevé la course ». Il y a l’idée générale de jeux, réduits à la seule épreuve de la course ; et il regarde en arrière celle-ci comme « terminée ». Dans un jour antérieur, quand il écrivait aux Corinthiens familiers des jeux olympiques, il avait appliqué cette comparaison à la vie et au service des saints en général : il se donnait en exemple de quelqu’un qui ne court pas dans l’incertitude, qui ne brasse pas de l’air, mais qui matraque ou meurtrit son corps, qui l’asservit au lieu de le livrer au relâchement, au laisser-faire et au luxe (1 Cor. 9:24-27). En Phil. 3:13, 14, nous l’entendons exprimer l’extrême ardeur de consécration à cette course pour obtenir le prix. Cette référence générale se retrouve en 2 Tim. 2:5, dans le même esprit que celui de 1 Cor. 9:25. L’apôtre l’applique maintenant à son propre cas, non pas pour s’auto-encenser, comme l’imaginerait une mauvaise conscience ou un cœur envieux, mais il transpose et applique ces choses à lui-même par amour de Timothée et de tous ceux qui liraient ces paroles par la suite avec foi. La vantardise était loin de quelqu’un qui avait un pied dans la tombe et tout son cœur avec Christ dans le ciel.
Ch. 4:7 — J’ai gardé la foi –les credo
Enfin, il ajoute : « j’ai gardé la foi ». Cela, la chrétienté a cherché à le rendre facile et sûr en professant régulièrement trois croyances ou credo. Mais hélas ! tous ceux qui regardent sous la surface savent combien c’est un échec pitoyable : les plus hétérodoxes dépassent toutes les bornes en répétant chaque mot par habitude et solennellement — les âmes pieuses, mais faibles, bafouillent trop souvent parce qu’elles ne comprennent pas ces credo ; et ainsi, les uns et les autres finissent par des dégâts sans fin. La foi était vraiment gardée quand les credo n’existaient pas. La parole et l’Esprit de Dieu sont pleinement suffisants pour celui qui a les yeux fixés sur Christ par la foi. Et puis, garder la foi jusqu’au bout comme Paul l’a fait, c’était un test béni de fidélité au Maître. Nombreux se sont détournés, suivant leurs propres pensées et leurs propres convoitises, sans credo d’abord, puis maintenant avec credo ! Les credo ne sont que des barrières humaines et pitoyables, et forcément impuissantes ; ce sont des inventions des hommes lorsque la parole et l’Esprit de Dieu ont perdu leur puissance à cause de l’incrédulité.
Ch. 4:8
Le sentiment que tout était fini ici-bas donnait de la force au regard de l’apôtre vers le royaume, et c’est cette perspective qui vient maintenant à point (4:8). Car la responsabilité et le service sont liés, non pas à la venue du Fils pour nous emmener dans la maison du Père, mais à l’apparition du Seigneur, lorsque sera manifestée la fidélité à Son nom sur terre, ou l’absence de cette fidélité.
On observera que c’est l’épiphanie du Seigneur qui est présentée dans ces épîtres pastorales plutôt que Sa présence ou Sa venue ; car il s’agit tout du long d’une question de l’œuvre accomplie dans et pour le Seigneur, avec la récompense spécifique de Sa main « en ce jour-là ». Il ne s’agit pas de la grâce céleste avec les résultats bénis de l’amour de Christ dans le ciel avant que le jour brille. Ici sont posés les principes nécessaires de justice et d’ordre, ecclésiastique ou moral ; et il est insisté sur l’œuvre faite sur ce fondement, avec sa récompense pour le fidèle. Ces deux aspects sont vrais et importants, chacun à sa place, et on ne peut jamais les confondre sans causer une perte. Celui des deux qui est devant nous au v. 8, n'est pas contestable : « Désormais m’est réservée la couronne de justice que le Seigneur, juste juge, m’attribuera en ce jour-là ; et non seulement à moi, mais à tous ceux qui aiment (ἠγαπηκόσιν ont aimé et continuent à aimer) Son apparition ». N’est-ce pas précieux ? La promesse est sûre pour l’apôtre, mais il veille à la garantir à tous ceux qui aiment l’apparition du Seigneur, qui renversera tout mal, jugera les indifférents comme les rebelles, et établira paix et justice sur la terre, avec la manifestation de tous les saints en qui Il est glorifié.
Chapitre 4 versets 9 à 13
Ch. 4:9-13
L’apôtre se tourne maintenant vers ses compagnons de service, avec des expressions de sentiments variées ; et vers Timothée d’abord, comme étant particulièrement proche de son cœur.
« Fais diligence pour venir à moi rapidement ; car Démas m’a abandonné, ayant aimé le présent siècle ; et il s’en est allé à Thessalonique, Crescens en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends et amène Marc avec toi, car il m’est utile pour le ministère. Or j’ai envoyé Tychique à Éphèse. Le manteau que j’ai laissé en Troas chez Carpus, apporte-le quand tu viendras, ainsi que les livres, spécialement les parchemins » (4:9-13).
Sans aucun doute, une profonde solennité imprégnait l’esprit de l’apôtre à la pensée de son prochain départ et surtout de l’apparition du Seigneur ; et ce n’est pas étonnant : c’est le but de la responsabilité, le moment où tout sera mis en lumière et où la pensée du Seigneur sera prononcée en conséquence. Au début de l’épître, Paul avait exprimé son grand désir de voir Timothée, qu’il considérait avec une affection particulière. Maintenant, il le presse de s’efforcer de venir rapidement, et lui en donne la raison. Il a été abandonné par un compagnon de travail. Cela le touchait profondément au cœur. Il éprouvait donc le plus grand désir d’avoir Timothée avec lui. Ce serait la dernière occasion, et comme le souvenir du passé revenait dans ses pensées selon le ch. 1, ainsi ici il ne pouvait que regarder vers l’avenir en pensant à ceux qui allaient continuer l’œuvre du Seigneur ici-bas quand il serait parti.
Ch. 4:10 — Démas
Peu de temps auparavant, en écrivant aux Colossiens, l’apôtre leur transmettait les salutations de Luc et de Démas, avec celles d’Epaphras et les siennes propres (Col. 4:12-14) ; et en écrivant à Philémon, probablement à peu près en même temps, il transmettait de nouveau la salutation de Démas à son bien-aimé Philémon, le distinguant des autres comme son compagnon d’œuvre (Philémon 23, 24). Il a maintenant la tristesse d’écrire, comme une raison de plus pour demander la présence de Timothée, « Car Démas m’a abandonné, ayant aimé le présent siècle (ou : âge), et il s’en est allé à Thessalonique » (4:10).
C’est tristement explicite. Dire que Démas a quitté l’apôtre pour partir en tournée d’évangélisation, c’est déprécier la parole, effacer le motif révélé, et confondre son cas avec celui des autres qui suivent. On a supposé que le départ de Démas pour Thessalonique était dû à l’amour de sa ville natale. D’autres ont supposé que c’était pour faire du commerce. Nous n’avons pas le droit de parler ainsi, d’autant moins que le Saint Esprit a déterminé que le motif était l’amour du présent siècle (âge). L’amour pour la ville natale était plutôt la faute de Marc et Barnabas dans les premiers temps ; mais il n’avait pas de racine profonde, et la grâce avait produit depuis longtemps le jugement de soi-même. La chute de Démas était bien plus grave, non seulement parce qu’elle était tardive, mais parce que l’amour du présent siècle s’oppose totalement au but moral de Celui qui s’est donné pour nos péchés, afin de nous délivrer du présent siècle mauvais (Gal. 1:4). Il n’est pas dit que Démas ait abandonné Christ, et encore moins que Christ ait abandonné Démas ; mais le péché était grave, comme l’est aussi l’effort d’en mettre la faute sur l’évangélisation. Ceci était une insulte réservée à la folie et à la rancœur. Prêcher l’évangile n’est certes pas tout, mais c’est le fondement de tout, comme l’évangéliste est le don de Christ. Il est plus que probable que les compagnons d’œuvre prenaient leur part dans le travail d’évangélisation, comme nous savons que l’apôtre Paul le faisait toujours avec le plus grand zèle et le plus grand dévouement ; mais ici ce n’est dit expressément de personne. Venir fourrer l’évangélisation pour la relier à la seule personne nommée comme péchant contre le Seigneur, c’est Lui faire un très grand affront, à moins que ce ne soit une plaisanterie oiseuse ; mais, si c’est le cas, c’est une plaisanterie qui manifeste un sentiment sans cœur vis-à-vis de l’évangile et de ses hérauts.
De Crescens, il est seulement dit qu’il est allé en Galatie. C’est la seule mention de lui dans l’Écriture. Il n’est pas dit le but dans lequel il y est allé, mais on ne peut guère douter que ce fût au service du Seigneur. La tradition la plus ancienne nous dit qu’il y est allé pour évangéliser ; mais une autre parle plus tard de lui comme travaillant en Gaule. Et il est bon de noter maintenant que deux des premiers manuscrits à lettres onciales (le Sinaïticus et le Rescrit de Paris) écrivent ici la Gaule au lieu de Galatie, tout comme plusieurs manuscrits cursifs, la version éthiopienne de Rome, et d’autres autorités. L’ignorance ou les mauvaises intentions ont très tôt altéré les copies de la Sainte Écriture.
Il est dit de Tite qu’il est allé en Dalmatie. Nous pouvons en déduire qu’il avait terminé son travail en Crète, qu’il avait rejoint l’apôtre, puis qu’il était reparti dans une autre direction. C’est la dernière fois que l’Écriture parle de lui. Il n’y a donc pas la moindre base pour la tradition selon laquelle il était diocésain de Crète. Ces détails notés en dehors de l’Écriture, semblent être fatalement marqués par l’erreur, et ils semblent n’être que des légendes de l’imagination, greffées sur une utilisation très superficielle de l’Écriture. Il est tout à fait exceptionnel de trouver une seule des anciennes traditions contenant un atome de vérité. Combien on doit ressentir la profondeur de bénédiction d’avoir la parole parfaite de Dieu !
Ch. 4:11 — Luc et Marc prophètes du NT
« Seul Luc est avec moi. Prends Marc, et amène-le avec toi, car il m’est profitable (utile) pour le ministère » (4:11). Il est intéressant d’observer que ce verset nous présente deux auteurs d’évangiles inspirés. Ils n’étaient pas apôtres, mais ils n’en font pas moins autorité. Ils étaient sans doute prophètes, ce qui était le don en exercice, comme pour Matthieu et Jean, lorsqu’ils ont écrit les écrits prophétiques, ou écritures, comme l’apôtre désigne les livres du Nouveau Testament en Romains 16:26.
Le contexte de ce passage est déterminant, sans parler de l’absence de l’article, pour montrer que les versions autorisée et révisée ont tort en écrivant « les écritures des prophètes » [en Rom. 16:26, au lieu de « les écritures prophétiques »]. Car l’apôtre parle de la « révélation du mystère qui avait été gardé sous silence à travers les temps éternels, mais qui maintenant a été manifesté ». À l’époque de l’Ancien Testament, le silence était gardé ; le temps est maintenant venu pour sa manifestation par les prophètes du Nouveau Testament, qui, au lieu de témoigner à Israël uniquement, ont fait connaître ce mystère, selon le commandement du Dieu éternel, à toutes les nations pour l’obéissance de la foi (Rom. 16:26). C’est l’évangile en bref, et ici spécifiquement l’évangile de Paul en contraste avec la loi. Et c’est faire de la confusion que de mélanger cela avec ce que Dieu avait promis auparavant par Ses prophètes dans les Saintes Écritures au début de l’épître (Rom. 1:1-5), où en conséquence il n’y a pas d’allusion au « mystère », lequel n’est introduit qu’à la fin de l’épître, de façon appropriée.
Luc était donc le seul qui accompagnait l’apôtre. Il avait été son compagnon de travail pendant une grande partie de son ministère ; il demeure avec lui avant sa mort. Mais non content de cela, l’apôtre désire que Timothée prenne Marc en chemin et l’amène avec lui, car il ajoute avec une grâce extrême : « il m’est utile pour le ministère ». Nous savons à quel point Paul avait été affligé par la désertion de Marc dans les premiers temps, et comment cela avait même conduit à une rupture avec Barnabas (Actes 15:37-40). Mais cela était effacé depuis longtemps par la bonté de Dieu en guérison. Et l’apôtre avait déjà signalé Marc, joint à lui-même, comme l’un des rares compagnons d’œuvre pour le royaume de Dieu qui lui avait été en consolation ; dans la même épître aux Colossiens, il fait allusion aux instructions qu’ils avaient reçues pour l’accueillir s’il venait à eux (Col. 4:10, 11). Mais maintenant, il va plus loin et le rétablit dans une proximité personnelle du service envers lui, cela même en quoi il avait failli à l’origine. Dans la nature, une rupture est irréparable ; il n’en est pas ainsi lorsque la grâce prévaut ; car « nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés » (Rom. 8:37).
Ch. 4:12 — Tychique
« Or j’ai envoyé Tychique à Éphèse ».
La version révisée a raison, la version autorisée a tort ; car l’apôtre fait ici une légère distinction, qui est exprimée par « or », plutôt que par « et ». Les autres avaient procédé sous leur propre responsabilité. Tychique avait été envoyé par l’apôtre à Éphèse. Ici encore, il est vain de conjecturer sur l’objet particulier de sa mission. Nous pouvons nous assurer que la foi dans le Seigneur et l’amour des saints en étaient les motifs. Mais il est bon de prendre acte d’une autorité qui l’a envoyé, à laquelle personne ne peut plus prétendre.
Ch. 4:13 — Apporter le manteau
Voici (4:13) un nouvel ordre de Paul, d’un grand intérêt, au milieu de ces remarques intéressantes au sujet de ses compagnons de travail : « Quand tu viendras, apporte le manteau que j’ai laissé à Troas chez Carpus, ainsi que les livres, spécialement les parchemins ».
Certains hommes pieux se sont permis la pensée étroite et inconvenante que l’inspiration se limite uniquement aux questions de vérité spirituelle. C’est perdre une grande partie de la grâce de l’évangile, et c’est exclure de nos âmes l’intérêt que le Seigneur porte à ce qui concerne le corps aussi bien que les pensées. La vérité est que la grâce de notre Dieu s’occupe de tout ce qui nous concerne, et notre sagesse consiste à tout prendre comme quelque chose où nous pouvons chercher la faveur, la direction et la bénédiction du Seigneur. Tel est le fruit merveilleux, non seulement de l’incarnation du Fils, mais aussi de l’habitation du Saint Esprit. Il fait du corps le temple de Dieu. S’il n’en était pas ainsi, les affaires ordinaires de cette vie seraient laissées au dehors et ne revêtiraient rien qu’une note humaine. Nous faisons du tort au Seigneur et nous nous privons beaucoup, si nous ne Le faisons pas entrer dans la moindre des choses périssables : « Soit que vous mangiez soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu » (1 Cor. 10:31).
C’est pourquoi le manteau laissé par l’apôtre chez Carpus à Troas, n’est pas laissé comme une remarque non inspirée. Cela fait directement partie de cette épître solennelle, écrite pour tous les temps. Dieu a conduit Son serviteur à faire appel à Timothée pour l’apporter quand il viendrait. L’hiver approchait, et le manteau allait être nécessaire. Il est bon pour nos âmes de croire que Dieu s’intéresse personnellement même à une aussi petite affaire. Si Dieu est mis de côté, les saints eux-mêmes deviennent la proie de la vanité personnelle ou de la mode mondaine.
Timothée devait aussi apporter les « livres », « spécialement les parchemins ». Ces derniers n’étaient probablement pas encore écrits : comme il s’agissait d’un matériel précieux et apte à transmettre de façon plus permanente, on ne peut douter que l’apôtre destinait « les parchemins » pour l’édification des saints et pour la gloire du Seigneur d’une manière particulière. « Les livres » n’étaient peut-être pas des écrits inspirés, et le langage indéfini utilisé ici impliquerait plutôt le contraire. Mais ils n’étaient donc pas dénués d’intérêt pour l’apôtre, même avec la mort et l’apparition du Seigneur devant son âme.
Chapitre 4 versets 14 à 18
Après avoir parlé des compagnons d’œuvre partis ou envoyés au loin, et du désir d’avoir Timothée auprès de lui, l’apôtre se tourne vers un adversaire déclaré et vers ceux qui l’avaient abandonné récemment à l’heure où il en avait besoin.
« Alexandre, l’ouvrier en cuivre, a montré envers moi beaucoup de méchanceté : Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres ; garde-toi aussi de lui, car il s’est fort opposé à nos paroles. À ma première défense, personne n’a pris mon parti, mais tous m’ont abandonné : qu’il ne leur en soit pas tenu compte. Mais le Seigneur s’est tenu près de moi et m’a donné de la puissance, afin que par moi la proclamation soit pleinement faite, et que tous les Gentils entendent ; et j’ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et Il me préservera pour Son royaume céleste ; à Lui soit la gloire aux siècles des siècles. Amen » (4:14-18).
Ch. 4:14 — Les divers adversaires de Paul. Alexandre
Notons avec profit les différentes formes du mal chez les différents adversaires de l’apôtre.
Phygelle et Hermogène ont joué un rôle prééminent dans la désaffection personnelle (1:15).
Parmi ceux qui, en Asie, se détournèrent de Paul, Hyménée et Philète (2:17) ont un caractère beaucoup plus sombre, car dans leur cas, la folie profane a opéré, et ils ont avancé vers une plus grande impiété. Ils étaient des enseignants (docteurs), semble-t-il, mais pas de Dieu. « Leurs paroles », dit l’apôtre, « se répandront comme une gangrène ». La caractéristique de leur erreur était la fable destructrice selon laquelle la résurrection a déjà eu lieu, ce qui renversait la foi de certains et ne pouvait que fausser la marche et le témoignage de tous ceux que cela égarait. Mais même vis-à-vis de ceux-là, il n’agit pas avec la même solennité que celle que Jean applique dans sa seconde épître à ceux qui reniaient la personne de Christ ; car ceci exige la plus forte réprobation du cœur chrétien, bien plus que toute autre chose.
Sur Démas (4:10), nous avons déjà parlé.
Le forgeron, Alexandre, apparaît plutôt comme agissant en ennemi personnel de l’apôtre — d’autant plus qu’il semble avoir été autrefois en communion, ce qui lui donnait un gros avantage dans les occasions de malveillance. Les nombreuses mauvaises choses peuvent ne pas avoir été suivies d’effets, mais il les a faites et il a montré ce qu’il était en les faisant.
Pourtant, on ne peut que ressentir que le texte critique, qui suit la plus haute autorité, est un grand soulagement pour l’esprit : « le Seigneur lui rendra selon ses œuvres ». Que ce verbe soit transformé en optatif [« que le Seigneur lui rende…], comme dans le texte commun [KJV], avec quelques manuscrits onciaux, la plupart des cursifs, et beaucoup d’écrivains ecclésiastiques et autres, on peut le comprendre ; car l’homme tombe facilement dans le sentiment juif. D’autre part, le fait que le Seigneur lui rendra selon ses œuvres est une vérité certaine que toute conscience chrétienne doit ressentir ; c’est aussi une vérité qui s’accorde particulièrement avec ces épîtres pastorales où l’apparition du Seigneur est spécialement mise en évidence.
Ch. 4:15 — Alexandre et Timothée
Timothée devait également se tenir sur ses gardes contre Alexandre. Il est donc clair qu’il était un adversaire porté sur le mal à l’encontre des saints et porté sur l’opposition à l’œuvre. La douceur du caractère de Timothée pouvait l’exposer à une gentillesse mal placée, il fallait absolument être prudent : « car », dit l’apôtre, « il s’est fort opposé à nos paroles ». D’autres que l’apôtre avaient averti ou exhorté cet individu malfaisant, et il se peut que Timothée lui-même en ait fait partie.
Ch. 4:16 — Que cela ne leur soit pas imputé
L’apôtre se tourne maintenant vers sa propre grande et récente comparution à Rome ; amère à bien des égards, cette expérience laisse une profonde reconnaissance envers Le Seul Qui ne fait jamais défaut et qui fait savoir que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu — de ceux qui sont appelés selon Son dessein (Rom. 8:28).
« Lors de ma première défense, personne n’a été avec moi, mais tous m’ont abandonné : que cela ne leur soit pas imputé ! » (4:16).
Peu de gens se rendent compte à quel point cela a été douloureux et humiliant pour l’apôtre, parce que si peu de gens s’approchaient tant soit peu de lui, soit dans la foi soit en amour. Pas une âme sur terre ne pouvait ressentir comme lui l’a ressenti la défaillance que c’était pour le Seigneur Lui-même ; ce sentiment donne donc une immense solennité à sa prière : « Que cela ne leur soit pas imputé ». Le Psaume 105:13-15 met en évidence ce que l’Éternel ressentait autrefois lorsque ses élus passaient d’une nation à une autre, d’un royaume à un autre peuple : « Il ne permit à personne de les opprimer, et il reprit des rois à cause d’eux, en disant : Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes ». Or maintenant, Il peut laisser n’importe qui leur faire du tort, et dans le temps présent il se peut qu’Il ne réprimande ni rois, ni leurs sujets, ni les esclaves (serfs), lorsqu’ils méprisent Ses oints, et qu’ils font tout le mal qu’ils peuvent à Ses serviteurs. Un jour arrivera où Il rendra à chacun selon ses œuvres. Mais que ressent-Il maintenant ? Qu’arrive-t-il dans les lieux où les Siens trahissent et abandonnent ceux que Lui honore, et ceux qui, par amour pour Lui, les ont le mieux servis à l’heure de leur besoin le plus pressant ? Que cela ne leur soit pas imputé !
Ch. 4:17 — La comparution
Christ, cependant, ne fait jamais défaut. Ainsi, l’apôtre au v. 17 dit : « Mais le Seigneur s’est tenu avec moi et m’a donné de la puissance ». C’était plus que le fortifier personnellement — « il m’a donné de la puissance afin que, par moi, la proclamation soit pleinement accomplie et que tous les Gentils l’entendent ». Ainsi, c’est à la gloire de Christ et en souffrant par amour pour Lui, que l’apôtre a rendu témoignage de la vérité, de l’évangile et du Seigneur devant les plus hautes autorités qui gouvernaient le monde. Il n’y a pas eu de flatteries des grands hommes, ni de patronage de la part du monde.
« Et j’ai été délivré de la gueule du lion ». Que cela fasse allusion à l’Empereur en particulier, ou à ses représentants de façon plus générale, les hommes disent ne pas être capables de déterminer. L’expression signifie clairement qu’il a été sauvé du danger le plus imminent ou le plus écrasant.
Ch. 4:18 — Regards vers l’avenir
Mais l’apôtre s’élargit en regardant vers l’avenir. « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise » — non pas nécessairement de la gueule du lion un autre jour, mais de tout mal réel, et « me préservera pour son royaume céleste ». La terre peut bien produire encore plus de douleur et de persécution humaine à l’extrême. Pour l’apôtre, il n’était pas question de chair à sauver, mais de préservation pour le royaume céleste du Seigneur, à Qui soit la gloire aux siècles des siècles. Sa prière et la nôtre peuvent bien finir par un Alléluia continuel.
Chapitre 4 versets 19 à 22
L’apôtre salue maintenant certains de ceux qui lui étaient cher, dont les noms nous sont familiers tout au long de l’histoire inspirée.
« Saluez Prisca et Aquila et la maison d’Onésiphore. Éraste est demeuré à Corinthe, mais j’ai laissé Trophime malade à Milet. Fais diligence pour venir avant l’hiver. Eubulus te salue, ainsi que Pudens, Linus, Claudia et tous les frères. Le Seigneur (Jésus-Christ soit) avec ton esprit. Que la grâce soit avec vous » (4:19-22).
Ch. 4:19 — Salutations
« Saluez Prisca et Aquilas et la maison d’Onésiphore ».
Les deux premiers étaient des associés de la première heure, qui sont restés fidèles jusqu’à la fin. Il leur associe la maison d’Onésiphore dont il est fait mention à la fin du ch. 1. L’apôtre a profondément ressenti l’identification d’Onésiphore avec sa situation de prisonnier : « Il m’a souvent consolé, et n’a point eu honte de ma chaîne » (1:16). Il n’était plus à Rome, mais peut-être pas alors à Éphèse, sa demeure habituelle. Lorsqu’il avait été à Rome, il avait cherché l’apôtre avec zèle et l’avait trouvé. Dieu fait prospérer l’amour sincère pour l’amour de Christ. En effet ce n’était pas un amour autre que ce dont l’apôtre avait fait preuve à Éphèse, et personne ne savait mieux que Timothée quel service il y avait rendu. Ces chers saints reçoivent maintenant ensemble la dernière salutation de l’apôtre, une fois de plus prisonnier de Christ.
Ch. 4:20
« Éraste est demeuré à Corinthe, et j’ai laissé Trophime malade à Milet »1.
1 Les remarques suivantes dans Horae Paulinae [Heures pauliniennes] de Paley, chap. xii. n° 1, peuvent intéresser le lecteur :
1. Au v. 20 du ch. 4 [de 2 Tim.], Saint Paul informe Timothée que « Éraste est demeuré à Corinthe ». La forme de l’expression implique qu’Éraste était resté à Corinthe lorsque saint Paul l’avait quittée. Mais cela ne peut pas s’appliquer à un quelconque voyage de Corinthe que Saint Paul aurait fait avant son premier emprisonnement à Rome, car quand Paul quitta Corinthe selon Actes 20, Timothée était avec lui. C’est la dernière fois que l’apôtre a quitté Corinthe avant son arrivée à Rome, car il l’a quittée pour se rendre à Jérusalem, où il a été mis en détention peu après son arrivée, et il a continué cette détention jusqu’à ce qu’il soit amené au tribunal de César. Il n’était donc pas nécessaire d’informer Timothée qu’Éraste était resté à Corinthe à cette occasion, car Timothée l’aurait su, étant présent autant que Saint Paul.
2. Dans le même verset, notre épître mentionne également « j’ai laissé Trophime malade à Milet ». Lorsque saint Paul passa par Milet en route pour Jérusalem selon Actes 20, Trophime ne fut pas laissé derrière lui, mais l’accompagna jusqu’à cette ville. Il fut en effet l’occasion du tumulte de Jérusalem, à la suite duquel saint Paul fut appréhendé, car, dit l’historien, « ils avaient vu auparavant avec lui dans la ville Trophime, un Éphésien, et ils supposèrent que Paul l’avait amené dans le temple ». C’est manifestement la dernière fois que Paul se trouvait à Milet avant sa première incarcération, car, comme on l’a dit, après son arrestation à Jérusalem, il est resté en détention jusqu’à ce qu’il soit emmené à Rome.
Dans ces deux articles, nous faisons référence à un voyage qui a dû avoir lieu après la conclusion de l’histoire de saint Luc (livre des Actes), et bien sûr après la libération de saint Paul de sa première incarcération. L’épître [2 Tim.] qui contient cette référence prouve donc que Saint Paul était revenu à Rome, puisque, d’après d’autres parties de l’épître, il apparait que l’épître a été écrite alors qu’il était prisonnier à Rome, et étant revenu dans cette ville, il y a subi un second emprisonnement ».
Il n’y avait aucune intention de régenter les travaux de ses compagnons d’œuvre, même étant apôtre. Ils étaient serviteurs du Seigneur, et nul plus que Paul n’aurait insisté solennellement sur ce fait de ne pas régenter, nul plus que lui aurait refusé d’établir une autorité dirigeante entre le Seigneur et Ses serviteurs. On trouve des appels urgents ailleurs, sans doute ; mais Éraste demeurait à Corinthe. C’est probablement lui qui avait autrefois été trésorier de la ville. Les circonstances de Trophime étaient très différentes. L’apôtre l’avait laissé à Milet, malade. L’apôtre n’a jamais utilisé son pouvoir miraculeux, ni pour soulager des frères, ni pour faire avancer l’œuvre. Là encore, on ne faisait que regarder au Seigneur, et Sa gloire était le seul motif soit pour opérer des miracles, soit pour s’en abstenir. Dans la première épître on voit l’apôtre prescrivant à Timothée de ne plus être un buveur d’eau, mais d’user d’un peu de vin pour son estomac et pour ses fréquentes indispositions — juste comme tout ami chrétien pourrait le faire en ce moment, sans avoir l’inspiration de l’Esprit. Cela reste maintenant dans la Parole écrite. Il n’y a certainement pas eu de miracle dans le cas de Timothée, pas plus que dans celui de Trophime. La règle était que les miracles étaient des signes pour les non-croyants, et non un moyen de guérison pour la famille de la foi.
Ch. 4:21a
« Fais diligence pour venir avant l’hiver » (4:21).
Au v. 9, il avait dit : « Fais diligence pour venir bientôt auprès de moi ». La répétition des mots précis « avant l’hiver » n’est certainement pas pour rien. Au v. 13, il avait dit à Timothée d’apporter le manteau laissé à Troas chez Carpus. Mais il voulait sans doute aussi avertir Timothée de partir avant que le temps hivernal ne l’expose à un voyage comme celui qu’il avait connu (Actes 27) ; et il voulait lui donner l’occasion d’aider Paul le vieillard, également prisonnier maintenant. L’Esprit de Dieu daigne penser aux choses les plus ordinaires de cette vie. Le corps est pour le Seigneur, pas seulement l’âme ; et le Seigneur est pour le corps (1 Cor. 6:13). Chaque saint ne devrait pas seulement fuir l’avilissement moral, mais aussi la vanité et la mondanité. D’autre part, le Seigneur condescend à penser à ce qui pourrait être un soulagement physique. Lui ne prend aucun plaisir à voir Son serviteur frissonner de froid ; le vrai dévouement au Maître se manifeste aussi tout à fait dans des objets moins évidents, comme supporter la vermine. La superstition se complait dans ces voies misérables ; l’Écriture est autant sobre que sainte. La tradition est l’orgueil de l’homme et le sport de Satan.
Ch. 4:21b
« Eubulus et Pudens et Linus et Claudia et tous les frères te saluent » (4:21).
L’apôtre prenait soin de promouvoir l’amour, et il envoie les salutations de plusieurs par leur nom, non seulement des hommes, mais aussi d’une femme, ainsi que des frères en général. Si une femme était placée en premier, et avec raison, au v. 19, c’est avec autant de sagesse qu’une femme est placée en dernier parmi ceux qui sont personnellement nommés au v. 21.
Les fabulistes ont épargné celui qui est nommé en premier [Eubulus]. On a cherché à identifier le second [Pudens] à l’infâme ami de l’infâme auteur d’épigrammes Martial, afin de construire la romance de sa conversion ultérieure au christianisme, et de son mariage avec Claudia, une supposée vierge royale de Grande-Bretagne, considérée ici comme faisant partie des compagnons chrétiens de l’apôtre ! On reconnaît l’ingéniosité de la mosaïque formée de petits morceaux de Martial 1:32 ; 4:13 ; 5:48 ; 6:58 ; 11:53 ; et de Tacite Agric. 14, Ann. xii. 32, ainsi que d’une inscription douteuse, mais possible, trouvée à Chichester en 1723 (Horsley’s Brit. Rom. p. 192, n° 76). Mais on remarquera que dans notre verset, ils ne sont pas classés ensemble comme une paire : Linus les sépare ; et il y a un Linus dans les épigrammes de l’espagnol, ainsi qu’un Pudens, et une Claudia, et une Claudia Rufina qu’elles soient identiques ou non. Il est naturel que les Romanistes se soient emparés du Linus mentionné ici comme d’un évêque de Rome aux temps apostoliques. Mais il est certain que la plus ancienne trace de cela est une phrase d’Irénée qui est manifestement infondée sur un point bien plus important que l’identité de Linus. En parlant de Pierre et Paul, il dit : θεμελιώσαντες οὖν καὶ οἰκοδομήσαντες οἱ μακάριοι ἀπόστολοι τὴν ἐκκλησίαν, Λίνῳ τὴν τῆς ἐπισκοπῆς λειτουργίαν ἐνεχείρισαν [Les apôtres bénis, ayant fondé et construit l'église, ont institué la liturgie de l'évêque Linus]. Il est maintenant démontré par l’Écriture que l’église de Rome ne peut pas se vanter comme Corinthe d’avoir été fondée par un apôtre. Dès le jour de la Pentecôte, il y a eu des convertis venant de Rome (Actes 2:10). L’apôtre Paul leur a écrit une épître élaborée en ignorant totalement un ministère de Pierre là-bas, et encore plus un prétendu épiscopat pendant 25 ans ( !) selon la chronique d’Eusèbe. Paul lui-même n’est connu à Rome que comme prisonnier, bien qu’il ait pu les édifier après sa libération, avant d’être enchaîné une seconde fois et soumis au martyre. Quant à Pierre, l’apostolat de la circoncision était la province à laquelle il a été affecté (Gal. 2:7) ; et bien que nous entendions parler de sa malheureuse visite à Antioche (Gal. 2:11), pas un seul mot n’est dit en rapport avec Rome. De ses travaux en dehors de la Judée, nous ne connaissons quelque chose qu’à l’Est (1 Pierre 5:13), rien à l’Ouest. Ses épîtres s’adressent toutes deux aux Juifs chrétiens, loin à l’Est de Rome ; s’il y est allé, c’était pour mourir pour Christ, non pas pour y fonder l’église, et encore moins pour se joindre à Paul dans une ordination de Linus à l’épiscopat. Même les éditeurs bénédictins confessent, sans prétendre les résoudre, « les difficultés de la chronologie des premiers successeurs ( !) de Pierre » (« difficultates quibus primorum Petri ( !) successorum tum chronologia, tum successio, .. ».. Eusèbe et Théodoret font que Linus aurait succéder à Pierre après sa mort ; Baronius et de Tillemont font de même. Les Constitutions apostoliques (vii. 46) et Ruffinus (Praef. Clem. Recog.) affirment que Linus a été nommé évêque à une date antérieure, du vivant des apôtres, tandis que ceux-ci se déplaçaient dans des régions situées au-delà, ce qui est cohérent avec les paroles d’Irénée, et donc à celles des historiens Pearson (évêque) et Fleury. Épiphane ajoute à la confusion en affirmant que c’est Clément qui a été ordonné par Pierre ( !) pour le siège romain, tandis que lui et Paul poursuivaient leurs travaux apostoliques, comme Tertullien l’avait affirmé avant lui. Toutes les différences des anciens sont loin d’être énoncées ici. La seule chose certaine, quand on quitte l’Écriture, c’est l’incertitude de la tradition humaine.
Quant à ceux dont les salutations figurent au v. 21, leurs noms étaient alors trop communs pour qu’on puisse en tirer quelque chose sur eux personnellement. Une chose est sûre, c’est qu’ils étaient chrétiens ; ceux sur lesquels Martial a écrit, étaient des païens qui, pour autant que nous le sachions, ne se sont jamais soumis à la justice de Dieu. Martial est venu à Rome en tant que jeune homme, seulement deux ans environ avant la mort de l’apôtre, et n’a pas commencé par écrire des lettres. Ses épigrammes, pour autant que l’on sache, ont été faits après, la plupart longtemps après, lorsque ses Pudens et Linus et Claudia étaient encore païens.
Ch. 4:21c
« Tous les frères », ajoute l’apôtre qui voudrait n’en oublier absolument aucun, qui étaient chers à Timothée comme à lui-même. Combien il serait étrange, pour ne pas dire inexplicable, que le grand apôtre Pierre, s’il était à Rome alors, comme la tradition le déclare hardiment, n’ait pas eu sa place là où des personnes si peu connues ont leur nom inscrit de façon indélébile par la grâce ! Peut-on croire que Pierre était à Rome avec « notre frère bien-aimé Paul » pour sa première défense, alors que personne ne prit son parti, mais que tous l’ont abandonné ? ou que Paul aurait pu écrire « seul Luc est avec moi » ? Il est trop évident que la tradition n’est pas digne de confiance et qu’elle fait totalement défaut dans les éléments moraux qui accompagnent l’inspiration de Dieu.
Ch. 4:22
Il existe des preuves anciennes et solides pour l’expression « Le Seigneur Jésus Christ » au v. 22. Le manuscrit alexandrin et deux cursifs écrivent « Jésus » seulement. Bien qu’un ou deux cursifs omettent toute cette phrase, il n’y a aucun doute sur le « Seigneur », qui, on peut le remarquer, est la désignation qui prévaut tout au long, sauf lorsque des raisons particulières ont fait écrire « Jésus Christ ». La prière est qu’Il soit « avec ton esprit ». Voilà le dernier désir inspiré de l’apôtre pour Timothée, avec « Que la grâce soit avec vous » pour ceux, en général, qui étaient avec Timothée. La version syriaque Peshito entache tout cela, en faisant de Timothée le seul objet du second souhait comme du premier. Ce dernier souhait était l’expression d’un cœur qui éprouvait des sentiments fervents pour tous, tout en sachant faire des différences.