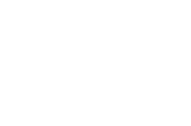Le passeport (suite)
Monsieur et Madame Martin ont décidé de se rendre aux Etats-Unis ou ils espèrent faire fortune, ou du moins obtenir une situation moins misérable qu'en Europe. Ils laissent leurs trois enfants -Jacques, Lise et Marie, âgés de 7, 4 et 1 ans - chez la grand-maman maternelle, en ayant l'intention de les faire venir plus tard.
De temps en temps arrivait une lettre d'Amérique; la distance était longue et ces messages n'apportaient ni joie ni argent. Martin et sa femme n'avaient pas rencontré la fortune de l'autre côté de l'Atlantique et ils faisaient la dure expérience que le chemin de la propre volonté n'est jamais celui du vrai bonheur.
Chapitre 2
Dix-huit mois s'écoulèrent ainsi; les enfants prospéraient, leur santé se fortifiait, et leur intelligence et leur cœur se développaient dans cette atmosphère d'affection. Mais Dieu, dans sa sagesse que nous ne pouvons souvent comprendre, mais que nous savons être parfaite, allait leur envoyer une nouvelle épreuve.
Un matin de printemps, Jacques, en se réveillant à l'heure habituelle, fut tout surpris de ne voir aucune lumière dans la chambre, aucune apparence de feu dans le poêle. Sa grand-mère aurait-elle dormi plus longtemps que d'habitude? il se leva et vit que la vieille femme reposait en effet sur son lit. Alors il s'habilla à la hâte et se mit à préparer le déjeuner, comme il l'avait fait plusieurs fois déjà. Il s'attendait à l'entendre dire cette fois encore: «Merci, mon garçon! » Mais elle ne s'éveillait pas! Quel profond sommeil!
Oui, bien profond, en vérité! Cette nuit-là, Dieu avait repris à lui la bonne grand-mère et ses yeux ne devaient plus s'ouvrir sur les choses de ce monde. Elle était avec Christ, ce qui est beaucoup meilleur. Jacques, après avoir longuement examiné ce visage chéri, comprit enfin ce qui s'était passé et, tout effrayé, il alla appeler une voisine. En quelques minutes la chambre fut remplie de curieux, mais parmi toutes ces bonnes âmes compatissantes, il ne s'en trouva aucune qui sût rendre grâces à Dieu pour la fin si paisible qu'il avait accordée à la veuve Vernier. Tous se lamentaient et plaignaient les pauvres enfants laissés absolument seuls au monde. Mais personne ne se rappela que Dieu veille sur les petits enfants et qu'ils sont très précieux à ses yeux. Le Seigneur Jésus n'est-il pas venu donner sa vie pour eux?
Jacques avait tendrement aimé sa grand-mère; des larmes coulaient sur ses joues, niais il ne pouvait parler. Il était bien petit encore et il ne comprenait pas toute la portée du malheur qui le frappait. C'était Dieu qui avait rappelé à lui la bonne grand-maman; elle se trouvait maintenant dans ce beau ciel dont elle lui avait si souvent parlé, mais alors pourquoi était-elle encore là, immobile et glacée? Le petit garçon aurait trouvé tout naturel que sa grand-mère disparaisse complètement; mais ainsi, il restait un peu perplexe, quoique toujours certain que ce que Dieu faisait était bien.
Dans la chambre, les voisines bavardaient entre elles, sans s'inquiéter de la présence des enfants.
- Que vont-ils devenir maintenant? Ils ne peuvent pas rester ici.
Lorsque Jacques eut entendu cette question répétée, sous une forme ou l'autre, par vingt bouches différentes, il s'écria enfin:
- Je veux aller en Amérique, trouver mon papa et ma maman.
- Et tes sœurs, où iront-elles?
- Avec moi, bien sûr!
Ce projet, insensé à première vue, était peut-être le plus raisonnable après tout. Il s'agissait seulement de savoir comment on s'y prendrait pour organiser le voyage des trois enfants. Pour le moment, ils furent placés, par les soins de la commune, chez une vieille femme (hélas! ce n'était pas une grand-maman, celle-ci!) et le maire du village écrivit à Martin pour lui faire part des événements et lui demander de venir chercher ses enfants ou d'envoyer, avec la somme nécessaire à la traversée, des indications précises quant à la route à suivre, la personne qui devait les accompagner, etc.
La réponse arriva aussi vite que possible. La maman écrivait quelques pages très tendres à son petit Jacques, exprimant une profonde anxiété au sujet du long voyage que lui et ses sœurs allaient entreprendre tout seuls. «Je prie le Seigneur Jésus de vous garder de tout mal», disait-elle en terminant et, pour le petit garçon solitaire, cette simple parole fut un encouragement et un réconfort. Maman pensait donc comme grand-mère. Quel bonheur de le savoir! Martin, de son côté, écrivait au maire ce que personne ne voulut croire d'abord: les trois enfants devaient faire le long voyage de France en Amérique sans être accompagnés. Il envoyait la somme nécessaire, y joignant des indications précises et traçant l'itinéraire de ces trois petits colis vivants. Le maire devait s'occuper de leur bagage, bien léger sans doute, puis les conduire à la gare et prendre leurs billets pour Paris. Là, au numéro 36 d'une certaine rue, ils trouveraient leur tante, sa sœur, qui les mènerait à la gare Saint-Lazare, et les mettrait dans le train se rendant au Havre. Dans cette ville, ils devaient chercher un bureau dont l'adresse leur était donnée et où les attendraient leurs billets de bord; et le premier du mois suivant ils s'embarqueraient sur le France. À New York, les enfants devaient voir un pasteur, qui les mettrait sur la voie pour rejoindre leurs parents. De Dakota, un trajet de peu de jours les amènerait à Kotteros, où ils les retrouveraient.
Martin écrivait en finissant: «Selon toute probabilité, ce voyage vous paraîtra extraordinaire. Mais dans ce pays, on apprend que l'homme ne vaut que par ce qu'il ose entreprendre, et c'est une vérité que les enfants ne sauraient apprendre trop tôt». Bien des gens s'indignèrent à l'idée de faire entreprendre un tel voyage par des enfants seuls. Mais personne ne proposait de les accompagner. D'ailleurs le père avait parlé et il portait la responsabilité de la décision qu'il avait prise. Les choses en étant là, le plus tôt serait le mieux. Ce serait une charge de moins pour la commune. Quant aux enfants, ignorant tout du voyage qu'ils allaient entreprendre, des dangers possibles, des difficultés inévitables, ils étaient enchantés à l'idée d'aller retrouver leurs parents. Jacques était tout à fait persuadé que le Seigneur prendrait soin d'eux et les fillettes avaient l'habitude de suivre leur grand frère, que ce soit dans la maison voisine, dans la forêt, à Paris ou de l'autre côté de l'océan! On vendit tout ce qui avait appartenu à Mme Vernier; on put ainsi procurer aux jeunes voyageurs un coffre de bois, un grand sac en cuir et une solide housse de toile dans laquelle on emballa trois coussins. Tels étaient les trésors que les enfants emportaient de leur terre natale. Des voisins compatissants avaient rempli leurs poches de provisions plus que suffisantes pour atteindre Paris. À peine étaient-ils assis dans le wagon que des mains amies leur tendaient toutes sortes de friandises. Les recommandations les plus diverses pleuvaient sur leurs têtes. Mais personne pourtant n'aurait eu le dévouement nécessaire pour les accompagner. Jacques était assis sur son coffre avec Marie sur ses genoux, Lise était confortablement installée sur le ballot de coussins et tous trois étaient bien étonnés d'être les objets de tant d'intérêt. Tandis que le train s'éloignait, les voisins, le village et la tombe de la grand-mère disparurent à leurs regards.
Chapitre 3
Un soir de juillet, vers neuf heures, un fiacre à l'allure un peu étrange, venant de la gare de Lyon, excitait l'étonnement des Parisiens qui le remarquaient. «Émigrants! » se disaient-ils à la vue des bagages; puis ils se ravisaient. «Trois enfants seuls! Pauvres petits!»
Jacques et ses sœurs avaient donc franchi sains et saufs cette première étape de leur long voyage. Dieu avait incliné le cœur d'un employé de la grande gare, sans doute père de famille lui-même. Voyant les enfants seuls au milieu de la foule, il leur avait trouvé un fiacre, avait aidé à transporter leurs bagages et, les enfants installés dans le véhicule, il avait donné au cocher l'adresse indiquée par Jacques. La voiture roulait toujours sur les pavés; elle passait d'une rue dans l'autre, traversant de vastes places, puis d'autres rues encore. Il semblait que cette course ne devait jamais finir. Était-ce donc toujours Paris? Jacques se sentait oppressé par tant de maisons et tant de monde. Les fillettes pensaient à tout autre chose. Lise caressait avec admiration l'étoffe râpée de la banquette sur laquelle elle était assise. Marie poussait des cris de joie à chaque réverbère qu'ils croisaient. Soudain les maisons s'éloignèrent. Ils passèrent sur un pont et virent se refléter dans l'eau qui coulait au-dessous mille lumières tremblotantes.
À suivre